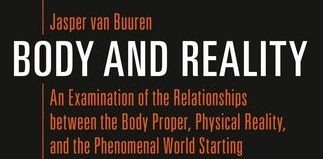Le toucher entre objets et ob-jectivité (II)

2. détaill du rapt de Proserpine
Ces publications sont une reprise de certaines interventions prononcées dans le cadre des journées d’études « L’objet de la perception », à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne , École Doctorale de Philosophie (ED 280), Philosophies contemporaines (PhiCo EA3562) EXeCO – CEPA, organisées par Roberta Locatelli et Pauline Nadrigny
Revenons à présent à l’énoncé de notre problème : l’objet du toucher. Nous pouvons dire à présent que nous ne touchons pas nécessairement des objets, ou que nous touchons des choses qui ne sont pas essentiellement des objets. Est-ce à dire alors que nous ne touchons rien ? Evidemment, non, lorsque nous touchons, nous touchons quelque chose, les exemples que nous avons pris précédemment le montrent. Mais alors, que touchons-nous ? Reprenons à présent cette question légèrement en amont. C’est évidemment une question très indéterminée, son seul présupposé étant que nous touchons quelque chose. Quel est alors ce « quelque chose » ? Et tout d’abord, est-ce distinct de nous ? Car, nous l’avons vu, toucher semble être un acte qui met en jeu tout autant la perception de notre propre corps que du monde extérieur. Toucher semble toujours impliquer une épreuve sur quelque chose de notre propre force, de notre propre poids, de notre propre positionnement dans l’espace, le toucher met en jeu notre conscience de notre corps tout autant que de cette chose qu’on touche.
Or, le présupposé de base de toute philosophie de l’objet est que l’objet n’est pas le sujet. La logique de l’objet suppose qu’il y a dans le réel une distinction pertinente entre ce qui relève du sujet et ce qui relève de l’objet, que tout n’est pas immanent au sujet ou de l’ordre du sujet. L’objet du toucher serait donc, pour le moins, ce qui n’est pas du sujet et avec quoi le toucher nous met en contact, que le toucher porte à notre connaissance ou à notre conscience. Le présupposé sous-jacent est donc qu’il y a deux pôles dans le toucher : le pôle du sujet sentant et le pôle de l’objet senti. Un tel présupposé pose un problème qu’il nous faut éclaircir avant d’élucider davantage ce que nous touchons : le toucher nous met-il bien en contact avec une extériorité ? Y a-t-il bien de l’objet dans le toucher, au sens où il y aurait de l’objet qui serait distinct et distinguable du sujet ?
La question peut paraître non intuitive mais elle semble imposée par le fait que, comme nous l’avons vu, le toucher est une sensibilité aux choses qui n’est pas séparable, pratiquement, d’une certaine sensibilité à soi, qu’elle est donc, inséparablement, une sensibilité aux autres et à soi. Certains textes très connus de Merleau-Ponty sur le chiasme et la chair semblent en tirer les conséquences et abolir la différence du sujet et de l’objet. Arrêtons-nous donc un instant sur certains de ces textes et, pour commencer, sur un argument développé dans Le visible et l’invisible. À la question « que touchons-nous lorsque nous touchons ? », Merleau-Ponty répond : « Toucher, c’est se toucher »[1]. C’est-à-dire que nous ne pouvons jamais toucher le monde extérieur qu’en nous touchant aussi, nous. Sentir le monde, c’est toujours aussi sentir le sentant. Il n’y a pas un sujet qui touche et un objet qui est touché, car toucher le monde, c’est toujours aussi toucher le touchant. Il y a donc une indistinction primordiale du sentant et du senti et un monde fondamentalement homogène, notre perception des choses extérieures étant toujours arrachée à cette indistinction primordiale. Pour le dire, comme cela est bien connu, Merleau-Ponty emploie à nouveaux frais le mot de « chair », qui englobe corps et monde dans un continuum de sensible-sentant, dans une même étoffe. La chair, dit Merleau-Ponty « est le sensible au double sens de ce qu’on sent et de ce qui sent[2]. » Et le monde, et non seulement le corps, est fait de chair, car il y a entre le corps et les choses une profonde communauté. Nous ne percevons les unes qu’avec le premier : il y a une participation du monde entier au corps, le monde, les choses participent originellement de mon corps. Merleau-Ponty dit ainsi :
« [J]e ne puis poser un seul sensible sans le poser comme arraché à ma chair, prélevé sur ma chair, et ma chair elle-même est un des sensibles en lequel se fait une inscription de tous les autres, sensible pivot auquel participent tous les autres, sensible-clé, sensible dimensionnel.[3] »
Le point de départ, c’est l’indistinction du monde et de mon corps, et tous les sensibles sont donc extraits de ma chair, de mon corps, dans lequel est inscrit originellement le monde entier, et à partir duquel il se déploie. Un problème évident se pose alors : « Où mettre la limite du corps et du monde, puisque le monde est chair[4] ? » Autrement dit, y a-t-il encore, sinon un sujet et des objets, du moins une différence entre le touchant et ce qu’il touche ?
Bien que Merleau-Ponty se situe dans Le visible et l’invisible en deçà de la division sujet-objet et qu’il pense le monde entier comme constitué d’une seule chair, il est nécessaire de rappeler qu’il y conserve pourtant une place à la distinction du soi et du non-soi. Car s’il y a malgré tout distinction entre mon corps et les autres sensibles, c’est, dit-il, que le corps est l’« ici », le « maintenant », le « tangible-étalon[5] », c’est-à-dire le pôle, le centre autour duquel apparaissent tous les autres sensibles. Mon corps se distingue des autres en étant le « mesurant de tous, Nullpunkt de toutes les dimensions du monde[6] » ou, pour le dire en français, le point zéro et l’origine de l’espace des coordonnées virtuelles dans lequel le monde qui m’entoure est situé. Il y a donc bien une distinction entre le monde et mon corps, ce n’est cependant pas une « frontière, mais une surface de contact[7] ». Dans une telle conception, le soi et le non soi ne sont que l’envers et l’endroit du même contact.
Pour le Merleau-Ponty du Visible et l’invisible, il y a bien une forme de communauté de nature entre le sujet et l’objet ou, pour en revenir au toucher, entre le touchant et le touché, et cela mine la différence du sujet et de l’objet et donc la pertinence de ce couple de termes. Demeure bien pourtant une distinction entre le touchant et ce qu’il touche, demeure bien dans cette analyse un « soi » et un « non-soi », un « soi » qui n’est que l’« envers de son entourage »[8], mais qui a pourtant bien un entourage, c’est-à-dire un « non-soi ». À défaut de « devant » et de « derrière », demeurent un « dedans » et un « dehors ». L’idée même d’un objet du toucher est ainsi obérée par l’analyse du toucher de Merleau-Ponty, laquelle rend problématique la différenciation ontologique du touché et du touchant en mettant en évidence la continuité qui les lie. Mais il semble pourtant que cette analyse permette aussi de fonder cette différenciation et une certaine forme de discontinuité entre touché et touchant. Merleau-Ponty ne pense évidemment pas cette discontinuité en termes objectifs, mais nous allons à présent tenter de voir comment une certaine notion d’objet de la perception peut être sauvée lorsque le « soi » n’est distingué qu’à titre de « Nullpunkt » servant d’étalon à notre perception du monde. Comme nous allons le voir, le concept d’objet, et donc le doublet sujet/objet, est alors justifié par l’impossibilité pour ce qu’on appelle « sujet » de servir d’« objet ».
La possibilité de maintenir une différence entre le touché et le touchant, i.e. le fait que l’on ne puisse pas englober à tous les points de vue le corps et le monde dans un continuum homogène, est affirmée par Merleau-Ponty dans Le visible et l’invisible dans une note de travail de mai 1960. Il écrit ainsi : « Toucher et se toucher (se toucher = touchant-touché). Ils ne coïncident pas dans le corps : le touchant n’est jamais exactement le touché. »[9]. Il dit plus loin : « je ne puis toucher mon mouvement ». Cette remarque – qui donne lieu dans le texte à une réflexion sur le statut de cet intouchable, qu’il qualifie d’originaire – est à rapprocher d’une remarque similaire que faisait Merleau-Ponty dès la Phénoménologie de la perception à l’occasion d’une analyse de la main touchée-touchante située dans le chapitre intitulé « L’expérience du corps et la psychologie classique ». Au début de ce chapitre, Merleau-Ponty entreprend de montrer que le corps n’est pas un objet. C’est alors la pertinence de la différenciation entre ce qui touche – le corps-sujet – et l’objet qu’il touche qu’il met en évidence. Pour montrer que le corps n’est pas un objet, il dit ceci :
« j’observe les objets extérieurs avec mon corps, je les manie, je les inspecte, j’en fais le tour, mais quant à mon corps, je ne l’observe pas lui-même : il faudrait, pour pouvoir le faire, disposer d’un second corps qui lui-même ne serait pas observable »[10].
Merleau-Ponty montre que cela est manifeste pour la perception visuelle de mon corps, puis il passe à la perception tactile que nous en avons :
« Il n’en va pas autrement, malgré les apparences, de mon corps tactile, car si je peux palper avec ma main gauche ma main droite, pendant qu’elle touche un objet, la main droite objet n’est pas la main droite touchante : la première est un entrelacement d’os, de muscles et de chair écrasé en un point de l’espace, la seconde traverse l’espace comme une fusée pour aller révéler l’objet extérieur en son lieu. En tant qu’il voit ou touche le monde, mon corps ne peut jamais être vu ou touché. »[11]
Je peux donc me toucher mais je ne peux pas me toucher en tant que je touche ; cela, que Merleau-Ponty reconnaît dès 1945, atteste du fait que se manifeste dans le toucher une différence phénoménologique entre ce qui touche et ce qui est touché. En 1960, Merleau-Ponty minimise cette différence en concevant le monde comme fondamentalement continu, bien que plié, et possédant deux côtés. La discontinuité est ici minimale, interne à un pliage. En 1945, Merleau-Ponty donne davantage de sens à cette discontinuité dans notre perception du monde : le monde n’est pas continu et homogène, car toucher le soi, ce n’est pas toucher le non-soi, et cela justifie alors à ses yeux la distinction ontologique du corps – corps qualifié de « propre » – et des objets. Pour autant, il ne serait guère pertinent d’user de cet argument en faveur de l’existence d’objets, au sens fort, du toucher, car la notion d’objet constitue en 1945 un présupposé de Merleau-Ponty, et nullement un acquis. Il nous montre que, s’il y a des objets, le corps ne peut en être un, et qu’il y a donc bien dans le monde quelque chose qui n’est pas de l’objet, que l’on peut appeler sujet. Mais y a-t-il des objets, est-il pertinent de parler en ces termes ? Voilà ce dont il doute explicitement en 1960. Peut-on alors (re)donner en amont un sens à cette notion d’objet ? Il faudrait donner à la discontinuité le primat sur la continuité, donner à l’opposition sous-tendue par le préfixe « ob » une valeur phénoménologique, ce qui n’implique pas nécessairement, espérons-nous, de substantialiser le concept ainsi motivé. Pour ce faire, nous voudrions faire appel à Condillac et à son grand œuvre de philosophie de la perception, le Traité des sensations.
Condillac commente dans le Traité des sensations l’expérience décrite à son tour, plusieurs siècles plus tard, par Maurice Merleau-Ponty – celle de la main touchée-touchante –, mais il en tire des conclusions bien distinctes. Car selon lui, cette expérience ne permet pas seulement de distinguer notre corps des objets, mais elle fonde cette distinction : ce serait l’extériorité comme telle et la sortie du régime de l’immanence qui seraient ainsi permises par le toucher. Il suffit du reste pour s’en convaincre de considérer son Titre II : « Du toucher, ou du seul sens qui juge par lui-même des objets extérieurs ». Le toucher permettrait bien sûr qu’on touche quelque chose, mais aussi qu’on voit quelque chose, qu’on sente quelque chose, qu’on entende quelque chose et que toutes nos impressions, en somme, ne soient pas que des modifications de nous-mêmes.
Notons d’ores et déjà que, si nous suivons Condillac, nous sommes en mesure d’apporter un élément de réponse à une autre interprétation possible de notre question initiale. Car la question « quel est l’objet du toucher ? » peut signifier : « quel est l’objet propre du toucher ? », c’est-à-dire quel est ce qu’il est seul à atteindre, ce qu’il a pour fonction d’atteindre ou, de même que l’on dit « quel est l’objet de la question ? », à quoi sert-il ? La question signifierait alors : quelle modalité de la réalité apporte en propre le toucher ? Quelle dimension de l’objet perçu est, à proprement parler, atteinte par le toucher ? La réponse serait alors : l’objet propre du toucher, c’est l’extériorité. Et donc l’objectivité, en un sens minimal de l’objectivité comme fait qu’il y ait de l’objet, c’est-à-dire qu’il n’y ait pas que du sujet. Le concept d’objectivité marquerait alors le fait que le monde n’est pas un continuum homogène, mais que nous nous y confrontons à des choses qui ne sont pas nous. Pour dire ce fait, Merleau-Ponty se refuse en 1960 à employer ce concept d’« objet », mais il laisse entendre alors que le monde est fondamentalement homogène. Comme cela ne nous semble pas tout à fait fidèle à notre expérience du monde, et notamment à notre expérience tactile du monde, laquelle nous donne à appréhender la différence exclusive, nous allons donc tenter de réhabiliter ce concept d’objet, en entreprenant, en un premier temps, d’étayer cette thèse du lien essentiel du toucher et de l’extériorité.
Engageons nous dans la lecture de Condillac, pour qui, comme nous l’avons dit précédemment, le toucher est ce qui nous donne la perception des choses extérieures. Voici le cœur de son argument :
« Tant que la statue ne porte les mains que sur elle-même, elle est à son égard comme si elle était tout ce qui existe. Mais si elle touche un corps étranger, le moi, qui se sent modifié dans la main, ne se sent pas modifié dans ce corps. Si la main dit moi, elle ne reçoit pas la même réponse. La statue juge par là ses manières d’être tout-à-fait hors d’elle. »[12]
Il y a ainsi un contraste entre « moi » qui touche « moi », et « moi » qui touche autre chose que « moi ». Car lorsque je me touche moi-même, ce que je touche me touche aussi, et je ressens donc le toucher, en quelque sorte, des deux côtés, à l’envers et à l’endroit pour parler en termes merleau-pontiens. Alors que lorsque je touche quelque chose qui m’est extérieur, je n’ai pas une telle sensation double. La différence du « moi » et du « non-moi » s’atteste donc dans le toucher.
Cependant, pourquoi y a-t-il sur ce point spécificité du toucher ? Pourquoi ne peut-on pas transposer cette expérience aux autres sens ? Pourquoi, en somme, Condillac dit-il du toucher dans son titre II qu’il est le « seul sens qui juge par lui-même des objets extérieurs » ? N’y a-t-il pas aussi une différence fondatrice entre les cas où les gens se voient et voient autre chose, ou se sentent et sentent autre chose, etc. ? Si l’on analyse systématiquement ce point, il semble bien que non. Car, par exemple, pourquoi ne peut-on pas proposer la même analyse du cas où quelqu’un se verrait dans un miroir ? Pourquoi ne peut-on pas dire qu’il y a une différence comparable entre quelqu’un qui se voit dans un miroir et quelqu’un qui voit autre chose ? Car dans ce cas, nous semble-t-il, ce que cette personne voit dans le miroir, ce n’est pas elle-même, mais quelque chose qui est lié à ses mouvements. Or, corrélation n’est pas identité et ce « quelque chose » peut tout à fait lui être extérieur. De même, dans le cas de l’olfaction, une odeur que nous émettons n’est pas différente d’une odeur que nous n’émettons pas, à ceci près que nous sommes habitués à la plupart de nos odeurs. Mais si nous sentons une odeur étrange, il n’est pas évident pour nous de savoir si elle vient de nous ou pas. Quant au goût, il semble qu’une expérience similaire à la main touchante-touchée ne soit pas du tout reproductible. La question semble enfin se poser de manière plus épineuse au sujet de l’ouïe, puisqu’il semble bien y avoir une différence phénoménologique entre les sons que l’on profère soi-même et les sons émis de l’extérieur. Pourtant, là encore, la place cruciale du toucher dans la différenciation du soi et du non-soi semble préservée car qu’est-ce qui nous permet d’attester sensoriellement cette différence entre les sons que l’on profère soi-même et les sons émis de l’extérieur, sinon la vibration de notre gorge, et donc le toucher ? Notre hypothèse serait donc qu’il y a bien, sur ce point, spécificité du toucher, conformément à la thèse de Condillac. À quoi serait-elle due ? Selon lui, l’élément déterminant à cet égard est que le toucher nous donne la sensation de la solidité. La découverte de l’extériorité se ferait ainsi en deux phases : la statue commence par découvrir son propre corps en tant que corps, distinct de son âme, puis elle découvre les autres corps, par l’expérience décrite ci-dessus de la main (de statue) touchante-touchée. Ce qui importe ici est que l’altérité est découverte dès le premier moment, celui de la découverte du corps, et donc, dit Condillac, de la découverte par l’âme du fait qu’il n’y a pas que « des modifications où elle se trouve et ne trouve qu’elle ». Ce moment est permis par la sensation de solidité :
« Puisque le propre de cette sensation [la sensation de solidité] est de représenter à la fois deux choses qui s’excluent l’une hors de l’autre, l’âme n’apercevra pas la solidité comme une de ces modifications où elle ne trouve qu’elle-même ; elle l’apercevra nécessairement comme une modification, où elle trouve deux choses qui s’excluent, et par conséquent, elle l’apercevra dans ces deux choses.
Voilà donc une sensation par laquelle l’âme passe hors d’elle »[13]
Ce qui est déterminant dans cet argument est que le toucher nous fait sentir la solidité, et qu’il nous donne donc accès à l’impénétrabilité (ainsi qu’à l’étendue, la dureté, la chaleur) et donc à la discontinuité corporelle, à la différence réelle et même (« deux choses qui s’excluent l’une hors de l’autre », écrit Condillac) à l’exclusion. C’est cette acquisition de l’idée, du fait de la différence exclusive qui est ensuite mise en œuvre dans l’expérience de l’extériorité. La simple expérience du toucher permet donc de fonder en tant que telle l’extériorité, la discontinuité, de donner un contenu phénoménologique, en somme, au préfixe « ob ». Condillac poursuit ainsi sur le thème des manières d’être tout-à-fait hors d’elle que la statue découvre à l’occasion du toucher :
« Comme elle en a formé son corps, elle en forme tous les autres objets. La sensation de solidité qui leur a donné de la consistance dans un cas, leur en donne aussi dans l’autre ; avec cette différence, que le moi, qui se répondait, cesse de se répondre. »[14]
Finalement, qu’est-ce qui apparaît fondamental dans le toucher ? C’est qu’en touchant, on sent la solidité, donc la contrainte, et donc la différence. Cette différence peut s’appeler différence de l’âme et du corps, ou différence du sujet et de l’objet, en un sens cela importe peu, ce qui nous importe ici est que le toucher est de toute façon ce qui fait sortir de l’immanence, ou met en contact avec l’extériorité, ce qui ne semble pas être nécessairement le cas des autres sens. En conséquence, l’objet propre du toucher serait l’extériorité, ce qui nous résiste, ce qui nous exclut et donc, en un certain sens, l’ob-jectivité, c’est-à-dire la possibilité qu’il y ait des objets pour nous. Il y a « de l’objet » du toucher, et ce serait donc grâce au toucher qu’il y a « de l’objet ». Merleau-Ponty a pensé le monde sur le mode de la continuité et les sensibles comme extraits de ma chair, mais il semble nécessaire de reconnaître une place dans notre expérience du monde à une expérience fondamentale de la discontinuité, et donc de l’objectivité, de l’ob-jection. Cela n’empêche d’ailleurs pas de penser une certaine indistinction de l’objet que je touche et de mon corps, car nous ne touchons l’un que relativement à l’autre, mais la relativité de deux choses n’implique pas qu’on ne puisse les distinguer et, plus loin, qu’elles ne s’opposent pas l’une à l’autre, comme notre corps pesant de son poids sur notre chaise. Parce qu’il y a du toucher, il y a « de l’objet », des corps, et ce régime de corporéité brute, résistante, constituant de notre rapport au monde (constituant en tout cas l’une de ses dimensions), a été peut-être en partie négligé par Merleau-Ponty dans Le visible et l’invisible[15].
Cependant, affirmer le caractère crucial du toucher dans l’existence pour nous d’un monde extérieur pose un problème de fond, qui mine l’ensemble de notre projet. Nous avons affirmé qu’il y avait une spécificité du toucher et un caractère crucial de cette spécificité. Indépendamment du toucher, les autres sensations ne sont, dit Condillac, que des modifications de nous-mêmes, de notre manière d’être. Il dit par exemple des odeurs : « les odeurs ne seront à son égard que ses propres modifications ou manières d’être. »[16] Et s’il existe un espace extérieur pour nous, c’est bien selon lui grâce à notre toucher. Il le dit nettement :
« Alors le plus difficile eût été d’imaginer comment nous contractons l’habitude de rapporter au-dehors des sensations qui sont en nous. En effet, il paraît bien étonnant qu’avec des sens, qui n’éprouvent rien qu’en eux-mêmes, et qui n’ont aucun moyen pour soupçonner un espace au-dehors, on pût rapporter ses sensations aux objets qui les occasionnent. Comment le sentiment peut-il s’étendre au-delà de l’organe qui l’éprouve et qui le limite ?
Mais en considérant les propriétés du toucher, on eût reconnu qu’il est capable de découvrir cet espace et d’apprendre aux autres sens à rapporter leurs sensations aux corps qui y sont répandus. »[17]
On voit donc, selon lui, des objets, c’est-à-dire des entités qui sont pour le moins extérieures à nous, différentes du sujet, parce que nous les touchons. Mais cela pose le problème de la délimitation stricte du toucher par rapport aux autres sens. Car touche-t-on jamais uniquement quelque chose ? L’objet du toucher n’est-il jamais que l’objet du toucher ? La démarche de Condillac dans le Traité des sensations a indéniablement, à cet égard, un caractère fictif, de même que toutes les études sur le « tactile pur », l’« audible pur »… C’est la problématique de la synesthésie qui paraît ici, bien trop vaste, encore une fois, pour que cet article puisse en rendre raison. Nous souhaiterions néanmoins faire à ce sujet quelques remarques, car ce problème va nous permettre de préciser le champ de pertinence des considérations précédentes. Nous pouvons en effet dire que ce que nous touchons et ce qui fait partie de notre champ tactile – ce champ qui inclut ce que nous touchons et ce que nous pouvons en droit toucher – fait aussi partie, si nous sommes voyants, de notre champ visuel, de notre champ auditif… « Ce que » nous touchons n’est donc pas essentiellement tactile. Quel sens peut-on alors donner à des réflexions sur l’objet propre du toucher ? Il semble qu’elles puissent être dotées d’un sens si l’on considère qu’elles tendent à déterminer les caractéristiques du champ tactile, et non pas, en une démarche constituante ou généalogique nécessairement fictive, ce qu’il fonde ou rend possible. En l’espèce, nous avons essayé de montrer que le champ tactile était précisément le champ de l’extériorité en tant que telle, de la résistance, ou du moins d’une certaine résistance et d’une certaine dimension de l’extériorité. Et cette dernière précision nous semble importante. Car si le toucher peut sembler essentiel au fait qu’il y ait pour nous de l’extériorité, en un certain sens de l’extériorité qui l’identifie à la résistance, la raison n’en est-elle pas que, puisque nous sommes pourvus du sens du toucher, l’extérieur est doté, à nos yeux, de cette solidité et de cette résistance ? C’est-à-dire que l’extériorité, l’objectivité est évidemment, du fait que nous sommes des êtres tactiles, également tactile. À ce titre, le toucher semble bien permettre la manifestation pour nous de certains caractères essentiels à nos yeux à l’extériorité, comme la résistance des corps et leur solidité, mais cette affirmation constitue en un sens un pléonasme ou une trivialité, car l’extériorité se définit pour nous comme une extériorité nécessairement tactile. La question de l’objet propre du toucher doit donc être libérée de toute ambition constitutive.
Revenons enfin sur le sens le plus évident de notre sujet. Si le toucher nous permet bien de faire l’expérience de dimensions qui nous semblent essentielles à l’ob-jectivité, au fait donc qu’il y a bien « de l’objet » pour nous, nous ne touchons pas toujours, ni même au premier titre, des objets. Est-ce à dire alors que nous n’en touchons jamais ? C’est à une recherche des objets du toucher que nous voudrions pour finir procéder. Car nous touchons bien parfois des objets. Commençons d’ailleurs par écarter un malentendu : il serait évidemment absurde de dire que nous ne touchons jamais d’objets sous le prétexte, par exemple, que l’on ne toucherait jamais qu’un aspect de ces objets. À la suite de Husserl, Merleau-Ponty fait une belle analyse à ce sujet dans la Phénoménologie de la perception[18]. Si la notion d’objet a un sens, il est clair que l’objet est bien quelque chose que l’on touche, et non pas quelque chose qui s’échapperait toujours, ou que l’on ne pourrait jamais toucher vraiment. On touche bien sûr des objets, et leur nature même d’objet est de ne jamais pouvoir être touché que partiellement, ou par une certaine main, en un certain sens, avec une certaine force. Cela étant posé, y a-t-il de si nombreux cas où il est pertinent de dire que nous touchons un objet ? Ce sont des cas, nous semble-t-il, où une attention particulière est accordée à nos sensations tactiles. Par exemple, lorsque nous avons en main nos clés, nous les touchons, évidemment. Donc nous touchons un objet, nous sommes en contact avec un objet. Mais pourtant, dirions-nous que nous touchons un objet, ou même que nous touchons nos clés ? Il semble qu’une telle affirmation n’aurait guère de sens, car le toucher n’est pas alors ce qui compte. À moins que cette affirmation ne soit proférée dans un certain contexte, où l’on nous aurait demandé, par exemple, pour la quatrième fois de suite si nous avons nos clés. Nous pourrions répondre, agacé : « je les touche ! ». L’expression « je touche mes clés » n’aurait ainsi de sens que dans des contextes très particuliers, où nous accordons une attention particulière à nos sensations tactiles, pour tenter d’en déduire des conclusions sur l’état du monde et, éventuellement, agir sur celui-ci. Par exemple, nous cherchons nos clés dans notre sac en y mettant seulement la main. Nous « farfouillons », et nous tentons alors d’identifier les objets à l’aide de nos seules sensations tactiles. Si nous cherchons nos clés, nous allons chercher la sensation froide de nos clés, ou celle du petit pompon de notre porte-clés. Si nous cherchons notre vieux porte-monnaie, nous allons chercher une sensation de tissu râpé avec de petites incrustations de strass. Quel sens y a-t-il, dès lors, à dire que nous touchons des objets ? La réponse, de nouveau, semble mettre en jeu l’attitude du sujet à l’égard de ce qu’il perçoit ; la pertinence de l’usage de la notion d’objet semble dépendre de l’attitude supposée du sujet touchant. C’est-à-dire que, si la notion d’objet du toucher a un sens, il ne faut pas, de nouveau, se représenter des objets en soi, permanents, ontologiquement déterminés, que nous nous efforcerions de toucher, et dont nous nous efforcerions de saisir les propriétés tactiles sans pouvoir jamais sentir la totalité de leurs propriétés, l’objet restant ainsi intouchable. Non, s’il y a quelque chose comme des « objets » que l’on touche, ce sont des choses que l’on touche effectivement, même si l’on ne sait pas toujours – et on ne le sait même jamais tout à fait – ce que l’on touche. Parler d’objet, c’est parler de cette incomplétude de notre connaissance, de notre démarche de prise, de connaissance et, en tout cas, d’identification des entités de notre monde. Parler des objets que l’on touche, ce serait, au fond, parler de cette démarche identificatoire de notre part, ce qui explique du reste qu’il puisse y avoir tout aussi bien des objets mentaux. Les objets du toucher, finalement, seraient les cibles de cette démarche d’identification lorsque nous utilisons le toucher pour la mener à bien.
Cette hypothèse permet de proposer une interprétation du célèbre texte du De anima sur l’objet de la perception. Dans ce texte célèbre[19], Aristote distingue en effet, comme objets du toucher (notons que le mot « objet » n’a pas d’équivalent dans le texte grec) les « sensibles propres » et les « sensibles par accident ». Si l’on transpose cette distinction à l’exemple des clés, on peut dire que, au moment où nous croyons trouver enfin nos clés, cette croyance est fondée sur le fait que nous sentons la sensation froide du métal. Mais en fait, ce que nous sommes sûrs de toucher, c’est un métal froid ou quelque chose qui donne la même sensation au toucher que le métal froid ; peut-être sommes-nous en train de toucher une fourchette abandonnée dans notre sac après notre dernier pique-nique. Ce que nous sentons par accident, donc, ce sont nos clés ; ce que nous sentons proprement, c’est le métal froid (ou ce qui a les mêmes qualités tactiles que le métal froid). Il y a donc une erreur possible sur l’identification de ce que nous touchons. Mais cela n’empêche pas que ce que nous touchons, ce vers quoi nous tendons notre attention tactile est bien un objet, que nous essayons d’identifier et de repérer parmi un ensemble d’autres choses. Aristote dit d’ailleurs que les « sensibles par accident » sont bien des sensibles : nous sentons les clés. Et s’il nous est possible de nous tromper sur la nature de l’objet que nous touchons, c’est, pensons-nous, intrinsèque à la nature même des objets : les objets sont toujours ce que nous identifions ou cherchons à identifier – de manière plus ou moins précise (cela aussi est contingent) – en les touchant, en les voyant, en les entendant… Il est dans tous les cas certain que, lorsque nous sommes dans une telle démarche identificatoire, nous sommes bien en train destoucher un objet, quel que soit le nom de cet objet. Il n’y a pas de hiatus possible entre notre volonté de toucher un objet et le fait de le toucher effectivement, puisque l’objet du toucher, par définition, est ce que nous voulons toucher.
C’est l’hypothèse proposée au début de cette analyse qui nous semble ici, en dernière instance, confirmée : la pertinence du concept d’objet est éminemment contingente, elle est relative à notre attitude envers le monde et son « mobilier ». Sens essentiel, par définition, à l’expérience que nous avons de l’objectivité qu’il y a pour nous, et nous précisons « par définition » car, comme nous l’avons dit, ce qui définit et caractérise pour nous l’ob-jectivité est, pour autant que nous sommes des êtres tactiles, toujours aussi et inévitablement tactile, le toucher ne semble pourtant pas avoir tant d’objets que cela. S’il y a des objets du toucher, au sens fort, ce n’est donc pas sans cesse et, lorsqu’une telle expression a un sens, cela ne concerne pas toutes les choses avec lesquelles nous sommes alors en contact, mais cela concerne ce que nous voulons identifier, ce avec quoi nous voulons agir. Parler de l’objet du toucher ou parler de l’objet de la perception en général, n’est-ce donc pas avant tout parler de notre attitude identificatoire à l’égard du monde ? Et l’on pourrait ainsi dire que, de même que tout ce que l’on touche n’est pas l’objet de notre toucher, tout ce que l’on voit n’est pas l’objet de notre vision. Loin d’être le tyran dominateur du champ de la perception, la vision serait donc, en l’occurrence mais probablement comme souvent, la première victime d’une tyrannie qui emprunte, aux yeux de nombreux auteurs, son visage : l’action, l’intervention, matérielle comme intellectuelle, sur le monde, que l’on laisse trop souvent effacer à nos yeux l’existence de ces autres dimensions, tout aussi essentielles, de notre rapport au monde, la co-présence, le positionnement, le repos.
Jeanne-Marie Roux (Université Paris I, Phico/Execo
[1]
Merleau-Ponty, M., Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 308.
[10]
Merleau-Ponty, M., Phénoménologie de la perception, [1945], Paris, Gallimard, 2009, p. 120.
[12]
Condillac, Traité des sensations, Paris, Fayard, 1984, II, 5, p. 105.
[15]
On pourrait aussi soutenir que Merleau-Ponty y était surtout soucieux d’éviter les concepts, ô combien lourds de préjugés, de sujet et d’objet. Notre procédé, qui consiste à reconnaître au toucher « de l’objet », vise à réduire la charge métaphysique de ce couple de termes tout en reconnaissant une part de discontinuité et d’objection dans notre expérience tactile du monde, laquelle ne fait pas le tout du toucher (pensons par exemple à l’expérience « océanique » d’un bon bain chaud) mais nous semble malgré tout quelque peu négligée dans les derniers travaux de Merleau-Ponty.
[16]
Condillac, Traité des sensations, I, 1, p. 15.
[18]
Nous pensons ici aux toutes premières pages de la première partie, intitulée “Le corps”.
[19]
Aristote, De l’âme, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 2003, II, 6.