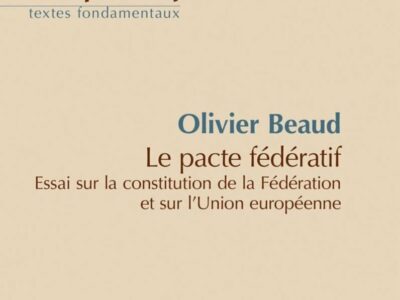Musil et Wittgenstein rapportés à Kierkegaard : l’articulation de l’esthétique et de l’éthique
Cet article est issue d’une communication de l’auteur dans le cadre du colloque international « MUSIL ET WITTGENSTEIN : La philosophie, l’art et la vie » organisé par Anne Coignard, Sophie Djigo, Pierre Fasula et Joseph Spadola et ayant eu lieu 24 et 25 septembre 2010 à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
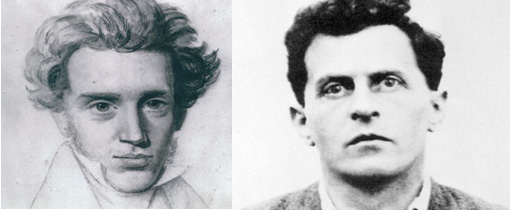
Le but de cet article est d’instaurer un dialogue entre Kierkegaard et deux auteurs qui nous intéressent ici, Musil et Wittgenstein, pour établir comment s’articulent précisément esthétique et éthique. Cette référence me semble importante non pas tant pour vérifier cette affirmation que l’on trouve chez Musil et chez Wittgenstein : « l’esthétique et l’éthique sont une », mais plutôt pour comprendre comment l’une et l’autre s’articulent.
Des jugements ambivalents (Musil et Wittgenstein à propos de Kierkegaard).
Pour ce faire, je voudrais partir de leurs jugements, qui sont au fond assez ambivalents : d’un côté, ils accordent une grande valeur à la pensée de Kierkegaard, mais de l’autre, ils y réagissent assez violemment – de manière significative quant à l’articulation de l’esthétique et de l’éthique.
Si l’on regarde du côté des Journaux de Musil, on trouve deux passages consacrés essentiellement à Kierkegaard. Dans le premier, il fait de Kierkegaard un grand penseur et plus précisément un grand psychologue :
D’où vient la manie psychologisante dans la littérature et la réaction là contre ? Du fait que la fin du XIXe siècle a compté parmi ses écrivains quelques très grands psychologues. Trois ou quatre. Dont Kierkegaard et Dostoïevski[1].
On notera que, malgré la critique de cette « manie psychologisante de la littérature », c’est un grand compliment de la part de Musil, dans la mesure où, s’il y a quelqu’un qui est exigeant en psychologie, expérimentale ou littéraire, c’est bien lui (il a étudié la psychologie, a continué à en lire après ses études, l’a utilisée dans ses écrits, etc., etc.).
Mais dans le deuxième passage, le ton est tout à fait différent :
Jeunesse et marche du temps. Aujourd’hui, même les philosophes de métier, s’ils se piquent de culture, citent Kierkegaard. Je ne l’aime pas, ne l’ai jamais aimé, n’ai pas besoin de lui : comment cela se fait-il ? Peut-être : ce que l’on peut en tirer de positif aujourd’hui était déjà dans l’air à l’époque, et je n’avais pas besoin d’y ajouter Kierkegaard, de sorte que m’en a frappé uniquement l’aspect négatif, déplaisant, le côté fin de siècle[2].
Le point important est que l’on a à faire à une réaction, qui est de l’ordre de l’affect et dont la raison se révèle être esthétique. Plus précisément, il y a bien quelque chose de positif dans la pensée de Kierkegaard, et Musil pense sans doute à la profondeur de certaines analyses psychologiques. Mais, d’une part, Kierkegaard partage ses avancées avec d’autres penseurs de son époque (Musil renverse la perspective du premier passage : il souligne ce que Kierkegaard a en commun avec d’autres et non plus ce qui le distingue). Surtout, d’autre part, ne reste alors que le déplaisant voire le repoussant dans Kierkegaard : ce que Musil désigne comme le côté « fin de siècle », c’est-à-dire ce style de la fin du 19e, qui renvoie plus généralement à une posture esthétisante à l’égard de la réalité.
Quel est l’intérêt pour nous de ce jugement de Musil ? D’un côté, il est assez classique de souligner la profondeur de Kierkegaard et d’exprimer en même temps un certain agacement à l’égard de sa posture d’auteur (son jeu avec les pseudonymes ou son ironie par exemple). Mais d’un autre côté, on a là tous les éléments d’une tension entre une posture esthétisante et quelque chose d’essentiel pour Musil, d’un point de vue littéraire et éthique : l’exploration des « motifs de l’âme »[3]. Cette tension devient explicite chez Wittgenstein.
Chez Wittgenstein, on retrouve une même ambivalence dans le jugement, avec cette différence que l’enjeu éthique est beaucoup plus marqué, clairement articulé à une réaction esthétique face à Kierkegaard. Le point de départ reste un des éloges les plus prononcés de Wittgenstein sur un philosophe. Dans une conversation avec Drury, il affirme que « Kierkegaard est de loin le penseur le plus profond du siècle dernier. Kierkegaard était un saint »[4]. Cet éloge est confirmé par la manière dont, en général, Wittgenstein se réfère à Kierkegaard : principalement dans les textes dans lesquels il exprime ce qu’il y a de plus important pour lui (certains passages des Remarques mêlées), mais aussi dans les textes les plus « privés » ou les plus personnels (les discussions avec Drury et surtout les Carnets de Cambridge et de Skjolden).
Face à cet éloge, on trouve cette réaction dans les Carnets :
Les écrits de Kierkegaard ont quelque chose de taquin & c’est naturellement voulu, même si je ne peux pas être sûr ; si cet effet qu’ils ont sur moi est exactement voulu. Il n’y a également aucun doute que celui qui me taquine m’oblige à m’expliquer avec son problème & si ce problème est important, cela est bien. – Et pourtant, il y a quelque chose que cette taquinerie condamne en moi. Et est-ce seulement mon ressentiment ? Je sais aussi très bien que Kierkegaard pousse l’esthétique jusqu’à l’absurde avec sa maestria & et qu’il le veut aussi naturellement. Mais c’est comme s’il y avait déjà dans son esthétique une goutte de vermouth, de telle façon que précisément le goût en soi n’est pas aussi agréable que celui de l’œuvre d’un poète. Il imite en quelque sorte le poète avec une incroyable maîtrise, mais sans être un poète & qu’il ne le soit pas, on le remarque bien dans l’imitation. / L’idée que quelqu’un use d’un artifice pour me pousser à quelque chose est désagréable[5].
Cette réaction négative s’ancre à nouveau dans quelque chose d’ordre affectif et esthétique. Plus précisément, le déplaisir voire la répulsion à l’égard du ton taquin de Kierkegaard réside dans l’esthétique de ce dernier. Un premier aspect intéressant tient à ce que l’esthétique en question, telle que la décrit Wittgenstein, ressemble au côté « fin de siècle » dont parle Musil : l’esthétique poussée jusqu’à l’absurde, son goût de vermouth, la mise en scène de soi comme poète sont autant d’éléments qui pourraient permettre de caractériser l’esthétique « fin de siècle ». Mais il y a un deuxième aspect plus important dans ce passage, à savoir l’articulation de cette réaction esthétique à un enjeu éthique. La taquinerie des écrits de Kierkegaard a pour fonction de pousser le lecteur à s’expliquer avec un problème. Ici, le problème mentionné est celui du ressentiment. Et si l’on regarde les autres occurrences de Kierkegaard dans les Carnets de Cambridge et de Skjolden, on s’aperçoit que ce problème est toujours de nature éthique : « Ma conscience me tourmente & m’empêche de travailler. J’ai lu des écrits de Kierkegaard & cela m’a rendu encore plus inquiet que je ne l’étais déjà. »[6], « Peu de choses me sont aussi difficiles que la modestie. Je m’en aperçois maintenant à nouveau en lisant Kierkegaard »[7]. Or, ce qui pose donc problème aux yeux de Wittgenstein, c’est que si d’un côté la taquinerie a pour fonction de confronter le lecteur à l’éthique, de l’autre, l’esthétique dans laquelle s’exprime cette taquinerie va dans le sens contraire. On ne peut que citer à nouveau la dernière phrase du passage choisi : « L’idée que quelqu’un use d’un artifice pour me pousser à quelque chose est désagréable »[8]. L’artifice de l’esthétique va contre la confrontation avec le problème éthique. L’enjeu éthique et les moyens esthétiques sont ici en conflit.
On pourrait objecter que ce qui est dit là n’est valable que pour Wittgenstein, que ce n’est là au fond qu’une réaction personnelle et qu’il n’y a donc pas lieu d’en tirer une thèse générale sur l’articulation de l’esthétique et de l’éthique. Il y a pourtant un autre passage des Carnets qui montre que cette réaction et ce jugement ont une portée générale, un passage dans lequel Wittgenstein critique les effets de l’ironie utilisée par Kierkegaard :
La fréquentation d’auteurs comme Hamann, Kierkegaard rend leurs éditeurs présomptueux. Cette tentation, jamais l’éditeur du Pèlerin chérubinique [Silesius, poète mystique du 17e] ne l’éprouverait, ni celui des Confessions de saint Augustin ou d’un écrit de Luther.
Il se pourrait bien que l’ironie d’un auteur ait tendance à rendre le lecteur présomptueux.
C’est alors à peu près ainsi : ils disent qu’ils savent qu’ils ne savent rien mais ils tirent de cette connaissance une vanité sans bornes[9].
La critique est bien générale, puisque les effets négatifs de l’ironie concernent d’abord les éditeurs, puis les lecteurs, quels qu’ils soient. Elle est de nature éthique, dans la mesure où elle condamne la présomption et la vanité dans la mise en avant de l’ignorance, et ce dans un genre de remarques qui rappelle les remarques des moralistes. Mais l’enjeu est plus important encore : cette critique porte sur ce qui joue un rôle charnière, chez Kierkegaard, entre esthétique et éthique. Dans la vie ordinaire, l’ironie manifeste la tension entre la vie esthétique, la vie de jouissance, et la conscience des exigences éthiques. Au niveau même des écrits de Kierkegaard, l’ironie est cette esthétique, ce style lié à des choix d’écriture, qui manifeste une conscience des exigences éthiques et pousse le lecteur à se confronter à elles. Or, Wittgenstein montre que cette attitude dans la vie et ce style dans les écrits de Kierkegaard peuvent être fourvoyants d’un point de vue éthique. Pour ne pas être injuste, il faut tout de même rappeler que Kierkegaard est le premier à souligner qu’il « est possible que l’ironiste soit un homme éthique […] ce n’est pas dit qu’il en soit un »[10]. Seulement, là où il fait une concession prudente, Wittgenstein aurait plutôt tendance à radicaliser le propos : l’ironie a tendance à nous détourner de l’éthique, à susciter en nous des sentiments qui ne sont pas vraiment moraux.
Que peut-on tirer de ces jugements ambivalents à propos du rapport entre esthétique et éthique ? De manière évidente, les réactions de Musil et surtout de Wittgenstein par rapport à Kierkegaard montrent une certaine méfiance à l’égard des attitudes esthétisantes, et notamment de celles qui, au nom de leur dimension esthétique, prétendent avoir un rapport privilégié à l’éthique, par exemple l’ironie. En même temps, a contrario, tout ce que dit Wittgenstein du ton taquin semble indiquer qu’un bon ton, un ton adéquat, soit nécessaire pour qu’un discours nous pousse à nous confronter aux problèmes éthiques. Nous allons donc nous consacrer au rapport entre esthétique du discours et éthique, et notamment au rapport entre réactions esthétiques et réactions morales.
Réactions esthétiques et réactions morales (Wittgenstein).
Le but dans ce deuxième point est de montrer, à partir de Wittgenstein principalement, que nos réactions esthétiques peuvent contribuer à résoudre un certain type de problèmes éthiques. Pour ce faire, il faut donc nous pencher sur cette notion essentielle de réaction, telle qu’elle est utilisée par Wittgenstein, aussi bien dans le domaine de l’esthétique que de l’éthique.
Concernant l’éthique, Wittgenstein dit la chose suivante dans les Carnets :
Une proposition éthique dit « Tu dois le faire ! » ou « Cela est bien ! », mais non : « Ces hommes disent que cela est bien. » Mais une proposition éthique est une action personnelle. Non la constatation d’un fait. Comme un cri d’émerveillement. Considère donc que le fondement de la « proposition éthique » cherche seulement à réduire la proposition à d’autres qui te font de l’effet. Tu n’en éprouves à la fin ni répulsion pour l’une, ni émerveillement pour l’autre, si bien qu’il n’y a pas de fondement qui mérite ce nom[11].
Ce que l’on peut souligner dans ce passage, c’est que la proposition éthique se démarque à la fois d’un constat sur ce que les hommes pensent ou disent, et d’une proposition qui doit être fondée. Ce que manquent le constat et la recherche d’un fondement, c’est l’émerveillement, ou la répulsion d’ailleurs, qu’exprime une proposition éthique devant l’action qui est envisagée (Tu dois le faire, cela est bien). Autrement dit la part fondamentale de réaction qui se trouve dans l’éthique. Wittgenstein semble même aller plus loin en suggérant que la recherche d’un fondement anesthésie nos réactions morales.
On peut par ailleurs ajouter à cela que la réaction n’est pas essentielle simplement au niveau de l’expression des propositions éthiques, mais aussi dans le rapport de l’individu à la proposition éthique exprimée devant lui ou pour lui. Cela est confirmé dans les paragraphes 143-145 des Recherches philosophiques, qui portent sur la manière dont un individu apprend à suivre une règle :
143. Considérons à présent le type suivant de jeu de langage : B doit, sur l’ordre de A, écrire des suites de signes selon une règle de formation déterminée. / La première de ces suites serait celle des nombres entiers naturels dans le système décimal. – Comment B apprend-il à comprendre ce système ? – A écrit d’abord à son intention des suites de nombres que B est tenu de recopier. […] Déjà à ce niveau, il existe une réaction normale et une réaction anormale de l’apprenti. – Sans doute au départ, lui tenons-nous la main pour qu’il recopie la suite de 0 à 9. Mais la possibilité d’une compréhension mutuelle dépendra du fait qu’après cela il continue à l’écrire par lui-même.[12]
Wittgenstein continue alors en envisageant les différentes manières possibles de développer cette réaction initiale. L’élève inscrit des chiffres, mais – 1ère possibilité – certains le sont au hasard, – 2e possibilité – leur ordre n’est pas respecté, – 3e possibilité – il fait une erreur systématique. Ce qui importe en tout cas, c’est qu’il y a « de la réaction » au fondement du rapport à l’ordre, et que, même si le domaine envisagé ici est celui de l’apprentissage des mathématiques, on peut sans doute étendre le propos à l’éthique. Sont de l’ordre de la réaction non seulement la proposition éthique, face à une situation ou à un acte par exemple, mais encore notre attitude face à un ordre éthique : il est fondamental que nous réagissions aux propositions éthiques.
De ce point de vue-là, on retrouve une idée analogue concernant l’esthétique. De même que l’éthique n’est pas une science de ce qui est bon ou un constat sur ce que les hommes considèrent comme bon, l’esthétique n’est pas une science du beau ou un constat sur ce qu’apprécient les hommes. De même que l’éthique ne réside pas dans un état particulier de l’esprit, par exemple dans tel ou tel sentiment (cf. la Conférence sur l’éthique), l’esthétique ne se confond pas avec des effets psychiques dont la cause serait certains objets particuliers : les œuvres, ou encore un phénomène naturel. Si l’esthétique, comme l’éthique, ne se confond pas avec tout cela, cela tient à ce que « peut-être la chose la plus importante en ce qui touche à l’esthétique est-elle ce que l’on peut appeler les réactions esthétiques, p. ex. le mécontentement, le dégoût, la gêne. »[13] On pourrait aussi rajouter à ces réactions négatives toutes celles qui sont positives, comme l’émerveillement, l’admiration, etc. En tout cas, s’il y a donc une parenté entre l’esthétique et l’éthique, c’est dans le fait qu’elles s’ancrent toutes deux dans des réactions, qu’elles appartiennent toutes deux à un domaine de notre vie où la réaction est le fait premier.
Peut-on aller plus loin dans leur assimilation ? Ce n’est pas sûr. Que la racine soit, dans les deux cas, de l’ordre de la réaction ne signifie pas que les réactions esthétiques et éthiques soient de même nature, ou encore que l’une se réduise à l’autre (comme si par exemple les réactions esthétiques se révélaient être morales, ou inversement). Ce qui importe au contraire, c’est qu’elles se développent dans des formes différentes : les réactions esthétiques sous la forme de l’appréciation de ce qui les suscite, les réactions éthiques sous la forme d’un changement ou non de la vie. Pour être basées toutes deux sur des réactions, elles n’en sont pas moins deux jeux de langage différents.
Il me semble pourtant que Wittgenstein n’en reste pas à cette distinction des réactions esthétiques et éthiques. On trouve en effet dans les Carnets de Cambridge et de Skjolden une autre situation éthique, qui est d’autant plus intéressante pour nous qu’elle est développée sur la base d’une référence à Kierkegaard :
A Kierkegaard : Je te présente une vie & vois à présent comment tu te comportes, si cela t’attire (te pousse) aussi de vivre ainsi, ou bien quel autre comportement cela t’inspire. Je voudrais pour ainsi dire débloquer ta vie grâce à cette présentation. […][14]
Dans ce passage des Carnets, il n’y a pas de proposition éthique qui est exprimée ni de réaction à une proposition éthique, nous sommes donc dans une situation tout à fait différente de ce que nous présentions plus haut. Pourtant la situation est réellement éthique dans la mesure où il s’agit de « débloquer » une vie, ce qui nous place non pas sur un plan technique mais sur celui des problèmes de la vie dont parlent notamment le Tractatus ou les Remarques mêlées. Or, pour une fois, la solution ne réside pas directement dans un appel à l’action, à la transformation de sa propre vie, comme ce peut être le cas dans le passage connu des Remarques mêlées :
La solution du problème que tu vois dans la vie, c’est une manière de vivre qui fasse disparaître le problème. / Que la vie soit problématique, cela veut dire que ta vie ne s’accorde pas à la forme du vivre. Il faut alors que tu changes ta vie, et si elle s’accorde à une telle forme, ce qui fait problème disparaîtra.[15]
Dans le passage des Carnets, la solution réside plutôt dans la présentation à la personne, dont la vie est bloquée, d’une autre vie, et dans l’examen de son comportement, de son attirance ou de sa répulsion, bref, dans l’examen de ses réactions.
L’hypothèse est la suivante : si l’esthétique joue un rôle en éthique, c’est notamment dans cette manière de présenter une vie, au sens où c’est cette manière qui permet les réactions et donc ce déblocage de la vie. Donner ce rôle à l’esthétique, c’est accorder une grande importance tout autant à la vie qui est présentée qu’à la manière de la présenter. Ce serait presque une affaire de séduction ou de persuasion, s’il ne fallait pas tout de même observer l’attirance ou la répulsion, ce qui suppose que l’on ne cherche pas trop à attirer. Il me semble notamment que les paragraphes cités des Recherches philosophiques (§143-145) vont à nouveau dans le sens de cette hypothèse :
145. Supposons que l’élève écrive maintenant la suite de 0 à 9 d’une façon qui nous satisfasse. – Ce sera le cas seulement s’il y réussit souvent, et non s’il le fait correctement une fois sur cent. Je le guide ensuite dans le développement de la suite, et j’attire son attention sur le retour de la première suite dans les unités, puis sur ce retour dans les dizaines. (Ce qui veut simplement dire que je recours à certaines intonations, que je souligne certains signes, que je les écris les uns sous les autres de telle et telle manière, et autres choses semblables.) – Et à un certain moment, il continue à développer la suite tout seul, – ou il ne le fait pas. – Mais pourquoi le dis-tu ? Cela va de soi ! – Évidemment, et je voulais simplement dire que l’effet de toute explication supplémentaire dépend de sa réaction[16].
Là où le paragraphe 143 se focalisait sur la réaction de départ dans le prolongement d’une suite de chiffres, ce paragraphe 145 se focalise sur la manière dont le maître guide l’élève. La fin du paragraphe met en relation notamment ce guidage avec les réactions de l’élève, qui continuent à être importantes tout au long de l’apprentissage. Mais ce qui nous importe, c’est surtout la manière du maître. Il s’agit pour lui d’ « attirer l’attention », ce qui est décrit très précisément par Wittgenstein : recourir à certaines intonations, souligner certains signes, en changer la disposition spatiale, etc. Nous voyons en cela une esthétique qui permet au maître de débloquer l’action de l’élève et nous retrouvons dans la présentation d’une vie des procédés similaires : mettre le ton, souligner certains éléments de cette vie, en marquer l’ordre, sont autant de manières d’en mettre en relief les aspects, de sorte que nous y réagissions.
Décrire des vies possibles (Kierkegaard).
Le but de ce troisième point sera de comprendre plus précisément pour quelles raisons cette présentation esthétique d’une vie peut débloquer la vie d’une personne, sur le plan éthique. Pour cela, il faut revenir à la mention de Kierkegaard qui est un élément essentiel ici. Ce que Wittgenstein décrit comme une solution possible aux problèmes de la vie correspond à ce que fait Kierkegaard dans ses propres écrits : décrire des types de vie. Dans Ou bien… ou bien…, sont décrites une vie esthétique et une vie éthique ; dans les Étapes sur le chemin de la vie, il leur rajoute la description d’une vie religieuse ; dans le Post-scriptum aux Miettes philosophiques, il opère une distinction entre deux types de vie religieuse. Mais il y a un point plus important encore qui justifie le rapprochement entre Wittgenstein et Kierkegaard : même si ce dernier distingue dans ses écrits la vie esthétique des deux autres types de vie (ceci dit, on pourrait nuancer ce point en regardant par exemple la structure complexe de Ou bien…, Ou bien…), ses propres écrits sont des descriptions de vies possibles, des descriptions dont la visée est éthique, mais sur le mode esthétique : c’est notamment le jeu bien connu avec les pseudonymes et l’usage de plusieurs genres littéraires (aphorismes, lettres, journal, propos, etc.). Autrement dit, l’esthétique et l’éthique, distinguées au plan de la vie, au plan des vies possibles, sont articulées au niveau de l’écrit philosophique.
Or, l’intérêt de Kierkegaard vient de ce qu’il répond à la question : quelle est l’importance pour ces vies éthiques et religieuses de se communiquer de manière esthétique ? La réponse à cette question se situe notamment dans un chapitre du Post-scriptum aux Miettes philosophiques (2e partie, 2e section, chapitre III : « La subjectivité réelle, l’éthique. Le penseur subjectif »). Dans un premier temps, ce chapitre souligne bien la différence entre esthétique et éthique. Kierkegaard commence par souligner la tension générale entre la pensée abstraite et l’existence, le danger d’une telle pensée abstraite, d’un point de vue éthique, étant de tirer l’existence hors de la réalité pour en faire une simple possibilité. Il prolonge ensuite cette tension au niveau de la distinction entre esthétique et éthique. L’esthétique, affirme Kierkegaard, en reprenant les thèses d’Aristote au début de la Poétique, s’occupe de ce qui est possible, là où l’éthique a à faire à la réalité de l’individu, c’est-à-dire à son existence : « Par rapport à la réalité, du point de vue poétique et intellectuel, la possibilité est supérieure […] Du point de vue éthique, la réalité est plus haute que la possibilité. L’éthique veut précisément détruire le désintéressement de la possibilité en faisant de l’existence l’intérêt suprême »[17]. La tension entre esthétique et éthique réside donc le fait qu’en s’occupant davantage de ce qui est possible que de ce qui est réel, l’esthétique nous détourne aussi de la seule réalité qui nous importe : notre propre existence.
Or, Kierkegaard revient sur cette tension dans deux passages, dont le centre est cette notion de possibilité. Tout d’abord, il affirme que celui qui se rapporte éthiquement à sa propre existence peut aussi trouver un intérêt éthique à ce possible dont s’occupe l’esthétique. La raison est la suivante : « il s’agit d’une possibilité qui n’est pas seulement esthétique ou intellectuelle, c’est-à-dire désintéressée, mais qui est une réalité pensée qui se rapporte à ma propre réalité, à savoir que je peux la réaliser » [18]. Autrement dit, ces possibilités de vie qui nous sont présentées dans l’esthétique peuvent ne pas nous détourner de notre existence ou ne pas la déréaliser, mais au contraire l’intéresser d’un point de vue éthique dans la mesure où elle y trouve des possibilités d’action. Pour retrouver ce qui était développé tout à l’heure, s’il y a un lien entre esthétique et réaction, cela tient à ce que l’esthétique nous propose des possibilités d’action. De cela Kierkegaard tire dans un deuxième temps une idée plus générale concernant la part de l’esthétique dans la communication de l’éthique. Il distingue notamment deux manières de vouloir communiquer l’éthique :
On pourrait croire que, par le récit de ce que tel ou tel a réellement fait ceci ou cela (de grand et de remarquable), on donnerait davantage au lecteur le désir de faire la même chose et d’exister en elle que si l’on se borne à la lui représenter comme possible. Mais […] le fait que tel ou tel a réellement fait ceci ou cela peut aussi bien agir comme une entrave que comme stimulant. Le lecteur n’a qu’à transformer celui dont il s’agit (à l’aide du fait que c’est une personne réelle) en une rare exception ; il l’admire et dit : pour moi je suis trop chétif pour faire quelque chose de semblable. […] Au lieu, comme on le fait d’habitude, de présenter le bien en forme de réalité, d’affirmer que tel ou tel a réellement vécu et réellement fait cela, et de transformer ainsi le lecteur en un contemplateur, un admirateur, un estimateur, on doit le présenter en forme de possibilité ; ainsi il est mis aussi près que possible du lecteur, s’il veut exister en lui[19].
Le cœur de cette distinction, c’est le rapport qu’introduit le discours entre le bien et le lecteur. Un discours qui insiste sur la réalité du bien, sur le fait que tel ou tel a réellement été bon ou a réellement bien agi, a tendance à introduire une distance entre le bien et le lecteur. Et Kierkegaard donne plusieurs exemples de cette distance : la contemplation d’une action bonne n’engage pas celui qui contemple dans l’action, l’admiration pour une personne exceptionnelle souligne la séparation entre cette personne d’exception et l’admirateur, l’estimation même de l’action suppose une distance à l’égard de ce qui est estimé (« […] et l’on discute, et l’on examine, et l’on tourne et retourne la chose sous toutes ses faces pour savoir si vraiment…, etc., et l’on admire, la larme à l’œil, que vraiment…, etc. »[20]). La solution que propose Kierkegaard consiste au contraire à présenter le bien au lecteur sous la forme d’une possibilité : « ainsi il est mis aussi près que possible du lecteur »[21], « l’on pose la possibilité comme terrain commun entre eux »[22]. L’on retrouve donc l’idée que la présentation d’une autre vie est aussi d’un intérêt éthique pour nous, précisément dans la mesure où cette vie n’est pas seulement possible en général, mais possible pour nous, dans la mesure où cette possibilité de vie se trouve dans un espace commun avec notre existence.
L’idée générale que l’on pourrait développer à partir de Kierkegaard serait donc la suivante. La présentation d’une vie peut permettre de débloquer la vie, dans la mesure où ce qui est présenté l’est sous la forme de la possibilité, et se trouve donc être une possibilité pour celui dont la vie est bloquée. On pourrait même peut-être dire que l’esthétique est ce qui rend l’individu sensible (ou attentif ou intéressé ?) à cette possibilité.
Le prolongement problématique de Wittgenstein.
Dans ce dernier point, qui sera en même temps la conclusion de cet article, j’aimerais souligner l’originalité de la perspective de Wittgenstein par rapport à celle de Kierkegaard, pour la prolonger de manière problématique au moyen de Musil.
Il y a une différence importante entre la perspective de Wittgenstein et celle de Kierkegaard. Les écrits de Kierkegaard ne sont pas simplement des descriptions de vies possibles, mais une véritable incitation à l’adoption de vies éthiques et religieuses. Plus précisément, il s’agit par l’esthétique de ses écrits d’intéresser l’individu à sa propre existence, c’est-à-dire de quitter une vie esthétique pour une vie éthique, mais aussi d’intéresser cette existence à celle d’un autre : Dieu, c’est-à-dire de quitter la vie éthique pour la vie religieuse. Mais dans la citation des Carnets qui a été exploitée, il s’agit plus simplement pour Wittgenstein de présenter à celui dont la vie est bloquée une autre vie, et d’observer sa réaction. La perspective est donc bien éthique mais rien n’est dit de la valeur de la vie qui est simplement présentée. C’est même peut-être l’intérêt de ce passage que de faire l’économie de cette valeur : c’est simplement la possibilité (et non la valeur) d’une vie qui est présentée. Or, cela pose un problème dans la mesure où celui dont la vie est bloquée cherche à savoir quelle est la bonne décision à prendre et plus largement quelle est la bonne vie à mener, parmi les possibilités qui s’offrent à lui. Il y a donc un décalage entre cette demande en terme de valeur et une réponse finalement assez neutre.
C’est là où la contribution de Musil est intéressante, non seulement dans la position du problème, mais aussi dans sa résolution. La situation d’Ulrich, le personnage principal de L’Homme sans qualités, est en effet exemplaire. Il formule ainsi le problème éthique dans toute sa radicalité : « Comment dois-je vivre ? »[23], et non pas : « comment pourrais-je vivre ? », « quelle vie possible pourrais-je mener ? ». Il s’agit donc de trouver une autre vie possible par rapport à celle qui est menée et qui est insatisfaisante, mais cette autre vie doit s’imposer en même temps comme étant ce qu’il appelle « la vie juste ». Le problème réside donc dans le rapport entre le possibilité et la valeur de cette vie : si elle est seulement possible, elle n’a pas de valeur particulière, mais si elle a une valeur particulière, alors elle n’est une plus une possibilité, mais la vie à mener. Le problème pour nous peut donc être reformulé ainsi : comment ce qui est présenté comme une vie possible peut-il devenir la vie à mener ? Comment comprendre le changement de statut de cette vie, d’une possibilité à ce qu’il faut adopter ?
L’intérêt du §62 dans le premier volume, c’est qu’il dessine l’espace où chercher la solution au problème de la vie juste :
[…] la question fondamentale, Ulrich ne se la posait pas seulement sous la forme de pressentiments, mais aussi, tout à fait prosaïquement, sous la forme suivante : un homme qui cherche la vérité se fait savant ; un homme qui veut laisser sa subjectivité s’épanouir devient, peut-être, écrivain ; mais que doit faire un homme qui cherche quelque chose situé entre les deux ?[24]
Il faut comprendre que la solution recherchée est à la fois en rapport avec la subjectivité et la vérité, sans qu’elle se confonde avec l’une ou l’autre. Ce serait donc quelque chose d’analogue à la vérité, qui en aurait notamment la stabilité, sans en être une à proprement parler (la vérité renvoie au domaine des sciences chez Musil), et sa fonction serait non pas d’épanouir mais de conduire la vie. Il y a bien un exemple de cet entre-deux, le précepte moral : Tu ne tueras point. Cela n’est en effet ni une vérité ni l’expression de l’individu, mais une exigence dans la conduite de la vie. Cependant d’emblée cette exigence pose problème, au regard notamment du mauvais tour qui lui est joué par la littérature :
On a rattaché cette exigence aux dogmes de la religion et de la loi, on lui a donné le caractère d’une vérité dérivée, mais les romanciers, en nous présentant les exceptions, depuis le sacrifice d’Abraham jusqu’à la dernière vamp meurtrière de son amant, la réduisent de nouveau en pure subjectivité. Ainsi donc, ou bien on s’accroche aux pieux, ou bien on se laisse ballotter par la lame entre deux ; mais dans quel sentiment ? Le sentiment qu’éprouve l’être humain pour ce précepte du Décalogue est un mélange d’obéissance bornée […] et un barbotement inconscient dans une houle de possibles[25].
Le point important pour nous, c’est que la littérature nous fait prendre conscience de toutes les exceptions aux règles de la morale et augmente ainsi le nombre de nos possibilités dans le domaine de l’action éthique, mais elle n’est pourtant pas la réponse au problème radical du « comment dois-je vivre ? ». Elle développe d’autres possibilités de vie, les présente de sorte que nous y réagissions d’un point de vue éthique, elle n’est donc pas sans lien avec l’éthique, mais ne nous dit pas quelle est la vie juste.
Que peut-on en conclure sur le rapport de la littérature aux problèmes éthiques ? Faut-il dire qu’elle n’est pas à la hauteur du problème éthique ? Non, et pour le justifier, il faut se rapporter à ce que dit Musil de la littérature dans une ébauche d’essais intitulée « Petite Novelette » :
[…] la réponse à ce genre de questions ne relève de l’art que dans l’exacte mesure où on ne peut pas la donner, c’est-à-dire : à partir du moment où il n’est plus possible de trancher entre le oui et le non au moyen de réflexions purement rationnelles. […] On est là dans le plurivoque, avec des solutions en nombre presque infini, dont aucune n’est la bonne, mais dont chacune doit être bonne […][26]
Le rapport de la littérature à l’éthique est paradoxal : le problème de la vie juste ne trouve de solution que dans ce qui ne peut pas lui en donner, justement parce que l’art ne peut pas lui en donner. La littérature est la seule à pouvoir assumer ce problème, dans la mesure où elle ne cherche pas à lui donner la solution, puisqu’elle ne le peut pas. Que fait-elle alors ? Elle multiplie les solutions, en substituant à « la » bonne solution « de » bonnes solutions (et l’on pourrait ajouter qu’elle montre aussi les mauvaises solutions). Pour reprendre une expression qui revient souvent dans L’Homme sans qualités comme dans les Essais, la littérature n’offre que des solutions partielles au problème de la vie juste.
Il faut donc bien mesurer ce que l’on attend de la description d’une vie en éthique, et notamment de la description littéraire d’une telle vie. D’un côté, elle est bien une solution : elle joue un rôle en éthique par les réactions qu’elle suscite et surtout par les vies bonnes qu’elle présente. Mais d’un autre côté, elle ne propose que des solutions partielles, des vies bonnes au lieu de la vie juste.
Pour ce dernier couple d’article du dossier, nous vous proposons « un dialogue dans le dialogue », c’est-à-dire un dialogue critique entre les deux contributeurs ayant traité la relation de Wittgenstein et Kierkegaard.
Je tiens tout d’abord à remercier Pierre Fasula pour la clarté et la qualité de son propos. Travailler sur cette relation entre Wittgenstein et Kierkegaard n’est pas chose aisée d’autant plus que le matériau autorisant les rapprochement entre les deux philosophes (les carnets personnels) doit être manipulé avec précaution. Je ne parlerai pour ma part que de ce qui est dit du rapport entre Wittgenstein et Kierkegaard, du fait de mon peu de compétence sur la pensée de Musil et la qualité manifeste de ton propos à ce sujet.
Ce que tu dis, dans le second moment de l’article, sur les réactions est extrêmement éclairant, en particulier ton hypothèse sur le rôle joué par l’esthétique en éthique « notamment dans cette manière de présenter une vie, au sens où c’est cette manière qui permet les réactions et donc ce déblocage de la vie ». Et la manière dont tu montres que Kierkegaard donne à voir ces vies possibles permet de mieux comprendre cette articulation entre éthique et esthétique. Tu mets bien en valeur le fait que pour Kierkegaard comme pour Wittgenstein, ces considérations visent directement le « problème de la vie ».
Ton diagnostic concernant l’agacement (partagé par Musil) de Wittgenstein sur la position d’auteur de Kierkegaard et « plus précisément, [son] déplaisir voire [sa] répulsion à l’égard du ton taquin de Kierkegaard réside dans l’esthétique de ce dernier » est juste. En effet, ce qui pose « problème aux yeux de Wittgenstein, c’est que si d’un côté la taquinerie a pour fonction de confronter le lecteur à l’éthique, de l’autre, l’esthétique dans laquelle s’exprime cette taquinerie va dans le sens contraire ».
Même si ce que tu dis de la portée de la critique wittgensteinienne de l’ironie est vraie, on pourrait en un sens le lui reprochait. Bien sûr, Kierkegaard espère justement : « Quand viendra le lecteur ami, il n’aura pas de peine à voir que lorsque je passais pour être ironiste, l’ironie n’était nullement là où le croyait un honorable public cultivé ; […] il verra que l’ironie consistait en ce que chez cet auteur esthétique et sous son “Erscheinung” [apparence] de mondanité se cachait l’auteur religieux » (Point de vue explicatif de mon œuvre d’écrivain. p. 45). Que « l’ironie a[it] tendance à nous détourner de l’éthique, à susciter en nous des sentiments qui ne sont pas vraiment moraux » est vrai, mais il me semble que l’usage de l’ironie chez Kierkegaard, qui opère le passage de l’esthétique à l’éthique chez lui, est un appel à une prise de conscience. C’est en ce sens qu’il y a une origine socratique à son usage de l’ironie.
Wittgenstein, de la même manière, n’apprécie pas ce procédé socratique. Dans les RM, il avance : « Quand on lit dialogues socratiques, on a le sentiment d’un effroyable gaspillage de temps ! A quoi bon ces arguments qui ne prouvent rien et n’éclaircissent rien ? » (p. 26)
Ou encore : « Socrate qui réduit toujours le sophiste au silence, le réduit-il à bon droit au silence ? – Certes, le sophiste ne sait pas ce qu’il croyait savoir ; mais il n’y a là aucun triomphe pour Socrate. Il ne peut pas s’écrier : “Tu vois ! Tu ne le sais pas ! », ni, d’un ton triomphal : « aucun de nous ne sait donc rien” » (p. 74).
Mais cela n’est pas là le but de Socrate, qui cherche, en menant son interlocuteur à un paradoxe, à lui faire prendre conscience « qu’il ne sais pas ce qu’il veut (vraiment) dire, et qu’ainsi il ne s’est pas connu lui-même et donc n’a pas connu le monde » pour reprendre Cavell (Dire et vouloir dire pp. 122-3). Socrate cherche à provoquer une prise de conscience chez son interlocuteur.
Somme toute, Wittgenstein reproche à Kierkegaard son succès et le fait que cette tromperie inspire du ressentiment. La critique du mode (esthétisant) d’exposition (et de progression dans les) des problèmes ne s’attache pas qu’à lui. Au fond, c’est un problème plus large que celui de l’articulation de l’esthétique et de l’éthique qui est ici visé par Wittgenstein, c’est celui du mode d’exposition propre à la philosophie.
Pour en rester sur cette question de l’ironie, il est frappant que Wittgenstein parle de « taquinerie » et non pas d’ironie dans la première citation que tu fais des CCS. C’est par le truchement des éditeurs qu’il parle d’ironie rapportée à Kierkegaard. De même, dans les RM on trouve deux mentions à « l’ironie » mais elles sont rapportées à la musique (p. 72 et 101) et j’avoue ne pas trop comprendre cet usage…
Il me semble qu’il y a quelque chose de flottant dans la critique de l’ironie kierkegaardienne chez Wittgenstein et qui vise autre chose que le propos kierkegaardien. En fin de compte, et peut-être de manière plus grave, ce n’est pas tant son ironie mais son style qui lui ai reproché, entendu ici comme les stratégies du dire, du comment on dit et non pas ce qu’on dit. Le style, qui est une question thématisée par Wittgenstein, est également au centre de la réflexion kierkegaardienne. Comme le souligne, V. Delecroix (Singulière philosophie, essai sur Kierkegaard, pp. 46-47.) :
« Si Kierkegaard s’intéresse à ce que disent les philosophes, c’est avant tout en observant de façon critique comment ils le disent, comment ils parlent – et ce qu’ils sont eux-mêmes quand ils le disent. Ce qui est important, et négligé par la philosophie “classique” (achevé par la spéculation), c’est le style. Et c’est par le style qu’ils seront d’abord jugés, les contenus de leurs propositions renvoyés à la forme dans laquelle ils sont exprimés, laquelle trahit en définitive toujours la personne du locuteur ». Kierkegaard avance que « la forme du penseur subjectif, la forme de sa communication, c’est son style » (PS, p. 302).
On trouve des remarques similaires, chez Wittgenstein ; par exemple : « “Le style c’est l’homme.” “Le style c’est l’homme même.” La première expression est pauvre par sa brièveté épigrammatique. La seconde, correcte, ouvre une toute autre perspective. Elle dit que le style est l’image de l’homme » (RM, 1949, p. 98) ; ou « Tu dois admettre les défauts de ton propre style. À peu près comme les imperfections de ton propre visage » (1948, p.95).
C’est pourquoi on peut comprendre l’agacement de Wittgenstein face à la « taquinerie de Kierkegaard », car comme tu le montres bien si « la présentation d’une vie peut permettre de débloquer la vie, dans la mesure où ce qui est présenté l’est sous la forme de la possibilité, et se trouve donc être une possibilité pour celui dont la vie est bloquée », cette présentation doit être en un sens « honnête ». C’est justement parce que Wittgenstein trouve aussi des résonnances entre sa pensée et les remarques kierkegaardiennes sur le style, qu’il me semble qu’il est agacé, et non pas tant par l’effet inverse que celui, souhaité, qui devrait être induit par l’ironie.
Delphine Dubs
[1] Musil, Journaux I, Paris, Seuil, 1981, p.577.
[2] Musil, Journaux II, Paris, Seuil, 1981, p.428.
[3] Musil, Essais [E], Paris, Seuil, 1978, p.83.
[4] Drury, Conversations avec Ludwig Wittgenstein, Paris, PUF, 2002, p.60.
[5] Wittgenstein, Carnets de Cambridge et de Skjolden [CCS], Paris, PUF, 1999, p.83.
[6] CCS, p.107.
[7] CCS, p.112.
[8] Déjà cité.
[9] CCS, p.57.
[10] Kierkegaard, Post-scriptum aux Miettes philosophiques [PS], Paris, Gallimard, 1949, p.339.
[11] CCS, p.61.
[12] Wittgenstein, Recherches philosophiques [RP], Paris, Gallimard, 2004, p.96.
[13] Wittgenstein, Leçons et conversations [LC], Paris, Gallimard, 1992, p.37.
[14] CCS, p.61.
[15] Wittgenstein, Remarques mêlées [RM], Paris, GF, 2002, p.84.
[16] RP, p.97.
[17] PS, p.212-214.
[18] PS, p.216.
[19] PS, p.241.
[20] Ibid.
[21] Ibid.
[22] Ibid.
[23] Musil, L’Homme sans qualités, tome II [HSQII], Paris, Seuil, 1956, p.274.
[24] Musil, L’Homme sans qualités, tome I [HSQI], Paris, Seuil, 1956, p.320-321.
[25] Ibid.
[26] E, p.328-329.