Recension – Hard Modernity
Recension Hard Modernity
Bertrand Cochard, ATER, Université de Sophia Antipolis / Université Côte d’Azur.
Il s’agit d’une recension du livre d’Aldo Haesler, Hard Modernity. La perfection du capitalisme et ses limites, Paris, Éditions Matériologiques, coll. « E-conomiques », 2018. Vous pouvez trouver l’ouvrage sur le site de son éditeur en cliquant ici.
Dans Hard Modernity. La perfection du capitalisme et ses limites, Aldo Haesler entend proposer une interprétation entièrement nouvelle du processus occidental de modernisation, fondée sur l’idée d’une transformation de la nature de l’échange marchand, c’est-à-dire d’une transformation dans la manière qu’ont eue les sociétés occidentales de considérer cet échange. L’argent – envisagé non pas comme un simple « moyen de paiement, mais comme [une] force de structuration[1] » des rapports sociaux – constituerait en ce sens l’agent principal de ce processus, ou le prisme privilégié pour expliquer son origine, son développement et son horizon.
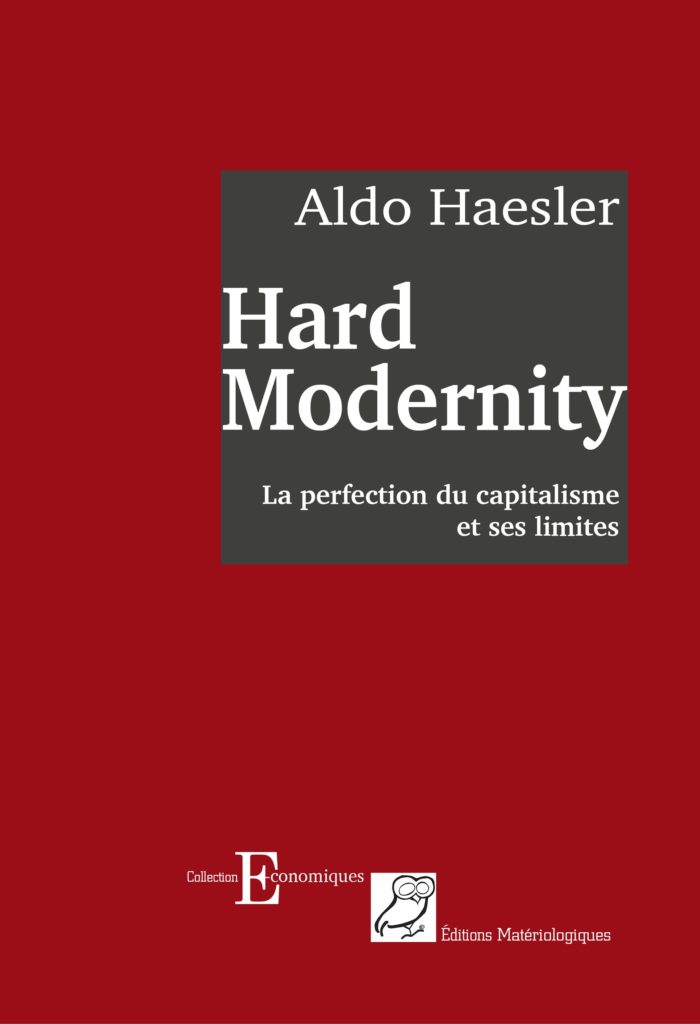 Convoquant pour ce faire une théorie relationnelle du changement social, sur laquelle on reviendra, l’auteur indique que son propos consiste à « montrer que la modernité n’est rien d’autre et rien de plus qu’une nouvelle grammaire sociale, c’est-à-dire une manière de mettre en rapport les choses de ce monde et le monde en adéquation avec ces choses[2] », ou encore consiste toute entière dans le passage d’une grammaire sociale ancienne fondée sur « l’échange à somme nulle » à une grammaire sociale moderne fondée quant à elle sur « l’échange à somme positive ». Dans la lignée de l’anthropologue Louis Dumont – ayant été le premier à avoir identifié cet « “élément idéologique de base”[3] », celui du jeu à somme positive, constitutif de la transformation sémantique moderne –, de l’historien Fernand Braudel – de son idée d’un long seizième qui verrait progressivement se consolider une modernité capitaliste – et du sociologue Georg Simmel, Aldo Haesler entreprend de rendre compte des conséquences historiques et anthropologiques de cette transformation, et offrir en même temps un nouveau prisme pour comprendre la crise actuelle.
Convoquant pour ce faire une théorie relationnelle du changement social, sur laquelle on reviendra, l’auteur indique que son propos consiste à « montrer que la modernité n’est rien d’autre et rien de plus qu’une nouvelle grammaire sociale, c’est-à-dire une manière de mettre en rapport les choses de ce monde et le monde en adéquation avec ces choses[2] », ou encore consiste toute entière dans le passage d’une grammaire sociale ancienne fondée sur « l’échange à somme nulle » à une grammaire sociale moderne fondée quant à elle sur « l’échange à somme positive ». Dans la lignée de l’anthropologue Louis Dumont – ayant été le premier à avoir identifié cet « “élément idéologique de base”[3] », celui du jeu à somme positive, constitutif de la transformation sémantique moderne –, de l’historien Fernand Braudel – de son idée d’un long seizième qui verrait progressivement se consolider une modernité capitaliste – et du sociologue Georg Simmel, Aldo Haesler entreprend de rendre compte des conséquences historiques et anthropologiques de cette transformation, et offrir en même temps un nouveau prisme pour comprendre la crise actuelle.
En effet, il ne s’agit pas simplement, dans cet ouvrage, de penser la modernité à partir d’un nouveau paradigme, mais de pointer du doigt, à l’intérieur de la modernité elle-même, le franchissement d’un seuil dans les années 1970. Selon l’auteur, alors que la modernité offrait encore, avant les années 1970, des portes de sortie, des alternatives, les possibilités donc d’une bifurcation dans le cours de l’histoire, elle aurait désormais atteint un régime hard, un « niveau structural[4] », métastable, interdisant tout espoir de sortie ou même simplement de réforme profonde du système capitaliste. Avec la dématérialisation de l’argent, stade ultime de son « devenir-médium », le capitalisme aurait atteint sa forme parfaite. Comme le résume l’auteur :
[…] nous croyons que dans les premières années 1970 un seuil a été franchi, d’une modernité douce à un régime que nous qualifierions de hard : douce, en ce qu’elle admettait encore des réformes, des alternatives, des échappées, des utopies concrètes, alors que ce seuil une fois franchi, il ne reste que le travail froid de l’observation et de l’analyse d’un système que plus rien, aucune guerre, aucune crise, aucune pandémie, aucun tremblement de terre, ne semble pouvoir ébranler. D’autre part, nous avons à présent les moyens de faire ce travail, car l’irréversibilité de l’ordre moderne capitaliste nous permet enfin de prendre la mesure de son événement […].[5]
***
Bien évidemment, la thèse radicale que défend Aldo Haesler dans cet ouvrage, qu’il présente comme la clôture d’un triptyque, un « travail de synthèse » issu d’une « lente maturation[6] », est polémique, et exige pour l’auteur de justifier un certain nombre de partis pris épistémologiques radicaux qui ne manqueront pas, comme il l’anticipe lui-même dès le premier paragraphe de l’« Avant-propos », de susciter le débat. On ne saurait proposer ici une liste exhaustive des points polémiques de ce travail, mais on peut néanmoins s’efforcer d’énoncer ceux qui devraient donner lieu aux discussions les plus vives :
1. Puisque Aldo Haesler choisit d’ériger l’argent en principe explicatif fondamental du processus de modernisation, il va de soi que ce choix impliquait pour lui, non seulement de dissocier, méthodologiquement, la sphère de la circulation de celle de la production, mais aussi et surtout de conférer le primat à la première par rapport à la seconde. Le paragraphe dans lequel il défend cette conception circulationniste mérite d’être cité dans son intégralité :
L’argument circulationniste qui sous-tend notre propos peut se résumer en deux thèses : 1° pour produire, il faut un mobile. Ce mobile n’est ni d’ordre technique, ni psychologique, ni éthique, ni économique : il est sociologique. Il correspond à une grammaire spécifique des échanges (qu’on se souvienne de Rodbertus cité par McLuhan). Bref, la sphère productive, ce qu’on produit et comment on le produit, n’est pas déterminante en dernière instance ; son expression est la conséquence de la sphère de la circulation sociale propre à telle ou telle période. Et 2° cette production, une fois enclenchée, va créer une réalité nouvelle, elle va donner forme à la logique des échanges qui l’a créée et ainsi l’accréditer pour former une boucle performative entre production et circulation.[7]
De nombreuses pages sont ainsi consacrées à la réfutation de la conception « marxiste » – catégorie dont il a d’ailleurs tendance à surestimer l’homogénéité – de l’histoire. En faisant l’économie d’une véritable critique de ce modèle – critique qui exigerait qu’il confronte par exemple ses thèses à celles défendues en ce moment par la « Nouvelle Critique de la Valeur » –, Aldo Haesler rejette l’idée qui sous-tend le marxisme « traditionnel », à savoir celle selon laquelle le changement social pourrait être expliqué par les contradictions historiques entre forces productives et rapports sociaux ;
2. Plus largement, c’est toute l’interprétation de la modernité comme produit de la transformation du rapport entre l’homme et la Nature du fait de l’émergence des techniques modernes que l’auteur rejette. Renvoyant dos-à-dos la théorie heideggérienne de l’arraisonnement, l’identification d’une dialectique de la Raison et du Mythe propre à l’analyse d’Adorno et Horkheimer, et en général toutes les théories critiques qui entendaient présenter le tournant moderne en vertu de l’idée d’une colonisation technique, et non monétaire, des rapports sociaux – et on regrette ici qu’il n’accorde pas plus de crédit à un auteur comme Jacques Ellul –, Aldo Haesler en vient à conclure que « tous les philosophes qui ont pensé la technique, et l’histoire en fonction d’elle, l’ont fait parce qu’ils n’ont pas réussi à penser l’histoire[8] » ;
3. Parmi les sociologues, nul doute non plus que la conception relationnelle du changement social dont il entend ici démontrer la fécondité suscitera des polémiques. En effet, comme il l’écrit, non seulement cette conception exige de redonner à la sociologie une ambition historique – « Quand un sociologue entend interroger le changement social, il conçoit, qu’il le veuille ou non, une théorie de l’histoire[9] » –, mais implique de proposer, contre la sociologie d’inspiration bourdieusienne privilégiant les mécanismes de reproduction, une « lecture inverse [qui] partirait de la formule : R= f(CS) ; formule qui dirait en substance ceci : essayons de penser le changement social comme normalité et la reproduction, la stabilité, comme l’exception. Pourquoi cette formule ? Non par esprit de contradiction, mais en raison du fait que ce qui distingue la modernité fondamentalement de toutes les autres formes de société, c’est cette soumission au changement, cette intranquillité ou cette in-quiétude permanente qui semble la caractériser[10] ».
***
L’ouvrage est composé de quatre grandes parties, avec un total de douze chapitres.
La première (« Présentation ») et la deuxième (« Méthode et terrain ») ont essentiellement une ambition épistémologique. Aldo Haesler y justifie la pertinence de son approche – celle de concevoir le changement social dans une perspective relationnelle –, la thèse sur la modernité à laquelle cette approche a donné lieu – l’identification de l’argent comme médium, d’abord privilégié, puis unique de mise en relation des individus suite à l’effondrement des valeurs et croyances productrices de lien social dans les sociétés traditionnelles – et la différence de cette lecture avec les trois grandes autres conjectures actuelles sur notre situation vis-à-vis de la modernité (posthistoire, surmodernité et postmodernité). Sa propre conjecture, qu’il qualifie de protomoderne, prend en effet le contrepied de tout ce qui a été pensé jusqu’ici à propos du processus de modernisation : l’achèvement de ce processus est récent, et si la modernité a toujours fonctionné comme un « mode de civilisation[11] », ce n’est que depuis peu que l’on est susceptible de constater, avec désespoir ou non, qu’elle est devenue irréversible.
C’est probablement dans le chapitre 3 (« Esquisse d’une théorie relationniste du changement social ») que l’on peut se faire l’idée la plus claire de la méthode d’Aldo Haesler. Ce chapitre fonctionne en effet comme un chapitre de positionnement, de défense par illustration de la fécondité heuristique de cette théorie relationniste, par rejets successifs, non seulement d’autres types d’approche (individualisme, holisme etc.) mais de références cardinales ou classiques de la sociologie – rejet qui le conduit à faire de la sociologie bourdieusienne une sociologie uniquement pertinente pour penser les sociétés traditionnelles. On trouve en outre dans ce chapitre un exposé détaillé du « modèle pentagonal » qui caractérise l’approche relationniste, modèle sans lequel il est difficile de se repérer dans cet ouvrage, qui entend justement le mettre à l’épreuve, notamment dans la confrontation qu’il propose entre sociétés traditionnelles et sociétés modernes. L’auteur présente ce modèle, et ses enjeux, de la manière suivante :
Un modèle sociologique élémentaire doit comprendre au moins trois éléments : les humains (H), les collectifs (C) et leurs environnements et constituants matériels (N, comme nature). Si l’on croise ces trois éléments, on obtient 5 rapports (en éliminant le rapport N-N qui n’entre pas dans le cadre d’une sociologie). Ces 5 rapports, à savoir (H-H), (H-C), (C-C), (C-N), (H-N), couvrent tous les rapports imaginables à l’œuvre dans la société humaine.[12]
Mais le chapitre 3 entend également répondre à une question plus générale, qui concerne le statut épistémologique même de la sociologie : comment la sociologie peut-elle gagner ses lettres de noblesse, et s’affirmer « dans le canon des disciplines des sciences humaines[13] » ? Là encore, la thèse avancée par Aldo Haesler est radicale. Selon lui, la sociologie est fondamentalement une science moderne, ou plus exactement une science issue des exigences et défis posés par le tournant moderne. Si, comme on le précisera, la modernité constitue le moment d’une rupture, l’effondrement d’un ordre traditionnel assuré par un principe transcendant, comment penser un ordre social possible ? On pourrait résumer sa thèse dans la formule suivante : il fallait que Dieu meure (ou s’absente) pour que la sociologie naisse.
C’est sur le fond de cette thèse – le tournant moderne consiste dans la réinstauration d’un ordre, la volonté de retrouver un ordre, « un habitat, un écoumène, un sol de certitude qui puisse rendre la vie possible[14] » dans un monde qui, suite à « l’ouverture du ciel par les astronomes[15] » n’en offre plus – que s’ouvre la troisième partie. Comment, pour reprendre la notion qu’il construit, s’est opérée la « repristinisation[16] » d’un monde livré à l’angoisse métaphysique du désordre ? Remobilisant des éléments développés dans le chapitre 4 (« Une période de seuil : la Grande transformation »), et pour mieux faire comprendre, par contraste, ce qu’il dira des sociétés modernes, l’auteur, à partir d’une analyse du fragment d’Anaximandre, entreprend un long travail de reconstruction des étapes qui ont conduit au tournant moderne. Comment décrire au mieux l’ordonnancement des sociétés traditionnelles ? En quoi peut-on lire, dans « les cosmologies traditionnelles » avec l’idée de « clôture de l’espace, [de] finitude des ressources, [de] hiérarchie des étants[17] » une grammaire sociale spécifique, fondée sur l’idée d’un jeu à somme nulle ? En d’autres termes, y a-t-il un fondement ontologique et cosmologique de la manière de se représenter l’échange marchand ? C’est ce qu’Aldo Haesler défend : « Dans cette finitude, la nouveauté apparaît toujours au détriment d’un étant qui disparaît […]. Toute émergence se paie par un sacrifice. Ce qui est certain, c’est que ce principe universel de justice ne laisse aucun crime impuni, aucune disparition sans contrepartie[18] ». À l’œuvre dans le fragment d’Anaximandre, c’est donc toute la forme de l’échange dans les sociétés traditionnelles qui peut être lue, et qu’il est donc possible, selon l’auteur, de comprendre la logique fondamentale de l’échange conçu comme jeu à somme nulle : « à un déséquilibre séquentiel » – dans l’échange traditionnel, une partie gagne, l’autre perd – « correspond un équilibre temporel[19] ». À l’intérieur d’un monde dont les ressources sont conçues comme finies, dans lequel à chaque disparition d’une chose correspond l’apparition d’une autre, selon une logique de transformation et de compensation permanentes et au sein duquel, enfin, chaque chose, chaque être, a sa nature, son lieu, son essence propres, aucune fiction possible d’un profit marchand conjoint. Seule la relation érotique, en somme, est pensable sur le modèle du « win-win ».
Si tel est le cas, qu’est-ce que la modernité ? « notre thèse sera que la modernité naît de la possibilité de penser le jeu à somme positive autrement que dans sa représentation érotique[20] ». C’est ici que réside fondamentalement, selon Aldo Haesler, l’entrée dans le monde moderne : à une rupture ontologique a correspondu une transformation de la grammaire sociale, dans laquelle le « win-win », d’exception qu’il était, est devenu « fait social total[21] ». En quoi cette conception de l’échange consiste-t-elle ? Alors que dans les sociétés traditionnelles, le déséquilibre produit par l’échange appelait une compensation – c’est la logique de la dette, à l’intérieur d’un ordre statique – l’échange dans la grammaire moderne repose sur l’illusion, ou la fiction, qu’un échange pourrait être autre chose qu’une relation dans laquelle l’un des pôles se trouve nécessairement lésé. L’échange marchand moderne est pensé comme un rapport de bénéfices mutuels, dans lequel chacun, pour ainsi dire, trouve son compte – sur le modèle de la relation entre un boucher et son client théorisée par Adam Smith ou encore de la fable des abeilles de Mandeville, deux références sur lesquelles Aldo Haesler revient d’ailleurs à plusieurs reprises. C’est donc, fondamentalement, cette conception nouvelle de l’échange qui inaugure la modernité, si bien que « la monétarisation n’est pas une condition, mais une conséquence de la formation de ce champ. Il y a d’abord formation de champ sémantique, puis échange à somme positive, puis émergence de l’argent moderne, et non l’inverse[22] ».
Quels sont les défis qui se posent à la sociologie relationnelle dans ce cadre ? On peut, avec Aldo Haesler, en dégager au moins deux :
Si l’échange marchand ne participe plus à la reproduction d’un ordre social spécifique ; s’il est au contraire conçu comme fonctionnel et dynamique[23] ; si, enfin, il est caractérisé par une logique d’accumulation, comment l’ordre moderne auquel il donne lieu peut-il disposer d’une stabilité relative ? Pourquoi y a-t-il ordre plutôt que désordre ? En convoquant le modèle pentagonal explicité au chapitre 3, l’auteur entreprend de rendre compte de l’organisation des sociétés modernes selon les 5 rapports possibles que ce modèle permet de penser – l’une des thèses principales du livre étant justement que le seuil des années 1970 consiste formellement dans le « passage de l’homologie des rapports du pentagone moderne à l’état de structure[24] », comme on l’a déjà mentionné. C’est l’objet du chapitre 9 : « Le système de la modernité, une reconstruction » ;
Si l’échange marchand pensé comme jeu à somme positive est bien une fiction – au sens où par exemple, dans un monde dont les ressources sont limitées, aucune transaction ne peut avoir lieu sans qu’un tiers ne soit en même temps privé de ce bien – comment comprendre le crédit accordé à cette fiction ? Le chapitre 10 se propose d’analyser la manière dont ont été construites les conditions sans lesquelles une représentation sociale de l’échange comme jeu à somme positive aurait été impossible. Mentionnons-en ici deux : « la fiction des ressources infinies[25] », caractéristique de l’hybris, de la consommation/consumation moderne des biens privatifs, et l’invisibilisation du tiers lésé.
***
Outre les éléments qui ont déjà été mentionnés, et dont on imagine, comme l’auteur lui-même, qu’ils ne manqueront pas de susciter le débat, on peut opposer à cet ouvrage une critique qui, touchant à la forme, est en même temps une critique qui peut porter sur le fond. Un philosophe ne peut qu’être gêné en tombant sur certaines formules lapidaires consistant à écarter certaines théories : on apprend ainsi qu’il n’y a « pas d’accès purement phénoménologique aux choses de ce monde[26] » ; que la théorie du changement social convoquant le concept de totalité n’a jamais abouti à une « réponse concluante[27] » et que « Sartre y perdit même la vue, sinon la raison[28] » ; que selon le « schéma marxien[29] » la contradiction entre forces productives et rapports sociaux « débouchera “inéluctablement” sur une révolution[30] » ; que la « fameuse question “Que faire ?” de Lénine est l’une des plus naïves, sinon des plus stupides de l’histoire de la pensée politique[31] » ; ou enfin qu’un « petit monsieur bien malin du nom de René Descartes » a appelé « cogito » la « faculté de douter[32] » etc. On comprend bien qu’il y va ici du style d’Aldo Haesler, qui n’hésite pas sortir des carcans de la prose académique – ce qui en soi n’est pas un mal. Mais de toute évidence cela le conduit parfois, au mieux à des critiques qui ne peuvent rester que superficielles, au pire, comme c’est le cas par exemple pour le cogito cartésien, à des contresens – le cogito n’étant pas identifiable à la faculté de douter. Les facilités qu’il s’accorde dans le style lui font également écrire :
Certes, la belle construction lukacsienne eut l’avantage de sauver l’idée de praxis révolutionnaire, mais en retour elle inocula à tout le néomarxisme occidental un élément idéaliste – la prise de conscience – qui lui permet de théoriser les divers obstacles à cette prise de conscience (troisième classe, culture industrielle, société du spectacle, reproduction d’habitus, etc.) comme autant d’ajournements possibles du Grand soir. […] la « théorie » de la marchandisation postule implicitement, qu’à partir du moment où une telle conscience est possible, son dévoilement permettrait aussitôt son dépassement. Tout se passe comme si pour transcender l’ordre marchand, les acteurs devaient prendre conscience de sa logique pathologique et aussitôt « changer la vie ». Lointain avatar de l’« élément idéaliste » lukacsien, le théorème de la marchandisation reproduit ainsi sur un plan réformiste, voire même libéral, les mêmes structures argumentatives et donc les mêmes illusions que son ancêtre révolutionnaire. Il y a donc lieu d’en faire la critique de manière radicale et urgente, et ce d’autant plus qu’il représente un redoutable obstacle-mot-valise épistémologique qui fait mine de tout expliquer, alors qu’il ne cesse de tout obscurcir.[33]
Or, on trouvera difficilement chez Lukács, et encore moins chez Karl Korsch ou Guy Debord, l’idée qu’une prise de conscience suffirait à renverser l’ordre social – ces trois auteurs, comme d’autres, s’efforçant en effet, contre la théorie de la « conscience-reflet » notamment, de faire émerger une relation de type dialectique entre la conscience et le social. Et, encore une fois, si la critique de la théorie de la marchandisation est au programme, elle exige que soient prises au sérieux les thèses récentes de la Wertkritik, dont on peut en effet difficilement dire qu’elles éludent les enjeux fondamentaux posés par l’analyse marxienne de la marchandise.
Aldo Haesler insiste également à plusieurs reprises sur le souci qu’il a eu d’appliquer à toutes ses théories le rasoir d’Ockham, autrement dit que « [l]e propre (et la supériorité épistémologique) d’une méthode relationnelle est d’économiser les concepts[34] ». Or, la lecture du texte nous semble considérablement alourdie par la convocation ou la création de nombreux concepts et néologismes dont Aldo Haesler ne prend pas toujours la peine d’expliciter la légitimité heuristique : métaconscience, repristinisation, horsolisation, hyperfétichisme, déréciprocation, sympathétisme etc. Il appartiendra à chaque lecteur d’en évaluer la nécessité.
***
Hard Modernity d’Aldo Haesler offre ainsi un panorama général, presque une « somme », sur la modernité. Du fait de cette ambition, l’ouvrage prête bien entendu à la critique, mais a le mérite de proposer et de défendre une thèse originale, clairement énoncée et contribuant sans aucun doute à une meilleure compréhension du processus de modernisation. Que ce processus puisse être entièrement expliqué par un changement de grammaire sociale est contestable, mais c’est encore l’auteur qui justifie le mieux l’intérêt d’un tel ouvrage :
On en mesure la difficulté. Mais au moins va-t-on inciter à la réfutation, et si l’exercice se révèle un tant soit peu probant, une chance de faire bouger les lignes du débat pourrait s’esquisser. Nous le savons bien, ce ne sont pas la longueur ni la lenteur, et la difficulté du travail moins encore, qui peuvent en justifier l’ambition. C’est au contraire la richesse des réfutations qui pourraient s’ensuivre.[35]
[1] Aldo Haesler, Hard Modernity. La perfection du capitalisme et ses limites, Paris, Éditions Matériologiques, coll. « E-conomiques », 2018, p. 6.
[2] Ibid., p. 5.
[3] Ibid., p. 28.
[4] Ibid., p. 112.
[5] Ibid., p. 27.
[6] Ibid., p. 61.
[7] Ibid., p. 335.
[8] Ibid., p. 126.
[9] Ibid., p. 75.
[10] Ibid., p. 88.
[11] Ibid., p. 67.
[12] Ibid., p. 110.
[13] Ibid., p. 76.
[14] Ibid.
[15] Idem.
[16] Ibid., p. 220.
[17] Ibid., p. 18.
[18] Ibid., p. 239.
[19] Ibid., p. 30.
[20] Ibid., p. 14.
[21] Ibid., p. 39.
[22] Ibid., p. 37.
[23] Ibid., p. 341.
[24] Ibid., p. 459.
[25] Ibid., p. 386.
[26] Ibid., p. 44.
[27] Ibid., p. 84.
[28] Idem.
[29] Ibid., p. 87.
[30] Idem.
[31] Ibid., p. 24.
[32] Ibid., p. 298.
[33] Ibid., p. 464.
[34] Ibid., p. 361.
[35] Ibid., p. 5.














