Disparaître de soi
David Le Breton, Disparaître de soi, une tentation contemporaine, Paris, Editions Métailié, 2015.
Claudine Sagaert, Membre du Laboratoire Babel-EA 2649, Université de Lettres et Sciences Humaines, Toulon-Var, équipe « femmes et genre » axe S.H.S. et médecine.
Auteur de plus d’une trentaine d’ouvrages, l’anthropologue et sociologue David Le Breton, est professeur à l’université de Strasbourg et membre de l’Institut universitaire de France. Son dernier essai, Disparaître de soi, nous invite par-delà une phénoménologie de la blancheur à une réflexion sur les nouvelles formes d’être au monde et du monde. Quand être soi n’est plus que pénibilité, surgit contre toute attente, une volonté d’impuissance. Volonté qui n’est pas de l’ordre de la maîtrise, de la domination, de l’agir ou du faire, mais volonté d’absence de soi, volonté de devenir injoignable, volonté de se déprendre de soi. La blancheur, finalité de cette volonté d’impuissance, est l’état dans lequel des êtres échouent quand, à bout de ressources, ils démissionnent d’eux-mêmes, se déprennent de leur histoire, glissent, flottent et gomment tout héritage familial, culturel et social avant de renaître ou de se perdre.
La ligne directrice de cet ouvrage porte donc sur la pénibilité d’être soi. Pénibilité ressentie par des adultes qui se découvrent épuisés, dépressifs, ou excédés par une surcharge d’activité, par des jeunes dont le sens de l’existence est fragilisé, par des personnes âgées qui ne parviennent plus à se maintenir dans leur soi, par des individus qui, en quête d’un ailleurs, souhaitent se réinventer ou simplement se mettre entre parenthèse. Ces nouvelles manières de se déprendre de soi, ouvrent toutes sur l’expérience de la blancheur. Par celle-ci, le sujet inaugure alors un autre type de rapport au temps. L’instant (sans mémoire, sans projet), le présent sans présence, (être en vie sans exister) et la circularité (la répétition des mêmes actes) en sont les principaux modes. Ce rapport à la temporalité peut être soit une brèche réorganisant ce qui est « à venir » soit un trou laiteux renvoyant à un vide, un blanc, une absence d’inscription dans la conscience. D’autre part, la blancheur s’ouvre également sur un rapport particulier à l’espace. Espace du dedans, dans lequel l’individu est verrouillé de l’intérieur, espace du dehors limité à la chambre d’hôpital ou au chez-soi, espace du lointain, ouvert sur des routes, des voyages, d’autres mondes. Dans ces différents types d’espace, l’individu ne rencontre plus ni les autres, ni lui-même, ni la société, ou s’ils les rencontrent c’est sous un tout autre rapport. L’individu est alors ce qu’il n’est plus.
Une volonté d’impuissance
L’individu contemporain est en partie son propre créateur. Sans cahier des charges, il doit se réaliser et « être à la hauteur » de ses naissances et renaissances (p. 14). Le lien social ne lui dicte pas ses orientations, il décide de la personne qu’il souhaite être et pioche dans les valeurs, celles qui lui correspondent le mieux. Tramée de multiples héritages conscients ou non-conscients, il s’enchevêtre dans les fils de son identité qui le relient à la société et aux autres. Dans cette quête de coïncidence, décousu, rafistolé, couturé, l’individu ne cesse de se réinventer un tissu d’être. Désorienté parfois, il se découvre autre que soi dans un ou de multiples « moi » qui ne sont pas tout à fait « lui ». Difficile identité donc, mais dans laquelle l’individu n’est pas immuablement enfermé comme « dans une forteresse solidement gardée ». Il « est toujours processus », il « ne cesse jamais de naître », il « n’est pas l’identique mais le passage » (p. 186-187). Par là même, « l’individu n’est jamais tout à fait l’auteur de son existence », comme l’ont montré Paul Ricœur et Ulrich Beck auxquels se réfère l’auteur, « il ne sait qu’en partie ce qu’il est et ce qu’il fait » (p. 188). Ainsi, on l’aura compris, « le maintien de l’identité ne coule plus de source, il est l’objet d’une lutte intérieure (…) chacun de nous est fait de bien plus d’imprévisible que de probable » (p. 190-192). La conscience du sujet, écrit David Le Breton, « n’est pas le phare toujours allumé pour éclairer de sa lumière persistante le monde environnant et le rendre vivable, parfois, elle s’éclipse » (p. 186). Cette éclipse, effet de sa volonté d’impuissance, n’a alors qu’une finalité, le soulager « de l’effort d’être soi » (p. 18).
N’être plus là pour personne, être dessaisi « de son existence », « dé-naitre », « se dépouiller des couches d’identité pour les réduire a minima, (…) [et] s’effacer avec discrétion », telle est cette entreprise qui consiste à disparaître de soi et à apprendre « à n’être plus rien », à « être en dehors du verbe être » selon les mots de Michel Leiris que cite David Le Breton (p. 23). Dévitalisé, l’individu se fuit lui-même, devient « hors de soi », une personne sans personnage, en un mot, un masque (p. 34). Dans cette « solitude ontologique », il transforme « le lien social en désert » et même vivant, il s’en fait l’absent (p. 25). Au final :
Cette figure de l’effacement (…) n’est pas une excentricité ou une pathologie, mais une expression radicale de liberté, celle du refus de collaborer en se tenant à distance ou en se soustrayant à la part la plus contraignante de l’identité au sein du lien social. (…) Ces existences sur le fil du rasoir (…) nous disent ce mélange de force et de fragilité inhérent au sentiment de soi, et le fait que l’on peut aussi se défaire de soi pour s’inventer autre quand la nécessité intérieure domine. (p. 50)
Les causes de la volonté d’impuissance
Outre la fragilité existentielle relative à une identité sur pilotis, les causes de la volonté d’impuissance sont multiples. Elles peuvent renvoyer à des événements douloureux tels que des séparations, des décès, des difficultés financières, mais elles peuvent aussi être directement en lien avec la réalisation de soi, le désir de reconnaissance, les exigences toujours plus nombreuses de la société actuelle. Par exemple dans le monde contemporain, l’individu est confronté à l’effacement de la frontière entre le domaine privé et le domaine public. Son activité professionnelle, par le biais de l’ordinateur portable ou du téléphone cellulaire, le somme de toujours répondre présent et d’être toujours opérant. Dans le train, en avion, à l’hôtel ou simplement chez lui, il doit se tenir connecté ou connectable. Ainsi comme le développe David Le Breton, « la contrainte ne pèse plus sur le corps mais sur les esprits, il n’y a plus de surveillance mais un autocontrôle permanent, une disponibilité sans repos » (p. 62). Disponibilité dont s’absout d’ailleurs le système « de toute accusation de violence » dans la mesure où elle est acceptée par les acteurs (p. 63). Cet autocontrôle sans surveillance caractérise donc une société dans laquelle l’individu est rarement contraint, mais par l’effet de la microphysique du pouvoir dont Michel Foucault a développé les rouages, l’individu intègre des mécanismes qui le conduisent à devenir son propre despote. Toujours « en excès » selon le terme de Robert Castel, l’individu s’oblige à aller « de plus en plus vite pour rester sur place » (p. 62). En conséquence, comme l’écrit Christophe Dejours que cite David Le Breton, plus les individus « donnent d’eux-mêmes, plus ils sont « performants » et plus ils font du mal à leurs voisins de travail, plus ils les menacent du fait même de leurs efforts et de leurs succès ». « Saoulé de travail », sous « amphétamine de l’action » selon l’expression de Nicole Aubert, l’individu est propulsé dans « une sorte de fuite en avant pour ne pas regarder l’abime » (p. 65). Piles électriques que l’on ne peut plus débrancher, « ils pètent les plombs » selon les propos de Nicole Aubert. Ces pathologies du travail trouvent peut-être au Japon leur forme extrême, si on en juge par le nombre de mort subite par arrêt cardiaque de salariés âgés d’à peine 30 ans. Ainsi donc, si le monde du travail génère souvent, surmenage et dépression, l’individu vidé, « expulsé de sa vie » est alors résumé à une « caricature malheureuse » de lui-même (p. 68-71).
Les différentes formes de la disparition de soi
Quand être éveillé fait mal, s’éteindre en dormant est une alternative qui permet de s’éclipser. Dormir est alors un baume calmant qui cicatrise, pour un temps du moins, les plaies de la pensée. Le sommeil ne devient pas seulement « repos, mais répit », et l’épuisement, distingué de la simple fatigue, décharge « de la peine d’être soi » dans la consommation boulimique de sommeil (p. 53-59). Contrairement à l’insomniaque qui « épinglé à lui-même », s’empêtre dans le ruminement et peine à trouver cette possible recherche de quiétude, le sommeil, « petite mort » ou « mime de la mort », peut être « une force renouvelée », une nouvelle naissance (p. 55-56).
Si dans le chapitre 2, l’auteur analyse les formes contemporaines de cette disparition de soi à partir de quelques-unes de ces facettes : le sommeil, la dépression, l’autisme collectif, le burn out, dans le chapitre 3, il aborde les figures de la disparition de soi à l’adolescence. Dans ce cadre, David Le Breton rappelle que si une grande majorité des jeunes sont épanouis et sans réelles difficultés existentielles, ce sont toutefois 15 % d’entre eux qui adoptent des conduites à risques. La consommation de substances comme l’alcool, la drogue ou la prise de médicament en est un des aspects. Elle révèle un « malaise diffus » une « démission de soi », une « grève de toute responsabilité », un moyen de « se quitter soi-même pour échapper à l’obligation de penser ». Quand le jeune « est la seule personne qu’il ne voudrait pas être », il cherche alors à « se débarrasser de soi pour échapper aux pressions d’une identité intolérable » (p. 79- 87).
Ne plus être fils ou fille de, changer de nom, partir sur des chemins de traverse, se couper du monde, se créer un monde à soi, se situer dans un « contre monde » ou se gommer soi-même en entrant dans une secte ou une communauté intégriste, telles sont certaines autres formes de la volonté d’impuissance (p. 102-105). On peut aussi leur relier les conduites anorexiques dont le vouloir est celui, non pas d’un corps féminin ou masculin, mais d’un corps autre, un corps à soi (p. 114). L’auteur écrit : l’anorexie est une « critique par corps d’un modèle social du féminin (…). Elle est la mise en œuvre d’une ironie cruelle à l’encontre des discours sur la minceur. Elle en pousse la logique à son point extrême. Elle dit par son corps la souffrance des représentations qui s’imposent à elle » (p. 114).
Le point commun de ces conduites est la quête d’un « temps neutralisé, (…) pris en main par l’acteur qui joue en partenariat avec la mort ». Il s’agit en définitive de « se perdre délibérément pour ne plus se perdre, [de] reprendre le contrôle, même paradoxalement sous une forme homéopathique ». Par homéopathique, l’auteur renvoie à une manière d’avoir une emprise sur son existence, de se sentir exister en opérant une transformation sur son corps ou dans son existence. Mais comme le note David Le Breton « certains ne reviennent plus de cette exploration des gouffres » (p. 134).
Le quatrième chapitre aborde une toute nouvelle facette de la disparition de soi. Absence, « prélude à la mort », désertion, temps hors du temps qui mélange toute les conjugaisons ou même ne les conjugue plus, tel est le syndrome d’Alzheimer. Quand le passé n’existe plus, que l’avenir n’est plus un à venir, l’individu est englué dans le « gel de l’instant » (p. 144-146). Alors « la personne se détruit par impossibilité de continuer à être soi, elle élimine en elle les repères de sa reconnaissance individuelle et sociale et elle se dérobe à toute identification qui la fixerait dans une identité que désormais elle récuse à son insu » (p. 151). « Un lâcher prise sans retour », dans lequel la blancheur est une forme de deuil de soi sans décès, un tomber de rideau sur la vie encore vivante, un enfermement dans la muraille du soi (p. 151-156).
Dans la virtualité infinie de cette volonté d’impuissance, la quête de blancheur est aussi celle de l’individu qui en partant sans laisser d’adresse, veut changer de vie et parvenir à une renaissance loin de tout, y compris, paradoxalement parfois, de lui-même. Attraper « la clé des champs », pour « souffler un peu », être en « vacance de soi » et « recommencer ailleurs » ou s’offrir une nouvelle version de soi-même, telles sont les disparitions de soi qu’analyse David Le Breton dans le chapitre 5 de son ouvrage (p. 157-159). Même si « la disparition est une forme euphémisée du suicide », il s’agit là de « s’effacer sans mourir », de sauver sa peau (p. 165).
Ces disparitions sont à l’image de celles de Marojana, grand physicien spécialiste de physique quantique, de Chris McCandless, ce jeune américain dont le voyage sans retour a été biographié par Jon Krakauer et adapté au cinéma par Sean Penn, mais encore de celles de certains personnages littéraires comme celui de Mathias Pascal de Pirandello ou de Marco Stanley Fogg de Paul Auster.
La volonté d’impuissance comme renaissance
Alors qu’on pourrait penser que cette volonté d’impuissance est stérile dans sa forme, il n’en est rien. Elle est paradoxalement aussi une extraordinaire puissance du sujet. Si la mise à distance de soi peut être salutaire, alors la volonté d’impuissance est un retrait qui se nourrit d’autres expériences. La lecture, la réflexion, la méditation, l’écriture, la marche ou les voyages sont une « suspension heureuse et joyeuse de soi, un détour qui ramène à soi » (p. 194). Car dans sa « virtualité infinie », la blancheur, refuge ou « sorte de sas », est « parfois une puissance, une énergie en attente de son déploiement prochain », elle décharge « de l’usure (…) d’être soi » (p. 194-195). Elle permet donc de se ressourcer pour mieux se réinventer. En somme, comme le disait Montaigne, que cite David Le Breton, « il faut se réserver une arrière-boutique toute notre, toute franche, en laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude » (p. 194).
Le dernier livre de David Le Breton, Disparaître de soi, ouvre une réflexion sur les différentes facettes d’une philosophie de la volonté d’impuissance qui associées au concept de blancheur inaugurent, par-delà d’autres rapports spatio-temporels, une nouvelle relation du sujet à lui-même, aux autres et au monde. Précisons toutefois, que dans les cas où la volonté d’impuissance veut ce qu’elle ne veut plus, choisit de ne plus choisir ou s’obstine à défaire ce qu’elle est ou a été, le sujet risque de n’être plus que coquille vide. Et pourtant, quand cette volonté d’impuissance est en dialogue avec la pensée, la nature, la beauté du monde, l’art, elle devient condition de possibilité de régénérescence.
Un très bel essai, novateur par son thème, riche par l’ampleur des sources sociologiques, anthropologiques, philosophiques et littéraires qu’il convoque et questionne. La clarté du style et la rigueur conceptuelle invitent non seulement à penser, mais nourrit le lecteur et lui donne envie de découvrir ou de redécouvrir des auteurs comme par exemple Pessoa, Walser ou Blanchot. Philosophiquement, l’apport majeur de cet ouvrage est de donner un nouvel éclairage à la désubjectivation en tant que déprise de soi.









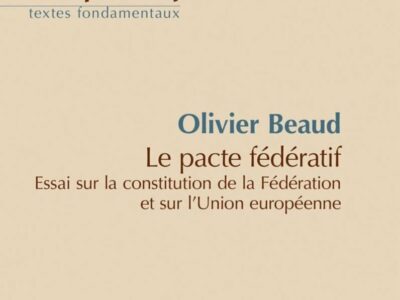


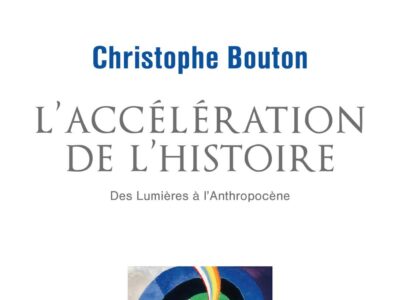
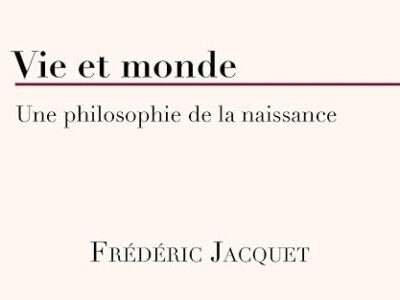


Ça a l’air très intéressant, merci ; toutefois, on aurait apprécié une explicitation du concept de « blancheur » qui, pour les non-initiés au moins, semble un peu tombé de nulle part. Il faudrait montrer dès le début le lien avec le souci de se déprendre de soi, ainsi que la nécessité de l’invoquer.
Il est très heureux que vous insistiez bien sur le fait que la volonté de « s’oublier » est un processus, peut-être pas nécessairement intellectuel, mais qui renvoie à l’esprit, à la pensée. Même le dépressif ou l’ado qui tombe dans la drogue le fait suivant un processus mental ; en un sens, se déprendre de soi est une nouvelle forme de « réflexion ».
Le livre de David Le Breton en fait peut-être mention : le thème de la désubjectivation dans des disciplines comme l’ethnographie/l’ethnologie/l’anthropologie (voir, bien sûr, Tristes Tropiques de Lévi-Strauss) – au fond, non seulement « s’oublier » peut être une renaissance, mais c’est aussi (souvent ?) le moyen d’une nouvelle co-naissance, d’une nouvelle rencontre avec autrui.