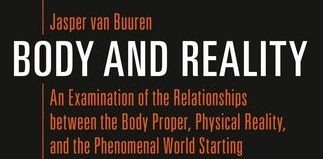Le cas Amiel à la lumière de la psychologie expérimentale
Le cas Amiel à la lumière de la psychologie expérimentale : Portrait d’un contemplatif velléitaire
Jeanne Proust, doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec M. Kambouchner, sur « La volonté et ses pathologies : psychologie moderne et théorie de l’âme chez Théodule Ribot ». Teaching Assistant, NYU, Departement of Philosophy.
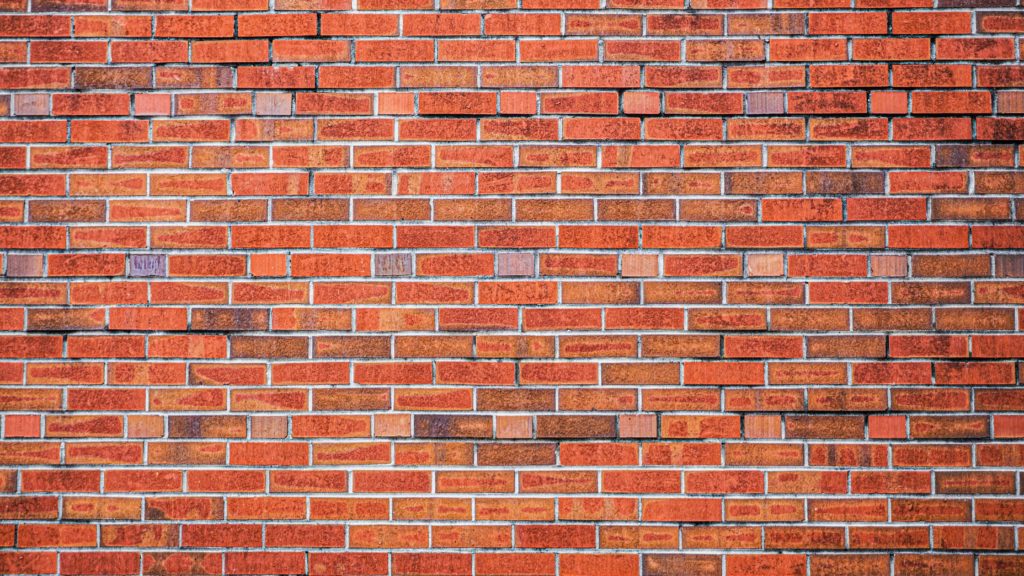 Considéré comme le fondateur de la psychologie expérimentale, Théodule Ribot ne jouit plus aujourd’hui de la renommée qui était la sienne à la fin du XIXe et au début du XXe siècles. Pourtant, ses travaux apportent une lumière nouvelle sur les pathologies mentales, notamment celles qui affectent notre propension à vouloir. Rapports de médecins, récits d’aliénistes, analyses de physiologistes sont convoqués pour tenter d’expliquer les mécanismes en jeu lors de la « dissolution » de la volonté. La méfiance de Ribot vis-à-vis de l’introspection se retrouve de façon diffuse dans l’ensemble de son œuvre. La méthode expérimentale est avant tout une méthode objective, et non subjective. L’étude de l’esprit humain doit se faire « du dehors grâce à l’examen de l’expression naturelle des passions » ; c’est là la seule manière de « remonter jusqu’aux causes mentales qui ont produit ces phénomènes[1] ».
Considéré comme le fondateur de la psychologie expérimentale, Théodule Ribot ne jouit plus aujourd’hui de la renommée qui était la sienne à la fin du XIXe et au début du XXe siècles. Pourtant, ses travaux apportent une lumière nouvelle sur les pathologies mentales, notamment celles qui affectent notre propension à vouloir. Rapports de médecins, récits d’aliénistes, analyses de physiologistes sont convoqués pour tenter d’expliquer les mécanismes en jeu lors de la « dissolution » de la volonté. La méfiance de Ribot vis-à-vis de l’introspection se retrouve de façon diffuse dans l’ensemble de son œuvre. La méthode expérimentale est avant tout une méthode objective, et non subjective. L’étude de l’esprit humain doit se faire « du dehors grâce à l’examen de l’expression naturelle des passions » ; c’est là la seule manière de « remonter jusqu’aux causes mentales qui ont produit ces phénomènes[1] ».
Pour saisir la personnalité réelle, concrète et non une abstraction qui prend sa place, il ne s’agit pas de se renfermer dans sa conscience, les yeux clos, et de l’interroger obstinément ; il faut au contraire ouvrir les yeux et observer[2].
L’engouement pour la méthode objective, qui avait déjà été inaugurée par Auguste Comte, témoigne de l’ambition de faire accéder la psychologie au statut de science – contre une méthode introspective qui semble condamner à l’impasse du solipsisme :
Car si ma réflexion m’avertit de ce qui se passe en moi, elle est absolument incapable de me faire pénétrer dans l’esprit d’un autre. […] Ainsi de deux choses l’une : ou bien la psychologie se borne à l’observation intérieure, et alors étant complètement individuelle, elle est comme enfermée dans une impasse et n’a plus aucun caractère scientifique; ou bien elle s’étend aux autres hommes, cherche des lois, induit, raisonne, et alors elle est susceptible de progrès; mais sa méthode est en grande partie objective. L’observation intérieure seule ne suffit donc pas à la plus timide psychologie[3].
Et de fait, l’introspection ou « ma réflexion » ne m’avertit ni adéquatement de ce qui se passe en moi, ni de l’intégralité de ce qui se passe en moi. Ribot emprunte à Comte son fameux paradoxe :
L’esprit humain peut observer directement tous les phénomènes, excepté les siens propres. Car, par qui serait faite l’observation ? […] L’individu pensant ne saurait se partager en deux, dont l’un raisonnerait, tandis que l’autre regarderait raisonner. L’organe observé et l’organe observateur étant, dans ce cas, identiques, comment l’observation pourrait-elle avoir lieu ?[4]
On ne peut être à la fois sujet et objet, spectateur et acteur : cette double condition ne peut que biaiser, voire empêcher la saisie de nos propres opérations mentales. Lorsqu’il s’agit de l’analyse des sensations, l’observation intérieure par la conscience est un procédé jugé trop insuffisant pour percevoir les sensations successives élémentaires qui composent nos sensations perçues, continues. « Le témoignage de la conscience, réputé indiscutable, est en réalité vacillant, précaire, sujet à caution, justiciable de la vérité objective[5] ». L’introspection se veut analytique, mais elle échoue à décomposer et identifier adéquatement les composants formant l’impression générale, seule accessible à la conscience. La confiance accordée à l’introspection repose en effet sur l’idée d’une transparence du psychisme à lui-même ; or, la conscience n’ayant pas accès aux tendances cérébrales et physiologiques, enfouies au plus profond de notre corps, elle en vient à postuler plus ou moins implicitement leur inexistence.
Pourtant, Ribot ne peut s’empêcher de reconnaître que « foncièrement, la psychologie est subjective[6] » : toutes les perspectives que la psychologie peut et doit adopter sur son objet ne sont possibles que parce que l’introspection nous a d’abord donné leurs rudiments : « il est clair que l’observation purement objective, qu’elle soit anatomique, physiologique, pathologique, ethnologique, historique ou linguistique, ne fera jamais comprendre ce qu’est une sensation, un sentiment, une idée, à celui qui, par hypothèse, n’en aurait aucune expérience personnelle[7] ». L’autoanalyse constitue donc un matériau digne d’intérêt – s’il est filtré ensuite par une méthode rigoureuse qui prend aussi en compte les causes physiologiques inconscientes cachées derrière les impressions perçues par la conscience de l’individu. Alors que nombre de psychologues physiologistes rejettent toute démarche introspective, Ribot en viendra donc à insister non seulement sur sa primordialité nécessaire, mais aussi sur la fertilité du dialogue entre méthode objective et témoignage de la conscience – avec toutes les précautions que l’exigence d’impartialité propre à la méthode expérimentale implique. Cet intérêt presque contraint pour l’introspection se retrouve dans les références à la littérature dans l’œuvre de Ribot – au témoignages anecdotiques d’écrivains se livrant sur leurs tourments intérieurs, et à ceux de médecins les ayant observés.
Il semble en effet que la valeur du récit introspectif dépende pour Ribot du niveau d’éducation, de la sensibilité et des aptitudes analytiques du narrateur. « On ne peut nier que l’introspection pratiquée par des gens bien doués et bien entraînés a fait ses preuves comme méthode d’analyse[8] ». Ces gens « bien doués » désignent certains romanciers et poètes, dont l’acuité du regard intérieur autoriserait même à les appeler eux aussi psychologues : « La littérature en particulier n’est-elle pas un instrument d’analyse ? et il ne manque pas de romanciers qui, à juste titre, se sont intitulés psychologues[9] ».
La littérature peut décrire avec une perspicacité toute particulière les phénomènes de l’esprit, sans pour autant qu’un statut ancillaire par rapport à la psychologie puisse d’emblée lui être accordé. La finesse de l’écrivain, du poète, qui prétendent saisir les nuances subtiles de la vie de l’esprit, est trop souvent tributaire d’une théorie de l’âme dépassée. Il est donc pour le moins surprenant que des récits littéraires soient convoqués par Ribot alors même qu’ils recourent au langage de l’ancienne philo-psychologie. En ce qui concerne l’aboulie, on retrouve souvent en filigrane une définition de la volonté comme effort rationnel, une attitude dualiste qui amène l’écrivain à disséquer ce qu’il nomme son âme, en se perdant en raisonnements spéculatifs faute de pouvoir rendre compte des tendances physiologiques en jeu dans certaines maladies de la volonté. Ribot reproche d’ailleurs aux psycho-philosophes de « l’ancienne psychologie » d’écrire comme des romanciers, ou comme des critiques littéraires ; de dépeindre les nuances de ce qui accède à la seule conscience, sans pouvoir vraiment rattacher à leur sous-bassement biologique les phénomènes de « l’esprit » :
Dans ces conditions, le psychologue devient un romancier ou un poète d’une espèce particulière, qui cherche l’abstrait au lieu du concret, qui dissèque au lieu de créer : et la psychologie devient une forme de critique littéraire très-approfondie, très-bien raisonnée ; rien de plus[10].
Il peut sembler étonnant de reprocher aux psychologues de l’ancienne école de « disséquer » et d’appeler la nouvelle école à plutôt « créer » ; l’attitude scientifique doit, de fait, elle aussi disséquer, et observer le concret sans créer d’hypostases inexistantes. Mais la psychologie expérimentale entend décomposer, sonder davantage que ce que l’introspection seule peut atteindre, et elle formule des hypothèses explicatives que la démarche purement descriptive d’un romancier ou d’un poète n’ambitionne pas de constituer. De quelles manières les témoignages issus de la littérature ont-ils alors pu nourrir la psychologie expérimentale, et notamment les études portant sur la volonté et ses pathologies ? La littérature pallie la pauvreté des recherches scientifiques sur la vie affective, dont l’analyse tient de plus en plus à cœur à Ribot. L’écrivain est attentif aux variations subtiles de sa sensibilité, à la mobilité de ses émotions – non pas seulement sur le mode de l’universalisation romantique du sentiment, mais aussi dans la perspective d’enregistrer et retranscrire les oscillations et alternances de sa vie affective intime, individuelle.
Lorsqu’il s’agit de décrire l’angoisse qui vient parfois se surajouter à l’absence généralisée de motivation, Thomas de Quincey fait figure d’illustration récurrente. Coleridge fait aussi partie des hommes de Lettres qui suscitent l’intérêt de Ribot, mais il ne cite pas l’homme lui-même. La littérature constitue un appui pour la psychologie non pas seulement au sens où les récits introspectifs des écrivains eux-mêmes viennent faire figure de témoignages éclairants, mais aussi dans la mesure où les intellectuels forment un groupe d’individus dont le comportement aboulique paraît plus surprenant. Lorsque Ribot étudie les affaiblissements de l’attention volontaire pour des raisons « congénitales » (l’attention volontaire peut faiblir aussi pour des raisons acquises, que Ribot développe par la suite), il écarte l’étude des « esprits bornés ou médiocres, chez qui les sentiments, l’intelligence et la volonté sont à un même unisson de faiblesse[11] ». Les cas communs sont délaissés et Ribot leur préfère les cas curieux qu’incarnent les intellectuels comme Coleridge ou De Quincey. Cependant, on aurait pu s’attendre à ce que Ribot se penche davantage sur la littérature pour illustrer les Maladies de la volonté[12] qu’il ambitionne d’analyser scientifiquement. On ne peut notamment que s’étonner de ce qu’Henri-Frédéric Amiel, dont Ribot connaissait l’œuvre, ne fasse pas lui aussi partie des cas curieux rapportés par le psychologue. En effet, le monumental journal intime dont Amiel est l’auteur[13] est l’expression par excellence d’un éternel ajournement, d’une indolence, d’un éparpillement, d’un gaspillage de soi. Qualifié par Paul Bourget d’ »Hamlet protestant« [14], Amiel propose une auto-analyse minutieuse qui laisse transparaître une nature scrupuleuse à l’extrême, rongée par l’angoisse de l’incomplétude, meurtrie par le constat d’une paresse, d’une timidité et d’une irrésolution qui l’empêche d’achever les actions qu’elle se prescrit. Nous nous proposons, dans cet article, de revenir sur la description qu’Amiel donne de son intériorité vacillante, pour mieux donner à voir tout l’intérêt qu’un tel écrivain pouvait présenter pour l’étude de la volonté morbide en psychologie expérimentale.
Si Ribot mentionne Amiel une fois, dans les Maladies de la Personnalité, ce n’est toutefois pas tant pour se pencher sur son caractère aboulique que pour décrire les aspirations vers l’infini qui animent le diariste genevois. Amiel tient alors lieu d’exemple pour illustrer la disparition de la personnalité dont les mystiques font l’expérience :
Il me semble que je suis devenu une statue sur les bords du fleuve du temps, que j’assiste à quelque mystère d’où je vais sortir vieux ou sans âge. Je me sens anonyme, impersonnel, l’œil fixe comme un mort, l’esprit vague et universel comme le néant ou l’absolu ; je suis en suspens, je suis comme n’étant pas. Dans ces moments, il me semble que ma conscience se retire dans son éternité, elle s’aperçoit dans sa substance même, supérieure à toute forme contenant son passé, son présent et son avenir, vide qui renferme tout, milieu invisible et fécond, virtualité d’un monde qui se dégage de sa propre existence pour se ressaisir dans son intimité pure. En ces instants sublimes, l’âme est rentrée en soi ; retournée à l’indétermination, elle s’est réimpliquée au-delà de sa propre vie, elle redevient embryon divin. Tout s’efface, se dissout, se détend, reprend l’état primitif, se replonge dans la fluidité originelle, sans figure, sans angles, sans dessin arrêté. Cet état est contemplation et non stupeur : il n’est ni douloureux, ni joyeux, ni triste ; il est en dehors de tout sentiment spécial comme de toute pensée finie. Il est la conscience de l’être et la conscience de l’omnipossibilité latente au fond de cet être. C’est la sensation de l’infini spirituel[15].
Il est surprenant que Ribot n’ait retenu que cet aspect de la pensée d’Amiel s’il l’avait bel et bien lu. En effet, fasciné par un panthéisme unifiant, une métaphysique de l’unité, Amiel souffre précisément d’une inaptitude à embrasser le monde, à s’y jeter, à en faire partie. C’est l’impression de hiatus perpétuel entre moi et le monde – et donc entre la pensée et l’action, qui constitue la matière principale du Journal. Dans la sensation d’infini spirituel comme dans l’angoisse de l’inaction, c’est l’état contemplatif qui prévaut ; mais dans le premier cas, tout neutre que soit le sentiment d’infini, on conçoit cet état contemplatif comme une bénédiction, une grâce, un « instant sublime ». Dans le second cas en revanche, cette « auto-contemplation » est douloureuse : Amiel s’isole du monde, se replie en lui-même, et se désole de ne pas pouvoir transmuer ses velléités en volontés.
Les « très beaux termes »[16] du journal d’Amiel retiennent l’attention de nombreux auteurs de la fin du XIXe : outre Bourget, Renan, Brunetière[17], Dugas, Moutier,[18] on doit évoquer Pierre Janet, disciple de Ribot, qui fait d’Amiel l’auteur le plus cité de son livre sur Les Obsessions et la Psychasthénie (1903). Amiel est le psychasthénique par excellence. Déficit de la volonté, de l’action, sentiment d’incomplétude, « fonction du réel » altérée : le psychasthénique est incapable d’agir dans le monde, particulièrement en présence d’autrui. Les Fragments d’un journal intime constituent ainsi pour Pierre Janet un témoignage remarquable de ce mal singulier, qui affecte primordialement les grands penseurs, et l’on ne peut que s’étonner que Ribot ne l’ait pas remarqué avant son disciple[19]. « Personne impersonnelle », « sujet sans individualité déterminée », « feu follet », Amiel se perçoit comme un homme sans caractère, un individu dépersonnalisé :
Tu perds l’unité de vie, de force, d’action, l’unité du moi, tu es légion, parlement, anarchie ; tu es division, analyse, réflexion ; tu es synonymie, oui et non, dialectique ; de là ta faiblesse. La passion du complet, l’abus de la critique, la manie anatomique, la défiance du premier mouvement, du premier mot, de la première idée, expliquent le point où tu en es venu. L’unité et la simplicité de l’être, la confiance et la spontanéité de la vie sont en chemin de disparaître. C’est pour cela que tu ne peux agir, que tu n’as point de caractère[20].
Le tutoiement dont Amiel fait usage semble ajouter au procédé de culpabilisation. Le dialogue de l’écrivain avec lui-même invite à penser la réflexivité sous l’angle du jugement : le « je » qui dit « tu » à l’autre « je » se présente comme un juge, certes incapable d’intervenir au sein du « parlement » anarchique qui débat sans jamais parvenir à rendre, et encore moins à exécuter de jugement définitif. Ce juge s’apparente peut-être à la figure religieuse d’un Dieu protestant qui loin d’être compatissant, réprimande la mollesse et l’irrésolution de sa créature.
Chez Amiel, « le système musculaire et les organes du mouvement sont intacts », « l’intelligence est parfaite », « Le but est nettement conçu, les moyens de même », et pourtant « le passage à l’acte est impossible ». C’est là un paradoxe qui fait de l’aboulie telle qu’Amiel en est affecté « une maladie de la volonté au sens le plus rigoureux[21] ». La fatale répétition de l’échec de l’action s’accompagne, et est entretenue par une rumination intellectuelle, une fouille méticuleuse de soi, par laquelle l’individu se désole de ne découvrir qu’une vacuité alarmante. Amiel se dépeint ainsi comme un être passif, qui observe dans le détail son incapacité à vouloir activement, à unifier ses tendances volatiles et flottantes vers l’action. Il énumère, en de nombreuses listes rigoureuses, les tâches qu’il se donne pour mission d’accomplir, en vain : les verbes d’action se multiplient dans le Journal comme autant de rituels conjuratoires inopérants, recettes et modes d’emploi de ses facultés -bien reconnues et estimées par ailleurs, juxtaposés aux constats d’impuissance de sa volonté :
Je crois être bien doué, mais mon état naturel est le repos. Tout ce que j’ai de facultés a besoin, pour s’éveiller, d’un acte formel de volonté. La volonté m’est plus nécessaire qu’à un autre, car mes facultés sont sans élan par elles-mêmes. Ce sont des serviteurs absolument dévoués et passifs. Une volonté énergique pourrait aller loin avec mes instruments, car elle serait richement servie. Si je n’acquiers pas la volonté, je ne serai rien[22].
Ce dédoublement réflexif apparaît à la fois comme la cause et la conséquence de l’angoisse qui accable celui qui veut vouloir, mais ne le peut pas. En effet, on est là face à un cercle vicieux similaire à celui que Ribot observe chez De Quincey : l’inactivité angoisse, et l’angoisse paralyse en retour. Le sentiment de l’effort à surmonter pour agir est tel qu’il devient impossible à Amiel de sortir de la paresse velléitaire qui lui répugne tant par ailleurs. Amiel souhaite, il ne veut pas. L’ardeur avérée de son souhait ne lui donne aucune force motivante : on a là l’illustration même du principe maintes fois énoncé par Ribot selon lequel la puissance de l’idée toute intellectuelle demeure inopérante, parce que la part d’affect qui devrait accompagner cette idée, part nécessaire pour qu’elle se traduise en acte, fait défaut.
L’attitude qu’aurait adopté Ribot face au cas Amiel est difficile à deviner. Avec De Quincey déjà, mais aussi plus tard, avec Sainte Thérèse, Ribot s’efface derrière l’auto-analyse de l’auteur sans franchement donner d’explication « naturaliste » de phénomènes dont il ne fait quasiment que rapporter la description. Cette neutralité apparente lors de longues citations ne doit pas faire oublier que c’est en dernière instance à une dégénérescence du système nerveux que Ribot attribue la plupart des maladies de la volonté. Il y a affaiblissement des incitations nécessaires pour stimuler les centres moteurs. Mais de fait, cette explication naturaliste semble réductrice : les intellectuels capables de diagnostiquer eux-mêmes avec la plus grande acuité leur propre état psychologique posent problème, et une pure et simple somatisation de leurs maux semble abusive. L’obsessif aboulique, dont Amiel constitue un exemple saisissant, n’est pas absent à lui-même ; il n’est pas aliéné par des impulsions incontrôlables, ni ignorant du trouble qui l’assiège ; de fait, il est juge et partie de ce siège dont il est victime (« obsession », du latin obsidio, renvoie au siège d’une place forte) ; il est sujet qui s’assujettit lui-même. Cette conscience dédoublée, traduite donc par un va et vient perpétuel entre énumérations de stratégies de défense destinées à encourager l’action, et apitoiement sur son propre sort face à l’inefficacité de celles-ci, montre un Amiel parfaitement lucide, présent à lui-même lorsqu’il fait état de ce déchirement interne, de cette Grübelsucht[23] obsédante.
Les réflexions morbides d’Amiel constituent une description clinique remarquable, auxquelles les psychologues ne trouvent pas grand-chose à ajouter. A l’explication naturaliste atemporelle que proposerait sans doute Ribot, on peut opposer une explication qui prend en compte le contexte moral et social dans lequel évoluent les abouliques de la fin du XIXe siècle.[24] La confiance accordée par Pierre Janet au témoignage des malades, et notamment d’Amiel, invite à envisager l’aboulie (Ribot), la psychasthénie (Janet), et ce qui deviendra la névrose obsessionnelle (Freud)[25], comme un « mal du siècle » inhérent aux scrupules moraux nés des valeurs véhiculées par la société dans laquelle les écrivains vivent. La maladie de la volonté dont souffre Amiel n’est pas atemporelle ; elle fait écho à ce que Renan ou Nietzsche voient comme la décadence propre à l’époque moderne. Les contradictions inhérentes à la société du XIXe siècle, caractérisée par la montée de l’individualisme dans une économie métamorphosée par l’industrialisation, viennent heurter l’austérité de l’éducation protestante qu’Amiel a connue à Genève. La foi calviniste qui le pousse au mysticisme rêveur et l’influence de l’idéalisme allemand sur sa pensée, dans un contexte rationaliste de progrès des sciences dont il admire par ailleurs le pouvoir explicatif, contribuent à alimenter l’indécision de son caractère. Le malaise d’Amiel est aussi celui d’une civilisation du doute ; et l’on comprend mieux le poison des atermoiements du genevois assoiffé de rigueur morale, son repli narcissique sur ses propres états d’âme, si l’on prend en compte les paradoxes du contexte moral et politique de la culture moderne de l’époque.
Ribot se situe au point de confluence entre l’approche naturaliste, clinicienne des aliénistes, et une sensibilité aux témoignages d’intellectuels accrédités comme autant de pièces à conviction légitimes – dont il tend pourtant à omettre qu’elle s’inscrit dans un contexte historique particulier. Ce contexte, particulièrement susceptible de faire naître l’aboulie des contemplatifs comme Amiel, n’est que brièvement mentionné dans la Psychologie des Sentiments, où la manie auto-analytique est considérée comme typique au tournant du siècle, dans un passage qui semble faire le portrait même d’Amiel :
La deuxième espèce[26] est celle des contemplatifs, qui se distinguent des précédents par un développement intellectuel très supérieur ; en sorte que leurs éléments constitutifs peuvent être énumérés dans l’ordre suivant : sensibilité très vive, intelligence aiguisée et pénétrante, activité nulle. Je groupe sous cette rubrique des variétés assez nombreuses, mais qui se ressemblent toutes parce qu’elles ont en commun les trois marques précitées :
Les indécis, comme Hamlet, qui sentent beaucoup, pensent beaucoup et ne peuvent passer à l’action.
Certains mystiques (non les grands, ceux qui ont agi et que nous retrouverons plus tard), mais les purs adeptes de la vie intérieure qui se trouvent à toutes les époques et dans tous les pays (yoghis [sic] de l’inde, soufis persans, thérapeutes, moines de toutes croyances), plongés dans la vision béatifique, n’ayant rien écrit ni rien fondé ; ayant, suivant leur rêve, traversé le temps sans y laisser leur trace.
Les analystes, au sens purement subjectif, c’est-à-dire ceux qui s’analysent eux-mêmes assidûment et minutieusement ; qui rédigent leur « journal », notant heure par heure les petits changements de leur vie interne, leurs changements d’humeur au gré des influences atmosphériques. Tels Maine de Biran parmi les psychologues, Alfieri parmi les poètes. Au reste, pourquoi citer des noms, puisque cette manie de l’analyse personnelle est devenue de nos jours une maladie, sous l’influence d’une excitation nerveuse excessive, du raffinement intellectuel et de l’énervement de la volonté. Noter que ces sensitifs sont presque tous pessimistes[27].
Ribot ne s’est pas assez franchement prononcé sur cette particularité de l’auto-analyse : on sait qu’il se méfie de l’introspection, et qu’il privilégie la description des états physiologiques associés aux maladies qu’il étudie. Il n’est pas exclu que la lucidité des propos d’Amiel l’ait embarrassé : comment comprendre « la maladie » qui affecte l’écrivain sous le seul angle physiologique, lorsque l’analyse psychologique qu’il en propose, dans l’exactitude de ses détails, semble indiquer qu’il s’agit d’un trouble tout intellectuel en partie produit par cet intellectualisme même ? En effet, il se peut fort bien qu’il y ait un lien causal entre l’auto-analyse et la défaite de la volonté. La faiblesse du vouloir semble, chez Amiel, être fonction des tergiversations intellectuelles auxquelles il se livre, s’adressant à lui-même en ces termes :
La critique de moi-même est devenue le corrosif de toute spontanéité oratoire ou littéraire. J’ai manqué à mon principe de faire la part du mystère, et mon châtiment est l’impuissance d’engendrer. Le besoin de connaître retourné sur le moi est puni comme la curiosité de la Psyché, par la fuite de la chose aimée. La force doit rester mystérieuse à elle-même ; dès qu’elle pénètre dans son propre mystère, elle s’évanouit. La poule aux œufs d’or devient inféconde dès qu’elle veut savoir pourquoi ses œufs sont d’or. -La conscience de la conscience est le terme de l’analyse, disais-je dans Grain de Mil ; mais l’analyse poussée jusqu’au bout se dévore elle-même comme le serpent égyptien. Il faut lui donner une matière à moudre et à dissoudre, si l’on veut empêcher sa destruction par son action elle-même. Nous sommes et devons être obscurs pour nous-mêmes, disait Goethe, tourné vers le dehors, et travaillant sur le monde qui nous entoure […]. Mieux vaut dilater la vie et l’étendre en cercles grandissants, que de la diminuer et de la restreindre obstinément par la contraction solitaire […] Assez longtemps tu t’es caché, retiré, refusé. Songe à vivre[28].
Le dépeçage minutieux de l’impuissance du vouloir accroît cette impuissance même, aggrave l’aboulie dont souffre Amiel plutôt que de la faire cesser. L’examen rationalisant de soi se surajoute comme un miroir grossissant qui prolonge et alourdit le problème. « Péché », « profanation », « faute », « croix » ; le vocabulaire religieux avec lequel Amiel s’auto-flagelle témoigne de l’intensité de la culpabilité ressentie face à l’impuissance.
Mon péché c’est le découragement ; mon malheur c’est l’indétermination, mon effroi, c’est d’être dupe, et dupe de moi-même, mon idole c’est la liberté, ma croix c’est de vouloir, mon entrave c’est le doute ; ma faute éternelle, c’est l’ajournement ; mon idole, c’est la contemplation stérile substituée à la régénération ; mon goût le plus constant c’est la psychologie […] L’inconsistance, le manque de fermeté et de fixité dans la volonté, dans les idées, dans les goûts, dans la conduite, tel est le vice qui a tout gâté chez toi[29].
La volonté est d’abord comprise comme un effort révélateur d’une force de caractère qui fait cruellement défaut à Amiel. C’est en effet dans le contexte d’une perspective volontariste, qui érige la volonté au rang d’une puissance d’affirmation de l’esprit sur le corps, qu’Amiel se condamne. On trouve ce volontarisme chez Descartes bien sûr, mais aussi, poussé à l’extrême, chez Maine de Biran, pour qui l’effort se fait exhortation, ordre moral impérieux. L’effort volontaire est l’expression active de la personnalité, dans une opposition radicale avec le désir, considéré comme passif. La volonté est pouvoir sur le corps, et sur l’étendue. Ni désir passif, ni choix au sens de préférence, mais efficience, tension, contrôle. « Je ne suis pas libre, car je n’ai pas la force d’exécuter ma volonté[30] » : l’absence de force, de contrôle sur soi, l’incapacité à l’autodiscipline ronge Amiel, qui tantôt essaie de trouver des remèdes contre les affres de la culpabilité, tantôt s’y asservit, voire essaie de légitimer son apathie. On aurait certes tort de voir une simple complaisance dans l’apitoiement d’Amiel sur son sort. Mais outre l’empathie qu’il formule parfois à l’égard de lui-même, il semble, de fait, qu’il se grise presque de la mise en échec de sa volonté, à la façon d’une intoxication qui là encore, invite au parallèle avec De Quincey. Conscient que le ressassement de ses faiblesses ne fait qu’accentuer celles-ci, il persiste dans une litanie à la fois culpabilisante et justificatrice. Cette autojustification prend deux formes principales : l’une dérive d’une attitude nihiliste à l’endroit des phénomènes, l’autre d’une auto-persuasion qui insiste sur les risques d’immoralité encourus lorsqu’on agit, et que l’inactivité, comprise alors comme abstention, permet d’éviter.
Le nihilisme pessimiste d’Amiel est à la fois l’aboutissement de son incapacité à vouloir, et un baume qui lui rend cette incapacité supportable. La profondeur des analyses nourrit, et ne fait qu’empirer son incapacité à entreprendre quelque projet que ce soit au point où le doute, de pratique, devient métaphysique, se transmue en nihilisme mélancolique, et légitime alors l’inaction :
Je suis un naufragé qui n’en convient pas. Je suis une aspiration déçue et une vie manquée. Le doute détruit en moi jusqu’à la faculté d’espérer ; à peine si je crois à ce que je tiens, tant la fragilité de tout bien m’est présente[31].
De nombreux passages dans le Journal insistent sur cet éloignement du réel (apparemment aux antipodes du seul passage cité par Ribot) prenant la forme d’un scepticisme désabusé :
Tout devient pour moi fumée, ombre, illusion, vapeur ; même ma propre vie. Je tiens si peu à tous les phénomènes, qu’ils finissent par passer sur moi comme des lueurs et s’en vont sans laisser d’empreintes. Avec un moi de réclusion et de concentration, je serais à volonté fou, visionnaire, halluciné, extatique. La pensée remplace l’opium et le haschich ; elle peut enivrer tout éveillé et diaphanéiser les montagnes et tout ce qui existe. C’est par l’amour seul qu’on se cramponne à la réalité, qu’on rentre dans son moi, qu’on redevient volonté, force, individualité. L’amour pourrait tout faire de moi, même s’il le voulait, un génie. Par moi-même et pour moi-même, je préfère n’être rien :
Car le néant peut seul bien cacher l’infini.
Le nihilisme quiétiste, le bouddhisme rêveur, l’universalité recueillie et immobile, l’omniscience ponctualisée, le coma vigil de l’esprit : c’est à peu près l’état où j’arrive par cette voie[32].
La réflexion se fait drogue anesthésiante, instigue un sentiment de déréalisation qui devient voulu, et non plus seulement subi. Amiel « préfère n’être rien » ; et il justifie son choix par le sentiment d’infini que nous évoquions plus haut, et que nous pouvons désormais mieux comprendre : il ne s’agit pas d’une osmose avec le monde et ses phénomènes, mais d’un ascétisme qui précisément y renonce. C’est cet ascétisme qui rassure Amiel, et le conforte dans l’hibernation psychologique qui le caractérise. Délaissant alors la culpabilité initiale ressentie face à l’impuissance de se lancer dans le monde, il se console en se rendant capable d’atteindre une sorte de nirvana austère, d’abdication détachée qui le prémunit contre tout risque d’action moralement répréhensible. Ainsi, il préfère se blâmer pour son inaction que risquer le blâme pour une action potentiellement regrettable. La honte virtuelle face à l’action entrevue se substitue à la honte d’être incapable d’agir. Vouloir est ainsi tout à la fois objet de désir – remède ultime – et de crainte : risque ultime de mal agir. « Je me suis énervé par le non-vouloir, délabré par la désespérance, rendu eunuque par l’abstention obstinée[33] » : l’impuissance est tantôt décrite comme un péché, tantôt identifiée à une abstention austère, presque vertueuse, qui prémunit Amiel de la tentation :
J’ai, pour ainsi dire, poursuivi, recherché avec un instinct diabolique les moyens de m’annuler, de me rendre infécond, impuissant, inutile. Et j’y suis à peu près parvenu. Actuellement, je suis dépourvu de caractère, de spécialité, de mémoire ; je n’ai pas de but, point de capitaux intellectuels ; je n’ai pas de femme ni d’enfants ; pas de foyer, plus de jeunesse ; nul crédit, aucune influence, pas d’entregent, point de perspective souriante. Ma rage est assouvie. Et d’où venait-elle ? De la honte d’avoir un désir, et de la crainte de ne pouvoir le satisfaire. Défiance du sort et faiblesse de la volonté, voilà ce qui m’a rendu tout négatif, ce qui m’a rejeté dans la quiétude, dans la passivité. Pour n’être pas refusé par la destinée, je ne lui ai rien demandé. Pour en pas être humilié, je n’ai rien voulu. Pour ne pas être vaincu, je n’ai pas lutté. Pour ne pas me tromper, je n’ai rien affirmé et je n’ai pas choisi. Pour rester indépendant, j’ai abdiqué toute ambition et renoncé à tout pouvoir. Zweifel, Verzweiflung, Diabolus[34].
Ce pessimisme résigné – résolu presque ! – à éviter tout engagement qui accompagne nécessairement l’action fait pendant à une sorte d’humilité affectée qui vient s’immiscer au sein d’une dévalorisation constante de soi : « dilettante boiteux de l’art, de la science et de la vie, je me suis dégoûté assez vite de moi-même, et la honteuse joie de n’avoir rien à faire est venue m’achever[35] ». Par un désœuvrement dont Amiel reconnaît le plaisir coupable, le moi se retient dans l’intimité de l’examen de conscience, se réfugie dans la contemplation vierge d’idéaux inatteignables. C’est que l’intelligence d’Amiel est toute abstraction, réflexion formelle qui fonctionne à vide. Il entrevoit pourtant quel autre type d’intelligence, émotionnelle ou intuitive cette fois, pourrait le sortir du vertige morbide qui le bannit du monde. On trouve cet appel à l’intuition dans un passage où Amiel compare son âme à un régime politique parlementaire dans lequel le pouvoir législatif a évincé les pouvoirs judiciaire et exécutif : la pensée délibère sans qu’un juge ou un homme d’action intérieurs puisse exercer son pouvoir d’arrêt, de conclusion et de décision[36] :
La réflexion chez toi ne conclut pas, parce qu’elle se retourne sur elle-même pour se quereller et se discuter […] L’analyse est dangereuse, si elle domine la force synthétique. La réflexion est redoutable, si elle détruit la faculté d’intuition. L’examen est fatal s’il supplante la foi. La décomposition est meurtrière, quand elle dépasse l’énergie combinatrice de la vie[37].
Contre l’inféconde délibération, amputée de la conclusion à laquelle elle était pourtant censée aboutir, Amiel reconnaît la puissance de l’intuition ; on retrouve là la célèbre distinction qu’opèrera Bergson entre une intelligence qui sépare, découpe, dissèque, décompose et l’intuition qui manifeste l’unité, la combinaison, l’harmonie d’un moi en accord avec lui-même.
Ribot, admiratif devant la virtuosité descriptive du journal, en a sans doute sous-estimé la pertinence pour une psychologie expérimentale qu’il veut fonder aussi sur l’étude de cas particuliers. Il n’est pas douteux que toute la finesse des analyses d’Amiel sur son incapacité à vouloir aurait apporté une illustration des plus éclairantes pour la psychopathologie de l’apathie contemplative. Les contradictions qui habitent Amiel ne semblent pas pouvoir être assimilées à de simples conflits de tendances physiologiques dans lesquels la conscience ne jouerait aucun rôle. L’attention hyperbolique qu’il porte à ses tourments intérieurs semble bien produire – ou inhiber, plutôt, des actes, et ne pas ainsi se réduire à un épiphénomène sans effet sur la pathologie elle-même. Le refus ribotien d’accorder quelque pouvoir causal que ce soit aux états de conscience est ici clairement remis en cause : chez Amiel, la conscience d’être immotivé produit entraîne, ou en tous cas amplifie, ce manque même de motivation.
[1] Théodule Ribot, La Psychologie anglaise contemporaine, 1870, p.31.
[2] Ribot, Les Maladies de la personnalité, Alcan, 1885, p.90.
[3] Ribot, La psychologie anglaise contemporaine, 1870, pp. 22-23.
[4] Auguste Comte, Cours de philosophie positive [1830-1842], vol. 1, pp. 31-32.
[5] Ribot,Leçon d’ouverture du cours de la Sorbonne : La psychologie nouvelle in Revue Politique et Littéraire, 36, 1885, p. 783.
[6] Ribot, (1885a). Leçon d’ouverture du cours de la Sorbonne : La psychologie nouvelle, in Revue Politique et Littéraire, 36, p. 782.
[7] Ibid.
[8] Ribot, De la Méthode dans les sciences, article Psychologie, 1909, Paris, Alcan. p. 233.
[9] Ibid., p. 244.
[10] Ribot, La psychologie allemande contemporaine, 1909, Alcan, Introduction, p. V.
[11] Ribot, Les Maladies de la volonté, Alcan, 1883, p. 93.
[12] Titre de l’ouvrage de Ribot qui connaît le plus de rééditions, publié pour la première fois en 1883.
[13] Il faut attendre la période qui s’étend de 1976 à 1993 pour que l’intégralité du Journal d’Amiel soit publiée en douze volumes aux édition L’Âge d’homme, sous la direction de Bernard Gagnebin et Philippe Monnier. A l’époque de Ribot, seuls les Fragments d’un Journal intime, en 2 volumes, avaient été publiés par Edmond Scherer, en 1882/1884.
[14] Paul Bourget, Essais de psychologie contemporaine, Editions Alphonse Lemerre, 1883, cité par Pierre-Henri Castel. http://pierrehenri.castel.free.fr/Articles/Amiel.htm#S
[15] Amiel cité par Ribot dans Les Maladies de la personnalité, Alcan, 1885. Note du bas de la page 137, tiré du Journal d’Amiel, année 1856.
[16] Ribot, Les Maladies de la personnalité, Alcan, 1885, p. 136.
[17] Pour Renan, voir le Journal des débats du 30 septembre puis du 7 octobre 1884 ; pour Brunetière, voir la Revue des deux mondes de janvier 1886.
[18] Ludovic Dugas et François Moutier, Dépersonnalisation et émotion. Article paru dans la Revue Philosophique de la France et de l’Etranger, (Paris), trente-cinquième année, tome LXX, juillet à décembre 1910, pp. 441-460. Dugas et Moutier voyaient en Amiel un “dilettante” peu susceptible d’illustrer le phénomène de dépersonnalisation. Ils évoquent cependant son talent à admirablement décrire l’apaisement ressenti dans la résignation au néant.
[19] Janet suit les conseils de Ribot et entreprend un parcours universitaire à la fois en philosophie et en médecine. Il lui succède à la chaire de psychologie expérimentale et comparée du Collège de France.
[20] Amiel, Journal, Septembre 1855.
[21] Ribot, Les Maladies de la volonté, Alcan, 1883, p. 49.
[22] Amiel, Journal, 18 juin 1841.
[23] Manie de douter, de questionner sans fin.
[24] Voir l’article de Pierre Henri Castel sur les rapports entre le mal du siècle et la névrose obsessionnelle chez Amiel. http://pierrehenri.castel.free.fr/Articles/Amiel.htm
[25] Les dénominations changent selon les auteurs, mais Pinel fait allusion à cette même maladie de la volonté lorsqu’il parle de « folie raisonnante », Esquirol de « monomanie », et Morel d’« obsession ».
[26] Ribot fait des contemplatifs la seconde espèce de « sensitifs », après avoir décrit la première, celle des « humbles », dont l’intelligence est bornée, et avant de décrire la troisième, celle des « émotionnels », qui présentent des phases d’activité incontrôlables.
[27] Ribot, La Psychologie des sentiments, p. 385-386. Nous soulignons. Amiel, diariste, fait définitivement partie de cette catégorie.
[28] Amiel, Journal, 3 février 1862. Grain de Mil est un recueil de poèmes publié par Amiel en 1854. La poule aux œufs d’or fait référence à la fameuse fable de La Fontaine du même nom (fable XIII du Livre V.).
[29] Amiel, Journal, Août 1860.
[30] Extrait du cahier qui porte le numéro I avec le titre, ajouté plus tard : « commencement d’un journal intime régulier », dans Fragments d’un journal intime. Tome 1. Henri-Frédéric Amiel ; introduction de Bernard Bouvier, Stock, Delamain et Boutelleau (Paris), 1927. p. 1.
[31] Amiel, Journal, 15 juillet 1873.
[32] Amiel, Journal, lundi 27 octobre 1856.
[33] Amiel, Journal, août 1860.
[34] « Doute, désespoir, diable », in Amiel, Journal, 29 septembre 1860.
[35] Amiel, Journal, Août 1860.
[36] Amiel, Journal, 4 septembre 1855.
[37] Amiel, Journal, 4 septembre 1855.