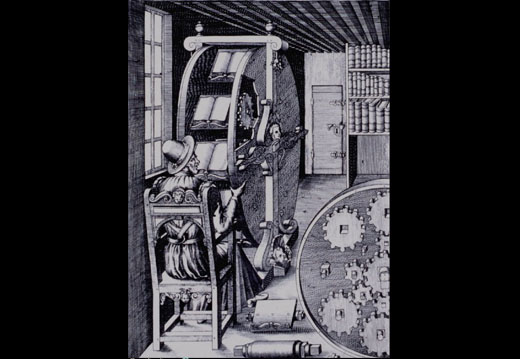L’écriture à la ligne, Linéarité de la pensée et morphogenèse de l’écriture (I).
Jacques A Gilbert, Maître de conférences en littérature à l’université de Nantes. (Université de Nantes/ AMo EA 4276)
Dans son dernier ouvrage Internet rend–il bête[1], Nicholas Carr interroge la transformation de la lecture sur Internet et le nouveau rapport qu’elle établit envers la chose écrite. Le titre de l’ouvrage paraît directement issu du marketing et sans doute rend-il mal justice à l’analyse qui y est développée, bien plus subtile et nuancée que le titre français ne le laisse entendre. Il est quasi certain qu’Internet ne rend pas « bête » et la mise à disposition d’immenses ressources documentaires paraît au contraire un formidable moteur au développement du savoir. Ce gain extraordinaire a ouvert la porte à l’essor de ce qu’on nomme aujourd’hui l’« économie de la connaissance ». Cette économie de la connaissance semblant toujours associée aux vecteurs du savoir et comprise comme somme d’informations. Le modèle de Google le montre : c’est la quantité d’informations qui permet d’affiner la qualité des recherches[2]. Mais le terme d’économie a plusieurs sens et, par goût de l’étymologie, je peux imaginer qu’il signifie aussi que la connaissance est entrée dans l’organisation de la maison (oiko nomos), autrement dit l’environnement de vie : par la présence de ma bibliothèque bien entendu, et aussi par la possibilité de commander dans le monde entier des ouvrages rares dans plusieurs langues, par l’accès, grâce à des bibliothèques en ligne comme Gallica, à des fonds auparavant peu accessibles. Pour certains textes, il n’est plus nécessaire de se déplacer, je peux les lire sur mon ordinateur. Cela sans parler des articles en ligne, des abonnements multiples que je peux lire sur ma tablette. Point de nostalgie donc.

Même chose en ce qui concerne l’écriture. J’ai pour une large part abandonné l’écriture à la main au profit du clavier. Pas complètement, car il y a encore des textes que je n’écris qu’à la main pour le plaisir de la graphie. Parce que, peut-être, je m’y investis d’une autre façon. J’ai observé progressivement l’évolution suivante : j’ai commencé par écrire à la main et taper à la machine, puis progressivement, avec la possibilité de corriger, au fur et à mesure que j’avais acquis une plus grande dextérité, je suis passé directement à l’écriture au clavier, pour les courriers, les articles scientifiques, puis aussi les écritures moins formelles. Les textes que j’écris encore à la main sur du papier ou même sur une tablette graphique traduisent une certaine attitude. La main est plus libre sur une page, même numérique. À côté de l’écrit, je peux tracer des petits dessins. Faire des flèches et procéder à une multiplicité de variations que les logiciels d’écriture nomment « enrichissements ». C’est le plaisir du geste. Mais, globalement, la productivité de mon écriture manuelle est bien inférieure à celle de mon écriture au clavier. Je tape maintenant plus vite que je n’écris à la main et la conservation du geste demeure comme une volonté un peu « emphatique », au sens anglo-saxon, de marquer une présence sur un espace moins formaté que celui de la ligne liée au clavier. L’outil du clavier est en effet plus dépendant de la ligne. Il suit une progression par caractère et par ligne et n’autorise que plus difficilement des allers-retours sur la surface de la page entière. Il y a bien sûr des logiciels de mise en page très élaborés qui permettent toutes les rotations et les déformations mais elles ne sont pas aussi directement liées au travail du geste. Pour la deuxième fois : pas de nostalgie.
Comme Carr, je me pose la question de la transformation du support et de l’influence qu’il peut avoir sur les activités de lecture et d’écriture et sur la pensée elle-même. Le livre de Carr n’utilise pas un point de vue surplombant et aborde le sujet à travers l’expérience même de l’auteur qu’il est dans son propre rapport à la lecture et l’écriture. Cette approche empirique de la lecture et l’écriture me paraît intéressante dans la mesure où lecture et écriture sont bien pour chacun à un moment ce que je pense. Ce que je lis me traverse et ensuite j’écris. Les outils numériques ne sont pas simplement des moyens pour faire la même chose qu’avant. Ils s’interposent d’une certaine façon même si cette médiation est insensible. Il s’agit bien d’une vie dans un milieu nouveau.
Nicholas Carr cite le Phèdre de Platon et sa condamnation de l’écriture. On connaît moins le texte Contre les sophistes[3] d’Isocrate qui paraît encore plus explicite. Ce que reproche Isocrate aux sophistes et à leur utilisation de l’écriture est essentiellement politique. L’enseignement direct par la parole d’un maître à un élève passe par une relation directe, ésotérique si l’on veut, puisque seul l’élève connaît la pensée du maître. L’écriture en revanche divulgue le savoir sans son mode d’emploi, si bien que les lecteurs auront un accès à un enseignement écrit, exotérique, mais ils n’en connaîtront pas le sens véritable. C’est un peu comparable à la réaction des médecins face à l’Internet : les patients arrivent aujourd’hui en consultation se croyant déjà informés, mais que vaut ce savoir dispersé à tous vents ? Pour Isocrate, Le medium écrit s’interpose dans un usage communautaire. Il en perturbe le fonctionnement. Il peut paraître très étrange que Platon, malgré cette méfiance pour l’écriture qu’il partage avec Isocrate, ait pourtant tant écrit. Bien entendu les possibilités de l’écriture, son aptitude à développer la pensée, ont attiré les philosophes attiques, même ceux qui s’en méfiaient, probablement parce qu’ils y ont trouvé quelque chose de nouveau. Chez Aristote déjà la question de l’écriture n’est déjà plus posée en tant que telle. La Poétique réhabilite la mimèsis sans s’attarder sur la question spécifique de l’écriture.
Nicholas Carr compare l’arrivée du numérique à la généralisation de l’écriture. La comparaison est intéressante dans la mesure où elle identifie une nette rupture qualitative. Il ne faut pas non plus sous-estimer le déjà là de la culture numérique. La généralisation des outils numériques modifie les usages mais eux-mêmes ne sont pas le produit d’une génération spontanée. La culture numérique a précédé le milieu et le « saut numérique » a été anticipé de longue date par toute une série d’inventions et de réflexions qui ont précédé la généralisation des usages contemporains. La constitution d’un milieu pose toutefois d’autres questions. Existe-t-il pour l’écriture un « espace » numérique ? Quel est son horizon ? Bien entendu, il existe toutes sortes de catégories d’écrits. La question se pose cependant pour certains types d’écrits, moins facilement transférables sur d’autres médias. C’est particulièrement la question de la littérature.
Nicholas Carr évite le piège du « contenu ». Il ne cesse de rappeler la phrase célèbre de McLuhan : le médium est le message. La notion de « contenu », opposée aux « tuyaux », est en effet problématique. Quand on écrit un livre, on ne produit pas un « contenu », on produit le livre lui-même, même si les feuillets sur lesquels écrit ne seront pas ceux qui seront imprimés. C’est l’ouverture vers l’œuvre, évoquée par Maurice Blanchot. Cela ne signifie pas que le livre n’ait aucun contenu mais il n’y est pas réductible. La référence paraît bien évidemment « inactuelle » quand on parle des écritures numériques, mais il faut relire Maurice Blanchot :
Mais précisément l’essence de la littérature, c’est d’échapper à toute détermination essentielle, à toute affirmation qui la stabilise ou même la réalise : elle n’est jamais déjà là, elle est toujours à retrouver ou à réinventer. Il n’est même jamais sûr que le mot littérature ou le mot art réponde à rien de réel, rien de possible ou d’important. Cela a été dit : être artiste, c’est ne jamais savoir qu’il y a déjà un art, ni non plus qu’il y a déjà un monde[4].
La proposition peut paraître maximaliste : les œuvres s’inscrivent bien dans un genre ou dans un format préalable, mais Blanchot récuse cette conception de l’œuvre : « jamais une œuvre ne peut se donner pour objet la question qui la porte »[5]. La question du format ne peut concerner qu’un déjà-là. L’œuvre littéraire définit son propre espace dans son élaboration même. Ou alors elle relève de la littérature de genre. La situation nouvelle d’immatérialité du livre nuit-elle à cette indétermination radicale de l’espace littéraire ? On peut légitimement penser que des œuvres sauront s’élaborer dans ce nouvel environnement. Dès 1999, La maison des feuilles[6] de Mark Z. Danielewsky laissait imaginer les pistes de ce que pourrait être une littérature née sur Internet. L’accessibilité et l’ouverture même de la créativité à tous posent des questions que Blanchot a envisagées bien avant l’émergence d’Internet. Dans L’amitié, parue en 1971, il s’en prend au livre de poche avec une distance qui a certainement paru dès cette époque comme l’expression d’une posture aristocratique et passéiste :
Le livre de poche a donc cette particularité de dissimuler et d’imposer un système ; il y a une idéologie de cette littérature, de là son intérêt. Ce livre proclame : 1) le peuple a désormais accès à la culture ; 2) c’est la totalité de la culture qui est mise à la portée de tous. […] Il n’y a rien à dire contre la technique. Mais ce qui frappe dans son emploi, c’est à nouveau l’idéologie qu’il recouvre et qui fournit au livre de poche sa signification de base, sa moralité : la technique règle tous les problèmes, le problème de la culture et de sa diffusion… […] L’invention du livre de poche — qui est de toute manière anodine, ne nous trompe que d’une manière anodine et annonce seulement d’autres inventions plus perfectionnées — nous rend le service, grâce à son mécanisme simple, de nous faire mieux comprendre le pouvoir réducteur qu’il est difficile de dissocier de toute culture […] Toutes les œuvres disponibles, accessibles et, mieux encore, immédiatement nôtres, reçues et absorbées par un simple contact : le geste furtif de l’acheteur. Ce qui suppose : 1) que la culture, grande puissance impersonnelle, se substitue à chacun et accomplisse, à sa place, le lent travail d’assimilation par lesquels les œuvres réduites à des valeurs, sont par avance déjà comprises, déjà lues, déjà entendues à l’homme de l’universelle compréhension que nous sommes censés être et qu’à la vérité nous sommes aussi nécessairement ; 2) que la distance irréductible de l’œuvre, cela dont l’approche est celle d’un éloignement et que nous ne saisissons jamais que comme un manque — un manque en nous, un manque dans l’œuvre et un vide langage —, que l’étrangeté de l’œuvre, cette parole qui ne parle qu’un peu au-delà d’elle-même, se réduise en une familiarité heureuse, à la mesure du savoir possible et du langage proférable[7].
On peut refuser ce qu’on a pu considérer comme le mysticisme littéraire de Blanchot, il n’en reste pas moins une vision assez prophétique de l’avenir du livre. Le livre de poche annonce « d’autres inventions plus perfectionnées » qui permettront « d’absorber par simple contact » des œuvres « disponibles, accessibles, et, mieux encore immédiatement nôtres », mais les œuvres seront alors « déjà comprises, déjà lues » et elles ne permettront plus cet « éloignement » ou « distance irréductible » de l’œuvre. Blanchot se plaît à le rappeler dans L’espace littéraire : un livre devient œuvre, « événement qui s’accomplit quand l’œuvre est de l’intimité de quelqu’un qui l’écrit et de quelqu’un qui la lit »[8]. Pour ces raisons, et ce même si l’écriture n’anticipe pas la lecture, la rencontre de la solitude du lecteur avec la solitude de l’écriture constitue une particularité de la littérature. Elle en constitue même l’événement initial. Le chapitre de Nicholas Carr intitulé « L’église de Google »[9] envisage un tout autre type de rapport aux livres, une toute autre lecture et, partant, une toute autre forme d’écriture. Il évoque les « nuages de mots » de Popular Passages qui permettent au lecteur d’« explorer un livre en dix secondes »[10]. Le livre ne fait plus œuvre mais devient une « pile de données »[11]. La transformation n’est en rien anodine et ce serait certainement une erreur de croire qu’une pile de « pile de données », pour reprendre l’expression de Nicholas Carr, ressemblera encore à ce que nous nommons aujourd’hui une bibliothèque. Les bibliothèques numériques ne ressembleront pas aux bibliothèques que nous avons connues jusqu’ici : des rangées de livres sur une étagère, une salle dédiée et couverte de volumes empilés les uns à côté des autres, un édifice important dans lequel sont stockés des milliers de volumes. Carr observe déjà dans certaines universités américaines, l’importance périphérique du « papier » au regard d’Internet[12]. Le constat est curieux : on croyait conserver des livres et soudain il s’avère que ce n’est que du papier. Nicholas Carr nous prévient : «Il ne faut pas confondre la grande bibliothèque que Google s’empresse de créer avec celles que nous avons connues jusque-là. Ce n’est pas une bibliothèque de livres, c’est une bibliothèque de fragments »[13]. Il n’est pas certain que le terme de «fragment » soit absolument adapté. La métaphore la plus appropriée serait plutôt celle d’une granulation des données qui métastasent ensuite sur la Toile. Les passages les plus cités le sont de plus en plus et on finit par les retrouver sur tous les sites qui traitent de la question, jusqu’à une certaine uniformité. Paradoxalement, l’extrême diversité des données se présente à nous sous une forme assez monotone. Bien entendu, l’écriture selon Blanchot est un concept littéraire, non généralisable à tous les écrits, mais elle se démarque nettement d’une conception selon laquelle un espace livresque se tiendrait en attente de l’écriture à venir. L’espace littéraire ne préexiste pas à ce qu’il produit. Aucun algorithme ne peut le sonder ni le prévoir. Il est possible que la « page profonde » soit précisément liée à cette attente irréductible aux informations qu’elle contiendra.
Devant l’émergence du livre numérique, on a beaucoup parlé de la nostalgie des livres : l’odeur du papier, le toucher. Ces éléments sont liés à des sensations fugaces et individuelles. Le support ne semble cependant pas décisif. Comment saisir cette différence très matérielle et pourtant si peu signifiante ? Un changement plus marqué concerne la production. Depuis la généralisation de l’informatique, chacun est en mesure de produire un « quasi-livre » avec des moyens simples et bon marché comme de le diffuser avec l’Internet. Cet abaissement considérable des coûts de production à fortement perturbé la chaîne de l’écrit. Le passage au livre électronique est une nouvelle étape, mais en réalité le rapport à l’imprimé s’est déjà transformé depuis déjà des années. L’imprimé est déjà électronique depuis longtemps. Simplement, nous envisageons désormais la disparition physique des livres papier. La décision de l’Encyclopédie Britannica de ne plus produire l’encyclopédie papier paraît ainsi une date repère. Le transfert d’un texte d’un support à un autre n’altère pas le texte lui-même ; c’est bien le même texte qu’on lit dans un livre ou sur un écran. Cela ne répond toutefois en rien aux interrogations qu’on peut formuler. Les conditions d’écriture et de lecture d’une œuvre peuvent changer du tout au tout avec le format. Cela ne change pas le texte mais les conditions de sa réception et, in fine, l’œuvre elle-même s’en trouve transformée. La phrase proustienne se livre d’une certaine façon quand elle constitue un milieu dans lequel on se déplace. Le simple agrandissement des caractères sur un IPad peut en modifier la perception et pourtant le texte ne change pas. L’odeur du papier et le toucher du livre concernent moins le texte que l’objet livre, lequel est lu dans un certain rapport. C’est ce rapport qui compte. On comprend mieux alors les réticences de Blanchot envers le livre de poche. L’épisode récent des Corans brûlés par mégarde par des soldats américains en Afghanistan interroge sur cette attention particulière de l’objet écrit. Quand le livre se trouve être le dépositaire d’une présence, il doit être conservé et ne peut être détruit. On peut alors l’enterrer comme un être humain.
Toutefois, l’hypothèse la plus intéressante du livre de Carr est la proposition selon laquelle cette mutation vers les nouveaux médias produirait un changement des consciences. Nicholas Carr lie l’abandon de la «lecture profonde » à la transformation des pratiques mémorielles qui sont liées à la lecture sur Internet, ce qui produirait à terme une recomposition de l’écriture. La proposition est audacieuse et elle repose sur un constat assez largement partagé par ceux qui sont passés de la lecture papier à la lecture sur écran. Comme toujours, un changement mesurable, la baisse de la lecture de livres, doit être envisagé avec prudence. L’écrit s’est fragmenté mais on n’a peut-être jamais autant écrit ni autant lu que depuis l’arrivée d’Internet. La problématique doit être envisagée de façon qualitative : l’écrit est-il devenu autre ? D’un point de vue naïf, je ne suis pas loin de partager l’avis de Carr. Depuis l’arrivée du numérique, je lis moins de papier : ma lecture de la presse est presque entièrement sur écran. C’est en partie vrai également pour les articles scientifiques que je trouve sur Internet, les textes anciens que je lis sur Gallica. La littérature résiste. Les textes que j’aime : j’aime les avoir. Et cela signifie un livre papier. Ce constat m’est propre mais je remarque qu’une large part de mes collègues m’a fait des réflexions semblables. Le changement concerne surtout la presse : je suis nettement plus informé mais je lis aussi plus en diagonale, et me comporte de façon plus sélective devant une offre plus abondante. Je pratique alors volontiers le « picorage »[14]. En revanche, je ne puis me comparer à ces étudiants américains que cite Carr et qui affirment ne plus lire aucun livre. Encore attaché au papier, je lis aussi sur support numérique, et demeure entre les deux mondes. Mais probablement mon rapport à la lecture a-t-il changé. Il est plus « productif » et il connaît moins cet état d’abandon qui fait le plaisir de la lecture des livres.
L’argumentation de Carr sur la différence mémorielle de la lecture sur Internet par rapport à celle de l’écrit papier repose sur deux éléments : d’abord le constat d’un changement dans le vécu de la lecture, ensuite des études fondées sur l’imagerie cérébrale. Le constat des transformations des modes de lecture est tout simplement évident. La lecture numérique ne possède pas la même densité que la lecture traditionnelle sur papier[15]. Les études comportementales citées par Carr semblent le montrer. Bien entendu l’activité de lecture est la même si on se situe au niveau du simple document : lire tel document sur papier ou sur écran ne produit pas de différences notables. C’est d’une manière plus générale qu’il faut appréhender le changement. La lecture d’un grand nombre de documents fait apparaître des différences assez marquées. Cette moindre densité est démontrée par les études auxquelles Carr se réfère. On peut penser que cela tient à la modification de l’offre, beaucoup plus importante, et à la multiplication des supports. Le temps disponible pour la lecture n’étant pas extensible, la lecture est moins attentive. Les exemples cités par Nicholas Carr montrent que le même texte lu sur papier ou sur écran ne produit pas la même mémorisation. Il souligne en effet une particularité des lectures numériques : la faible mémorisation qu’elles suscitent. Il en vient à noter ce fameux déficit de l’attention qu’il attribue à une différence fondamentale entre les deux structures de mémorisation : la « lecture superficielle » et la « lecture profonde ». C’est à ce niveau que l’imagerie médicale vient à son secours. Elle montre une transformation des zones éclairées du cerveau selon le type de lecture pratiquée. On reconnaît là les méthodes comportementales de la science américaine et il faut certainement utiliser ce type d’argument avec beaucoup de précautions. Qu’une image cérébrale ait changé ne nous informe pas sur la teneur du processus psychique. Il s’agit de corrélations entre des modifications observées par l’imagerie et des transformations comportementales. C’est instructif mais on ne « lit » pas le cerveau[16]. Nicholas Carr propose l’hypothèse selon laquelle les deux types de lectures relèveraient d’activités psychiques distinctes. On peut, bien entendu, déjà le constater culturellement. Il suffit d’observer comment l’irruption de l’écriture dans des sociétés qui ne la pratiquaient pas a pu susciter une certaine réticence[17] et produire de nombreux changements. Les nouveaux écrivains et lecteurs acceptaient d’extérioriser une partie de leur mémoire et il est certain que certaines capacités mémorielles en ont été diminuées. Ensuite, le recours plus important à l’écriture a fini par modifier la nature de ce qu’on écrivait. Cette extériorisation de la mémoire s’est encore considérablement accrue avec le développement des outils numériques. Il semble cependant qu’à un moment l’approfondissement culturel produit par l’écriture soit arrêté et même que le mouvement soit inversé. Mais il ne s’agit pas seulement d’une perte quantitative. Le maintien de la « pensée profonde » produite par la lecture immersive s’en trouverait menacé.
Ainsi, Nicholas Carr considère la différenciation mémorielle produite par la lecture numérique non pas comme une simple version extensive de la lecture classique mais une transformation du mode de conscience. Il attribue ce changement aux sollicitations multiples du support Web qui mobiliserait d’après lui plusieurs niveaux simultanés d’attention et empêcherait l’absorption de la lecture profonde. Devant un support multimédia, ou même devant un support textuel multiple, comme peut l’être une page Web, et notamment avec la présence de liens hypertextuels, le lecteur, constamment sollicité, ne saurait s’abandonner au sens comme il pouvait le faire dans l’activité de lecture profonde qui précédait. Une remarque de Carr paraît encore plus surprenante : il se demande si la pensée linéaire ne trouve pas sa fin avec l’Internet et la perte de la lecture profonde, comme si les nouvelles pratiques mémorielles remettaient en cause la forme, le format même de la pensée.
[1] Nicholas Carr, Internet rend-il bête ?, Paris, Robert Laffont, 2011 pour la traduction française ; The Shallows, New York, W. W. Norton & Company, 2010. Le titre original est plus sobre et plus évocateur.
[2] Idem, Chapitre sur Google intitulé « L’Église de Google ».
[3] Isocrate, Discours, Contre les sophistes, Paris Les Belles Lettres, 2008.
[4] Maurice Blanchot, Le livre à venir, Paris, Gallimard, collection Idées, 1959, p. 294.
[5] Ibid., p. 294.
[6] Mark Z. Danielewski, La Maison des feuilles, Paris, Denoël, 2002.
[7] Maurice Blanchot, L’amitié, Paris, Gallimard, 1971, p. 81-84.
[8] Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955, p. 11.
[9] Nicholas Carr, op. cit., p. 233.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] Ibid.
[14] L’expression est utilisée par Nicholas Carr pour désigner le nouveau type de lecture « superficielle ».
[15] Nicholas Carr, Op. cit. Cela est développé dans le chapitre intitulé « Le cerveau du jongleur ».
[16] Pierre Cassou-Noguès, Lire le cerveau, Paris, Le Seuil, 2012.
[17] Nous avons cité Isocrate mais on peut aussi évoquer la « leçon d’écriture » des Tristes tropiques de Claude Lévi-Strauss.