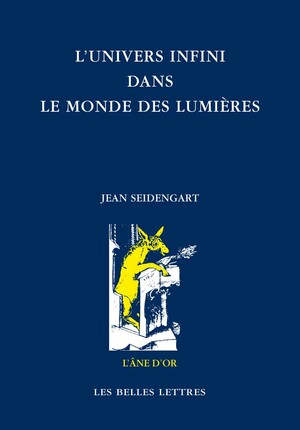Renversements du clair et de l’obscur : le rationalisme paradoxal de Jean Paulhan, esquisse.
Seconde partie de l’article Renversements du clair et de l’obscur : le rationalisme paradoxal de Jean Paulhan, esquisse.
4. Révélations réalistes

Le concept d’ « échange » apparaît donc comme le véritable pivot de la réflexion paulhanienne. C’est lui qui permet de comprendre de quelle manière nous pouvons passer, sans solution de continuité, de la pensée au langage, et des mots aux idées. C’est lui qui permet de refranchir la distance ouverte entre la conventionnalité du signe et la liberté capricieuse de l’activité du penser. C’est également lui qui va permettre de comprendre comment pensée et langage peuvent s’articuler à la chose.
Là encore, Paulhan part d’un constat simple : celui de l’emploi, de l’utilisation de ces catégories dans les circonstances ordinaires, lorsque nous disons d’une affirmation, ou d’une pensée, qu’elle n’est pas simplement un mot, une phrase, ou une idée, mais la chose même. Rien n’intéresse plus Paulhan que ce genre de déclaration. D’une part, elle nous introduit au cœur de l’usage le plus concret du langage – la grammaire du langage ordinaire, pourrait-on dire. Mais surtout, elle met en lumière que dans le fonctionnement même de celui-ci, il y a de la pensée aux phrases, des idées aux choses, quelque chose comme une polémique. Le langage ordinaire, l’exemple tiré de la conversation la plus courante ne fonctionne donc pas, chez Paulhan, comme la norme de tout langage. Elle n’en découvre pas seulement la robustesse, trop sous-estimée par les philosophes. Elle permet aussi, et surtout, d’y découvrir cette « mauvaise humeur séculaire » contre la pensée et le langage vis-à-vis des choses, qui est précisément ce qu’il faut étudier. Car tout se passe comme si, face à la chose, nous voulions nous débarrasser de l’édifice encombrant, du poids excessif du langage et des mots, comme à la recherche d’un contact muet avec elle, qui nous la restitue dans son évidence. Or il y a bien là un réflexe comparable à celui qui, dans la question du rapport entre la pensée et les mots, donnait lieu à la Terreur. Tel est le geste de Paulhan de repérer ce réflexe au fondement même de notre rapport avec la réalité elle-même, et de chercher à l’éclaircir, à le comprendre, à l’empêcher de dériver dans une thèse de séparation totale des sphères de la pensée et du langage avec celle du réel. Bref, de comprendre comment ce réflexe d’hostilité guide la logique de l’échange auquel nous procédons entre pensée, mots et choses, lorsque c’est de la « réalité » que nous voulons parler. Cette exploration mène Paulhan vers l’affirmation d’un réalisme, qui se trouve exemplairement traitée dans deux textes, Le grand scandale de la philosophie et Le clair et l’obscur[1].
Le texte publié par Fata Morgana sous le titre, éminemment kantien, du Grand scandale de la philosophie, reprend et infléchit le thème principal de la première Critique : sous quelles conditions l’expérience peut-elle nous donner un brevet de réalité ? Mais la stratégie de Paulhan est de refuser de voir dans un certain type de description de cette expérience – description théorique de ses structures et des facultés qui les mettent en œuvre – la réfutation du scepticisme qu’elle prétend constituer. La raison en est la même que celle qui a été jusqu’ici avancée : une certaine représentation de la pensée dans laquelle celle-ci possède essentiellement le caractère d’un argument, d’une preuve :
« (…) l’ingéniosité, la puissance, la cohérence du raisonnement sont des qualités de la pensée : elles ne font donc que nous enfoncer plus avant dans la pensée : soit, par opposition à la Réalité qu’on voulait prouver, dans le rêve et la fantasmagorie[2] »
Cela signifie que le caractère fondamentalement argumentatif d’une pensée – qu’avait permis d’isoler l’examen « dialectique » de celle-ci – ne nous permet pas d’ouvrir la pensée « vers » les choses. Que la pensée puisse avoir la prétention d’établir un fait – celui de l’existence du monde –, cela est parfaitement légitime : mais il faut bien voir que cette prétention est encore un fait de pensée, que c’est encore la pensée elle-même qui la déploie. En sorte que la puissance ou l’habileté d’une preuve ne nous fait pas sortir du domaine de la pensée : elle nous y enfonce encore davantage. Il y a une raison fort simple à cela : c’est que, de quelque manière qu’on envisage le rapport entre la pensée et les choses, on est conduit à penser un tel rapport. C’est dire si le rapport pensée/monde s’évalue avant tout en termes de pensée : il n’y a pas moyen de sortir de la pensée pour mesurer son rapport au monde. Cette thèse pourrait sembler d’allure kantienne – nous ne sortons pas des structures de notre expérience pour évaluer leur adéquation avec le monde. Chez Kant, cette formulation fonctionne comme une thèse, qui ouvre la tâche d’une constitution de l’objectivité au sein de ces structures, afin d’établir qu’elles n’ajoutent ni ne retranchent aucun des critères traditionnels de cette objectivité. Il en va très différemment chez Paulhan. Dire que nous ne sortons pas des pensées pour les mesurer au monde exprime très exactement un défaut de la question, une erreur dans cette représentation de la pensée. Paulhan dénonce donc un geste très profondément semblable à celui de la Terreur dans cette évacuation du terrain de la réalité mené à partir du postulat d’une extériorité de la pensée par rapport à lui. Car il y a un saut entre le fait de dire que le fonctionnement de la pensée ne nous fait pas quitter son terrain et celui de postuler que la pensée et les choses vivent dans deux règnes séparés et sans communication, que Paulhan se refuse à franchir. Car nous sommes amenés à traiter nos pensées en choses : tel est le fruit de l’analyse du langage ordinaire. Lorsque nous disons « Ce ne sont pas des idées que j’évoque, ce sont les choses mêmes », il est aussi exact de dire que « ces choses mêmes » sont pourtant bel et bien des idées et de comprendre que, pourtant, ces idées fonctionnent pour moi comme des choses. Pour Paulhan, il est donc clair que c’est dans la pensée elle-même qu’il faut trouver le « point de contact » avec la réalité. Mais ce n’est certes pas au sens où la pensée, menée jusqu’à son terme, nous donnera la chose, en elle-même. C’est au sens où la pensée, menée jusqu’à son terme, sécrètera le point de vue d’après lequel l’idée d’une extériorité de la pensée à l’égard de la chose s’annulera d’elle-même. Il ne faut donc pas attendre que la pensée opère une alchimie par laquelle, à une certaine étape, elle se change en chose. Il faut repérer le point où elle s’échange avec elle.
On le voit, c’est bel et bien l’argument sceptique qui fascine ici Paulhan, et qu’il s’efforce d’emprunter jusqu’à ses plus extrêmes conséquences. Mais c’est aussi pour en étudier les stratégies habituelles de la conjuration. Paulhan découvre en elles le thème constant du petit fait ou du petit geste qui reçoit le rôle de dissoudre le vertige de l’inexistence du monde :
« Du seul point de vue logique, c’est évidemment absurde de se dire : “Mais enfin, je rêve, rien de tout ce que je vois ne peut être vrai” et de se pincer pour s’assurer qu’on ne rêve pas. (C’est absurde puisqu’on peut aussi bien se pincer en rêve et que le pincement d’aucune façon ne peut rien prouver.) Bien. Mais enfin le fait est que cela se fait, que cela est courant, que ça réussit, puisqu’on continue à le faire. Il y a là un événement d’autant plus digne de remarque qu’il échappe aux règles de la logique et de la raison. Or c’est un événement courant. En quoi consiste-t-il ? En ceci : on suspend toute la vérité du monde (que pourtant on voit, on touche, on entend) à un tout petit fait – ici, le pincement – tenu pour incontestable. On se prive un instant du monde entier, tenu pour un cauchemar, et on ne compte plus pour le rendre que sur ce malheureux pincement.[3] »
La structure de l’argument est la suivante : il est certain que le geste du pincement est un geste qui, en lui-même, est profondément insuffisant pour rendre au monde sa réalité, brusquement devenue douteuse. Mais – c’est le sens de l’affirmation d’irrationalité de ce geste –, si absurde semble-t-il, on ne tarde pas à découvrir que les règles de la logique et de la raison, comme on l’a vu, semblent tout aussi insuffisantes à nous délivrer du scepticisme, puisque toute leur rigueur et leur efficacité ne feront que nous enfoncer davantage dans la vasière de la pensée, au lieu de nous donner la terra firma de la chose elle-même. Ce que le thème du petit geste irrationnel nous permet de découvrir selon Paulhan, ce n’est certes pas une supériorité de l’irrationnel sur le rationnel dans la conjuration du scepticisme. C’est l’existence d’une logique de l’échange, dans laquelle nous sommes amenés à troquer sans hésitation la richesse de la perception, son opulence, sa monotonie, contre la pauvreté d’un simple petit geste où s’affirme pourtant la certitude du monde. De sorte qu’en première analyse, ce n’est pas du tout la recherche d’un index favorable, d’un cours avantageux, que produit la recherche de cet échange : la robustesse de la chose même ne trouvera pas forcément son équivalent dans la richesse de la logique ou le pittoresque de la perception. Bref, ce n’est pas tant dans l’étude du pincement – geste parfaitement anodin et insignifiant en lui-même – que l’on trouvera l’explication de notre certitude retrouvée, mais dans cet appauvrissement général, où nous nous accrochons au plus petit des qualia pour y retrouver le sens de l’expérience directe du monde. Cet appauvrissement est le trait le plus essentiel de notre pensée, celui qui gouverne notre humeur à l’égard des dispositifs traditionnels de l’intellection du réel ; c’est lui qui nous fait trouver la certitude dans une sorte de rétrécissement de la pensée à sa plus infime réalisation : la douleur du pincement.
Plusieurs autres exemples iraient à l’appui de ce « trait » fondamental de l’esprit : ainsi de l’apologue du jeune bûcheron qui, refusant de croire que la princesse puisse être amoureuse de lui, s’enfonce un couteau dans la cuisse pour s’assurer qu’il ne rêve pas[4]. C’est aussi ce que livre l’analyse de l’ « incident guerrier » au début du Clair et l’obscur. Paulhan y fait appel à un souvenir de Quatorze : bloqué par l’avance ennemie dans une maison à demi démolie, pilonnée par l’artillerie des deux camps, une atmosphère de rêve et de fantasmagorie s’empare du spectacle funèbre des corps, créant un vertige d’irréalité :
« Imaginez là-dessus une lumière d’éclipse, des éclats ronflants à droite et à gauche, le bruit d’orgue que fait un obus en plein vol, un cadavre qui vous regarde sans vous voir, un cheval éclaté comme un poisson de grands fonds et, dans une poussière de pierres et de fumée que traversaient des fusées éclatantes, de tous côtés le désordre et la dislocation.
Tout cela était étrange, mais à certains égard, merveilleux. Et je dois avouer qu’il m’arrive un instant de m’en réjouir : que de feux d’artifice ! Que de châtaignes et de girandoles, de crapauds et d’acrobaties, de clowneries et de parade ! D’aimables figurants faisaient le mort à la perfection. Quel spectacle ! Est-ce donc pour moi qu’on a monté tout cela ?[5] »
Le solipsisme n’est pas le luxe de la spéculation du cabinet ; il s’y révèle comme caractéristique de l’expérience guerrière au moment où la mort et la survie se décident – et s’annulent, dans l’impression d’une « farce gigantesque » ou d’un « cauchemar[6] ». Or voici qu’une flaque d’eau gelée, « demeurée, par quel hasard, intacte et même brillante » va fournir les conditions d’un juste échange, et délivrer la certitude de l’expérience réelle. Paulhan y jette un violent coup de soulier :
« La glace se fendilla, s’écailla, puis s’écroula dans un grand bruit et je connus très bien que je ne (?) rêvai pas. Je le connus, et me trouvai, chose curieuse, satisfait – en tout cas comblé. Il faut bien que la vérité – fût-elle atroce – nous soit d’un grand prix.[7] »
Là encore, c’est le fait minuscule qui sert, irrationnellement, de retour à l’évidence du monde sensible. « À la faveur de l’anomalie, la norme. » Évidence, sensibilité, échange de l’idée et de la chose : ainsi s’élabore la définition d’une perception, qui n’est pas ouverture, déchirure du réel dans le rideau des pensées, mais plutôt appauvrissement, rétrécissement de celle-ci jusqu’au (presque) rien – condition nécessaire de l’échange : ce n’est plus le monde en général qui me semble donné, mais la pensée d’une chose infime qui me rend les caractéristiques de la chose, et avec elles, le sentiment de la réalité, et, sous la « glace intacte » du rêve, le « sol dur » de la réalité.
Mais faut-il attendre de ce genre d’expérience, somme toute exceptionnelle, les conditions d’une redécouverte des choses au bout du fil de la pensée ? La seconde expérience relatée dans le Clair et l’obscur, « Petite aventure nocturne», élargit le spectre, et dépasse la question de la fantasmagorie solipsiste et de la conjuration du scepticisme. Paulhan y plaide, cette fois, pour une expérience directe des choses. Obtenue par une ascèse de la pensée, une réduction des impressions sensibles ? Non, mais à la faveur de la « révélation d’un atelier ». Rentré tard d’une soirée, Paulhan découvre son atelier plongé dans le noir et son épouse déjà endormie. La prévenance le dissuade de recourir à la lumière du plafonnier. Aussi prend-il la décision
« de donner, à peine entré, un coup de lumière d’une extrême rapidité, trop bref pour importuner ma femme ou la réveiller, mais suffisant néanmoins à m’entrer dans les yeux les obstacles de toute espèce – de la table à la commode, de la commode à la cheminée (avec sa pendule), de la seconde table au paravent – qu’il me fallait éviter ou contourner délicatement (ma femme ayant le sommeil léger) avant de parvenir à l’endroit-chambre de la pièce.[8] »
Le stratagème commence par fonctionner ; mais bientôt, l’obscurité déroute l’orientation initiale, et l’espace devient singulier :
« Point de ces places lointaines et de ces places voisines ! Ici, tout m’était voisin. De ces parties indifférentes, et de ces parties curieuses. Ici, tout me concernait, tout m’était passionnant, tout m’était diablement vrai. Ni de ces plans aimablement étagés, en fuite douce. Ici, tout était imminent, hérissé de pointes, creusé de vides ! Ah ! non, ça ne fait pas un paysage de tout repos ! Et ma femme qui continuait à dormir paisiblement entre ces tables pointues, cette pierre (ou plutôt cette brique vaguement gravée) qu’un frôlement jetterait par terre, ce lierre traînant à terre où je vais me prendre les pieds (drôle d’idée, d’avoir du lierre dans un appartement), cette armoire dont la porte est quelque peu déglinguée et bâille, cette pendule sous son globe de verre, ces piles fragiles de livres que j’élève le plus haut possible pour échapper à la poussière (…), cette bibliothèque tournante (qui n’attend que le moment de grincer)…[9] »
Telle est le résultat de l’attention extrême, dans la circonstance d’une parfaite désorientation. Elle fait apparaître un processus de révélation à la lumière – photographique – d’une chambre obscure. Dans l’expérience de la pièce plongée dans le noir, la neutralisation des conditions ordinaires de l’expérience fait brusquement découvrir, à un Paulhan qui s’y trouve submergé, des impressions aveugles, et devenues, toutes, à la fois singularisées et pourtant égales en force. Ce que l’habitude avait recouvert – la connaissance et la familiarité d’un atelier qu’on ne remarque plus – s’échange avec une donation du monde dans la coaction des choses. Ce n’est donc plus, comme dans la réfutation du scepticisme, au prix d’une ascèse, d’une quasi-abolition volontaire, que la pensée finit par valoir pour la chose infime et singulière. Au contraire, à partir d’un point de vue retourné, en négatif, c’est cette fois une totalité, différenciée et pourtant homogène dans sa texture de réalité, qui se trouve retrouvée. Paulhan peut ainsi dire que la pensée est susceptible de s’échanger avec la chose dans la perception d’un fond, d’une obscurité ultime à partir de laquelle la clarté de ses déterminations constitue celle des choses elles-mêmes. Parvenue à un certain stade, à la faveur d’une certaine intensité – qui est celle de l’attention désorientée – la pensée (car il ne reste qu’elle dans cette scène où les choses se découvrent sans être jamais perçues par les sens) se révèle n’être que pure perspective, point focal à partir duquel toute autre pensée – pensée de la table, de l’armoire, de la brique – se trouve de même valeur que la chose, de même poids et de même certitude qu’elle. Il ne s’agit pas là d’un contenu, moins encore d’une pure faculté : c’est le fondement même d’un processus de transparence aux choses qui, pour s’accomplir, a dû trouver le point aveugle qui le rend possible.
De cette reconnaissance d’un pôle d’obscurité de la pensée, à partir duquel se laisse discerner la possibilité de son échange avec la chose, Paulhan tire une conclusion sur le récit même de cette pensée. C’est pour en constater le fort taux d’erreur, chaque fois qu’une expression qui laisse croire au récit d’une genèse de la pensée se trouve utilisée.
« Partout où je disais (ou je laissais entendre) : “je pensai, je formais l’idée, j’eus la pensée”, il conviendrait mieux de dire : les choses s’imposèrent à moi, le monde reflua sur moi, l’extérieur me bouscula, me brutalisa.[10] »
La raison en est que genèse et récit s’appellent mutuellement. Or c’est tout l’inverse qui s’est passé : non pas genèse d’une pensée à partir de la perception, mais découverte des choses, recommencement de cette perception à partir d’une pensée laissée à elle-même, et qui découvre, au lieu du solipsisme attendu, un réalisme profond. Paulhan met donc en œuvre une déstabilisation d’un procédé d’énonciation, celui du récit heuristique, celui de la narration d’une découverte. Comment ne pas y voir, en profondeur, une ultime rupture avec le genre philosophique, tel que l’illustre, par exemple, le dispositif narratif des Méditations métaphysiques, dans lesquelles la découverte spéculative est le dernier moment d’un processus intellectuel d’analyse et d’élucidation ? Par le thème de l’obscur, Paulhan fait voir un autre régime que celui de l’énonciation philosophique : non pas récit, odyssée (avec son passage obligé d’une descente dans les enfers du doute hyperbolique et du Malin Génie), initiation d’une pensée dans sa recherche du monde qui l’entoure, dans son retour au bercail des choses ; mais, au contraire description d’une expérience dans laquelle la pensée et le monde s’effectuent ensemble dans une même perception, se donnent pour équivalent dans un même retournement ; dans laquelle la pensée ne s’ouvre pas ultimement sur les choses, mais se donne simultanément avec elles, à partir d’un point zéro, d’une obscurité. La notion de perspective suppose alors celle de tache aveugle, plus originaire qu’elle, et qui instaure, dans la dramaturgie métaphysique, un point de passivité, d’absence, de silence, de non-visibilité – une stase, qui en invalide le statut discursif.
5. Le rationalisme paradoxal
Dans une lettre de 1946 au philosophe Yvon Bélaval, spécialiste de Leibniz et correspondant de Paulhan depuis 1944, Paulhan écrit :
« Que vaut la méthode dont je me sers ? C’est une méthode que l’on est tenté d’abord d’appeler rationaliste : puisqu’il s’agit de former touchant les Lettres un ensemble d’hypothèses et d’idées précises, cohérentes, vérifiées par l’observation. Bien. Cependant je n’ai pas plus tôt dégagé ces hypothèses (ou à proprement parler, ces lois) que je me vois contraint, par certaines bizarreries qu’il me faut leur reconnaître, à me poser plus loin ce nouveau problème : à quelles conditions puis-je admettre les diverses hypothèses et précisément penser les diverses lois, qu’il m’a été donné de dégager ? Si vous aimez mieux : à quel prix de l’intelligence peut-on, en de telles matières, être rationaliste – être raisonnable.[11] »
Rationaliste, Paulhan l’est assurément, par son attention portée aux expériences concrètes, par le souci de l’observation, du classement, de la nomenclature, et également par le thème intellectualiste de la pensée. Dans le même temps, ce rationalisme se retourne en paradoxe tant l’attachement aux obstacles, l’écriture fragmentaire, le refus obstiné de souscrire à toute thèse qui ne puisse être renversée en son contraire, structurent la réflexion paulhanienne et en perturbent la lecture la plus systématique. C’est pourquoi cette étiquette d’allure philosophique, Paulhan ne peut que la présenter à son interlocuteur comme une concession : « si vous aimez mieux ». Et c’est pour aussitôt la mettre en balance avec une autre, d’apparence plus modeste : être rationaliste, être raisonnable. C’est dans cet échange toujours possible entre deux positions adverses que doit sans doute se situer une lecture philosophique de Jean Paulhan. De l’attitude philosophique à l’attitude ordinaire, de la perspicacité spéculative à la vigilance raisonnable, il s’agit pour elle d’en examiner les diverses figures, équivalence, alternative, correction – comme si le raisonnable devait toujours fournir une position de repli favorable pour un rationalisme dont le prix s’avèrerait trop grand.
On a vu que cette question du prix était centrale dans la conception paulhanienne de la réflexion et de la pensée. Elle signale à première vue une défiance, une réserve – mais tout autant, et peut-être surtout, le constat que le geste philosophique n’est pas un geste sans conséquence pour l’intelligence. Il l’engage certes à une certaine méthode, à une rigueur spécifique. Mais ce sont là deux exigences qui ne vont pas sans reste, sans abandons, sans dommages. Le geste philosophique n’est certainement pas anodin, mais, de surcroît, il est loin d’être inoffensif, et cela, pour l’esprit même qui s’y livre. Soit, mais de quel point de vue ? Comment, avec quels moyens, et surtout dans quelle perspective ce prix à payer pour la philosophie peut-il être mesuré, évalué, pesé ? Ce qui revient à dire : quelle conception de la philosophie sera le plus à même de rendre possible cette mise à distance d’un rationalisme comme option et comme coût ?
La lecture de Paulhan n’engage donc pas la question classique de l’alternative entre ce qui est philosophique et ce qui ne l’est pas. Elle engage la question d’un rapport à la philosophie que celle-ci, et sans doute aussi pour elle-même, gagnerait sans doute à mieux comprendre.
Thibaut Sallenave (Paris 1 – PhiCo-ExeCo)
Fernandez (Ramon), « Les Fleurs de Tarbes, par Jean Paulhan », La Nouvelle Revue Française, n° 333, Novembre 1941, p. 595-602.
Pascal (Blaise), Pensées (1670, posth.), Gallimard, 1977, éd. Michel Le Guern.
Paulhan (Jean) et Bélaval (Yvon), Correspondance Jean Paulhan – Yvon Bélaval 1944-1968, Paris, Gallimard, coll. « Les Cahiers de la NRF », 2004, éd. Anna-Louise Milne.
Paulhan (Jean), Œuvres complètes IV, Paris, éditions Claude Tchou, 1966 :
« Bernard Groethuysen » (1945), p. 143-146 ;
—, La Vie est pleine de choses redoutables, Paris, Éditions Claire Paulhan, 1997 ;
—, Le grand scandale de la philosophie, Paris, Fata Morgana, 2006 ;
—, Œuvres complètes II. L’art de la contradiction, Paris, Gallimard, 2009, éd. Bernard Baillaux :
« Traité des figures ou la Rhétorique décryptée » (1949), p. 277-321 ;
—, Œuvres complètes III. Les Fleurs de Tarbes, Paris, Gallimard, 2011, éd. Bernard Baillaux :
Les Fleurs de Tarbes ou la Terreur dans les Lettres (1941), p. 107-202 ;
Lettre à Maurice Nadeau (1953), p. 399-414 ;
Le Clair et l’obscur (1958), p. 444-473.
Proust (Marcel), À la recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 4 volumes, 1987-1989.
[1] Le grand scandale de la philosophie, Paris, Fata Morgana, 2006 (N. B. : le texte de Paulhan qui a servi de matière à cette édition ne comporte pas de titre ; celui-ci procède l’éditeur) ; Le clair et l’obscur (1958), in Œuvres complètes III, op. cit., p. 444-473.
[2]Le grand scandale de la philosophie, op. cit., p. 9.
[3] Ibid., p. 11-13.
[4] Ibid., p. 15-16.
[5] Le Clair et l’obscur, op. cit., p. 445
[6] Ibid.
[7]Ibid., p. 445-446.
[8] Ibid., p. 448.
[9] Ibid., p. 449.
[10] Ibid., p. 468.
[11]Correspondance Jean Paulhan – Yvon Bélaval. 1944-1968, Paris, Gallimard, coll. « Les Cahiers de la NRF », 2004, éd. Anna-Louise Milne.