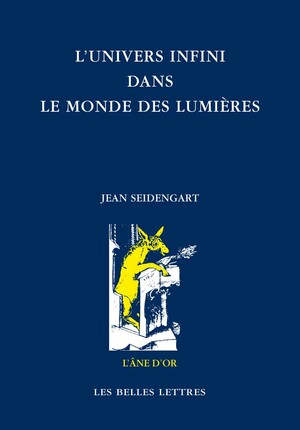Renversements du clair et de l’obscur : le rationalisme paradoxal de Jean Paulhan, esquisse.
Première partie de l’article Renversements du clair et de l’obscur : le rationalisme paradoxal de Jean Paulhan, esquisse. 
De Jean Paulhan, la figure de l’éditeur, du directeur de la Nouvelle Revue Française, « sentinelle de la littérature[1] », a cessé d’effacer l’œuvre personnelle, longtemps résumée aux énigmatiques Fleurs de Tarbes (1941). L’édition des Œuvres Complètes chez Gallimard, sous la direction de Bernard Baillaux, vient d’atteindre son troisième tome, livrant progressivement à une lecture toujours déroutante la masse des textes paulhaniens – la masse ou plutôt, selon l’expression de l’éditeur, « l’archipel ».
Reste, pour un public philosophique, à éclaircir le type d’entente dont cette œuvre peut faire l’objet ; et les malentendus, inévitables, qu’elle ne peut manquer de faire naître et qui, pour être juste, semblent délibérément suscités par son auteur lui-même. Les provocations de Paulhan par rapport à la philosophie sont toutefois beaucoup plus qu’une simple désinvolture. À la rigueur, elles rendent caduque l’alternative entre ce qui est déjà philosophique, déjà travaillé de philosophie, et ce qui se définit contre elle. Car le critère du philosophique et de l’extra-philosophique n’est pas de ceux que retient Paulhan, qui lui apparaissent comme un préalable. Faire autre chose que de la philosophie, ou faire de la philosophie autrement, ce sont là deux positions qui circonscrivent bien mal les contours de la réflexion paulhanienne : elles n’en forment que deux options, deux possibilités qu’elle n’a pas jugé intéressant de prendre. Laissons donc de côté la question de savoir qui, de la critique ou de la philosophie, fonctionne chez lui comme un masque, pour nous efforcer de cerner, sinon la cohérence, du moins les lignes de force d’une entreprise à laquelle l’étiquette, fort vague, de « rationalisme », ne fut jamais par lui que concédée. Cela n’interdit pas la tâche de comprendre selon quel rapport à la philosophie une telle réflexion s’est tenue pour possible.
1. Paulhan et les philosophes
Paulhan a reçu une formation philosophique, par son père, le philosophe Frédéric Paulhan, et à l’Université. Il s’y confronte au clivage qui traverse la philosophie « 1900 ». La psychologie associationniste de Théodule Ribot, fondateur d’une chaire de psychologie à la Sorbonne puis au Collège de France, auteur des Maladies de la mémoire en 1885 et d’une Psychologie des sentiments en 1896, en constitue l’un des versants, couramment associé à une forme de scientisme, qu’il faudrait plutôt considérer comme un positivisme et un expérimentalisme. Paulhan en partage les références avec son adversaire des Fleurs, Rémy de Gourmont, qui avait utilisé les thèses de Ribot sur la mémoire pour formuler sa théorie du cliché dans l’Esthétique de la langue française en 1899. L’autre versant est tout entier occupé par la philosophie de Bergson, dont le second grand livre, Matière et Mémoire, paraît la même année que la Psychologie des sentiments de Ribot. L’ascendant du bergsonisme sur la littérature et la critique de l’époque (Paulhan a côtoyé à la N.R.F. son plus illustre représentant, Albert Thibaudet) constitue l’une des clés de la réflexion paulhanienne sur la Terreur : il l’en proclame « philosophe officiel » dans les Fleurs de Tarbes. Ces deux mouvements se partagent la critique d’un héritage kantiste qui constitue l’une des nombreuses références « en clins d’œil » de l’œuvre de Paulhan. La Petite Préface à toute critique (1950) fait clairement signe vers les Prolégomènes à toute métaphysique future : la question de la critique et de sa possibilité attire évidemment Paulhan sur ces terres. Mais, par rapport au tribunal de la raison des trois Critiques, l’entreprise paulhanienne est à la fois plus restreinte et plus distanciée : ce n’est plus sur la raison elle-même que la critique porte, mais sur les œuvres ; et ce sont les jugements, opinions, évaluations, conceptions touchant les Lettres que Paulhan se propose à son tour de classer et de juger. De sorte que l’œuvre de Paulhan constituerait les fragments d’une Critique de la raison littéraire parodique, où ce serait la doctrine des apparences, des opinions et de leurs antinomies, qui en formeraient le couronnement – dernier et singulier avatar d’un néo-kantisme qui aurait successivement renoncé à l’Esthétique puis à l’Analytique.
Dans ce climat, Paulhan a voulu, à son tour, s’inscrire. Entre 1906 et 1909, il rédige plusieurs comptes rendus et recensions pour le Journal de Psychologie normale et pathologique. En 1907, il publie dans la Revue philosophique de la France et de l’étranger un court et singulier article, « L’imitation dans l’idée de moi ». La même année, un échec à l’agrégation de philosophie le pousse à prendre le bateau pour Madagascar, où il s’initie à la littérature et à la parémiologie locale. Inflexion considérable : à son retour à Paris, Paulhan dépose un sujet de thèse auprès d’Antoine Meillet, en charge de la chaire de grammaire comparée au Collège de France, et maître de la génération des Benveniste, Tesnière et Gustave Guillaume. Il se plonge dans l’étude et la lecture : il assiste ainsi au commencement d’un véritable moment linguistique de la philosophie française, où la référence à Saussure prend une importance considérable. L’histoire de cette thèse, qui devait s’intituler Sémantique du proverbe, est toutefois celle d’un abandon progressif, dont le journal de Paulhan[2] trace le compte-rendu. La recherche paulhanienne connaît en effet de brusques embardées. Elle peine à se soumettre aux exigences universitaires, prise dans la force centrifuge de références toujours plus larges et, à bien des égards, inhabituelles.
Car la culture philosophique de Paulhan multiplie les références les plus disparates : la philosophie de la Renaissance, l’empirisme écossais et français du XVIIIe siècle, et même les sagesses orientales, qui prennent, à partir de 1950, une place de plus en plus importante dans son œuvre. Le goût paulhanien des petits textes, des auteurs mineurs voire inconnus, des citations énigmatiques et parfois apocryphes, fonctionne comme effet de dispersion de la tradition philosophique, qui interdit de situer la réflexion de Paulhan dans le cadre d’une quelconque « actualité ». À la hiérarchisation des textes, des doctrines ou des grands problèmes philosophiques, Paulhan fait subir une sévère déstabilisation, destinée à les ramener tous sur un plan unique : celui de l’observation. Le montage, le puzzle, le collage des références forment en effet l’étape préliminaire et la surface d’un programme beaucoup plus profond, que Paulhan énonce en 1953 dans la Lettre à Maurice Nadeau :
« Ce que je tâche de mener à bien depuis pas mal d’années, c’est une sorte de nomenclature, ou de caractéristique des Lettres, où les opinions diverses, qui ont eu cours de tout temps sur la littérature, se trouveraient réunies, classées, confrontées, ce serait peu : jugées (dans la mesure du possible) sur leur exactitude. (…) Il se trouve, en gros, que ces opinions se partagent en deux groupes. Tantôt en effet, le critique tient que le fond entraîne la forme, et qu’on écrit toujours assez bien quand on a quelque chose à dire. Tantôt que la forme guide le fond, et que la pensée vient toujours habiter la demeure qu’un soin suffisant lui a ménagée. Ainsi, les uns admettent – avec tous les Classiques et les Rhétoriqueurs – que l’esprit procède du langage (…). Mais les autres – avec les adversaires de la Rhétorique : Romantiques, Terroristes – que le langage n’est bon qu’à opprimer la pensée, et que l’œuvre rhétoricienne, trop soumise aux règles, a le grand tort d’être fausse, abstraite, et banale[3]. »
La classification des diverses opinions suppose donc l’élimination de leur historicité et la déstructuration des traditions auxquelles elles appartiennent. Il suffit de les traiter en extériorité, dans l’horizontalité d’une perspective partes extra partes, comme des spécimens. Peu importe qu’il existe une distance intellectuelle plus grande entre un Platon et un Bergson qu’entre un Bergson et un Alain. Dans la « caractéristique » paulhanienne, il n’y aura aucun inconvénient à ranger les deux premiers dans la catégorie des « Terroristes », et le second dans celles des « Rhétoriqueurs ». C’est dans l’optique taxinomiste, et non dans celle de l’historien de la philosophie, que se peuvent isoler des caractères communs, malgré deux mille ans de distance, et des discontinuités sans retour, en dépit de la contemporanéité. La conséquence d’un tel traitement est que l’observation n’a pas à s’attacher aux distinctions traditionnelles, en particulier génériques : les opinions des écrivains, des critiques et des philosophes restent opinions, et n’ont pas à faire l’objet de classements séparés. Du coup, on comprend mieux le statut de la référence philosophique chez Paulhan, et de son apparente désinvolture : dans la recomposition nomenclaturale des opinions, la philosophie cesse de se prévaloir d’une autonomie ou d’une autorité quelconque : le caractère philosophique d’un jugement perd toute pertinence du point de vue des critères de classification retenus. Si cela ne signifie certes pas qu’une opinion philosophique sera jugée de moindre valeur qu’une autre, la philosophie n’ajoute pourtant rien, aucun crédit, aucun prestige, aucun supplément de rigueur ou de profondeur, en un mot, aucun statut d’exception dans la grande entomologie paulhanienne des opinions.
À cet égard, il est difficile de ne pas songer à Pascal, et nombre de concepts paulhaniens – renversement, misère, point de fuite – se colorent d’une référence à l’auteur des Pensées. En substituant les « opinions des philosophes » à l’ « opinion de la philosophie », c’est l’idée d’un régime de véracité propre à cette dernière qui se trouve remis en question. Mais, comme chez Pascal, la question cruciale de la juste perspective ne manque pas de se poser : « en vérité et en morale, qui l’assignera ?[4] » La neutralisation d’un concept de « point de vue » spécifiquement philosophique se paie d’une difficulté à déterminer le point depuis lequel ces opinions se laisseront étaler selon une perspective tabulaire.
2. D’une « dialectique » des opinions
Cette difficulté peut être reformulée de la façon suivante : l’idée d’une nomenclature des opinions suppose la constitution d’un ordre autonome de l’observation, c’est-à-dire la définition d’une méthode et de critères qui, bien qu’ils puissent s’y appliquer, ne soient pas tirés des manières dont les opinions elles-mêmes se conçoivent les unes par rapport aux autres. Or c’est un fait tout simple, et pourtant éclairant, que des opinions ne se considèrent jamais comme telles : leurs prétentions sont plus élevées. Et, pourrait-on ajouter, il semble même que ce soit à cela qu’on les reconnaît. Le problème posé glisse alors – ou plutôt, rétrocède – de la question de la perspective générale, surplombante, sur les opinions, à la question préalable de leur authentification. Du même coup, ce n’est plus exclusivement le mécanisme de l’opinion « en littérature », de la thèse ou de la doctrine littéraire qui se trouve au cœur des analyses. C’est l’opinion en général qui retient l’analyse de Paulhan ; non pas la simple croyance ou la représentation collective, mais les diverses figures sous lesquelles une pensée, quelle qu’elle soit, se trouve avancée, soutenue, défendue. Le terme de « dialectique » pourrait ici être avancé, si on l’entend dans son sens aristotélicien : une étude des opinions admises, des thèses reçues, des propositions « probables », bref, des endoxa. Mais encore faut-il pouvoir repérer le terrain où de telles opinions ont cours, leur lieu et leurs conditions d’exercice. De la sorte, la réflexion paulhanienne s’élargit d’une évaluation de la critique à l’analyse de la conversation, de l’échange verbal, de la dispute.
Dans la douzième section de la Lettre à Maurice Nadeau, significativement intitulée « Questions de méthode », il remarque
« que les observations et les doctrines qu’il s’agit de démêler offrent – à côté de leur part purement abstraite et intellectuelle – on ne sait quoi d’avantageux et de convaincant. Elles nous séduisent dès l’abord, sitôt exprimées. Elles semblent nous révéler quelque loi du monde. Bref, elles ont toutes l’apparence d’un argument[5]. »
Une telle affirmation semble à première vue ne recouvrir que la thèse traditionnelle d’une impossible impartialité. Poussée jusqu’à son terme, elle semblerait conduire à juger illusoire l’idée d’une perspective juste sur les opinions. Mais le propos de Paulhan est tout autre : ce n’est pas que l’impartialité du classement soit une difficulté insoluble, c’est plutôt que tout effort d’impartialité dans l’examen d’une opinion présente un risque : celui de négliger un aspect incontournable de celle-ci, à savoir sa « partialité » ; c’est-à-dire son orientation propre, la force de conviction en faveur d’une certaine conclusion qui fait intrinsèquement partie d’elle ; bref, son aspect fondamentalement « argumentatif ». Le « positivisme des opinions » ne rencontre donc pas une limite dans l’observateur, mais dans la précision même de l’observation à laquelle il prétend. Poussé jusqu’à son terme, l’examen attentif des opinions ne peut faire l’économie de leur caractéristique principale, à savoir leur séduction. Cela signifie-t-il qu’on ne peut convenablement traiter en opinions des thèses et des doctrines qu’en s’y abandonnant tour à tour ? Certaines affirmations de Paulhan semblent devoir aller dans ce sens, : ainsi ne cesse-t-il pas de répéter que l’observateur, jusqu’à un certain point, ne peut se différencier de l’observé[6]. Mais si cela est exact, l’argument ressemble à un sophisme : car la reconnaissance d’une part argumentative essentielle à la notion d’opinion ne suppose pas qu’on y doive succomber. Or, la thèse de Paulhan est légèrement différente : le caractère avantageux d’une opinion doit constituer le point de départ de son analyse, et non son terminus ad quem. Que toute opinion nous présente une certaine pente, que toute pensée se présente avec un avantage n’exclut qu’à l’intérieur même de cette séduction, de ce charme, il soit impossible de procéder avec rigueur. Ce qui signifie qu’il faut prendre au sérieux son caractère de conviction, et se montrer en mesure de le détecter.
Mais ce n’est pas par l’analyse et la thématisation d’une certaine « force » des énoncés ; c’est plutôt par l’obligation de considérer les contextes dans lesquels surviennent ces phénomènes de séduction des opinions. Tel est le « second point » de la méthode énoncée dans la Lettre, et qui suit l’extrait mentionné :
« Voici le second point : c’est qu[e les opinions] possèdent cet avantage sans pour autant relever – du moins en apparence – des catégories de la logique classique. Mais tout se passe comme s’il y avait lieu de considérer, à côté de cette logique (et, dans une certaine mesure, contre elle) une ou plusieurs logiques appliquées ou brutes, dont relèveraient – plutôt que les philosophies et les sciences – les querelles de ménage, la propagande politique et la publicité des grands magasins[7]. »
Là encore, le malentendu se nourrirait aisément de cette revendication d’une logique appliquée : Paulhan semble bien envisager une logique particulière aux opinions, qui s’opposerait à la logique classique. Logique doxique, pourrait-on dire, mais à laquelle manquerait pourtant un préalable de taille : à savoir la définition d’une opinion, sa délimitation nette en propositions, la spécification du type de connecteurs qui lui seraient propres. Or un examen plus attentif montre que ce n’est pas exactement là que porte l’argument de Paulhan. Le thème d’une logique appliquée ne fait pas tellement fond sur l’idée d’un régime de preuves alternatif à la logique classique, mais plutôt sur les conditions d’exercice de ces preuves, sur les circonstances dans lesquelles elles sont utilisées ou encore, ce qui vaut comme preuve dans tous les cas où des opinions et des arguments se trouvent mobilisés. Bref, il n’y a pas à attendre de la « logique brute » qu’elle définisse a priori le caractère doxique ou non d’une proposition isolée : c’est ce qui peut être considéré ou non comme opinion, ce qu’il peut y avoir du sens à traiter en argument dans des contextes correctement décrits, qui constituera son objet d’étude privilégié. Il ne s’agit donc pas de substituer à l’édifice de la logique « classique » une poussière de logiques particulières, mais d’examiner les cas précis, les circonstances déterminées, les expériences du langage dans lesquelles les notions de preuves, d’arguments, et de conviction propres au phénomène de l’opinion prennent un certain sens pour ceux qui les emploient. Les termes de « logique brute » et de « logique appliquée » renvoient ici à une logique véritablement « expérimentale » : la, ou les logique(s) telle(s) qu’on peut l’/es extraire de la conversation, de la querelle, de la propagande. Dans l’étude du phénomène de l’ « opinion », il est clair que la construction de catégories générales, descriptives ou prescriptives, s’efface devant l’exigence de considérer les exemples, les cas particuliers, les véritables « situations » dans lesquelles l’opinion fonctionne comme telle, c’est-à-dire fonctionne avant tout comme argument.
Pour quelle raison parler encore de logique dans ces conditions ? La raison en est que pour Paulhan la logique « classique » ne s’oppose pas aux logiques « appliquées » sur le modèle de l’opposition entre logique formelle et langage naturel. Il est clair que Paulhan fait fond sur une conception tout à fait préfrégéenne de la logique. C’est la Logique de Port-Royal qui sert ici de modèle à la compréhension du terme de « logique », beaucoup plus que la Begriffschrift de Frege. La logique n’est pas autre chose que la discipline qui prend en considération le phénomène de la conviction, de l’inférence qui s’impose, de la preuve « efficace ». Par conséquent, la « logique brute » qu’il paraît appeler de ses vœux ne s’oppose à la logique classique qu’en raison de ses conditions d’application, et de la méthode de son extraction : il s’agit non pas d’analyser la force de conviction d’une proposition isolée, mais de montrer comment dans une « situation de langage » donnée, quelque chose comme de la conviction peut sembler être en jeu. C’est ce que montre fort clairement le troisième point de méthode évoqué dans la Lettre :
« Voici le dernier point : si profondément qu’elles diffèrent de la logique classique, ces logiques diverses ne s’adressent pas moins en nous à un sentiment d’évidence immédiate ou de nécessité – fort proche de celui qui nous irrite ou nous enchante au contraire devant un mot nouveau, une faute de français. Bref, comme il y a une grammaire des mots, il doit exister une grammaire des idées, qu’il nous resterait à constituer[8]. »
On touche ici au centre névralgique de la réflexion paulhanienne. Les opinions se présentent comme des arguments du fait de leur séduction, en raison de la conviction qu’elles emportent ou non, mais qui constituent leur caractère le plus essentiel. Or, c’est un fait qu’en cela, les opinions se présentent à nous avec la même force d’enchantement que certains mots. Pas n’importe lesquels, cependant : Paulhan retient ici la figure du mot « nouveau » ou de la « faute de français ». Ce qui l’intéresse, ce sont les cas où ces « nouveautés » ou ces « fautes » se présentent à nous comme quelque chose d’intéressant, de remarquable, de mystérieux. On pourrait songer aux fautes de français commises par Françoise dans la Recherche du Temps perdu qui font l’enchantement du Narrateur, non seulement par la curiosité de l’idiolecte, mais par les étranges raccourcis de sens auxquels ils procèdent[9]. Cette proximité nourrit le projet d’une « grammaire des idées » comparable à celle de la grammaire des mots. Mais il serait tout à fait erroné de croire qu’elles seraient pourtant identiques. Car Paulhan ne soutient pas la thèse d’une parfaite adéquation entre les mots et les idées. Ce qui retient son attention, ce sont précisément les cas favorables dans lesquels mots et idées nous semblent parfaitement retournables, échangeables. Mais il ne s’agit précisément que de cas favorables ; ce qui signifie qu’une telle adéquation ne peut être posée au principe de l’examen du rapport entre les pensées et les mots. Certes cet examen devra partir de ces cas où les mots semblent nous offrir une juste perspective sur les pensées ; c’est-à-dire tous les cas où nous sommes habilités à traiter les mots en pensées. Mais les autres cas n’en seront pas moins intéressants : car ils nous renseigneront sur les phénomènes d’apparente distance entre la pensée et les phrases, ils nous apprendront les raisons pour lesquelles c’est aussi quelque chose que nous faisons avec les mots que de leur refuser le statut de « pensées ».
La « dialectique » des opinions, qui part du constat que la dimension de conviction, de séduction, d’enchantement, leur est intrinsèque, aboutit donc à la formulation d’un problème d’allure extrêmement classique, et profondément philosophique : celui du rapport entre langage et pensée. Mais le vocabulaire de Paulhan doit ici alerter sur le type d’inflexion qu’il lui fait subir : ce n’est pas la pensée en général, mais les « idées », les « opinions », c’est-à-dire ces pensées singulières, en acte, identifiables et délimitables. De même, ce n’est pas le langage qui doit être examiné, mais les phrases, les mots, les tournures, c’est-à-dire là encore des singularités, des expériences concrètes, des situations complexes. C’est dire si la question d’un tel rapport ne peut se poser en général. Et c’est également poser le problème sous un angle très particulier : celui d’une interrogation primordiale sur l’efficacité des pensées et des mots, sur les circonstances particulières dans lesquelles l’efficacité des uns nous donne l’efficacité des autres.
3. Vers une rhétorique décryptée
La difficulté de la méthode recherchée par Paulhan tient à son attachement à la notion d’obstacle. Obstacle d’opinions toujours séduisantes, toujours efficaces là où le critique revendique une stricte impartialité ; obstacle de pensées toujours singulières, sur lesquels vient buter la quête d’une généralité intelligible ; obstacle du langage, dont les mots et les phrases ne nous délivrent jamais l’assurance d’un rapport stable du mot et de l’idée, là où pourtant des traits communs devraient pouvoir nous guider. Mais ces obstacles ne tiennent pas à un défaut de la méthode ; ils tiennent aux objets considérés eux-mêmes. Tel est le pari de Paulhan que ces obstacles sont précisément ce à quoi doit s’attacher la méthode, parce que c’est de la sorte qu’elle gagnera en justesse, et parce que l’obstacle signale quelque chose à penser, à mesurer, à peser, à retenir.
Dans un hommage au philosophe et ami Bernard Groethuysen, Paulhan écrit : « Il tenait que chaque pensée mendie d’être repensée[10] ». Cette phrase résume assez bien la conception de la pensée propre à Paulhan, la seule qui soit de nature à pouvoir nous guider dans l’examen de sa singularité et de son fonctionnement. La pensée selon Paulhan est fondamentalement quelque chose qui se trouve et qui se réeffectue. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’y a pas là une affirmation de l’objectivité de la pensée, la thèse d’une pensée-objet. C’est au contraire une telle illusion qui est l’objet de la critique, et qu’on rencontre dans la thèse d’une extériorité de la pensée à l’égard du pensant, et dans celle d’une genèse psychologique de celle-ci. Dans les deux cas, c’est la même chose qui se trouve postulée : une nature différente de la pensée pensante et de la pensée (pourrait-on dire) pensée, comme s’il fallait en dupliquer le terme pour en rendre plausible l’exercice convenable. Or la pensée n’est ni contenu, ni visée d’une entité différente d’elle. Elle est le développement, l’étude, l’analyse d’une opinion, dans laquelle l’observateur n’a pas d’autre choix que d’en respecter la morphologie et la structure, y compris – et surtout – dans les « accidents » de parcours, les sinuosités qu’elle présente. Tel est, rigoureusement, le sens de l’activité du « penser ». La pensée paulhanienne possède en elle-même un certain degré d’organisation, de robustesse, de cohérence qui donne l’illusion de l’objectivité ou de la fixité aussi longtemps que l’on n’a pas commencé d’en suivre le rythme propre. La conséquence en est que l’examen d’une pensée ne peut se prévaloir d’aucune distance par rapport à elle, que l’observation ne peut se différencier de l’observé. Mais ce n’est pas au sens où toute « réflexion » serait impossible. C’est en raison du fait qu’il n’y a aucune appréhension autonome de la pensée, aucune perception de la pensée qui ne soit par la pensée, et donc de la pensée elle-même. Du même coup, il y a fort à parier que les obstacles que nous rencontrons dans leur examen ne puissent être levés autrement qu’en la poursuivant, en la prolongeant. L’obstacle, le nœud, l’apparente incohérence, la difficulté ne signalent donc pas une limite de l’observateur – tout au plus une résistance –, mais un certain dénivellement, un accident de terrain qui fait partie de la pensée elle-même, qui appartient à sa structure, et dont le contenu est évidemment différent de pensée en pensée. L’analyse de la pensée ne garantit donc aucune progression linéaire de son intelligibilité ; rien ne dit que la poursuite d’une pensée la fera gagner en clarté dans le déploiement expressif de ses plis. C’est même tout le contraire : nous sommes forcés d’assister à ses caprices et ses imprévus, dans une dynamique qui relève de la transformation plutôt que de la progression, un peu à la manière d’un origami. Telle est la force de conviction d’une pensée, qui tient à sa pente naturelle, à la nécessité de l’emprunter pour la comprendre.
Une telle conception suppose donc que soit fermement combattue l’illusion d’une pensée fixe, arrêtée, chosifiée. Mais c’est tout le propos de Paulhan que d’établir qu’une conception dynamique du penser procède moins à la rectification des illusions qu’au dévoilement d’un régime d’illusions placé en son cœur même. Ces illusions sont intrinsèques à la pensée, elles relèvent de sa séduction. C’est pourquoi il n’y a pas d’autre choix que de les déployer, avant que de chercher à les rectifier. La rectification des illusions – et, par conséquent, la possibilité de juger correctement une pensée – ne survient qu’au stade dernier de son développement, parce que c’est à se stade seulement qu’elle se met à sécréter le point de vue sous lequel ces illusions se révèlent comme des illusions. Commencer à penser, c’est procéder à la dissolution des premières illusions, liées à la fixité des pensées-choses. Mais cela ne mène qu’à l’étape vertigineuse où, nous enfonçant dans leur matière meuble, la pensée ne se donne plus que comme illusion. Cette phase dynamique est la plus redoutable, mais aussi la plus nécessaire au correct accomplissement de l’activité de la pensée : nulle position semble n’y être tenue que pour aussitôt être renversée en son contraire.
Il apparaît donc qu’à chaque pensée correspond un type de développement dont on ne peut établir les règles avant que d’en avoir fait l’épreuve, et dans laquelle les illusions ont leur compte.
Reste une difficulté majeure : comment repérer une pensée ? Qu’est-ce qui nous donne la pensée comme telle ? Où trouve-t-on des pensées ? La réponse de Paulhan doit ici être correctement entendue : c’est le langage qui nous donne accès aux pensées. Tel est le reproche que fait Paulhan, dans les Fleurs de Tarbes, à la Terreur : celui de refuser systématiquement que les mots puissent être de la pensée. Mais la thèse de la Terreur vient d’une remarque profondément exacte : c’est qu’il n’est pas vrai que tous les mots soient de la pensée. Et, en cela, contre son adversaire, la Rhétorique, elle a profondément raison. Les mots ne nous donnent aucun accès au monde invisible des pensées ; encore plus inexact serait de dire qu’ils se confondent avec elles. Paulhan met en ici en garde contre deux écueils. Le premier consiste à isoler dans deux règnes différents pensée et langage ; le second est celui qui identifie naïvement pensée et langage. En réalité, toute la question est d’interroger le langage au niveau, c’est-à-dire, sous une certaine perspective, dans lesquels la pensée, dans tout le mystère de sa singulière logique, se révèle ; dans lesquels, loin de nous la dissimuler, le langage nous la donne, mais dans son véritable fonctionnement, c’est-à-dire non comme objet, mais comme activité, à la fois structurée et déroutante. Il y a une perspective dans laquelle la pensée nous paraît n’être que phrases (ainsi la Terreur perçoit-elle le cliché, le lieu commun, le proverbe) et une autre dans laquelle une phrase semble renfermer la totalité d’une pensée (telle est, en politique, le statut du grand mot : démocratie, monarchie, liberté, etc.). Or toutes deux sont profondément inexactes, parce qu’elles traitent le langage en simples phrases, ou les mots en (courtes) pensées. Elles partagent ce présupposé de faire du mot ou de la phrase la « chose » qui nous est donnée, l’objet que nous appréhendons – soit pour lui donner la figure d’une pure matérialité sonore, soit d’une pensée-chose, c’est-à-dire d’une illusion de pensée. La vraie perspective est ailleurs : elle se trouve dans une certaine manière de percevoir le mot et la phrase comme une authentique pensée. Tout est dans cet adverbe : les mots ou les phrases valent comme des pensées, peuvent être traités comme telles, non pas au motif qu’ils la renfermeraient, mais qu’il y a des circonstances dans lesquelles nous avons toutes bonnes raisons de procéder à cet échange. La valeur noétique du mot est profondément, essentiellement fiduciaire ; mais le cours auquel il peut être échangé avec la pensée n’est point fixe. C’est donc ces cas dans lesquels les mots peuvent être échangés avec de la pensée qu’il faut étudier.
La raison en est que c’est avec eux que le langage nous apparaît obéir au même fonctionnement paradoxal, capricieux, équivoque que l’idée dont il est le signe. Ils nous délivrent la bonne perspective qui nous fait percevoir un événement de langage, qui est la trace d’un événement de pensée.
Or il est une discipline susceptible d’interroger le langage au niveau de problématicité dans lequel la complexité de la pensée nous apparaît soudain ; lorsque le langage, donc, se fait événement, occasion d’incertitude, problème. Cette discipline serait ce que Paulhan nomme, dans un essai de 1949, un « traité des figures » ou une « rhétorique décryptée »[11]. Cette rhétorique est « décryptée », car elle a rompu avec la thèse d’identification de la pensée et des mots qui présidaient, d’après Paulhan, aux anciennes Rhétoriques. Celles-ci avaient cru pouvoir fixer dans certains procédés de langage la garantie qu’une expression pourrait sembler efficace. La nouvelle rhétorique de Paulhan se présente comme un traité de l’événement du langage : la figure y est analysée non plus comme garantie offerte au discours de son intelligibilité en pensée, mais comme ce qui fait qu’une expression peut être reçue comme événement, trace, écho et impact d’une pensée. La figure est le nom d’une phénoménalité de la pensée à travers le langage ; à condition que ce phénomène soit compris comme fondamentalement incertain, équivoque, capricieux : car c’est ainsi qu’il authentifie qu’une véritable pensée, et non une illusion de pensée, une simple pensée-chose, la sous-tend. La rhétorique paulhanienne ne termine donc pas l’investigation des cas dans lesquels nous échangeons efficacement des mots avec des pensées – ces cas sont en nombre potentiellement infini – ; mais il évoque quelques-uns des traits les plus spectaculaires par lesquels le langage joue son rôle de phénoménalisation de la pensée :
« Les philosophes se sont demandés de tout temps s’il existait une pensée sans mots ; mais la Rhétorique, en retirant à cette pensée toute expression certaine et faisant en quelque façon à nos yeux vaciller le langage, nous débarrasse à sa manière du poids et des contraintes dont les mots pèsent sur l’âme.[12] »
Telle apparaît la figure : non pas une règle ou un stéréotype de l’expression, mais l’occasion d’un vacillement du langage, comme relai d’une incertitude fondamentale des détours de la pensée.
La thèse d’une inséparabilité du langage et de la pensée guide par conséquent la mise en œuvre du regard critique, ou plus exactement rhétorique, qui n’est pas simple examen du langage, mais attention au niveau de problématicité où celui-ci nous fait découvrir le régime véritable de la pensée. La méthode paulhanienne ne commence donc pas dans une esthétique, mais dans une rhétorique ; non dans la perception, mais dans la critique, non dans le phénomène mais dans la figure ; non dans l’invariant d’un contenu de pensée, mais dans la variation constitutive d’un événement de langage.
Thibaut Sallenave (Paris 1 – PhiCo-ExeCo)
[2] Jean Paulhan, La Vie est pleine de choses redoutables, Paris, Éditions Claire Paulhan, 1997.
[4] Pascal, Pensées, 19, éd. Michel Le Guern, Paris, Gallimard, 1977.
[5] Lettre à Maurice Nadeau, loc. cit., p. 411
[7] Lettre à Maurice Nadeau, loc. cit., p. 411
[8] Ibid.
[9] « “Mais enfin, lui demanda ma mère, comment expliquez-vous que personne ne fasse la gelée aussi bien que vous (quand vous le voulez) ? — Je ne sais pas d’où ce que ça devient”, répondit Françoise (qui n’établissait pas une démarque bien nette entre le verbe venir, au moins pris dans certaines acceptions et le verbe devenir). » À l’ombre des jeunes filles en fleurs, I, in À la recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1987, p. 476. V. encore Le Côté de Guermantes, I : « “La duchesse doit être alliancée avec tout ça”, dit Françoise en reprenant la conversation aux Guermantes de la rue de la Chaise, comme on recommence un morceau à l’andante. “Je ne sais plus qui qui m’a dit qu’un de ceux-là avait marié une cousine au duc. En tout cas, c’est de la même ‘parenthèse’. C’est une grande famille que les Guermantes !” ajoutait-elle avec respect, fondant la grandeur de cette famille à la fois sur le nombre de ses membres et l’éclat de son illustration, comme Pascal, la vérité de la religion sur la raison et l’autorité des Écritures. Car n’ayant que ce seul mot de “grand” pour les deux choses, il lui semblait qu’elles n’en formaient qu’une seule, son vocabulaire, comme certaines pierres, présentant ainsi par endroits un défaut qui projetait de l’obscurité jusque dans la pensée de Françoise. » Ibid., t. II, p. 322-323.
[10] Œuvres complètes IV, Paris, Tchou, 1966, p. 143.
[11] « Traité des figures ou la Rhétorique décryptée », Œuvres complètes II, op. cit. p. 277-321.
[12] Ibid., p. 321.