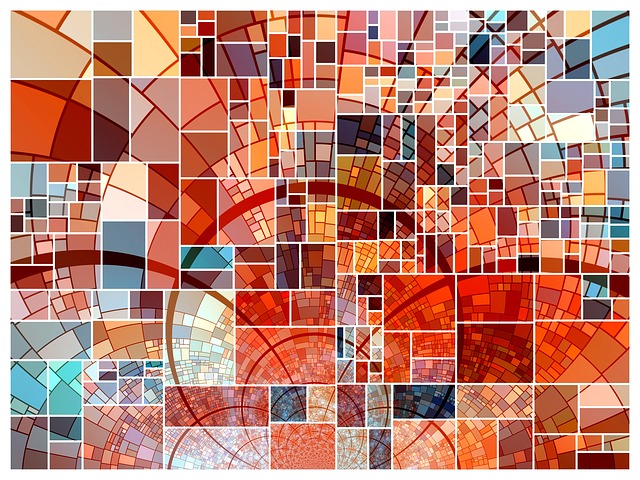Patočka et le paradoxe européen
Marion Bernard – Phico – Ater à l’université de Poitiers
« L’Europe – l’Europe occidentale surtout, mais aussi celle qu’on appelle « l’autre Europe » – est issue du soin de l’âme. Της ψυχης επιμελεισθαι[1] – voilà le germe dont est né ce qu’a été l’Europe. Bien sûr, l’Europe n’a pas été que cela. Il y a longtemps que le souci de l’âme a subi une singulière transformation, qu’il s’est pour ainsi dire estompé sous les alluvions de quelque chose qu’on pourrait appeler le souci, le soin de la domination du monde. C’est là une autre histoire, elle aussi unique, qui recèle le germe de ce qui s’est produit devant nos yeux : la disparition de l’Europe, vraisemblablement pour toujours »[2].
La première question à poser au philosophe qui, comme Jan Patočka, place l’Europe au cœur de ses réflexions est une question de légitimité : en quoi l’Europe est-elle un problème phénoménologique – et philosophique en général ? Dans les nombreux écrits que Patočka consacre à l’Europe – et qui se concentrent pour la plupart sur deux périodes différentes, années 1930-40, puis années 1970[3] – l’enjeu n’est pas celui du dessin factuel de ses limites géographiques, mais l’élucidation de son idée. Et considérer l’Europe comme idée est éminemment problématique. N’est-il pas suspect, voire dangereux, de distinguer une Europe de fait et une Europe idéale, ou encore de parler d’une essence de l’Europe ?
La réflexion philosophique sur l’Europe est prise dans un cercle caractéristique : d’un côté, il faut justifier l’érection de l’Europe comme objet digne de réflexion philosophique. En ce sens, il est tentant d’opérer un dédoublement de l’Europe, afin d’écarter sa figure empirique – insignifiante ou identitaire – au profit de « l’idéal européen », qui n’est autre que celui de l’humanité universelle. Le problème est que d’un autre côté, cet écart idéalisant annule, dans une dialectique d’auto-dépassement, l’objet « Europe » en tant que tel. Le premier paradoxe qui parcourt les analyses patockiennes est ainsi que l’Europe ne peut être objet légitime qu’en tant qu’elle s’annule comme objet – c’est-à-dire dans son identité particulière.
La seconde difficulté est liée au destin contemporain de l’Europe à l’ère planétaire : si elle constitue un objet de réflexion privilégiée, pour Patočka, c’est parce qu’elle a disparu alors même qu’il était impensable qu’elle disparaisse, et que le philosophe est l’héritier post-européen de ce drame. Quand Husserl, dans les années 1930, écrivait sur la crise de la spiritualité européenne – Patočka dans les années 1970 écrit sur sa disparition. « L’Europe, cette structure vieille de 2000 ans qui avait réussi à hisser l’humanité à un niveau tout à fait nouveau non seulement de conscience réfléchie mais aussi de force et de puissance, (…) cette réalité colossale a été liquidée définitivement en une trentaine d’années (…). Elle s’est détruite elle-même par ses propres forces »[4]. Son constat est clair : la mondialisation contemporaine ne correspond pas à une extension planétaire de l’idéal européen, mais à l’émergence d’autre chose, époque faite de fragments culturels divers, et dont le cœur spirituel n’a pas encore cristallisé en une unité véritable. Ce qu’il s’agit d’élucider, c’est alors le ratage fondamental de l’universalisme européen et de la rationalité qui le caractérise.
I. L’idée d’un privilège européen : de l’Europe empirique à l’Europe transcendantale.
Commençons par le versant en apparence le plus européocentriste des analyses patockiennes. Chez le jeune Patočka comme chez son maître Husserl, la réflexion est indéniablement normative : l’Europe n’est pas une identité particulière mais une valeur à défendre, car elle incarne non pas une forme culturelle déterminée, mais, précisément, l’apparition historique d’une culture universelle, c’est-à-dire rationnelle et suprêmement spirituelle. Le paradoxe de l’Europe universaliste est alors évidemment la tension entre la particularité de l’Europe, en tant que spiritualité identifiable et différente des autres, et sa prétention à porter le telos universel de l’humanité. Husserl écrit dans la Krisis :
L’Europe se signale parmi toutes les humanités jusque-là par le fait que sa particularité est la généralité : le généralement compréhensible, qui tend à s’étendre à tout et à tous, ne laisse rien en dehors de sa sphère, soumet la vie entière à une réflexion qui la passe au crible en retenant ce qui peut être vérifié et réalisé dans son cadre. Le rationnel compris en ce sens est ce qui distingue foncièrement l’Europe ; c’est ce qui, depuis les Grecs, porte le nom de logos, le sens partagé dans la communication de tous avec tous .[5]
De même, tout au long de l’œuvre patočkienne, la ratio restera la clé de la compréhension de l’idée européenne. L’Europe, dont la naissance coïncide avec celle de la philosophie et la politique grecque, est issue d’une modification de ce qu’est la culture en son essence : elle est la première forme culturelle qui ne soit pas appuyée dans son fondement sur une origine mythique insondable, première culture de la justification au présent de la théorie comme de la pratique. A travers la science : discours qui n’est pas transmis, mais conquis au présent par une vue dans ce qui est susceptible de s’imposer à tous ; et la politique : règles non plus respectées seulement par héritage, mais par convention, issues du dialogue, au présent, des hommes de la cité.
Mais encore, l’Europe a un autre privilège, celui d’être une spiritualité en un sens nouveau et redoublé. Autrement dit, l’Europe n’est pas seulement spirituelle : elle cultive en outre activement la spiritualité en général, en la figure de l’âme individuelle. Quelle idée pourrait être plus spirituelle que celle de l’âme elle-même ? Or l’humanité qui invente la culture de l’âme, c’est l’Europe – du moins la Grèce qui en constitue spirituellement le berceau. Il faut en effet comprendre la spiritualité de deux manières différentes : en un sens immédiat d’un part, ou bien d’autre part au sens réfléchi d’une humanité se comprenant elle-même dans sa vocation à orienter les individus, cultivant activement l’âme en chacun et en tous. Patočka esquisse donc une distinction entre l’humanité simplement animée et celle qui soigne et cultive son âme. Il faut entendre par culture de l’âme celle de l’âme individuelle, se traduisant historiquement par l’apparition sociale de l’individu, son éducation à la responsabilité et sa reconnaissance dans le cadre de l’espace public. Apparaît en Grèce antique, en effet, l’idée de « l’âme que je suis », non au sens d’un « ego », mais au sens d’un être responsable de la destinée de son âme.
Dans la tradition antérieure à Démocrite et Platon, l’âme est essentiellement du point de vue de l’autre. C’est l’âme-ombre, l’âme-image, l’âme qui requiert, afin de subsister, une enveloppe corporelle embaumée, une image sculptée, la parole, l’écriture, une inscription, etc. – c’est moi pour l’autre. L’âme des mystères elle aussi est l’âme pour l’autre, cette âme qui se renouvelle dans le cycle organique qu’accomplissent les éleusinies, cette âme qui réside dans le fait que tout dans la nature renaît, que le même se renouvelle sous des aspects toujours nouveaux, que poussent de nouveaux épis, qu’Adonis revient, etc. (…)
L’âme que je suis apparaît pour la première fois chez Démocrite et Platon [6].
La culture européenne de l’âme va ainsi de pair avec la quête, pour la première fois, d’une immortalité individuelle. Patočka fait la différence entre le souci collectif d’une immortalité de l’espèce à travers la filiation, par laquelle les hommes sont unis par delà la mort d’une manière supra-individuelle – « une manière d’immortalité, une immortalité qui affecte, non pas l’individu, mais toutes les personnes unies par un lien génératif de filiation »[7] – et le souci d’une survie individuelle, qui pour lui « n’apparaît qu’avec l’idée platonicienne du « soin de l’âme » »[8]. Apparue au commencement grec de l’histoire « à la troisième personne »,[9] l’âme individuelle évolue ensuite – passant, entre autres, par la doctrine chrétienne du salut personnel, la découverte cartésienne de l’ego cogito, etc.
Il y a ainsi indéniablement, pour Patočka comme pour Husserl, quelque chose de nouveau qui apparaît avec l’Europe philosophique et démocratique. A la spiritualité mythique succède celle, proprement historique, d’un projet actif, rationnel et choisi, que Patočka nomme projet du soin de l’âme et qui a, selon ses propres termes, « créé » l’Europe.[10] Cependant, l’intérêt des analyses patockiennes et de ne pas s’en tenir là. Car la difficulté est que ce projet est d’emblée équivoque – présidant à la naissance de l’histoire sous la double figure du soin de l’âme et de celui de la domination du monde.
II. Les deux sources de l’identité européenne : le soin de l’âme et la raison.
Si l’Europe correspond bien à une possibilité nouvelle, cette nouveauté est immédiatement équivoque, inaugurant certes une nouvelle forme de spiritualité – dont la science rationnelle deviendra emblématique, mais encore des formes de domination inédites de la nature et de l’humain. En lecteur de Heidegger, Patočka isole en effet, dans sa lecture de l’histoire du monde historique européen, un moment source épochal porteur de possibilité encore indéfinies, qu’il réinterprète comme un moment tout à la fois « post-mythique » et « pré-européen », suspendu entre les deux possibilités historiques fondamentales que sont la spiritualité mythique et le rationalisme[11]. Il distingue deux moments distincts : un moment source épochal, celui de l’étincelle de la problématicité du monde (moment d’ébranlement de la vérité mythique acceptée sans question), et un moment réactif, inaugurant l’histoire de l’Europe comme domination autonome du monde, tournant le dos à la problématicité nouvellement découverte au profit de la reconstruction de nouvelles évidences, cette fois rationnellement fondées.
La distinction de ces deux moments s’incarne dans les deux personnages fondateurs de la philosophie européenne que sont Socrate et Platon, auxquels Patočka consacre une place centrale dans ses analyses, comme en témoigne le titre du séminaire privé qu’il donné en 1973, « Platon et l’Europe »[12] – et qui incarnent chacun deux versions divergentes du « soin de l’âme » que Patočka identifie comme source de l’Europe. Le premier mode du nouveau projet de vie européen, ouvert dans l’émerveillement philosophique, est ainsi celui porté par Socrate : modalité éthique avant d’être théorique, courageuse et risquée avant d’être savante et maîtrisée. Patočka en donne la formulation suivante : « L’âme qui, faisant l’expérience de son in-science, l’expérience de savoir ne pas savoir, expérimente son être propre – s’expérimente en même temps comme courageuse, en tant qu’elle s’expose elle-même à la mise en question ; sage en ce savoir du non-savoir en tant qu’examen ; retenue et disciplinée, car elle subordonne toutes les autres affaires de la vie à ce combat de la pensée ; juste dans la mesure où elle fait son œuvre propre, ce qu’elle a à faire »[13]. Cette première figure socratique du soin de l’âme représente une possibilité source pour un revirement radical du rapport au monde, qui sera reprise par Patočka pour penser le revirement contemporain : « il en résultera une manière nouvelle de se rapporter au sensé : le sens ne pourra se révéler que dans la quête active qui procède d’un défaut de sens, en tant que point de fuite de la problématicité, épiphanie indirecte. Si nous ne nous trompons pas, cette découverte du sens dans la quête qui découle de son absence, comme nouveau projet de vie, est le sens de l’existence de Socrate »[14].
Mais Patočka reconstitue à partir de Platon une seconde formulation du projet du soin de l’âme, en même temps qu’il y trouve la première confusion qui présidera à son dévoiement progressif au cours de l’histoire européenne. Patočka réinterprète ainsi l’idée heideggérienne développée dans l’Introduction à la métaphysique selon laquelle la métaphysique platonicienne constitue la « fin initiale » de la philosophie grecque. Platon en effet se sépare de Socrate, selon la lecture patočkienne, en subordonnant le mouvement « épochal » de l’âme constituant l’étincelle philosophique proprement dite, à la vision transcendante et immobile qui sera le point de départ d’un recouvrement de la problématicité-source par le savoir métaphysique – puis scientifique. Dans Platon et l’Europe, il propose un schéma concentrique, articulé en trois cercles plus ou moins éloignés du noyau de l’âme que je suis et qu’il s’agit de conquérir, depuis la totalité du monde, puis la communauté, jusqu’à l’âme propre individuelle. Voici les trois volets du projet platonicien du soin de l’âme : 1) Au plus éloigné, « le projet onto-cosmologique » : soigner l’âme en tant qu’elle est le destinataire, en mal de fondation, de l’apparaître de l’étant. 2) Dans le cercle intermédiaire, le projet politique, celui d’une nouvelle forme de vie au sein de l’Etat : celui de soigner l’âme en tant qu’elle vit dans une communauté en conflit avec elle-même. 3) Au plus proche enfin, le projet individuel, comme élucidation de ce qu’est l’âme en elle-même, consistant à prendre soin de l’âme « sous le rapport de sa vie intérieure, son rapport au corps et à l’incorporéité, le problème de sa mort et de l’immortalité »[15].
Mais dans ces trois cercles du soin de l’âme platonicien, Patočka distingue d’emblée deux aspects : l’aspect de la formation de soi – formation par l’action de la pensée, « action de l’âme sur l’âme »[16], et l’aspect objectif – souci de la domination du monde. Deux aspects qui vont conduire à distinguer deux sens de la rationalité : la rationalité comme responsabilité, et la rationalité comme intuition de ce qui est. Ce qui est en jeu ici, c’est le glissement de sens possible de la vérité depuis l’idéal vivant et éthique de la vérité vers l’idée logique maîtrisée et manipulable qui sera le propre de l’histoire de la science européenne. Platon ne se laisse pas lui-même prendre au piège, mais il est pourtant celui qui va le poser,[17] en mêlant la quête responsable de la vérité et l’intuition idéale qui la satisfait. De même, au niveau politique, Platon cherche à fonder l’unité de la communauté non plus sur le mystère mythique, mais sur un principe lumineux et contraignant : sur une autorité spirituelle. « La polis grecque laisse un héritage, l’héritage de la réflexion sur un Etat où les philosophes pourront vivre, sur un Etat où la justice fondée non pas sur la simple tradition mais sur l’intuition au sens du regard dans ce qui est »[18]. L’équivoque du projet philosophique originaire, c’est donc qu’il relève à la fois d’une fascination pour la problématicité et d’une ambition de la surmonter.
La métaphysique constitue l’alliance indissociable et inéclaircie de ces deux moments : elle concentre l’ambiguïté du projet du soin de l’âme, entre conversion éthique de l’âme et conversion scientifico-technique du monde en objectivités maîtrisables. En effet, parallèlement au projet de conversion de l’âme, la philosophie, des premiers penseurs à Platon et Démocrite, constitue parallèlement un programme de justification métaphysique de l’étant changeant à partir de ce qui est durablement. D’un côté, Démocrite, qui subordonne la conversion de l’âme à la conversion de la manifestation, préside au retournement de la philosophie en science : par la géométrie, le philosophe est « à même d’opérer une coupure profonde qui, en nous faisant pénétrer au-delà du domaine de ce qui est visible en l’acception courante du terme, convertit la réalité entière du mouvement de la manifestation à la manifesteté continue »[19]. De l’autre, Platon, qui subordonne, inversement, la conversion de la manifestation à la conversion de l’âme, commande le basculement de la philosophie en métaphysique. Il s’agit de demeurer auprès de l’éternel afin de convertir l’âme elle-même à ce qu’elle est, c’est-à-dire autre chose qu’un devenir : un étant éternel et continûment présent.
Cette activité de conversion du mystère qui se retire à la présence va rendre possible, dans un second temps, la maîtrise humaine du contenu du monde. C’est cette possibilité qui va finalement prévaloir dans le tournant de la science moderne, par lequel l’aspect à l’origine secondaire du soin de l’âme – le souci de la domination du monde – finira par prendre la première place : l’homme moderne sent bien qu’il est « en rapport avec la totalité (sentiment essentiellement métaphysique), et il cherche à transformer ce rapport à la totalité en une domination sur la totalité »[20]. La science moderne quitte pour la première fois complètement le terrain de l’émerveillement, afin de réaliser l’objectif de domination – tournant qui dévoile clairement, à la fin de l’histoire européenne, l’équivoque première du soin de l’âme. Du travail indéfini de conversion métaphysique à la présence, on bascule dans la science moderne à un travail de réduction (élimination ou mise de côté pure et simple) de l’imprésentable positivement. « La mathématisation indirecte ne repose pas sur une simple idéalisation, mais sur une hypothèse. Cette hypothèse suppose qu’on peut trouver, pour n’importe quel remplissement qualitatif, un parallèle dans le domaine strictement mathématique des formes spatiales ou spatio-temporelles, qu’on peut alors ne considérer que ce parallèle et, en se fondant sur la déterminabilité exacte de ces domaines, prédire les événements à venir qui seront ainsi dominés par la pensée »[21]. Dans un manuscrit du début des années 1970, Patočka définit alors la ratio comme un « comportement expressément actif de l’homme à l’égard du contenu du monde, à l’égard des choses et des processus en tant qu’objets. »[22] Autrement dit : la ratio européenne n’est plus un rapport au monde. Elle est un rapport explicite et actif aux objets, c’est-à-dire à ce qui peut être converti à la présence et dominé[23].
III. La lutte européenne contre le mythe
Nous voilà prêts à ressaisir ce qui chez Patočka rend finalement raison du paradoxe constitutif de l’universalisme européen et de son échec historique : la lutte entre vérité mythique et vérité rationnelle. Car Socrate et Platon n’inventent pas seulement deux versions du soin de l’âme : ils incarnent deux rapports diamétralement opposés à la vérité mythique. Quand Socrate se fait l’héritier du mythe dans un monde nouvellement autonome, Platon inaugure l’histoire proprement européenne de la lutte contre lui.
Faisons d’abord retour sur ce qui caractérise pour Patočka la vérité mythique, à savoir le dévoilement du mystère. Le mythe ne correspond pas à une explication dans l’ordre du présent : il raconte un passé incommensurable qui offre aux hommes une fondation inaccessible, de telle sorte que la vérité possède une profondeur qui empêche de parvenir de manière homogène depuis l’origine jusqu’au présent.
A l’origine, le monde se donnait à nous comme une tradition indéterminée, ancrée dans un passé indéterminé, une tradition qui arrive on ne sait d’où et dont les racines plongent dans on ne sait quel passé auquel nous n’avons pas accès et qui, bien qu’il soit toujours présent en quelque manière dans la mesure où c’est lui qui a fondé ce monde qui est le nôtre, échappe aussi bien à notre intuition qu’à notre intervention [24].
Cette profondeur est signe que la vérité ne nous appartient pas mais que, bien plutôt, nous lui appartenons : « ici on voit que le se-montrer des choses est le domaine, non de l’homme, mais des dieux. Les hommes ne savent pas ».[25]
C’est dire fondamentalement que, loin d’être un rapport primitif ou défectueux à la vérité, le mythe délivre au contraire pour Patočka un savoir indépassable, celui de la vérité de l’appartenance de l’homme au monde et à la transcendance. Patočka donne ainsi au mythe un sens existential : le mythe, c’est le monde naturel qui nous enracine premièrement, la croyance originaire qui précède tout émerveillement.
L’homme ne peut vivre sans le mythe parce que le mythe est vrai. Le mythe réel est véridique. Or l’homme est un être qui vit dans la vérité, qui ne peut vivre autrement, car l’homme est un être déterminé en sa structure par la manifestation en tant que telle et par la manifesteté, et la manifesteté première, radicale et encore non réfléchie, s’exprime sous la forme du mythe. Le mythe dans l’histoire ne meurt pas. (…) En un sens, nous vivons toujours dans le mythe pour la simple raison que nous vivons dans le monde naturel, dans un monde qui apparaît [26].
Or ce savoir – ou plus exactement ce sens du mystère – propre aux mondes pré- ou extra-européens, est voilé et méconnu à tort par la culture européenne de la rationalité moderne :
Ces mondes étrangers, si « primitifs » qu’ils puissent sembler, ont conservé quelque chose que nous combattons systématiquement en le transformant en présence – si besoin est, au moyen d’hypothèses dont le caractère hypothétique est oublié, ce qui est précisément le cas du monde de substitution mathématique. Or, notre combat n’est rien d’autre qu’un témoignage négatif et stérile de la paradoxale présence-absence de ce à quoi nous résistons [27].
En effet, en gagnant leur terrain propre, celui du savoir humain autonome, contre la tradition mythique du non-savoir humain, la métaphysique puis la science européennes oublient que la responsabilité se fonde dans l’assomption du fait que le savoir humain n’est pas total, et se condamnent à un universalisme superficiel, abstrait et paradoxalement partiel.
C’est alors dans l’obscurité du rapport au mythe qu’il faut chercher la raison de l’oscillation historique de l’Europe entre grandeur et catastrophe. Dans ses deux versions, socratique ou platonicienne, le soin de l’âme représente une prise de distance par rapport au mode mythique, c’est-à-dire un changement de rapport à la vérité : depuis la vérité détenue par les dieux et confiée aux hommes, vers la vérité questionnée par l’humain de manière autonome. « On apprend ce qu’est l’Europe en posant la question de son devenir. Comment est-elle née ? Parce que les Grecs ont réfléchi à la spécificité de leur monde de la vie, découvrant ainsi, de plus en plus, ce qui dans ce monde faisait question »[28]. La philosophie grecque inaugure ainsi une époque d’explication de la philosophie avec la vérité mythique. Mais dans le moment socratique, il n’est pas question de choisir entre le mythe et la philosophie. Le premier philosophe est celui qui cultive le mystère mythique de manière autonome et s’en constitue garant pour la communauté – son rôle est celui de continuateur : « Socrate défend l’ancien par des moyens nouveaux »[29], il défend le non-savoir humain comme principe d’unité de la communauté, « en s’entretenant avec ses concitoyens et en les dévoilant comme ce qu’ils sont, comme des hommes errants, dévoyés »[30].
Au contraire, la filiation platonicienne inaugure un rêve de rupture par la constitution d’un savoir humain autonome et positif, impliquant que la discussion avec le mythe en Europe prenne finalement la forme d’une lutte – offensive clivante de la première métaphysique, qui se perpétuera dans les royaumes hellénistiques de l’antiquité, dans l’empire romain, puis en Europe proprement dite :
Dans les réalités comme les royaumes hellénistiques, il y avait toujours des hommes issus de cette tradition, des hommes qui ont contraint la réalité, qui était d’une origine entièrement différente, à s’expliquer et à dialoguer avec cet héritage, qui ont contraint cette différence non réfléchie à se réfléchir elle-même en tentant de résoudre les questions posées par cet héritage. C’est ce processus qui nous intéresse. Il ne s’agit pas d’une réception unilatérale de façons de voir, mais bien d’une discussion de la philosophie avec la non-philosophie et avec une réalité non-philosophique. Durant toute l’époque métaphysique, cette réflexion avait le caractère d’une offensive [31].
Or, paradoxalement, l’apparition de la réflexion sur le mode de l’offensive divise le monde humain en voulant le fonder. Car s’opposer à l’obscurité mythique, c’est opposer une évidence à une autre. Au lieu d’être une continuation réflexive du mythe, l’Europe se constitue comme élaboration d’un mythe nouveau et concurrent (dogmatique) : celui de la rationalité non plus comme responsabilité dans la finitude mais comme puissance alternative et autonome. Le monde européen est ainsi le monde qui, à nouveau, fuit la problématicité socratique : à ceci près qu’il ne le fait plus par le mythe, mais de manière réfléchie.
Patočka met ainsi le doigt sur la réduction de l’altérité spirituelle qui est au fondement de la prétention universaliste, car l’Europe prétend gagner l’universel en s’opposant de manière conflictuelle aux sociétés mythiques. Le fait éminemment signifiant pour la phénoménologie de l’histoire est que le monde européen qui se croyait universel ne l’était pas, il n’était qu’une humanité parmi d’autres : « L’Européen croit à une humanité une parce qu’il identifie l’Europe à l’humanité »[32]. Un manuscrit du début des années 70[33] contient à ce propos une comparaison assez saisissante entre Husserl et Marx, en tant qu’ils représentent tous deux les dernières grandes figures de cette confusion de l’universalisme et du rationalisme européen. En ce sens, le marxisme intéresse Patočka en ce qu’il lutte non pas contre l’impérialisme européen en général, mais pour un certain impérialisme contre un autre. D’un côté le marxisme s’appuie sur une critique de l’Europe coloniale et défend l’émancipation des peuples coloniaux et semi-coloniaux opprimés, mais de l’autre cette critique est à comprendre comme un renvoi à une dialectique de l’Europe elle-même, qui doit s’annuler et se dépasser en s’universalisant. L’émancipation des masses coloniales correspond alors à l’expansion de la rationalité européenne hors de ses frontières. Commentant l’exemple de l’Inde, Patočka écrit :
Dans sa critique de l’Europe, le marxisme aura cependant esquissé une prise de position qui le prédestine à transplanter et à diffuser la mentalité européenne chez les non-européens (et les post-européens enracinés dans des traditions étrangères à l’Europe). (…) Il permet de prendre position à la fois contre le monopole européen de la puissance et du capital, et pour la conception de la vie propre à l’Europe [34].
La spécificité européenne est donc certes d’inaugurer un rapport réflexif au monde naturel, mais loin que cette spécificité coïncide avec la réalisation de l’humanité une et universelle, elle se traduit au contraire par un expansionnisme hégémonique. « L’histoire de l’Europe n’est pas celle de l’humanité, comme les Européens l’ont longtemps pensé : (…) elle est l’histoire (…) d’une humanité parmi d’autres, fait attesté précisément par la soif unique d’hégémonie en conséquence de laquelle l’Europe s’est opposée aux autres humanités et est entrée en conflit avec elles »[35].
Conclusion. Le « point d’hérésie » de la phénoménologie de l’histoire patočkienne
L’interprétation patočkienne, dans les années 1970, de l’héritage européen, est donc plus complexe qu’il n’y paraît : d’un côté l’Europe a bien inauguré une possibilité singulièrement nouvelle, d’un autre côté cette possibilité, restée inéclaircie, a conduit à sa destruction. Les nouvelles coordonnées du problème constituent alors l’espace d’un étonnement nouveau : étonnement devant le fait que les idées d’« universel » et d’« individu », telles qu’elles ont constitué la spécificité de la spiritualité européenne, ne sont pas authentiquement spirituelles puisque les hommes ne peuvent y trouver leur unité commune.
La tâche que Patočka assigne alors à la phénoménologie de l’histoire – post-européenne – est en conséquence de repenser l’histoire non plus comme le processus de la relève du particulier en universel, mais comme problème étonnant de l’opposition (et de la division) du naturel et du réflexif. Quand la Grèce inaugurait l’ère européenne de la réflexion sur le monde mythique, l’ère planétaire post-européenne rend ainsi possible une nouvelle réflexion sur le rationalisme réflexif en tant qu’il s’oppose au mythe – c’est-à-dire sur la spiritualité européenne. Dans un fragment de lettre au destinataire non identifié (années 70), Patočka écrit quant à son projet :
Comprendre ces rapports du métaphysique, du mythique, du théologique et du pratique (individuel et collectif, politique), c’est ce qui me tient à cœur dans mon étude de l’Europe. Jusqu’à présent je n’ai guère écrit sur la post-Europe, car ce post présuppose le terme-clef, l’Europe (…). J’essaie de me pencher sur l’origine métaphysique de la science moderne et d’expliquer pourquoi sa découverte d’un savoir « efficace » va de pair avec la perte des perspectives sur l’unité, l’universalité, l’éternité ; pourquoi nous avons perdu logiquement nos institutions universelles, sans les remplacer ; finalement, la catastrophe [36].
Mais c’est à partir de ce point de vue post-européen que les travaux de Patočka sur l’histoire prennent leur véritable sens « hérétique », comme le remarque Ricœur en préface des Essais hérétiques – s’écartant tant des philosophies de l’histoire hégélienne et marxiste que de la description husserlienne du monde de la vie et de la pensée heideggérienne de l’historicité. Car au-delà de l’histoire européenne, la naissance conjointe de la politique, de l’histoire et de la philosophie sont à resituer chez Patočka dans « la perspective d’un thème unificateur singulièrement plus difficile d’accès, celui de la problématicité de l’homme historique, opposée à la certitude naïve de l’homme pré-historique »[37]. Cette opposition éclaire notamment le fait que Patočka s’appuie sur Lévi-Strauss pour faire des « Grandes découvertes » de l’Europe de la Renaissance une expérience de rencontre fondamentale pour l’humanité, et même « la plus grande expérience que l’homme ait faite de lui-même » :
L’homme se présente essentiellement dans ces deux modifications [de l’historique et du non historique], et c’est pourquoi Lévi-Strauss a raison de dire que la plus grande expérience que l’homme ait faite de lui-même est la rencontre, après la découverte du Nouveau Monde à la fin du XVè siècle, entre une forme néolithique d’humanité et la modification européenne, historique par excellence [38].
Que cette rencontre ait pris la forme à la fois d’une fascination pour le monde et d’une conquête impérialiste révèle la tension constitutive de l’universalisme européen et sa non coïncidence avec l’humanité une – et c’est là le problème. L’importance de ces lignes apparemment anodines se manifeste par ailleurs dans le fait que l’idée est sous la plume de Patočka redondante, comme en témoigne cette remarque quasi identique de Platon et l’Europe :
Prenons ce que Lévi-Strauss considère comme la plus grande expérience que l’homme ait encore faite de lui-même, à savoir la rencontre, au quinzième et au début du seizième siècle, de l’humanité européenne avec l’homme du Nouveau Monde (l’homme des grands empires de l’Amérique centrale et Australe), rencontre de l’homme mythique avec une humanité qui s’est depuis longtemps dégagée de l’emprise du mythe [39].
En quoi l’élucidation de cette rencontre est-elle décisive ? D’abord, parce qu’elle offre une possibilité de reprise du moment épochal de l’étonnement socratique qui conduise à un approfondissement du sens de la rationalité[40], non plus comme ce qui s’oppose au monde naturel, mais au contraire est présupposé par lui : invitant à questionner à nouveau le rapport de la raison et du mythe. Ensuite, par la possibilité d’un approfondissement du sens de l’universalisme par une méthode de saisie « variative »[41] du commun.
Il s’agit de trouver, pour l’homme « préhistorique » et historique, civilisé et « primitif », pour l’homme des hautes cultures et des civilisations rudimentaires, un fonds commun de possibilités. Il s’agit de faire apparaître le fondement où toutes ces possibilités ont leur source [42].
Cette saisie variative, cependant, en écho à l’analyse existentiale heideggérienne, a pour but non pas de saisir une essence fixe, mais au contraire l’unité négative de la différence, afin de dépasser à la fois l’image schématique de « l’homme naturel » et celle, positive, de « l’homme historique », vers le problème de l’humanité en tant que telle. « L’historicité en tant que fond propre impliquerait (…) l’absence d’une détermination concrète que l’on puisse cerner définitivement chez l’homme comme ce en quoi son être consiste ou subsiste. L’ « homme naturel » au sens moderne n’est toujours qu’un schéma – schéma du problème de l’humanité »[43].
Patočka invite à reprendre la réflexion sur l’Europe en la reconduisant à un universel plus profond et plus fondamental que l’universel européen, universel négatif auquel doit ouvrir un questionnement renouvelé du rapport au mystère du monde, qui fut la condition de possibilité de l’Europe historique, et que l’Europe a pourtant combattu. C’est en effet le rapport de l’homme à ce mystère du monde en tant que tel, dont l’extranéité des différentes humanités est une des manifestations les plus éclatantes, qui seul peut fournir la base d’une unité véritable de l’humanité qui ne se réduise pas à une conquête homogénéisante. « Aussi longtemps que ce fondement, commun à toutes les formes d’humanité, si diverses soient-elles, n’aura pas été tiré de l’oubli, aucun dialogue effectif entre les « cultures » et les « humanités » ne sera possible, car l’ « entretien » ne partira jamais de ce qui est commun, mais chaque fois d’un spécifique et d’un particulier qu’on tentera de faire passer pour l’universel »[44].
[1] Expression que Patočka traduit par « soin » ou « souci » de l’âme.
[2] Platon et l’Europe. Séminaire privé du semestre d’été 1973, trad. Erika Abrams, Verdier, Lagrasse, 1983, p.99. Voir aussi Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Lagrasse, Verdier, 1999, p.111 : « C’est le souci de l’âme qui a créé l’Europe – il n’y a aucune exagération a soutenir cette thèse ».
[3] Les textes que Patočka consacre spécifiquement à l’Europe sont les suivants (par ordre chronologique) :
– 1936 « La conception de la crise spirituelle de l’humanité européenne chez Masaryk et chez Husserl », trad. E. Abrams, in: La crise du sens, vol. 1, Bruxelles, OUSIA, 1985, pp. 19–37.
– 1939 « La culture tchèque en Europe », trad. E. Abrams. in: L’idée de l’Europe en Bohême, Grenoble, J. Millon, 1991, pp. 133–173.
– 1941 « La Raison européenne », trad. E. Abrams, in: L’Europe après l’Europe, Lagrasse, Verdier, 2007, pp. 187–190.
– Années 1970 « [Ce qu’est l’Europe – Sept fragments] », in L’Europe après l’Europe, trad. E. Abrams, Verdier, Lagrasse, 2007, pp. 219-241.
– Années 1970 « [La genèse et la catastrophe de l’Europe] », in L’Europe après l’Europe, trad. E. Abrams, Verdier, Lagrasse, 2007, p. 273-274.
– Années 1970 « [Les problèmes de l’ère posteuropéenne] », in L’Europe après l’Europe, trad. E. Abrams, Verdier, Lagrasse, 2007, p. 243-272.
– Début des années 1970, « L’époque posteuropéenne et ses problèmes spirituels », in L’Europe après l’Europe, trad. E. Abrams, Verdier, Lagrasse, 2007, p. 207-218.
– Années 1970 « L’Europe et après. L’époque post-européenne et ses problèmes spirituels », in L’Europe après l’Europe, trad. E. Abrams, Verdier, Lagrasse, 2007, p. 37-136.
– Début des années 1970 « Réflexion sur l’Europe », in Liberté et sacrifice. Écrits politiques, trad. E. Abrams, avant-propos d’E. Abrams, postface d’A.-M. Roviello. Jérôme Millon, Grenoble, 1990, p.181-213.
– 1973 Platon et l’Europe. Séminaire privé du semestre d’été 1973, trad. Erika Abrams, Verdier, Lagrasse, 1983.
– 1975 « L’Europe et l’héritage européen jusqu’à la fin du XIXe siècle », trad. E. Abrams. in Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Lagrasse, Verdier, 1999, pp. 106–124.
– 1977 « La genèse de la réflexion européenne sur le beau dans la Grèce antique », trad. E. Abrams. in L’art et le temps, Paris, P.O.L, 1990, pp. 47–64.
[4] Platon et l’Europe, op. cit., p.14.
[5] « [Les problèmes de l’ère posteuropéenne] », L’Europe après l’Europe, op. cit., p.249.
[6] Platon et l’Europe, op. cit., pp.78-79.
[7] « Considérations préhistoriques », Essais hérétiques, op. cit., p.42.
[8] Idem.
[9] Comme le remarque Philippe S. Merlier dans Patočka. Le soin de l’âme et l’Europe, l’individu grec pour Patočka n’est pas celui qui se livre à une quelconque introspection subjective, mais celui qui se soucie de l’éveil son âme et de celle des autres, notamment par le souci « de rationalité, d’unité, de fermeté et de concentration de l’être, de cohérence et d’absence de contradiction » qu’on trouve chez Socrate (P.S. Merlier, Patočka. Le soin de l’âme et l’Europe, L’Harmattan, Paris, 2009, p.21). Cf Patočka, « La phénoménologie du corps propre », Le monde naturel et le mouvement de l’existence humaine, trad. E. Abrams, Phaenomenologica n° 110, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1988, p.142 : l’expression socratique du soin de l’âme désigne « la maïeutique grâce à laquelle le penseur (…) ne cesse systématiquement de s’éveiller lui-même et d’éveiller ses interlocuteurs à la vigilance d’un logos cohérent, ce qui semble être quelque chose d’éminemment personnel. Mais il ne faudrait pas non plus perdre de vue la généralité et l’objectivité du logos dont il s’agit ici (…). L’impératif grec « gnôthi seauton » [connais-toi toi-même] ne signifie pas « réfléchis, tourne-toi vers ton moi », mais « connais la place qui te revient dans l’échelle des étants, n’oublie pas que tu es une créature éphémère et mortelle qui n’a pas d’importance face à ce qui est en vérité et éternellement ». Patočka parle ainsi de la philosophie antique comme d’une « philosophie à la troisième personne ».
[10] Voir Essais hérétiques, op. cit., p.111.
[11] Heidegger, dans l’Introduction à la métaphysique de 1935, distingue dans le commencement grec à la fois un début et une fin – le commencement-source inital (anfänglicher Anfang), qui sera susceptible de reprise, et la fin initiale (anfängliche Ende) – début du déclin européen (Sur le second commencement de la philosophie, voir F. Dastur, « La fin de la philosophie et l’autre commencement de la pensée », in Heidegger, Questions ouvertes, Collège international de Philosophie, Osiris, Paris, 1988, pp. 125-141).
[12] Platon et l’Europe, op. cit..
[13] Ibid., p.103.
[14] Essais hérétiques, op. cit., p.86.
[15] Platon et l’Europe, op. cit., p.107.
[16] L’Europe après l’Europe, op. cit., p.104.
[17] Platon ne se laisse pas lui-même prendre au piège qu’il tend, car, comme le rappelle Patočka, il refuse d’écrire sous une forme déposée son système onto-cosmologique, opposant à l’équivoque du logos la pureté de l’intuition immédiate : « Le soin de l’âme, dont la pratique consiste en une œuvre d’investigation continuelle, inclut aussi en soi l’idéal, l’étincelle qui se nourrit d’elle-même, et dans cette étincelle il y a quelque chose qui se découvre, quelque chose qui se montre, il y a en elle un regard qui ne peut être confié à la parole, dans la mesure où celle-ci est essentiellement équivoque, ambiguë ». Platon et l’Europe, op. cit., p.106. Platon ne confond donc pas, en réalité, l’idéal vivant et l’idée logique.
[18] Ibid., p.98.
[19] Ibid., p.77.
[20] Voir Crise du sens, op. cit., I. III.
[21] Le monde naturel et le mouvement de l’existence humaine, op. cit., p.233.
[22] Liberté et sacrifice, op. cit., p.182.
[23] Voir à ce sujet « Le schéma de l’histoire », L’Europe après l’Europe, op. cit., p.34 : « La civilisation rationnelle n’étant elle-même que le fruit d’une explication du monde orientée vers le déploiement de la puissance et de la force vitale, pouvons-nous nous étonner d’assister à la débâcle de l’Europe à l’instant où l’élément créateur d’histoire dans ce continent créateur d’histoire se rallie lui-même à la négation de l’historicité ? ».
[24] Platon et l’Europe, op. cit., pp.105-106.
[25] Ibid., p.65.
[26] Ibid., p.52.
[27] Liberté et sacrifice, op. cit., p.197.
[28] « [Ce qu’est l’Europe] », L’Europe après l’Europe, op. cit., p. 225.
[29] Platon et l’Europe, op. cit., p.94
[30] Id.
[31] Ibid., p.140.
[32] « L’Europe et après », L’Europe après l’Europe, op. cit., p.59.
[33] « [Réflexion sur l’Europe] », in Liberté et sacrifice, op. cit., pp.181-214.
[34] Ibid., pp.202-203.
[35] « [Les problèmes de l’ère posteuropéenne] » (années 1970), in L’Europe après l’Europe, op. cit., p.248.
[36] « [La genèse et la catastrophe de l’Europe] », L’Europe après l’Europe, op. cit., p.274.
[37] Paul Ricœur, Préface aux Essais hérétiques, op. cit., p.9.
[38] Le monde naturel et le mouvement de l’existence humaine, op. cit., p.25 .
[39] Platon et l’Europe, op. cit., p.240.
[40] Il s’agit ainsi de poursuivre plus profondément le travail initié par Husserl dans la Krisis dont le mérite et le génie est d’avoir signalé « la tâche urgente d’un approfondissement du fondement de la rationalité européenne qui seul pourrait rendre possible une vraie explication avec toutes les traditions vivantes du monde concret », in « L’époque posteuropéenne… », L’Europe après l’Europe, op. cit., p.213.
[41] Voir « Le monde naturel et la phénoménologie », Le monde naturel…, op. cit., p.24 : « La tâche de la saisie du « monde naturel » est identique au problème de la saisie de ce qui en l’homme est indépendant des contingences historiques de son évolution, de ce qui peut être sélectionné variativement en retenant ce qu’il y a de commun dans toutes les modalités de la vie humaine ».
[42] Id.
[43] Ibid., p.25.
[44] « Réflexion sur l’Europe », Liberté et sacrifice, op. cit., p.212.