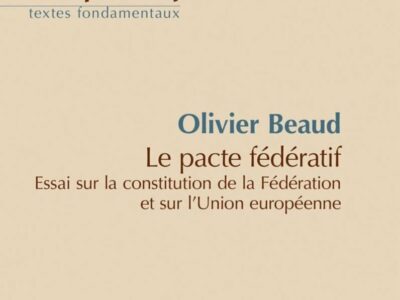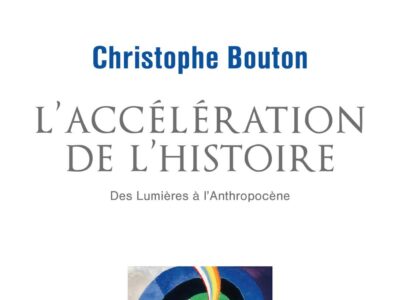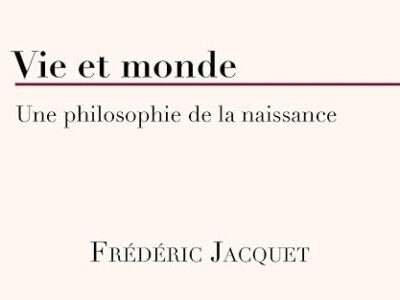Compte-rendu – Philosophie critique et éducation
Compte-rendu: Philosophie critique en éducation, de Irène Pereira.
Yaël Jean-Baptiste, Université Jean Jaurès.
Il s’agit d’un compte-rendu du livre d’Irène Pereira, Philosophie critique de l’éducation. Vous pourrez avoir de plus amples informations sur le livre ici.
 L’ouvrage qu’Irène Pereira fait paraître dans la collection « Didac-philo » des éditions Lambert-Lucas s’intitule Philosophie critique en éducation. L’auteure, dont les recherches portent sur la philosophie et la sociologie de l’éducation, a donc un objectif clair : examiner le système éducatif français tel qu’il fonctionne aujourd’hui. Elle assume une position philosophique selon laquelle l’objectif de l’éducation est la transformation de la réalité sociale et s’adresse à des enseignant·e·s ou futur·e·s enseignant·e·s qui considèrent la justice sociale comme un idéal en vue duquel ils ou elles souhaitent orienter leur pratique. Elle invite celles et ceux qui partagent cette « vision du monde » à s’interroger sur le rôle qu’ils ou elles peuvent se donner dans cette activité transformatrice. L’auteure cherche à savoir s’il est possible d’enseigner de manière émancipatrice. Il s’agit de savoir si l’enseignant·e, plus spécifiquement le·a professeur·e de philosophie, peut aider les élèves subissant des discriminations (liées à la classe sociale, l’origine ethno-raciale, l’identité sexuelle) à s’émanciper socialement. Pour se faire, elle croise différentes approches : les recherches françaises en sociologie d’une part, des paradigmes tels que le matérialisme socio-historique, la théorie critique, l’intersectionnalité, et la théorie décoloniale d’autre part.
L’ouvrage qu’Irène Pereira fait paraître dans la collection « Didac-philo » des éditions Lambert-Lucas s’intitule Philosophie critique en éducation. L’auteure, dont les recherches portent sur la philosophie et la sociologie de l’éducation, a donc un objectif clair : examiner le système éducatif français tel qu’il fonctionne aujourd’hui. Elle assume une position philosophique selon laquelle l’objectif de l’éducation est la transformation de la réalité sociale et s’adresse à des enseignant·e·s ou futur·e·s enseignant·e·s qui considèrent la justice sociale comme un idéal en vue duquel ils ou elles souhaitent orienter leur pratique. Elle invite celles et ceux qui partagent cette « vision du monde » à s’interroger sur le rôle qu’ils ou elles peuvent se donner dans cette activité transformatrice. L’auteure cherche à savoir s’il est possible d’enseigner de manière émancipatrice. Il s’agit de savoir si l’enseignant·e, plus spécifiquement le·a professeur·e de philosophie, peut aider les élèves subissant des discriminations (liées à la classe sociale, l’origine ethno-raciale, l’identité sexuelle) à s’émanciper socialement. Pour se faire, elle croise différentes approches : les recherches françaises en sociologie d’une part, des paradigmes tels que le matérialisme socio-historique, la théorie critique, l’intersectionnalité, et la théorie décoloniale d’autre part.
I. Histoire philosophique de la forme scolaire
La première étape consiste à poser les fondements d’une « méta-théorie critique » et à les appliquer un objet d’étude : la forme scolaire[1]. Le·a lecteur·rice prend connaissance, à cette occasion, du contexte institutionnel au sein duquel s’inscrit sa propre pratique de l’enseignement. Irène Pereira inscrit sa réflexion sur l’éducation dans un courant pédagogique appelé la « pédagogie critique » et attire l’attention du lectorat sur l’existence de différentes sous-tendances critiques[2]. Selon elle, on assiste à l’heure actuelle à un éclatement des mouvements sociaux (féminisme, écologie, anti-racisme, etc.) et la diversité des discours critiques est telle qu’ils entrent parfois en contradiction[3]. La philosophe souhaite décrire et dépasser les points d’opposition ; il s’agira d’interpréter l’histoire de la forme scolaire à la lumière d’une théorie globale de la production des inégalités sociales dans la modernité. Elle appelle « méta-théorie critique » cette approche globale. L’expression « forme scolaire » désigne l’école comme forme socialisée d’apprentissage et d’enseignement. Or la forme scolaire est née en Europe, à l’époque moderne, dans un contexte d’extension de la rationalité formelle à différentes sphères de l’existence. Le sociologue Max Weber a fait voir les liens existants entre l’émergence de l’économie capitaliste et la rationalisation du travail et de l’administration. L’auteure se demande donc si la rationalisation du travail scolaire (le temps et l’espace sont organisés, les savoirs sont classifiés, les corps sont contrôlés, etc.) tient aux modalités d’apprentissage propres à la lecture et à l’écriture, ou si elle s’inscrit dans un processus plus général de domination. Le dressage idéologique et corporel à l’œuvre à l’école semble avoir pour fonction de faire obéir le système scolaire à des principes tels que l’efficacité et le rendement. Or on peut se demander si la logique de l’efficacité doit prévaloir en matière d’éducation.
L’auteure s’intéresse ensuite à l’expansion de la forme scolaire elle-même. Elle cherche à illustrer, ainsi, le concept de « colonialité du pouvoir »[4] dont elle veut mettre en lumière le potentiel critique. Le terme « colonisation », rappelons-le, désigne un processus par lequel une population en domine une autre en envahissant son territoire. La forme scolaire, comme le rappelle Irène Pereira, joue un rôle crucial dans le processus idéologique visant à pénétrer le contexte culturel des envahi·e·s. Mais ce que la philosophe tient à démontrer, c’est qu’il est possible de considérer l’école comme un vecteur de « colonisation du monde vécu » par les logiques de système. En effet, la forme scolaire rend possible une emprise grandissante de la raison instrumentale dans la vie quotidienne, et dans les relations intersubjectives. L’institution scolaire — fréquentée par la quasi-totalité de la population française — modèle le comportement des individus en dehors du temps scolaire, et dans les autres espaces sociaux (certains sociologues parlent à ce propos de « scolarisation de la société »). Si l’école est intrinsèquement aliénante, alors n’est-ce pas à condition d’en finir avec la forme scolaire qu’il est possible de mettre en place des pratiques pédagogiques émancipatrices ?
Il existe un certain nombre de mouvements alternatifs dont l’objectif est de libérer les enfants de la forme scolaire. L’auteure se demande dans quelle mesure ces mouvements d’émancipation rompent avec ce qui a été appelé la « colonialité du pouvoir ». La philosophe témoigne d’un grand intérêt pour les mouvements éducatifs à partir desquels s’élaborent les critiques de l’institution scolaire ; mais elle en fait voir les limites. N’est-il pas possible de concevoir une société où tout ce qui serait appris le serait au cours de la vie sociale ? Si l’apprentissage est naturel à l’être humain, qu’il est possible d’apprendre à lire et à écrire comme on apprend à parler et à marcher, alors la forme scolaire n’est-elle pas une contrainte inutile ? Ces questions méritent d’être posées, et l’auteure les pose, mais elle nous invite aussi à tenir compte des problèmes pratiques que poserait l’absence de forme. En effet, dans la mesure où la forme scolaire rend possible l’instruction de masse des enfants des milieux populaires, on pourrait craindre, par exemple, que le rejet de cette forme aboutisse à une déscolarisation massive. La philosophe rappelle aux lecteurs·trices que ce sont les enfants issus de milieux sociaux privilégiés qui ont accès aux infrastructures dont les principes éducatifs rompent avec le système scolaire public. Elle remarque, en outre, que les valeurs promues par les courants pédagogiques « alternatifs » — la créativité, la coopération, l’esprit critique, la communication — sont susceptibles d’être « récupérées » par l’économie néo-libérale[5]. On peut donc se demander si la critique de la forme scolaire suffit à produire une émancipation éducative. Mais ce qui pose problème aujourd’hui c’est que l’institution scolaire est soumise aux injonctions du système capitaliste. Or la demande du monde patronale est double : il faut produire des travailleur·euse·s peu qualifié·e·s — faire acquérir aux élèves des milieux populaires des compétences de base — et des travailleur·euse·s très qualifié·e·s — faire acquérir aux futur·e·s cadres supérieur·e·s des compétences telles que la créativité et l’esprit d’initiative. Si c’est ainsi que la fonction publique fonctionne, il y a là une injustice sociale à laquelle il faut remédier.
La réflexion que mène Irène Pereira au sujet de la forme scolaire lui fait voir la nécessité d’une philosophie critique en éducation qui soit adaptée au contexte hexagonal. Les paradigmes intersectionnels et décoloniaux ont un certain nombre de « points faibles » qui les rendent inaptes à penser le système éducatif français. L’auteure constate que les critiques de la forme scolaire — qui ont le mérite de réfléchir au potentiel émancipateur de l’éducation — ne suffisent pas à libérer l’école de la rationalité formelle qui caractérisent la modernité.
II. Rapports sociaux dans la forme scolaire
Selon Irène Pereira il est nécessaire de penser l’éducation en s’appuyant sur une analyse sociologique des rapports sociaux dans la société française ; c’est l’objet de la seconde partie de l’ouvrage. Cette section permet au lecteur·trice de prendre connaissance des dynamiques de pouvoir telles qu’elles opèrent dans l’espace scolaire, et notamment en classe. Irène Pereira a pour ambition, on l’a dit, de construire une théorie critique qui englobe l’ensemble des enjeux sociaux actuels : la lutte pour les droits sociaux, l’égalité femme-homme, les droits homosexuels, les combats anti-racistes, écologiques, etc. Or cela n’est possible, explique-t-elle, que si on pense la multiplicité des rapports sociaux[6] sur une base matérialiste. En effet, on limite sans cela l’analyse des rapports de pouvoir à des questions normatives ; cela aboutit à une pluralisation et non à une abolition des normes sociales dominantes. L’abolition des normes suppose, nous dit l’auteure, la remise en question du système de production économique qui les sous-tend. La question qui se pose est alors la suivante : l’approche matérialiste est-elle applicable à l’école ? Pour que ce soit le cas, il faudrait qu’il y ait du « travail » à l’école. Si on prend pour objet d’étude le travail des élèves et des enseignant·e·s, il semble difficile d’aborder la chose en termes de mécanismes d’exploitation. Mais dans la mesure où l’école reproduit les inégalités sociales et que cela aboutit à une distribution inégalitaire des positions sociales sur le marché du travail, on constate qu’inégalités scolaires et inégalités sociales sont directement corrélées. Il est important de rendre conscient·e·s les enseignant·e·s de ce phénomène.
Les réflexions menées par les pédagogues libertaires[7] permettent à l’auteure d’interroger la reproduction de la division du travail et des rapports de classes à l’école. Les pédagogies libertaires prônent, en matière d’éducation, le respect de la liberté absolue de l’individu et la suppression des contraintes qu’exerce sur lui la forme scolaire. Ils ou elles considèrent que la pédagogie traditionnelle — qui repose sur l’autorité verticale de l’enseignant·e — prépare les individus à des formes politiques autoritaires. L’auteure rappelle qu’à l’école comme sur le marché de l’emploi, on distingue travaux manuels et travaux intellectuels ; à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, par exemple, les travaux « manuels » sont considérés comme indignes des enfants issus de la bourgeoisie. Les libertarien·ne·s récusent la division sociale du travail des élèves d’une part, la division verticale du travail entre élèves et enseignant·e·s d’autre part. L’enseignant·e doit adopter une posture démocratique plus exigeante. Mais selon l’auteure, l’horizontalité des rapports élèves-enseignant·e·s ne suffit pas à neutraliser l’ensemble des rapports sociaux. Les inégalités sociales demeurent, et ce quand bien même la posture enseignante a évolué : en France, par exemple, les élèves n’ont pas la même aptitude à prendre la parole selon leur sexe, leur classe, et leur origine migratoire. La philosophe invite donc l’enseignant·e à mettre en place des pratiques de régulation visant à éviter la reproduction de rapports sociaux de pouvoir dans la salle de classe.
Les rapports sociaux demeurent prépondérants dans la reproduction des inégalités sociales à l’école en France. Irène Pereira s’intéresse, notamment, aux inégalités scolaires liées à l’origine migratoire. A première vue, il y a une moindre réussite scolaire des élèves immigré·e·s ou descendants d’immigré·e·s en France[8], or ces élèves sont issu·e·s en grande majorité de milieux populaires. Dans la mesure où la distribution des élèves sur le marché de l’emploi est directement influencée par leur origine migratoire, on ne peut pas se borner à considérer qu’il y aurait un même traitement de l’ensemble des classes populaires, nous dit l’auteure. Il est possible qu’un des facteurs explicatifs soit la représentation sociale et culturelle qu’ont les enseignant·e·s des élèves en fonction de leur origine ethno-raciale. L’auteure exemplifie et rapporte les propos tenus par un membre de l’éducation nationale au sujet d’un élève hésitant entre deux choix d’orientation : un bep comptabilité et la plomberie. Selon cette personne l’élève, qui est d’origine portugaise, « sera mieux dans un chantier ». Il sera plus facile pour lui de « suivre les traces de son père » car les enfants d’origine portugaise « ne sont pas faits pour les études : ce sont surtout de bons manuels », comme leurs parents[9]. Dans ce cas, la sur-représentation des travailleurs portugais dans les métiers du bâtiment a une influence directe sur la décision d’orientation. Irène Pereira, invite les enseignant·e·s à faire preuve de prudence : en évitant de recourir à des explications de type culturalistes pour analyser les difficultés scolaires des élèves, et en s’efforçant de ne pas produire de biais ethno-raciaux dans leurs évaluations. Les différenciations pédagogiques (les pratiques visant à adapter son enseignement à l’origine migratoire des élèves) participent à renforcer les inégalités.
Quelles que soient les classes sociales, il existe un écart entre les trajectoires scolaires des filles et des garçons : les filles obtiennent, en effet, de meilleurs résultats. Pourtant la réussite scolaire des filles – qui sont confrontées à des discriminations systémiques – ne se traduit pas par une réussite professionnelle comparable à celle des hommes. La philosophe s’interroge : comment s’effectue ce renversement ? Comment se fait-il que la réussite scolaire des femmes n’ait aucun impact sur leur statut social : elles continuent, en effet, de percevoir un salaire plus bas que celui des hommes et occupent des positions hiérarchiques inférieures sur le marché de l’emploi. Selon Irène Pereira, l’école contribue insidieusement à reproduire les inégalités de sexes. Les manuels scolaires et les enseignant·e·s, qui véhiculent des stéréotypes sexistes, jouent un rôle dans la reproduction de ces inégalités. La question de la violence à l’école[10] doit également être posée : en effet, lorsque les filles sont victimes de violence à l’école, c’est le plus souvent de la part de garçons. L’auteure encourage les enseignant·e·s à déconstruire les effets de la « masculinité toxique » en favorisant la construction d’une « masculinité positive ». Elle les incite à veiller à ce que les filles développent leur capacité à s’affirmer : cela peut passer par la prise de parole en public, et par des choix d’orientation socialement ambitieux. Si l’approche matérialiste passe par une analyse des rapports sociaux, précise l’auteure, elle ne nie pas pour autant l’existence d’une dimension normative de l’oppression. Les normes de genre occupent une place importante dans l’espace scolaire : et les élèves ne s’y conformant pas sont stigmatisé·e·s. Irène Pereira rappelle en outre que la déconstruction de la norme dominante ne porte pas seulement sur le genre, mais aussi sur la norme « capacitiste » qui règne dans l’espace scolaire. Le handicap donne lieu, en effet, à divers types de discriminations : certain·e·s subissent les stigmates du handicap visible, d’autres rencontrent des comportements qui équivalent à une négation de leur handicap. Elle attire l’attention, enfin, sur une norme qui oppose réussite scolaire et échec scolaire. Son influence est telle que les parents font de plus en plus fréquemment appel à la médecine pour expliquer la situation d’échec scolaire dans laquelle se trouve leur enfant. On parle à ce propos de « médicalisation de l’échec »[11].
L’analyse sociologique des rapports sociaux à l’école telle qu’Irène Pereira la mène tient compte des dimensions matérielles de l’oppression (approche matérialiste) et de l’existence de normes sociales contraignant les individus (approche normative). Selon la philosophe, l’amélioration des conditions matérielles de vie reste la priorité. La lutte contre les inégalités passe par une remise en question de l’organisation du travail à l’école, et dans la société. Or les enseignant·e·s, nous dit-elle, peuvent devenir acteur·rice·s de cette transformation.
III. Les enseignant·e·s et la question de l’émancipation sociale
Cet ouvrage est principalement adressé à des enseignant·e·s ; la dernière étape consistera donc à interroger le rôle et la fonction de l’enseignement dans l’émancipation sociale. L’auteure fournit ici des pistes aux enseignant·e·s qui souhaitent mettre en pratique une pédagogie critique. Irène Pereira appelle « intellectuel·le transformateur·rice » (l’expression est empruntée à Henry Giroux[12]) l’intellectuel·le dont l’objectif est de transformer la société. L’enseignant·e qui développe la conscience sociale critique des élèves ainsi que leur capacité à s’engager dans des mouvements sociaux émancipateurs peut être qualifié ainsi. Il ou elle transforme les attitudes rebelles – certains élèves issu·e·s de milieux populaires résistent spontanément au système scolaire – en processus d’émancipation, et de non-reproduction. Il ou elle conçoit son enseignement comme une pratique de résistance et pense l’activité enseignante comme un travail militant. Théoriser une pédagogie « émancipatrice », comme le fait l’auteure, implique donc de se poser les questions suivantes : « Peut-on émanciper autrui ? Quel peut être le rôle de l’enseignement et des connaissances théoriques dans le processus d’émancipation ? »[13] Pour répondre à ces interrogations, l’auteure s’appuie sur les travaux du philosophe Paulo Freire[14]. Selon le pédagogue brésilien on peut identifier le processus de conscientisation (l’enseignant·e fait passer l’élève d’une conscience « naïve » ou « rebelle » à une conscience « critique ») à un processus de libération. En effet, dans un contexte d’invasion culturelle par exemple, la conscience naïve est bien souvent une fausse conscience, voire une aliénation. Le rôle de l’enseignant·e est alors, selon le philosophe, d’aider l’élève à prendre conscience de cette situation. L’enseignement a pour fonction de fournir aux apprenant·e·s des connaissances théoriques qui l’aideront à produire une analyse objective des structures générales de l’oppression. Un problème se pose alors : ne peut-on pas reprocher au philosophe de mettre l’enseignant·e « libérateur·rice » dans une posture telle qu’il ou elle impose une vérité à des sujets aliénés ? Dans la mesure où la pédagogie critique place le dialogue au cœur de l’activité enseignante, le danger de dérives dogmatiques est limité. La responsabilité éthique des enseignant·e·s est de faire de l’espace de classe un espace où questions et objections sont admises. C’est à condition que cette exigence dialogique soit respectée que les opprimé·e·s peuvent, effectivement et activement, se libérer.
La notion de conscientisation renvoie, chez Paulo Freire, à une certaine vision de l’homme dans le monde. Selon le philosophe l’être humain se caractérise par l’inachèvement et par le fait d’être conscient. La conscience de l’opprimé·e, explique-t-il dans Pédagogie des opprimé·e·s, est double : il ou elle veut ressembler à l’oppresseur·se (jouir des mêmes privilèges sociaux) et « détruire » l’oppresseur·se (abolir le système de privilèges sociaux). L’opprimé·e hésite quant à la façon dont il souhaite mener son existence, et les deux manières de vivres auxquelles il ou elle aspire sont antagonistes. La praxis éducative a pour objectif d’aider l’élève opprimé·e à dépasser ce conflit existentiel. Cela passe par une dialectique intersubjective au cours de laquelle s’opère un passage d’une conscience naïve ou rebelle à une conscience « réflexive ». L’élève peut ainsi évoluer socialement sans adhérer naïvement au système social au sein duquel il évolue, ou à une quelconque interprétation du réel qui lui serait imposée de façon péremptoire. L’objectif pédagogique est de lui fournir des outils critiques qui lui permettront de développer un rapport exigeant à la réalité sociale qu’il ou elle cherche à déchiffrer, tout en évitant de subir des discriminations liées à sa classe sociale, son origine ethno-raciale, ou son identité sexuelle. Si l’éducation émancipatrice ne remplace pas les mouvements sociaux, comme le rappelle l’auteure, ne peut-on pas considérer qu’elle est susceptible d’aider à la transformation sociale ?
La conscientisation conduit à l’émergence d’une conscience sociale critique, mais il est important, dans le cadre d’une praxis dialogique, d’être attentif aux rapports sociaux tels qu’ils opèrent durant les séances de cours. L’activité pédagogique peut être conçue, nous dit l’auteure, comme une « micro-politique » de la salle de classe : l’enseignant·e et les élèves apprennent à désamorcer les violences et les inégalités. Si la France est un des pays où les trajectoires scolaires sont le plus liées à l’origine sociale des élèves[15], c’est sans doute que certains élèves – ceux qui jouissent d’un privilège culturel et social – sont plus proches de la culture scolaire que d’autres. C’est ce que les travaux sociologiques de Passeron et Bourdieu ont démontré dans les années 1960. Irène Pereira enjoint l’enseignant·e à être explicite quant à l’existence de ce curriculum caché qui avantage et désavantage les élèves en fonction de leur appartenance sociale ; elle les invite à « vendre la mèche »[16] et à dévoiler aux élèves issu·e·s des classes populaires les règles implicites du système scolaire. La philosophe rappelle aux lecteurs·trices que dans une république démocratique comme la France, le principe général qui s’applique à la relation pédagogique est le principe d’égalité. Or les usager·e·s du service public ne sont manifestement pas égaux·ales dans le contexte scolaire. L’objectif du professeur·e doit être, par conséquent, de réduire les inégalités d’informations liées aux privilèges dont bénéficient certain·e·s. Elle met en garde les enseignant·e·s, toutefois, contre le risque qu’il y a à mettre en place un enseignement différencié en adaptant les exercices proposés au niveau scolaire des élèves. En effet, simplifier le contenu pour les élèves en difficulté et être plus exigeant avec les élèves mieux noté·e·s aboutit à une amplification des inégalités scolaires et sociales.
Si l’enseignement favorise l’émergence d’une conscience sociale, rien ne garantit que cela aboutisse à un engagement citoyen. Voilà pourquoi la pédagogie critique doit favoriser l’émergence de mouvements sociaux, et veiller à ce que le renforcement de la conscientisation aboutisse à une action collective de transformation sociale. En effet, une pratique dialogique se limitant au discours est une « parole insignifiante » ; il n’y a de dénonciation véritable qu’à condition qu’il y ait une articulation entre théorie et action, et c’est en classe que ce travail d’articulation doit commencer. On peut associer la pédagogie critique, nous dit l’auteure, à la notion d’« empowerment » qu’on pourrait traduire en français par « autonomisation », « encapacitation », ou « augmentation du pouvoir d’agir ». Elle renvoie aux pratiques pédagogiques ayant pour fonction de développer le pouvoir d’agir des personnes socialement opprimé·e·s, en incitant les « victimes passives » à former un « sujet collectif actif ». Le·a praticien·ne critique fait de la salle de classe un « brave space » : un espace d’encouragement, où chaque élève apprend à faire entendre sa voix. Il ou elle incite les élèves à tenir compte des enjeux sociologiques qui se jouent dans l’espace scolaire. Cela suppose qu’ils et elles apprennent à établir des « alliances » passant par une reconnaissance mutuelle de l’existence des privilèges sociaux et des situations d’oppression. Il est possible de pratiquer en classe des exercices consistant à étudier de façon critique le curriculum caché — les implicites liés à la classe, le sexe, et l’origine ethno-raciale — présent dans le fonctionnement de l’institution scolaire. On peut utiliser, par exemple, les supports scolaires ; inciter les élèves à identifier les stéréotypes genrés qui y sont véhiculés : seuls des couples hétérosexuels sont mis en scène, et chacun y occupe une fonction stéréotypée. Il est possible aussi d’étudier la division du travail dans l’espace scolaire : interroger la présence d’une division ethno-raciale du travail, en se focalisant sur les activités de nettoyage, de cantine, de gardiennage, etc. L’auteure rappelle que le programme de l’Enseignement moral et civique (EMC) comprend une partie sur la culture de l’engagement. Il est possible de mettre en place des actions collectives en lien avec l’écologie : les élèves peuvent envoyer, par exemple, des lettres de protestations aux autorités à propos de dégradations environnementales près de chez eux.
Si la conscientisation ne suffit pas, alors il faut développer chez les élèves une disposition à l’action. L’enseignant·e peut mettre en place des pratiques pédagogiques qui visent à développer le pouvoir d’agir du « sujet collectif » qui se construit en classe. Le·a lecteur·trice qui souhaite donner à son enseignement cette direction peut s’appuyer sur les fiches méthodologiques qui sont fournies en annexe.
Conclusion
L’objectif de cet ouvrage était d’inscrire l’étude du système scolaire français au sein d’une conceptualisation des rapports sociaux. Irène Pereira s’est appuyée, à cette fin, sur des approches diverses : le matérialisme socio-historique, la théorie critique, le féminisme, la théorie décoloniale, etc. Une école socialement juste, nous dit l’auteure, est une école qui n’amplifie pas les inégalités sociales. Or on constate en lisant ce livre que c’est moins le cas en France que partout ailleurs. Il semble donc important de lutter contre les politiques éducatives qui visent à renforcer les mécanismes de discriminations et d’inégalités. On constate aussi, et on peut s’en réjouir, qu’il est possible d’agir en vue de la justice sociale en enseignant la philosophie. L’enseignant·e peut faire de la salle de classe un espace au sein duquel se développent la conscience critique des élèves, ainsi que leur capacité à s’engager en vue de la justice sociale et écologique.
[1] Guy Vincent (dir.), L’Education prisonnière de la forme scolaire ? Scolarisation et socialisation dans les sociétés industrielles, Lyon, PUL, 1994.
[2] Pédagogie post-moderne, pédagogie féministe, pédagogie culturellement adaptée, pédagogie queer, éco-pédagogie, etc.
[3] Irène Pereira, « Controverses savantes et débats militants : mises en abîmes épistémologiques autour de la notion de sens commun » in Raisons politiques, n° 47, 2013, p. 35-56.https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2012-3-page-35.htm#no3
[4] Ce concept est central dans la théorie critique latino-américaine car il permet de penser ensemble la dimension économique (exploitation) et culturelle (idéologie) des rapports sociaux de pouvoir.
[5] La « critique artiste » du système capitaliste contribue à sa régénération. Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.
[6] La sociologue Danièle Kergoat propose une définition dynamique des rapports sociaux. Voir M. Maruani (dir), Femmes, genre et sociétés, Paris, La Découverte, 2005, p. 95.
[7] Voir entre autres Sébastien Faure, « La Ruche », Encyclopédie anarchiste, 1934 (en ligne). https://fr.wikisource.org/wiki/Encyclop%C3%A9die_anarchiste/Routine_-_Ruche
[8] Le poids de l’origine migratoire dans la trajectoire scolaire fait l’objet de controverses liées à l’interdiction de statistiques ethniques en France.
[9] Sylvie de Amorim Alves, « Jeunes d’origine portugaise et maghrébine. Etude comparée des positions scolaires et des mobilisations identitaires », Migrations Société, t. 129-130, fasc. 3, 2010, p. 13-30.
[10] Eric Debarbieux, avec Arnaud Alessandrin, Johanna Dagorn et Olivia Gaillard, 2018, Les violences sexistes à l’école – Une oppression viriliste, Rapport de l’Observatoire européen de la violence à l’école. http://prevenance-asso.fr/wp-content/uploads/2018/06/Les-violences-sexistes-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9cole-une-oppression-viriliste.pdf
[11] Stanislas Morel, La Médicalisation de l’échec scolaire, Paris, La Dispute, 2014.
[12] Henry Giroux, « Teachers as Transformative Intellectuals », Social Education, t. 49, fasc. 5, 1985, p. 376-379.
[13] Irène Pereira, Philosophie critique en éducation, Limoges, Lambert-Lucas, 2018, p. 115.
[14] Paulo Freire, Pédagogie des opprimés, Paris, Maspero, 1974 + Pédagogie de l’autonomie, Toulouse, Eres, 2013.
[15] OCDE, « France – Résultats de l’enquête Pisa 2015 », Notes par pays, 2016 (en ligne) https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-France-FRA.pdf
[16] Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers, Paris, Les éditions de minuit, 1964, p. 111.