Recension – L’autorité de la démocratie
RECENSION :
L’AUTORITE DE LA DEMOCRATIE – UNE PERSPECTIVE PHILOSOPHIQUE
David Estlund, trad. Yves Meinard, Paris, Hermann, 2011 [2008, Princeton University Press]
DE LA NOTION DE VERITE EN POLITIQUE EN GENERAL ET EN DEMOCRATIE EN PARTICULIER.
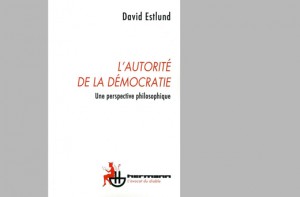
1. Concilier démocratie et savoir : le procéduralisme épistémique.
Qu’est-ce qui confère aux décisions prises démocratiquement leur autorité ? Le débat traditionnel s’articule autour de deux réponses : la procédure – les décisions sont bonnes parce qu’elles ont été choisies démocratiquement – ou la substance – les décisions ont été choisies parce qu’elles étaient bonnes. C’est dans ce débat que s’inscrit l’ouvrage de David Estlund qui propose une théorie de l’autorité de la démocratie. La position qu’il défend cherche à concilier l’autorité que confère une procédure démocratique à une décision et l’exigence de savoir qui est la nôtre : nous aimerions penser que la démocratie tend à prendre les bonnes décisions. Cette dimension épistémique participerait de l’autorité de la décision, que la procédure seule ne saurait lui conférer.
Le thème que choisit David Estlund est engageant : la question du savoir dans la démocratie a toujours été d’actualité. C’est un lieu commun que de dire qu’aujourd’hui la démocratie n’est plus remise en cause. Pourtant l’épistocratie — terme choisi par l’auteur pour désigner le gouvernement par la compétence — continue de hanter l’affirmation démocratique et de la déranger de ses velléités : pourquoi en effet donner une voix aux incompétents ou aux égoïstes ? Cette attitude ne se limite pas aux discours puisqu’elle se traduit dans les faits : que la démocratie soit représentative se fonde en grande partie sur l’argument de la compétence ; et les commissions d’experts se multiplient qui traduisent l’idée qu’une compétence particulière est nécessaire pour nombre de questions dans nos sociétés complexes. La confiance en la démocratie n’a jamais été entière.
David Estlund refuse le glissement de l’expert au chef et se propose de montrer qu’il s’agit là d’un sophisme : le savoir ne donne pas autorité. Même le médecin n’a d’autorité que par notre consentement et non par son diplôme[1]. Nous pouvons refuser le traitement ou contester son diagnostic, il ne peut pas nous contraindre à nous soigner. Il n’en reste pas moins cependant que nous ne souhaitons pas que notre ordonnance soit établie par un vote. L’objectif de David Estlund est donc de proposer une solution à ce dilemme entre, d’un côté, l’exigence démocratique et, de l’autre, l’insatisfaction que nous éprouvons à penser qu’il y a peu ou pas de savoir qui oriente les votes. Cette solution prend la forme du procéduralisme épistémique dont il esquisse ici le cadre philosophique.
L’idée-maîtresse en est la suivante : l’autorité des décisions démocratiques ne provient pas uniquement de la procédure, mais également de leur dimension épistémique. La meilleure preuve en est que si notre seul desideratum était l’équité, nous pourrions, plutôt que de donner par le vote la même possibilité à chaque individu d’influencer le résultat, jouer la décision à pile ou face. Cette procédure également donnerait à chacun la même chance d’influencer le résultat (en l’occurrence, aucune). Si nous n’agissons pas ainsi, c’est donc qu’en réalité nous pensons qu’il vaut mieux ne pas laisser l’initiative au hasard parce qu’il y a de plus grandes probabilités que la décision soit la bonne si elle est prise par des individus qui, à la différence d’une pièce, ont toujours la possibilité de se concerter et de réfléchir.
Cela ne signifie en aucun cas que le vote démocratique conduit systématiquement aux bonnes décisions. Mais son autorité provient en partie du fait que cette décision a de bonnes chances d’être la bonne. Le procéduralisme épistémique donne des raisons morales d’obéir aux résultats et non pas des raisons épistémiques de croire : nous ne sommes pas tenu-e-s de penser que la décision était la bonne ; mais nous sommes tenu-e-s de la respecter. L’autorité de la démocratie repose donc en dernier lieu sur la procédure, mais celle-ci ne suffit néanmoins pas : la décision n’est pas la bonne simplement parce qu’elle a été choisie. Il est nécessaire de faire appel à un critère extra-procédural pour comprendre pourquoi la décision peut faire autorité. Et David Estlund s’emploie à montrer que même les théories qui se veulent les plus purement procédurales — telles la théorie du choix social et la théorie de la démocratie délibérative — font en réalité appel à des critères extérieurs à la procédure[2].
Une analogie utilisée par David Estlund éclaire utilement la solution qu’il propose : le procéduralisme épistémique peut être comparé au jury dans le système judiciaire. Il s’agit en effet d’une procédure que nous configurons de telle sorte qu’elle ait les meilleures chances de trouver la bonne réponse. Mais rien ne peut garantir que ce sera le cas. Nous respectons pourtant les verdicts rendus en choisissant de ne pas châtier nous-mêmes le coupable acquitté ou de libérer l’innocent incarcéré. Ce n’est pas la seule procédure de mise au vote qui confère cette autorité au verdict. C’est également parce que sa décision a une dimension épistémique. Nous serions nettement moins tenté-e-s de respecter le résultat juridique d’un jeu de hasard.
Pour savoir si une décision démocratique est bonne ou non, ne faut-il pas disposer d’une théorie de la justice ou du bien commun préalable ? Si oui, nous en reviendrions à une conception substantielle. Mais David Estlund défend ce qu’il nomme la « valeur épistémique formelle[3] » : une procédure a tendance à trouver les bonnes réponses, quelle que soit la conception de la justice ou du bien commun, c’est-à-dire sans que l’on sache ce qui doit compter comme une bonne réponse. Il n’y là rien d’absurde explique-t-il : n’est-ce pas ce que nous faisons en science ? Nous ne pouvons avoir accès au réel indépendamment de la science que nous en édifions et cela ne nous empêche pourtant pas de juger qu’il y a de bonnes et de mauvaises réponses. Nous faisons la même chose en politique, et ce qui tient lieu alors de prédictions vérifiées — expériences importantes pour la validité d’une théorie scientifique, mais non indispensables puisque toutes les sciences ne sont pas prédictives — est la capacité des démocraties à éviter ce que l’auteur nomme les « maux premiers : la guerre, la famine, l’effondrement économique, l’effondrement politique, les épidémies et le génocide[4]».
Le procéduralisme épistémique se veut ainsi une théorie politique normative qui apporte sa contribution au débat entre procédure et substance et formule une théorie de l’autorité et du consentement. Mais ce qui s’avère particulièrement intéressant est la défense de la démocratie que David Estlund met en place et la manière dont il tente d’articuler les deux exigences initialement posées : celle de la démocratie et celle de la vérité.
2. Défendre la démocratie.
Si la vérité est si souhaitable que cela, pourquoi ne pas se tourner directement vers un gouvernement par les plus compétent-e-s ? C’est l’argument de l’acceptabilité générale[5] qui limite le champ d’extension du principe épistémique : il énonce qu’une procédure ou une décision doivent être acceptables pour tous les points de vue considérés comme qualifiés, c’est-à-dire raisonnables. Or, souligne l’auteur, s’il est possible que tout le monde soit d’accord sur le fait que les plus compétent-e-s devraient gouverner, il n’y a aucune chance que leur identité ne soit pas un problème majeur. C’est ce critère d’acceptabilité générale qui constitue la réponse au sophisme de l’expert et du chef.
Faut-il donc se résoudre à laisser ignorants, incompétents, égoïstes et autres irrationnels diriger ? Pour l’auteur, ces critiques classiques faites à la démocratie ont leur raison d’être et il ne s’agit en aucun cas de les nier. Mais il affirme qu’elles ne sont pas dévastatrices pour la théorie politique normative. Deux éléments doivent en effet être pris en compte. Premièrement, le procéduralisme épistémique ne réclame pour fonctionner qu’une faible probabilité que la décision prise soit la bonne. Il suffit que cette probabilité soit supérieure à celle d’une procédure aléatoire, telle la pièce à pile ou face. C’est la « modestie épistémique[6] ». Deuxièmement, les défauts des votants ne sont peut-être pas aussi rédhibitoires que l’on se plaît à le croire : ne laisse-t-on pas les parents éduquer leurs enfants alors même qu’ils ignorent pour la plupart tout des soins de premiers secours, de la côte des universités et de la valeur énergétique des légumes ? Ces lacunes, leur égoïsme et leur irrationalité n’empêchent pourtant pas que les choses se passent à peu près bien, surtout si l’on y ajoute les vertus de la communication. Peut-être moins bien que si les enfants étaient élevés par des experts, mais cette possibilité a été écartée par le critère d’acceptabilité générale.
Il reste cependant une dernière possibilité à écarter. Celle-ci a notamment été formulée par John Stuart Mill dans ses Considérations sur le gouvernement représentatif : il s’agit du vote plural. L’idée de donner à tous les individus le droit de vote tout en donnant à certains d’entre eux le poids de deux ou trois voix permet de faire en sorte à la fois que la diversité des perspectives s’exprime et que la compétence soit reconnue. David Estlund juge que le critère d’acceptabilité générale est insuffisant et se propose de formuler une objection plus spécifique à la proposition millienne. Elle prend la forme ce qu’il nomme l’« argument démographique[7] » et qui renvoie dans un premier temps à un fait sociologique bien connu : les individus instruits peuvent appartenir principalement à un même groupe social, un même genre, etc., et leurs jugements pourraient ainsi être biaisés. Les effets positifs de l’instruction seraient alors annulés par les caractéristiques qui lui sont liées. On peut aller plus loin et formuler l’argument démographique sous une forme plus radicale encore : il est possible que l’instruction s’accompagne nécessairement de caractéristiques qui contrebalanceraient les effets épistémiques positifs. L’instruction pourrait par exemple conduire statistiquement à des individus plus conservateurs ou plus libéraux. Le vote plural se retrouve donc disqualifié.
Telle est donc la manière dont David Estlund articule démocratie et vérité, écartant l’épistocratie et le procéduralisme pur au profit d’un procéduralisme pondéré par un souci de la décision bonne. La défense ainsi produite de la démocratie est très intéressante sur certains points, même s’il n’est pas toujours évident de voir en quoi la théorie ainsi présentée est normative et non pas simplement descriptive dans une large mesure. Mais ce qui me semble plus problématique et qui constitue un point central dès que l’on aborde le thème ici choisi est la question de la vérité politique.
3. Comment défendre la démocratie s’il existe des vérités en politique ?
Le problème de la vérité en politique est suffisamment important pour que David Estlund l’aborde dès après le chapitre introductif. Il s’agit pour lui de défendre l’idée qu’il existe des critères extra-procéduraux normatifs vrais qui permettent de juger les décisions politiques. Cette affirmation est d’importance parce qu’elle va décider de l’endroit où va se porter l’attaque contre le sophisme de l’expert et du chef. L’épistocratie est en effet définie par trois principes[8] : le principe de vérité (ci-dessus énoncé), le principe de savoir (« certaines personnes (relativement peu nombreuses) connaissent ces critères mieux que les autres ») et le principe d’autorité (selon lequel l’expert doit diriger). Or, David Estlund soutient à la fois qu’il existe des critères substantiels et que certain-e-s d’entre nous sont mieux à même de les connaître. C’est donc sur le troisième principe que vont porter ses objections.
Le second chapitre prend le temps d’examiner plusieurs attaques contre ces deux premiers principes et entame l’argumentation poursuivie dans les chapitres suivants selon laquelle toute théorie de la démocratie qui se veut purement procédurale fait en réalité appel d’une manière ou d’une autre à des critères extra-procéduraux. David Estlund se montre prudent dans son utilisation de critères extra-procéduraux pour sa propre théorie et il différencie le niveau abstrait de sa position générale de ce qui est utilisé dans le procéduralisme épistémique pour évaluer les décisions : le critère d’acceptabilité générale[9]. Il n’en reste pas moins, et l’auteur le souligne, que ce principe ne peut suffire sans référence à la vérité[10] et l’ensemble de sa thèse repose sur cette idée qu’il existe des vérités en politique.
Cela ne va pas sans poser quelques difficultés puisque l’auteur se retrouve alors obligé de soutenir que les citoyens partagent globalement une même conception de la justice publique[11] afin que sa théorie fonctionne. En outre, l’ouvrage prête le flanc aux traditionnelles questions qui accompagnent le débat actuel sur la place des experts et des sages dans nos démocraties. Que peut vouloir dire en effet l’affirmation selon laquelle une décision politique est plus sage que d’autres ? David Estlund mentionne régulièrement l’exemple des taux d’imposition. Mais existe-t-il réellement une réponse qui soit plus vraie que les autres entre une tranche d’imposition à 94% dans les États-Unis de 1944 et le taux actuel de 35% ? Sans compter que l’auteur mentionne principalement comme exemple d’experts moraux des experts religieux et oppose implicitement compétence morale et compétence technique, supposant ainsi qu’il existerait des savoirs purement objectifs et dénués de toute valeur et de tout préjugé.
Mais surtout, il me semble que cette posture rend très fragile la défense de la démocratie que propose David Estlund, et ce d’autant plus que, des deux exigences à concilier — vérité et démocratie —, sa préférence va à la première. D’une part, David Estlund n’affronte jamais la question de savoir pourquoi je devrais préférer la vérité à la démocratie. Il part du principe que, si bonne décision il y a, naturellement nous mettrons tout en œuvre pour l’atteindre. N’était le principe d’acceptabilité générale, l’auteur plaiderait probablement pour un gouvernement des plus compétent-e-s. Il ne montre d’ailleurs aucune ambiguïté sur ce point puisqu’il affirme que la démocratie n’est pas pour lui une valeur ultime[12].
D’autre part, David Estlund se retrouve en position de prouver que la démocratie est conciliable avec une dimension épistémique comprise à l’aune de cette notion de vérité politique. Conformément au principe de modestie épistémique, il suffit de montrer que la probabilité que la décision prise démocratiquement soit bonne est supérieure à celle d’une procédure aléatoire. Or, il peine à satisfaire ce principe, aussi modeste soit-il. Il contourne habilement la difficulté en affirmant que ce qui importe n’est pas de prouver cette supériorité, mais d’établir que les citoyens sont compétents sur les questions relatives aux maux premiers, compétence qui viendrait contrebalancer leur possible médiocrité sur des questions moins vitales pour la société : « Ce dont nous aurions besoin, ce n’est donc pas d’une compétence globalement meilleure que le hasard, mais plutôt d’un bilan meilleur que le hasard quand la valeur des décisions est pondérée au prorata de leur importance[13]». Mais ce point ne paraît pas plus facile à démontrer.
La démocratie ne se retrouve pas alors en très bonne posture au terme du raisonnement. Concilier l’exigence démocratique et l’exigence de vérité se révèle en effet compliqué. Or, le principe de vérité étant préféré, il paraît logique, si une telle conciliation échoue, de chercher à le conserver au détriment de la participation de tous et toutes au processus politique.
Adeline Barbin – Paris 1, Phico/Nosophi
[1] D. Estlund, L’Autorité de la démocratie. Une perspective philosophique, tr. fr. Y. Meinard, Paris, Hermann, 2011, p. 15.
[2] Cf., notamment, chapitres 4 et 5.
[3] D. Estlund, L’Autorité de la démocratie. Une perspective philosophique, tr. fr. Y. Meinard, Paris, Hermann, 2011, p. 312.
[4] Ibid., p. 303.
[5] Voir notamment le chapitre 3.
[6] D. Estlund, L’Autorité de la démocratie. Une perspective philosophique, tr. fr. Y. Meinard, Paris, Hermann, 2011, p. 311
[7] Ibid., p. 395
[8] Ibid., p. 63
[9] Sur ce point, voir notamment pp. 50-51
[10] Voir notamment le chapitre 3 qui est consacré au critère d’acceptabilité générale.
[11] D. Estlund, L’Autorité de la démocratie. Une perspective philosophique, tr. fr. Y. Meinard, Paris, Hermann, 2011, p. 210
[12] Ibid., p. 309
[13] Ibid., p. 432














