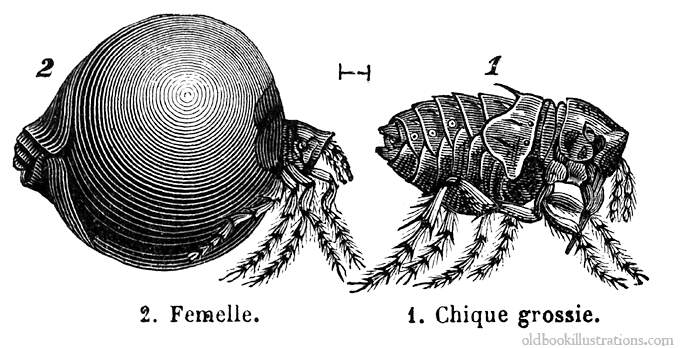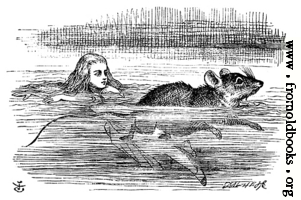Variations sur la fin de l’exception humaine
Florian Forestier
Dans son étude dédiée aux schèmes cognitifs, Kant et l’ornithorynque[1], Umberto Eco souligne la distinction qu’il faut poser entre type cognitif, contenu nucléaire et contenu molaire d’un concept.
1) Le type cognitif (que d’autres appelleraient prototype, ou schème au sens kantien) permet la reconnaissance de l’exemplification d’un concept à travers l’organisation d’un pattern (perceptif… ou non) et sa plus ou moins grande proximité à une distribution optimale de celle-ci. 2) Le contenu nucléaire désigne le « noyau stable et social » qui permet aux individus de se comprendre lorsqu’ils prononcent le terme correspondant au concept en question, alors que 3) le contenu molaire désigne l’ensemble élaboré des connaissances portant sur lui (sachant que le contenu nucléaire lié à certaines pratiques scientifiques peut se rapprocher du contenu molaire).
Avoir une telle distinction à l’esprit avant d’aborder la problématique philosophique de l’animalité de l’humain est important pour éviter un certain nombre d’empiétements. D’une part en effet, notre science des choses et des êtres s’est développée à partir des mots, eux-mêmes imprégnés de notre expérience, portant les traces d’évaluations, de contextes et d’usages passés, bref, de leur inscription dans ce que Marc Richir appelle une institution symbolique.
« Par institution symbolique, nous entendons donc tout d’abord, dans sa plus grande généralité, l’ensemble qui a sa cohésion, des “systèmes” symboliques (langues, pratiques, techniques, représentations) qui “quadrillent” ou codent l’être, l’agir, les croyances et le penser des hommes, et sans que ceux-ci en aient jamais “décidé” (délibérément) […][2] »
D’autre part, sur fond de ces mots se sont élaborées des sciences plus systématiques, fixant leurs concepts à partir de caractères définitionnels plus stricts et rigides. Le terme d’animal est alors peu à peu devenu une catégorie, puis, au fur et à mesure des raffinements de la science biologique, un rameau dans l’arborescence plus vaste du vivant : les animaux sont consensuellement décrits comme des organismes eucaryotes (qui se caractérisent par un noyau de mitochondries dans leurs cellules) pluricellulaires généralement mobiles et hétérotrophes (qui se nourrissent de matière organique prélevée sur d’autres vivants plutôt que de la synthétiser eux-mêmes).
Stabilisé scientifiquement, ce concept demeure bien sûr cependant évolutif et négociable[3], et sa plasticité dépend toujours aussi de son historicité et de son évolution. Ainsi, on réserve aujourd’hui le terme d’« animal » à des êtres complexes et multicellulaires, bien qu’on ait longtemps considéré les protozoaires comme des animaux unicellulaires – ce que le concept d’animal exclut à présent. En effet, les protozoaires sont maintenant classifiés parmi les protistes (eucaryotes unicellulaires) hétérotrophes, les protistes (catégorie générale désignant les eucaryotes autres que les animaux [métazoaires], champignons [eumycètes], et plantes[4]). L’établissement et l’évolution de ces nomenclatures, de l’étude des proximités génétiques et fonctionnelles à la proximité phylogénétique (cladistique), constituent en tant que tel une discipline en évolution[5].
Quelle que soit cependant l’évolution du concept d’animal, l’espèce humaine appartient sans conteste à ce rameau du vivant, dont elle constitue une énième subdivision. En ce sens-là, la question de l’appartenance de l’humain au phylum animal ne pose aucune difficulté. Tout au plus en importent peut-être les conséquences pour caractériser certains traits spécifiques de l’espèce humaine rapportés à cet itinéraire évolutif (genre homo, grands singes, singes, mammifères, vertébrés, etc.[6]) dans le cadre des sciences de l’homme. La question, méthodologique, partiellement factuelle et partiellement intellectuelle, est alors plutôt celle de la pertinence des sciences biologiques à proposer des paradigmes ou des modèles de compréhension de l’humain et des sociétés humaines.
1) Peut-on séparer philosophie et méthode ?
L’approche éthologique de l’humain et des sociétés humaines s’est longtemps calquée sur la méthodologie biologique classique, de sorte qu’une sociobiologie souvent grossière s’est vue récusée par des sciences humaines se targuant de posséder leur propre grille de lecture et d’interprétation de leurs objets : formes culturelles, structures sociales, etc.
La question de l’élargissement et de la circulation de ces catégories fait encore débat, tout autant à vrai dire que le rôle que pourrait jouer une biologie admise au sein des sciences humaines et sociales. Que le biologique soit un support ou une base des structures sociales et culturelles (en ce sens minimal qu’elles ne se développent pas contre lui) n’implique en rien que celui-ci soit encore lisible comme tel au sein de leurs objets. Les disciplines d’interfaces, comme la psychanalyse ont bien plutôt insisté sur la façon dont l’intrication du social et du culturel au biologique en décale et déphase d’emblée (et donc indémélablement) l’expression.
Derrière ces questions de méthodes et de frontières, insistent cependant des questions philosophiques qui procèdent bien plutôt du contenu nucléaire du concept d’animal, des traces de sa genèse et de son élaboration, du système d’oppositions et de hiérarchisation que sa mise en place recouvre. En ce sens alors, la question philosophique de l’animal requiert plutôt une archéologie[7] et une déconstruction[8]. À ce titre, la question du sens d’une « généralité animale » autant que d’une exception humaine, de sa dissipation ou de son maintien se pose dans toute sa complexité. Si l’homme est de part en part animal, cela n’implique en rien que la culture, la société et le sens lui-même soient réductibles au biologique : culture, société, subjectivité deviennent alors plutôt des formes spécifiques de l’animalité humaine qui invitent à élargir la compréhension générique que nous avons de l’animalité (ou des animalités).
Peut-être s’agit-il alors de mettre plus précisément en perspective l’idée de l’exception humaine et de sa fin. Pour Jean-Marie Schaeffer[9], cette thèse se décline en trois acceptions : philosophique, avec l’inaliénabilité de la subjectivité humaine, sociologique et culturelle, les trois déclinaisons suscitant autant de verrouillages disciplinaires : « Mon but n’est pas de détruire le “sujet” ou la métaphysique, mais de réfléchir à une étude de l’humain qui intégrerait les connaissances apportées notamment par la biologie et la psychologie[10]. » Pour autant, cette thèse relève selon lui de l’ordre des visions ou conceptions du monde et non de celui des savoirs ; c’est bien plutôt la façon dont elle entrerait en contradiction avec les développements de l’ordre des savoirs qui la rendrait indéfendable (et qui plus est, nocive aux sciences) : une prise de conscience de cette contradiction inviterait plutôt à développer une nouvelle vision du monde articulant les rapports de l’humain aux non-humains, animaux, végétaux, vivants, naturels en général. Pour autant, une telle réforme nous paraît, pour notre part, utopique si l’on ne travaille pas d’abord à même les structures sous-jacentes à notre vision du monde : comme telle, la suspension de l’exception humaine risque de faire surgir de nombreux spectres incontrôlés (pour reprendre les termes de Derrida), si l’on ne tente pas de comprendre ce qu’on nie ou affirme quand on nie ou affirme l’exception humaine.
Dès lors, on se demandera aussi bien si la suspension de l’exception humaine ne risque pas à son tour d’être dupe de ce contre quoi l’humanité elle-même s’est constituée dans ses représentations : que dit-on précisément lorsque l’on affirme la fin de l’exception humaine et l’appartenance de l’humanité au règne animal (donc, plus avant, au vivant, à la nature, au monde) ? Toute la question est bien ici que les catégories subsumantes que nous avons dégagées au sein de systèmes d’oppositions et de hiérarchisations (nature, vivant, animal) doivent à leur tour être comprises d’une façon qui fasse droit à ce que nous savons de nous-mêmes.
Trop souvent, quelles que soient les précautions prises, une telle assertion s’accompagne en effet d’un mouvement réductionniste proclamant que nous sommes des animaux (que nous ne sommes que des animaux, au sens nucléaire et non molaire), proclamant ainsi que nous relevons d’une catégorie que nous avons-nous même forgé, que, dès lors, nous ne sommes plus ce qui nous était le plus proche. Nous incluant nous-mêmes dans ce que nous avons constitué comme domaine restreint et privatif, en niant trop unilatéralement les différences, nous sommes pris à notre propre piège et nous nous faisons à nous-mêmes ce que nous avons fait aux autres animaux.
2) Sciences de la société, sciences de l’homme et sciences du vivant
Les réactions défensives des sciences humaines et sociales s’expliquent aisément face à des disciplines ayant souvent cherché à nier la spécificité de leurs objets ou à les réduire à des compositions des leurs. Insister en retour sur la réalité fondamentale du social et du culturel (réalités s’inscrivant aussi bien au sein des corps mêmes qu’elles modèlent) était à ce titre légitime. Pour autant, après les premiers tâtonnements sociobiologiques, les stratégies interprétant des phénomènes humains à partir de catégories issues de la biologie se sont raffinées : de prime abord, tant la mémétique[11] que le modèle viral de contagion de Sperber procèdent de transpositions méthodologiques. Il s’agit d’appliquer à des phénomènes culturels et sociaux des mises en formes catégoriales inspirées de la biologie – méthodes dont l’échec ou la fécondité devront être estimés au sein même des sciences humaines.
Le darwinisme, explique D. Dennett[12], produit une structure interprétative extrêmement forte pour expliquer l’émergence, le développement et l’évolution de phénomènes complexes. En ce sens, il propose un paradigme qui dépasse les seules sciences biologiques et s’applique en vérité à l’ensemble des phénomènes dont l’étude implique de résoudre un certain format de problèmes – non formalisables[13]. Bien évidemment, l’élargissement d’un tel paradigme aux sciences humaines et sociales implique des ajustements : pour que le concept de « mème » s’avère porteur, il faut pouvoir le spécifier au même titre que celui de gène, examiner ses processus de réplication, de transmission, de combinaison, son hérédité. Ce faisant, on impose en fait aux sciences humaines et sociales bien plus qu’un modèle heuristique : on leur impose des principes (une certaine forme de déterminisme naturaliste), une méthodologie, des axes de travail, de telle sorte qu’une part importante de leurs questions traditionnelles deviennent inaudibles ou non-scientifiques. À l’absorption par la biologie succède ici la colonisation par les principes méthodologiques de la biologie.
Il faut bien voir cependant que c’est moins la réduction ou la mise entre parenthèses des descriptions intentionnelles et de la subjectivité en général que la réduction des objets que sont les sociétés, le social, la culture qui peut susciter un rejet méthodologique ; après tout, le structuralisme de Lévi-Strauss autant que celui de Bourdieu est, à l’égard de la subjectivité, tout aussi méfiant, voire plus, que le paradigme naturaliste. La conception émergentiste du social et du culturel fragilise ce qui est le cœur des sciences sociales depuis Durkheim, à savoir la décision de considérer le social comme une réalité (les faits sociaux durkheimiens) et, dès lors, de penser à partir de lui.
Nous nous individuons et prenons conscience de nous-même socialement et symboliquement : le social est premier pour nous, au sens où c’est en son sein et à partir de lui que notre conscience élabore son rapport à ses objets. L’éthologue, pour lequel une longue familiarité avec les grands singes permet de déceler au sein des comportements humains le même type de fonctionnements et de rituels auquel ses observations l’ont accoutumé ne devrait pas oublier qu’il décèle ceux-ci au sein d’une société constituée, sur fond de celle-ci, que sa propre étude s’est déjà accomplie sur fond d’une socialisation sans laquelle la position même d’observateur n’aurait jamais pu être gagnée. Le travail de distanciation et d’objectivation à l’égard des choses qui produit l’horizon de l’objet et celui de la véracité, la catégorie de nature et le projet d’une science de la nature, est lui-même porté par une structure sociale, une éducation, une discipline collective, de sorte qu’il paraît risqué de soumettre en retour le social à une catégorie dont il porte aussi la genèse et soutient la mise en travail.
Par conséquent, c’est moins l’absence de pertinence des résultats de la biologie pour la sociologie ou l’anthropologie que la question du sens sociologique de résultats biologiques qu’il s’agit de poser. La nature humaine s’exprime socialement et culturellement ; les résultats de la biologie doivent être traduits dans la langue de la sociologie ou de l’anthropologie, de telle sorte que l’unification d’un paradigme naturaliste de l’humain perd un peu de son sens confronté à la diversité des niveaux de discours ici à l’œuvre[14]. L’enjeu, sans doute, est bien plus dans les discours d’interfaces et de traductions que dans l’unification de paradigmes dont la définition préalable et rigide des objets et des méthodes rend la rencontre impossible ou infructueuse.
3) Structures dissipatives et zigzag méthodologique
Un mouvement contraire rétrocédant de l’homme aux autres animaux, s’est, lui, attaché à comprendre les animaux (et au-delà, la vie elle-même) à partir de concepts issus du développement de l’informatique et de la cybernétique. Le vivant est appréhendé à partir de la notion d’information et de réplication : il préserve, réplique, enrichit l’information et constitue en cela un ensemble de structures dissipatives[15]. Dans cette perspective, l’idée d’auto-organisation est également importante : celle-ci « […] est un mécanisme ou un ensemble de mécanismes par lesquels des structures sont produites au niveau global d’un système à partir d’interactions entre ses constituants à un niveau d’intégration inférieur[16] », dont le propre est de créer des significations imprévues et surprenantes en utilisant le « bruit » des niveaux sous-jacents au système considéré.
L’homme est pensé comme un animal néoténique (il naît peu formé et peu spécialisé et conserve des caractéristiques juvéniles, comme la faible pilosité, à l’âge adulte), comme un fœtus de primate parvenu à maturité sexuelle, qui se constitue un environnement technique auquel il est conduit à s’adapter, l’hominisation n’étant pas autre chose que l’ensemble des feed-back réglant le mouvement de cette extériorisation. Le développement des possibilités imaginatives, atténuant la distinction des perceptions externes et internes, la désactivation des instincts inhibiteurs de comportements néfastes à la survie des groupes favorise à son tour celui du langage et la formulation des interdits. Dans un tel contexte, les messages nerveux correspondant aux comportements automatiques sont hachés et dispersés par la multiplicité des connexions neuronales, de sorte que les rituels qu’on peut identifier et isoler comme instinctifs chez l’homme n’auraient lieu qu’avant 3 ans, mis à part quelques comportements ultérieurs très vite détournés et décalés à leur tour par le jeu social et culturel[17].
Plus avant, les approches inspirées de la systématique et des théories de l’auto-organisation prennent au sérieux, pour leur part, la question du sens et de l’expérience subjective humaine qui cesse d’être seulement matériau. Dans la filiation des éthologies d’inspiration phénoménologique de Von Uexküll et Buytendijk, on prendra au sérieux le fait que si les autres animaux sont des animaux comme nous, c’est bien aussi qu’ils ressentent, expérimentent, qu’en tant qu’êtres sentants et sensibles, leur expérience n’est pas totalement étrangère à la nôtre. Cette contamination expérientielle[18] et catégorielle est l’un des axes de la réflexion développée par D. Lestel[19], interrogeant tout autant les origines animales de ce que nous appelons culture que les façons dont nous entrons en contact avec les animaux et dont nous les appréhendons sur fond d’une certaine empathie qui nous permet – sinon de les comprendre – du moins de ne pas rencontrer en eux une pure et muette altérité.
Le vivant est alors ce qui n’adhère pas entièrement à son environnement, à quelque niveau que ce soit, il est mouvement, évolutif, métastable plutôt que stable. De ce point de vue la membrane cellulaire est autant ce qui distingue un intérieur d’un extérieur que ce qui engendre ce mouvement d’inspiration[20] à même le décalage. S’il y a un sens à invoquer une subjectivité de la cellule[21], c’est bien que la subjectivité elle-même est conçue comme défaut primordial d’intériorité et sur fond de ce défaut, co-individuation articulée à une extériorité, schéma qui est d’ailleurs pour Bernard Stiegler le fond commun de toute la « french theory ». L’hominisation prolonge et démultiplie alors ce décalage en accumulant l’indétermination et les potentialités. Pour utiliser les termes d’Edgard Morin :
« […] Le terminus de l’hominisation est en même temps un commencement. L’homme qui s’accomplit en homo sapiens est une espèce juvénile et enfantine : son cerveau génial est débile sans l’appareil culturel […]. Ce sur quoi s’achève l’hominisation, c’est l’inachèvement définitif, radical et créateur de l’homme.[22] »
4) En quête de l’an-archique
Mais cette lecture à son tour, malgré toutes les précautions qu’elle veut prendre, n’échappera pas à certaines naïvetés méthodologiques si elle reconduit à partir de là une vision stratifiée et hiérarchisée de la genèse plutôt que d’en assumer la « complication originelle » et d’en interroger le concept sur fond d’allers-retours tout au long du spectre du vivant. Ici, il sera plus fécond et plus prudent encore de nous intéresser aux tentatives d’envisager l’articulation de l’animalité et de l’humanité dans leur conflictualité (l’animalité renvoie bien à quelque chose que le symbolique ne peut enserrer dans ses rets) et leur intraductibilité partielle. Il s’agit de « tenir compte de ce qu’est réellement l’homme », d’en prendre acte[23], non au sens de l’assomption d’une détermination irréductible, mais de celle d’une finitude, indiquant qu’il est aussi vain d’espérer d’illusoires prouesses évolutives de l’homme en direction d’un perfectionnement, sachant qu’il est aussi un carnivore et un prédateur, et que s’il n’y a pas de nature humaine à proprement parler (sinon de se dénaturer et de s’indifférencier), il y a malgré tout un noyau de naturalité inassignable, mais tout aussi irréductible.
Pour autant, on l’a vu, prétendre sortir complètement de l’humain, du symbolique et du social par l’imposition de catégories elles-mêmes produites au sein du social et du symbolique est risqué. Malgré le perfectionnement de l’appareillage de la connaissance, nous n’échappons sans doute que de façon épisodique et fugace aux précompréhensions trop humaines au sein desquelles celui-ci opère. La perte de familiarité du monde dans lequel nous vivons et des façons dont nous l’investissons, l’angoisse heideggerienne ou l’inquiétante étrangeté freudienne constituent à ce titre des indices bien plus probants de l’abîme qu’est la concrétude de notre propre existence.
La psychanalyse freudienne, laquelle s’est toujours montrée prudente à établir des continuités et des dérivations, s’est précisément voulue, en son temps, une semblable pensée des lisières[24], de même que la phénoménologie tardive de Merleau-Ponty. Penser l’animalité de l’homme implique bien en effet de concevoir, dans les termes de Merleau-Ponty, une préhistoire du sujet et de l’objet pour comprendre les processus qui sous-tendent à leur « bifurcation »[25]. Pour Merleau-Ponty, on le sait, corps et monde se constituent au sein de ce qu’il nomme la chair : le sensible se scinde en sentant et senti, éclate et se phénoménalise par éclatement, déhiscence de sa propre masse.
Dans les notes pour Le visible et l’invisible, Merleau-Ponty place à la base de la phénoménalisation d’un monde et de ses horizons de sens un processus originaire de sédimentation existentiale mettant en jeu des concrétudes qui agissent comme des existentiaux incarnés[26]. Ailleurs, Merleau-Ponty évoque « […] ce logos qui se prononce silencieusement dans chaque chose sensible en tant qu’elle varie autour d’un certain type de message dont nous ne pouvons avoir l’idée que par notre participation charnelle à son sens, qu’en épousant par notre corps sa manière de signifier[27]. » Pour Merleau-Ponty, les espaces sensoriels sont d’une certaine façon « articulation avant la lettre […][28] » : cette articulation au sein du sensible porte la possibilité du langage et de la sédimentation de significations stabilisées en idéalités. Comme le signale par ailleurs Étienne Bimbenet :
« On reconnaîtra […], en revenant à la lettre de La Structure du comportement, que la “conscience naturée” y est présentée comme inséparable de la “conscience naturante”, que par conséquent la vie en nous est inséparable de la fonction “symbolique” ou “catégoriale” qui est dite en sublimer intégralement le sens, que dès lors un corps humain, aussi vivant soit-il, n’est plus rien d’animal, enrôlé qu’il est dans “la sphère de l’esprit” et de la “connaissance d’un univers”, qu’enfin “le problème de la perception est tout entier dans cette dualité”, La Structure du comportement, p. 190-191.[29] »
Ici, la refonte mise en place par Marc Richir de la thématique des Wesen sauvages peut servir de guide pour cette compréhension de la « sauvagerie » phénoménologique, de cet « excès de la facticité de la certitude factice d’exister sur ses contenus contingents[30] ». En effet, la préhistoire merleau-pontyenne est peut-être elle-même encore trop humaine et la compréhension de notre animalité nous invite à concevoir une préhistoire plus profonde et anarchique, faite d’une multitude d’éclats, dont le régime serait celui de la trace plutôt que celui de la chair. Ainsi, écrivions-nous :
« Aussi bien les instincts et les prégnances sensibles que des amorces d’habitus culturellement transmises sans être comme tels ressentis ont le statut de traces. Pour tout vivant, le rythme n’est pas pensé comme étreinte du vivre ou de la vie, mais comme jeu de traces[31]. »
Pour Alexander Schnell, les Wesen sauvages jouent en effet dans la phénoménologie richirienne comme une archi-écriture derridienne. L’humanisation s’arrache d’une résonance chaotique et hasardeuse ouvrant à une proto-temporalisation/proto-spatialisation :
« […] l’homme est toujours en chemin vers l’homme, son humanité réside tout entière dans l’hominisation – la civilisation – in-finie de l’inhumain en lui, sans que nous puissions jamais savoir en quoi consiste “proprement” l’inhumain[32]. »
Avec Jean Zin, nous pouvons tout aussi bien, pour parler un langage plus biologique, rappeler que :
« De même qu’information et communication, système nerveux et cerveaux nous précèdent bien sûr largement, on trouve certes des ébauches d’à peu près tous les comportements humains dans le règne animal[33]. »
La logique permettant de penser cette situation s’avérant bien, là encore, celle de l’inscription et de la trace – la possibilité d’une sortie de l’animalité étant inscrite au sein même de cette animalité, qu’il faut à son tour repenser selon cette structure.
5) Repenser l’animalité sous le régime de la trace
Dès lors, si nous ne pouvons penser notre animalité que sur le registre de la trace, c’est cependant l’animalité elle-même que nous sommes invités à concevoir ainsi. Chez l’animal aussi il y a de la culture et de la trace.
L’animal aussi est habité par sa propre préhistoire, ce qui l’accroche au reste du monde étant du même coup qui l’en coupe et lui fait écran. Tout vivant hérite d’une inscription avec laquelle la vie s’est faite, car « […] il n’y a pas d’organe qui ne se développe sur une aptitude préalable du vivant[34]. » La vie se bricole à partir de traces : elle est bel et bien prothétique de sorte qu’il « […] faut penser la vie comme trace avant de déterminer l’être comme présence. C’est la seule condition pour pouvoir dire que la vie est la mort […][35]. »
Le concept d’archi-écriture, loin de n’affecter que la question de l’idéalité et son jeu avec la trace, implique que questionner les processus d’inscriptions en tant que tels – plus vieux, donc, que les comportements humains qui s’y structurent. Loin cependant d’être reconductible à l’idée de programme génétique ou mémétique, la logique de l’archi-écriture permet de repenser les conditions de constitution d’un tel concept et ses impensés. En effet :
« Au lieu de recourir aux concepts qui servent habituellement à distinguer l’homme des autres vivants (instinct et intelligence, absence ou présence de la parole, de la société, de l’économie, etc.), on fait ici appel à la notion de programme. Il faut l’entendre, certes, au sens de la cybernétique, mais celle-ci n’est elle-même intelligible qu’à partir d’une histoire des possibilités de la trace comme unité d’un double mouvement de protention et de rétention[36]. »
Il s’agira certes, comme le proposent déjà un certain nombre de biologistes, dont H. Atlan, de remettre en question l’« idée de code génétique, et du modèle informatique qu’elle véhicule, confondant selon lui “données” et “programme” et postulant une relation verticale du génome à l’organisme »[37]. Plus avant cependant, c’est la logique d’inscription que recèle l’idée de code ou de programme génétique qu’il s’agit de comprendre sur fond de la problématique de l’archi-trace, afin de préciser le sens de cette idée – ou plutôt, de mieux comprendre ce que le programme génétique n’est pas.
Sous cet angle, l’étude des prémisses non vivants du vivant (qui ne sont, c’est un truisme, prémisses que du point contingent de l’émergence du vivant sur leur base), de la synthèse des monomères (acides aminés, bases organiques) puis des polymères complexes (protéines constituées par accrochage d’acides aminés, acides nucléiques par accrochage de sucres, puis combinaisons des uns et des autres[38]) est particulièrement instructive dans la mesure où ceux-ci ne constituent d’abord qu’autant d’inscriptions, de briques ou de signes aléatoires avant qu’un processus de complexification, lié à la mise en place de la membrane cellulaire, ne les enrégimente pour la réplication et la complexication de l’information – le code génétique ne devenant tel que contingentement, et sans se départir de la facticité de ses supports.
Une telle conception semble superficiellement rejoindre la conception de D. Dennett :
« Pour employer une image, votre arrière-arrière… grand-mère était un robot. Mais ces robots macromoléculaires ne sont pas seulement vos ancêtres, ils sont la matière dont vous êtes faits […] – votre corps tout entier (y compris votre cerveau, bien entendu), à tous les niveaux de l’analyse, depuis la molécule, est composé de mécanismes qui accomplissent aveuglément un travail magnifique, conçu avec art[39]. »
À cela près que D. Dennett semble faire du robot et de l’idée de robot quelque chose d’évident, que l’on pourrait tout aussi simplement opposer à une conception classique du vivant, sans s’interroger sur ce que les définitions de l’un et de l’autre recouvrent d’intrications cachées. Si le terme de robots a un sens dans la perspective de l’archi-écriture, c’est seulement dans la mesure où ces robots fonctionnent mal, qu’ils sont agencés et articulés de façon approximative, en un organisme où bruit et organisation s’entremêlent.
Mais là encore, moins que la mise en avant du bruit comme source d’auto-organisation, donc de création de significations nouvelles (selon les mots d’H. Atlan), c’est l’intrication de ce bruit et des agencements comme écriture qu’il faut questionner. Comme nous l’écrivions ailleurs :
« De même alors qu’on a vu comment penser et affiner la différence de l’homme aux autres animaux à partir de la contamination des critères, de même on pensera dans cet horizon ce qu’avec Derrida, Nancy et Stiegler j’appellerai les contaminations de l’inanimé vivre ou de la vie, mais comme jeu de traces[40]. »
Le vivant se constitue et se maintient sur fond de la non-vie (signalait déjà Nietzsche)[41] – non contre-elle ni en elle, mais avec elle, habité par elle, comme un processus de formation jouant de la finitude : « En tant que vie-en-différance, la vie zoo-biologique n’est pas la vie : elle se déploie comme la non-identité à soi du rien, comme trace donc – ou comme mort[42]. » La mise en place de la membrane cellulaire est particulièrement importante dans cette perspective, dans la mesure où elle ne permet pas seulement la séparation fonctionnelle d’un intérieur et d’un extérieur mais la stabilisation d’une facticité – elle protège la complexité interne de la cellule et en protège tout autant dès lors les arrangements aléatoires et superflus sinon voués à la dissolution rapide.
La préservation de cette facticité, de ce bruit, facilite les phénomènes d’émergence ; elle ne cesse d’habiter la complexité qui s’organise sur sa base, celle-ci étant d’ailleurs à penser de manière tout aussi spatiale que matérielle. Les dispositions originelles et contingentes des premiers composants au sein de la cellule et leur évolution s’expriment ainsi au sein de la variété des organisations physiologiques ultérieures, et cela quelles que soient les convergences fonctionnelles et morphologiques décelables entre rameaux distincts[43]. La complexité des formes et des corps s’exprime sur fond de la contingence spatiale d’un système d’inscriptions[44] que l’évolution met en travail dans la pluralisation du vivant : en quelque sorte, cette facticité permet de comprendre le vivant en lui appliquant une logique de quasi-transcendantalité[45], selon laquelle la contingence d’arrangements initiaux soutient une complexité ultérieure sans menacer les principes à partir desquels celle-ci est lisible[46].
6) La finitude comme condition de pensabilité de l’onto-logie et le toucher du monde
Bien évidemment, une telle approche revient aussi bien à interroger la finitude comme condition de possibilité de toute onto-logie, dans la mesure où nous sommes du même mouvement invités à réinvestir le concept de physis comme ce qui croît de soi et par soi. Et en effet, il faudrait ici montrer comment la déconstruction d’une certaine compréhension de la physis, et avec elle, de la possibilité de penser l’étant en tant que tel, indépendament de toute configuration (de penser l’étant « de nulle part »), de toute constellation et de toute coexistence, apparaît comme un préalable à une telle pensée du vivant et de la « vie-en-différance ». Citons Derrida :
« Notre monde se touche. Est-ce que cela voudrait dire, comme le tolère une grammaire française, qu’on le touche qu’il est touchable et tangible ? Non, non seulement “notre monde” se touche lui-même, il se fléchit, s’infléchit et se réfléchit, il s’auto-affecte et s’hétéro-affecte ainsi, il se plie à lui-même, sur lui-même. Il se touche pour devenir monde, certes, mais aussi pour sortir de lui-même. […] Il se touche pour sortir de lui-même. Il touche “quelque chose” en lui-même. Mais ce “quelque chose” n’est pas une chose et cet “en soi” n’est plus une intériorité[47]. »
Précisons-bien qu’il n’est pas question ici de chercher à conceptualiser une puissance d’apparaître de l’être, comme Ruyer ou Chambon, mais bien d’interroger la co-appartenance d’une certaine idée de contact et de celui d’étant – de comprendre que l’étant n’est envisageable qu’en tant qu’il touche et est touché par d’autres étant, en temps qu’on le pense à l’intérieur du monde et depuis l’intérieur du monde[48].
Cela ne revient pas dès lors à faire de la vie une puissance de la nature, mais à montrer que, de par leur conditions de pensabilité, physis et zoe sont déjà mêlés : la vie n’est plus pensée comme une rupture miraculeuse et inouïe de l’ordre de l’inerte, mais, au sein de l’étant qui n’a de sens que contigu, rapporté à l’étant, inscrit dans l’étant, comme un redoublement de cette finitude : « […] au niveau de la physis-en-différance, celle-ci, en tant qu’entame pré-phénoménale de l’apparaître, avait le statut d’une origine dont il fallait reconnaître la participation a priori […][49]. »
À quoi sert cependant, pourra-t-on demander, cette approche extrêmement spéculative qui ne nous apprend rien sur le vivant lui-même, et finalement bien peu sur l’homme ? À rien, sinon à défaire, ou du moins à mettre en évidence l’entr’appartenance de catégories posées comme hétérogènes, à compliquer la logique des oppositions, des continuités, des émergences miraculeuses ou des genèses lissées, et ainsi, à avancer à tâtons pour ne pas recouvrir une question qui, en tant que telle, est bien plus opaque qu’il n’y paraît, et qu’il s’agit d’abord de désenfouir.
Conclusion
Ainsi donc, la fin de l’exception humaine ne s’assumera encore que sur fond de cette exception. À ce titre, la matrice derridienne (genèse, trace, contamination) nous paraît la plus riche façon d’assumer la complexité de la question de (ou des animalités) et du rapport des pensées que l’on peut en avoir et d’une pensée de l’humain.
Nous conclurons alors sur ceci qu’une pensée de l’inscription et de la trace (donc, une pensée de la complication originaire de l’origine), permet à la fois l’appartenance et l’exception, dans la mesure où l’appartenance elle-même se comprend sur fond de la possibilité de l’accident – donc du surgissement de rupture. Pour citer encore une fois Derrida :
« La psyché – ou la culture, ou le symbolique […] prend le relais, un relais différantiel, justement des lois dites génético-biologiques. À certains moments, cette différance peut l’interrompre ; à d’autres, elle peut introduire dans l’immanence du vivant, l’économie d’une nouvelle configuration. L’interruption elle-même[50]. »
Dès lors, on assumera bien une certaine forme d’exception humaine, articulée à la question de l’idéalité et de son adresse. Comme nous l’écrivions ainsi :
« La racine de la phénoménologie est peut-être même la distinction fondamentale de l’abstraction et de l’idéalisation, et la mise en évidence de la structure d’horizontalité normative de l’idéalisation, laquelle implique la position d’un champ d’objets potentiels, quand l’abstraction peut s’accomplir de manière locale, aveugle à sa propre opération, totalement incapable de la réfléchir et de l’objectiver à son tour. Elle est liée à l’acte d’idéalisation, à l’acte de se donner comme objet la formalité du raisonnement, de poser l’idée de raisonnement. Cette idéalité n’a cependant de sens qu’en ce qu’elle convoque un sujet à un acte d’actualisation. Étienne Bimbenet, dans L’animal que je ne suis plus, insiste à juste titre sur l’aspect capital de la dimension subjective de cette question, qu’on l’envisage où non de la façon dont Husserl le fait. Dès lors, cependant, cette idéalisation n’est également compréhensible que sur fond d’une forme de distance interne[51]. »
Mais la logique de l’idéalité à son tour sera compliquée, rapportée au jeu d’inscription et de trace qui en ouvre la possibilité, de sorte que l’exception humaine elle-même renverra encore à une ouverture à l’exceptionnel toujours déjà logée dans la logique an-archique du vivant.
[1] U. Eco, Kant et l’ornithorynque, Paris, Le Livre de Poche, 2001.
[2] M. Richir, L’expérience du penser, Grenoble, Éditions Jérôme Millon, 1996, p. 14.
[3] Sur la plasticité des concepts et les négociations de leur usage, cf. bien sûr J. Benoist, Concepts. Introduction à l’analyse, Paris, Cerf, 2010.
[4] Le vivant lui-même se divise en deux règnes : les procariotes (archées et eubactéries) et les eucaryotes (qui se caractérisent par la présence d’un noyau et de mitochondries, et se partagent en protistes, plantes, animaux, et les champignons, la classification pouvant encore être compliquée de nombreux clades). Sur tout cela, cf. le classique de J. Ruffié, Traité du vivant, Paris, Fayard, 1982, p. 436 – 510.
[5] Voir S. Pécaud, Cladistique et évolution : une fondation problématique, Paris, Classiques Garnier, à paraître en 2015.
[6] De même, le phylum animal se constitue d’abord de formes primitives à symétrie radiale (éponges), peu à peu complexifiée avec la constitution d’un ventre (anémones) : la brisure de la symétrie radiale et le développement de la forme ver (symétrie axiale) constitue la rupture fondamentale, permettant la constitution d’un système nerveux, point d’explosion radiative distingant les mollusques, artropodes et vertébrés, poissons d’abord, puis amphibiens, reptiles, oiseaux et mamifères, pour poser les jalons principaux de ces classifications). Voir J. Ruffié, ibid.
[7] Proposée par exemple par É. de Fontenay dans Le silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité, Paris, Fayard, 1998.
[8] Voir bien sûr J. Derrida, L’animal que donc je suis, Paris, Galilée, 2006.
[9] J.-M. Schaeffer, La fin de l’exception humaine, Paris, Gallimard, 2007. On pourra lire à ce sujet l’excellente recension de Thibaut Gress, « Jean-Marie Schaeffer : La fin de l’action humaine », Actu-Philosophia, 20 mars 2009, http://www.actu-philosophia.com/spip.php?article102
[10] É. Lévy et J.-M. Schaeffer, L’homme un animal comme les autres ?, in Le Point, n° 1890, 4 décembre 2008, p. 108, cité in T. Gress, ibid.
[11] R. Dawkins, Le gène égoïste, Paris, Odile Jacob, 2003 ; D. Dennett, Théorie évolutionniste de la liberté, Paris, Odile Jacob, 2004 ; D. Dennett, Darwin est-il dangereux ?, Paris, Odile Jacob, 2000.
[12] Voir S. Blackmore, La théorie des mèmes : Pourquoi nous nous imitons les uns les autres, Max Milo Editions, « L’Inconnu », 2005. À ce sujet, voir l’excellent article de Katia Kanban, « L’unification du paradigme naturaliste grâce au darwinisme étendu : la mémétique et ses contradicteurs », Actu-Philosophia, 27 février 2013, http://www.actu-philosophia.com/spip.php?article449
[13] Sur le modèle du jeu de la vie de Conway chez Dennett, cf. en particulier son article « De l’existence des patterns », dans Fisette et Poirier, Philosophie de l’esprit, Psychologie du sens commun et sciences de l’esprit, Paris, Vrin, 2001.
[14] C’est toute la fécondité de travaux anthropologiques comme ceux de P. Descola que de tenir compte de la naturalité de l’humain en l’étudiant cependant à même ses expressions sociales et culturelles, à travers la reprise de la problématique des schématismes et de leur mise en oeuvre. Voir bien sûr Par delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005 : « (…) contrairement aux contructions harmonieuses et bien finies que le dualisme de la nature et de la société nous avait donné l’habitude d’ériger, la présente tentative demeure un chantier dont le maitre d’œuvre ne se résout à avancer la livraison que dans l’espoir de voir ceux qui souhaiteraient s’y engager lui donner au fil du temps, en même temps qu’un aspect et une disposition peut-être fort différents de ceux qu’il avait anticipés, l’allure d’un véritable édifice habité en commun », p. 551.
[15] I. Prigogine et I. Stengers, La Nouvelle Alliance : Métamorphose de la science, Paris, Gallimard, « Folio », 1986.
[16] H. Atlan, Le vivant post-génomique, Paris, Odile Jacob, 2011, p. 10. L’auto-organisation caractérise une forme spécifique d’émergence, marquée par sa complexité. Pour rappel, on parle d’émergence lorsque l’interaction d’un ensemble de « composants » acquiert des propriétés qu’il faut analyser au niveau global (ce qu’on traduit en langage courant en disant que « le tout dépasse la somme des parties »). Les systèmes moléculaires se caractérisent ainsi par un ensemble de propriétés émergentes par rapport aux processus atomiques. On ne peut cependant pour l’auteur parler d’auto-organisation qu’en cas d’émergence « non-triviale » : les molécules ne résultent pas de processus d’auto-organisation des atomes, et forment elles-mêmes des structures homogènes, régulières ; les cristaux sont à l’inverse une bonne illustration de l’auto-organisation de par leur variété et la richesse de leurs structures.
[17] C’est la théorie exposée par Edgar Morin dans Le paradigme perdu : la nature humaine, Paris, Seuil, 1979.
[18] Dont nous avons exposé quelques traits dans notre article : « Pourquoi l’animalité intéresse-t-elle la phénoménologie », Eikasia n°59, 2014 : « Sous cet angle, il n’est certes plus question de dégager un absolu de l’humain, ou un absolu de l’animal, mais bien d’engendrer dialectiquement des concepts plastiques et problématiques. Continuité et ruptures se pensent alors de concert, car la méthode qui les met à jour ne rend plus contradictoire le fait de les assumer dans leur réverbération. L’opposition polaire et première (pour l’itinéraire de pensée phénoménologique) de l’homme et de l’animal s’accompagne d’une contamination méthodologique, les structures dégagées au sein des pôles humains et animaux s’éclairant les unes les autres, sans supprimer la polarité qui anime cette logique d’échanges. »
[19] Voir par exemple D. Lestel, Les origines animales de la culture, Paris, Flammarion, 2001.
[20] B. Stiegler, Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue, Paris, Flammarion, 2010.
[21] J. Zin, La subjectivité du vivant : http://jeanzin.fr/2011/06/12/la-subjectivite-du-vivant/. L’auteur tente d’élaborer une théorie de ce qui serait la subjectivité de la cellule. Ainsi, écrit-il, « Parler de spontanéité pourrait sembler plus approprié que de parler de subjectivité pour une cellule si on ne restait ainsi dans le mécanique, réduit aux biotechnologies, alors que le vivant se spécifie à chaque fois par le fait de constituer une totalité. Un organisme peut être le lieu de toutes sortes de contradictions internes entre processus concurrents mais n’en constitue pas moins une totalité effective, qui se (re)produit elle-même constamment comme totalité (elle fait système). D’après Varela, le système immunitaire qui maintient l’intégrité de l’organisme peut être considéré comme l’organe cognitif au niveau moléculaire mais cette fois sans aucune subjectivation en dehors du signal de douleur ou de stress, la réponse immunitaire étant essentiellement locale. »
[22] E. Morin, Le paradigme perdu, op.cit., p. 103.
[23] Darwin commentait ainsi la pensée de Marx : « très belle théorie, mais il y a erreur sur l’espèce ».
[24] Cf. l’excellent article d’Augustin Dumont : « La pulsion à traduire : animalité, rêve et psychosomatique de l’humain », Eikasia, n°59, 2014. http://revistadefilosofia.com/59-06.pdf. Ici, parler d’instincts chez l’homme est trompeur ; la pulsionnalisation brouille d’emblée toute expression inctinctive, au point de précéder celles-ci (dans le cas de la sexualité). « Laplanche n’hésite pas à écrire ceci : « Ce qu’il faut dire, est à proprement parler stupéfiant : dans la sexualité humaine et son développement, l’acquis survient, non pas sur la base de l’inné, mais avant l’inné ». En d’autres termes, au moment où les transformations hormonales de la puberté confèrent à l’adolescent des moyens qu’il n’avait pas auparavant, ses instincts sont déjà intégralement vicariés par ce qu’il a appris au contact de l’autre adulte depuis l’état de nouveau-né, où l’expérience de montages adaptatifs est transie de l’altérité et intégralement subvertie. »
[25] M. Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, Paris, Gallimard, 1979, p. 160.
[26] Très explicitement, il écrit : « Des concrétudes ou des Wesen phénoménologiques sauvages portant en eux-mêmes, en leur masse indivise, du sensible (visible, tangible, audible, etc.), de la Stimmung, et de la pensée. » (Ibid., p. 57). Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964, en particulier « Interrogation et intuition ». Voir aussi, dans les Appendices, le concept de rayons de monde (p. 293-295).
[27] M. Merleau-Ponty, Le visible et l’Invisible, op.cit., p. 261.
[28] M. Merleau-Ponty, ibid., p. 168. Merleau-Ponty parle également de « (…) significations qui ne sont pas de l’ordre logique », Structure du comportement, Paris, PUF, 1942, p. 135. Il se propose de développer « une nouvelle idée de la raison » (Sens et non Sens, Paris, Nagel, 1948, p. 7.), et évoque « une raison élargie », ibid., p. 79.
[29] É. Bimbenet, « Sens pratique et pratiques réflexives », Archives de Philosophie n°1/2006, Tome 69, p. 57 -78.
[30] M. Richir, Phantasia, affectivité, imagination, Grenoble, Éditions Jérôme Millon, 2004, p. 150.
[31] F. Forestier, « Pourquoi l’animalité intéresse-t-elle la phénoménologie ? », Eikasia n°59, 2014.
[32] M. Richir, L’expérience du penser, Grenoble, Éditions Jérôme Millon, 1996, p. 17.
[34] J. Zin, L’humanisation du monde : http://jeanzin.fr/2011/07/07/l-humanisation-du-monde/
[35] J. Derrida, « Freud et la scène de l’écriture » dans L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967, p. 302, cité par Stanislas Jullien, La Finitude Infinie et ses Figures. Considérations philosophiques autour de la radicalisation de la finitude originaire chez Derrida, (thèse), p. 552. La thèse de S. Jullien constitue une reference majeure pour les développements qui suivent.
[36] J. Derrida, De la grammatologie, Paris, Éditions de Minuit, 1967, p.125.
[37] H. Atlan, Le vivant post-génomique, Paris, Odile Jacob, 2011.
[38] Voir J. Ruffié, ibid., p. 428.
[39] D. Dennett, La diversité des esprits. Une approche de la conscience, Paris, Hachette, 1998, p. 40.
[40] F. Forestier, « Pourquoi l’animalité intéresse-t-elle la phénoménologie ? », Eikasia n°59, 2014.
[41] F. Nietsche, « La vie n’est qu’une variété de la mort, et une variété très rare », Le gai savoir, III, § 109.
[42] S. Jullien, op.cit., p. 552.
[43] R. Gorenflot, « Convergences Morphologiques », Encyclopædia Universalis [en ligne], consultée le 9 novembre 2014. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/convergences-morphologiques//
[44] Selon Luciano Boi, « (…) les mathématiques connaissent une révolution profonde parce qu’on observe qu’elles sont partie prenante aux phénomènes qu’elles décrivent et essaient d’expliquer. Le réel agit sur les objets mathématiques. Les espaces se modifient sous l’effet des phénomènes qui s’y déroulent. Finalement, la structure dépend pour une large part des phénomènes dynamiques qu’elle organise et qui en deviennent une part intégrante. Ce qui veut dire, bien sûr, que la connaissance des structures géométriques, ou topologiques, est inséparable de la compréhension des phénomènes qui s’y déroulent. », Luciano Boi : La nature est-elle géométrique ? www.elisabrune.com/pdf/Boi.pdf
[45] Le terme de quasi-transcendantal est utilisé par Derrida dans Positions (Paris, Éditions de Minuit, 1972, p. 220.). Dans Glas (Paris, Éditions Galilée, 1974), Derrida évoque également un simili-transcendantal (p. 272, note 1) et désigne une acception élargie du transcendantal capable d’englober également l’impur et l’accidentel.
[46] Le concept kantien de l’organisme n’est pas détranscendantalisé, comme le voudrait H. Atlan, mais plutôt quasi-transcendantalisé. Avec Kant, on peut toujours affirmer qu’un « corps peut être considéré, en lui-même et dans sa possibilité intérieure, comme une fin de la nature, à condition que les parties de ce corps se produisent toutes réciproquement, dans leur forme et dans leur liaison, et produisent ainsi, par leur propre causalité, un tout, dont le concept puisse à son tour être jugé comme étant la cause ou le principe de cette chose dans un être qui contient la causalité nécessaire pour la produire (…), de telle sorte que la liaison des causes efficientes puisse être jugée en même temps comme un effet produit par des causes finales. » (Critique de la faculté de juger, § 66), mais en assumant une base factitielle de cette organisation dont la contingence est irréductible.
[47] J. Derrida, Le toucher, Jean-Luc Nancy, Paris, Galilée, 2000, p. 67.
[48] En cela, nous rejoignons le réalisme spéculatif de G. Harman ou de T. Garcia, même si nous n’en tirons pas les mêmes conclusion.
[49] S. Jullien, op.cit., p. 554.
[50] J. Derrida, De quoi demain – dialogues, Paris, Fayard-Galilée, 2001, p.73-74.
[51] F. Forestier, « Pourquoi l’animalité intéresse-t-elle la phénoménologie ? », Eikasia n°59, 2014.