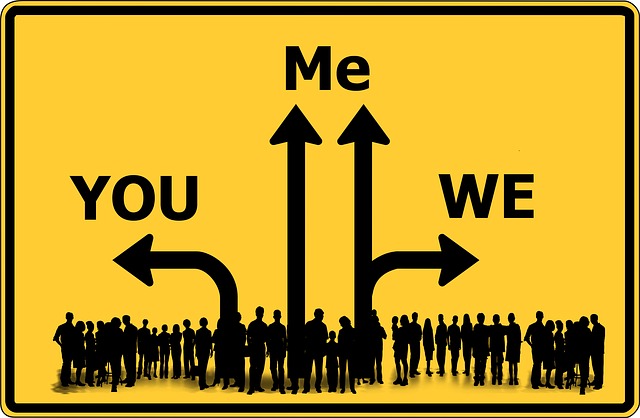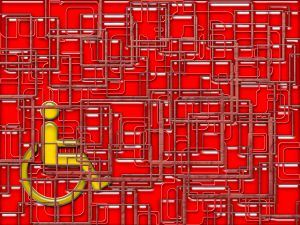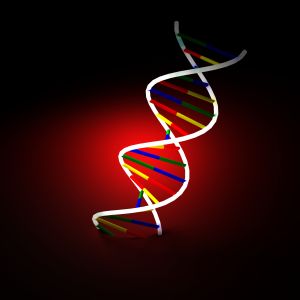Biopolitique et biopouvoirs
Judith Revel – Paris 1 – Phico
On pourrait commencer par une espèce d’inventaire à la Prévert : un philosophe contemporain affirme qu’Auschwitz aurait été la matrice du paradigme biopolitique ; des associations de parents et d’enseignants réagissent à la proposition gouvernementale de détecter l’asocialité des tout petits enfants en première année de maternelle parce qu’ils y voient une mesure de contrôle biopolitique ; un président des Etats-Unis, au début des années 2000, parle de l’importance de relancer le thème – fondateur pour la politique américaine – de la « frontière » sous la forme d’une « nouvelle frontière biopolitique »[1]. En somme, on le voit : le mot « biopolitique » – et son apparent synonyme de « biopouvoir » – connaissent depuis quelques années une fortune très grande ; et pourtant, mais le sens qu’on leur attribue – et les usages qui en sont faits – sont bien loin d’être homogènes.
Par biopolitique, on semble malgré tout se référer dans tous les cas à un type particulier d’exercice du pouvoir (ou à un type d’intervention des dispositifs politiques) portant sur des objets spécifiques, et que l’on pourrait caractériser au sens littéral comme des « biopouvoirs », c’est-à-dire comme une application des pouvoirs à la vie. Du même coup, si la « biopolitique » implique la transformation d’un certain nombre d’éléments de nos vies en enjeux du pouvoir – alors même que nous considérions jusqu’alors comme extérieurs à la sphère politique en ce que nous les qualifions de « privés » -, deux grands axes de réflexion semblent en réalité se déployer.
L’un privilégie l’interrogation sur les conditions historiques d’émergence de ce type de pouvoir : dans quel contexte, en fonction de quels impératifs, au nom de quelle rationalité de gouvernement la biopolitique est-elle devenue une forme nécessaire – ou peut-être même la modalité générale – de l’exercice du pouvoir ? L’autre préfère faire jouer dans notre propre présent la notion de biopolitique afin de redoubler l’analyse historique d’un discours pour aujourd’hui. Ce discours peut envisager l’extension du politique à des objets nouveaux, appartenant au champ de la vie, comme un nouveau défi qu’il s’agit de relever avec passion – c’est le cas par exemple des politiques de recherche autour de la question du séquençage du génome humain ; mais il peut tout aussi bien s’alarmer du fait que ces nouvelles politiques se traduisent souvent par des pouvoirs inédits qui « mordent » dans nos vies de manière nouvelle – il s’agit alors essentiellement de dénoncer les abus de ce pouvoir renouvelé, son ingérence dans nos existences, son extension sans limite, et les dangers que cela est susceptible de générer. Et, des techniques de reconnaissance de l’individu par son iris ou ses empreintes digitales, comme c’est désormais le cas aux frontières de nombreux pays, au fichage généralisé des goûts que nous professons, des idées que nous affichons, des images et des musiques que nous partageons, comme dans l’étrange publicisation du privé si caractéristique des réseaux sociaux sur internet, de plus en plus d’éléments de nos existences ramènent de fait à la dimension de la biopolitique .
En réalité, entre l’intention descriptive et le discours critique, entre l’archéologie d’une émergence et le diagnostic vigilant porté sur notre propre actualité, il n’y a pas de réelle opposition : chez Michel Foucault, à qui l’on doit le néologisme de biopolitique[2] (et celui, intimement lié, de biopouvoirs), l’un et l’autre sont tour à tour explorés.
On s’en souviendra peut-être : dans la réflexion foucaldienne, le terme de « biopolitique » désigne originairement la manière dont le pouvoir tend à se transformer, entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, afin de gouverner non seulement les individus à travers un certain nombre de procédés disciplinaires, mais l’ensemble des vivants constitués en « populations », c’est-à-dire en ensembles homogènes généralement définis à partir d’un ou plusieurs traits considérés comme «naturels ». La biopolitique redouble donc les disciplines, et superpose au gouvernement des individus un gouvernement des populations : c’est avant tout d’un changement d’échelle qu’il s’agit ; mais la biopolitique, parce qu’elle massifie le contrôle des disciplines, doit utiliser un levier nouveau ; et ce levier, ce sera celui du déplacement du contrôle du côté de champs d’existence qui, jusqu’alors, étaient considérés comme « extra-politiques ». Si l’on ne considère plus seulement les hommes en tant qu’individus, c’est-à-dire comme citoyens, mais qu’on les définit en tant que « vivants », comme appartenant à telle ou telle « population » (les « jeunes » et les « vieux » : les » sains » et les « malades » ; les « femmes « et les « hommes » ; les « féconds » et les « stériles » ; les « normaux » et les « porteurs de tares » etc.), le contrôle des naissance , les politiques de santé, la vigilance à l’égard des mœurs, l’attention à « normalité » de la structure familiale, l’imposition de normes d’hygiène et d’alimentation, la prévention de l’alcoolisme, de la violence intra-familiale ou de la « déviance sexuelle » deviennent autant de domaines d’action nouveaux. On n’y fera plus jouer la règle juridique (vieille expression de la souveraineté s’il en fut) mais un autre instrument – la norme – afin de déterminer en permanence la distribution massifiée des « populations » qu’il s’agira dès lors de gouverner.
Bien sûr, cette extension des rapports de pouvoir à l’existence des hommes considérés comme « vivants » (et la mutation qualitative qui affecte dès lors ces mêmes rapports en ce qu’ils sont désormais devenus « normatifs », et non plus seulement juridiques) se traduit par des interventions parfois extrêmement utiles et positives, qui changent très concrètement les conditions d’existence des hommes et des femmes en les améliorant – c’est le cas, par exemple, de l’essor des politiques de santé à partir du XIXe siècle ; mais ce que l’on pourrait considérer comme une soudaine « philanthropie » du pouvoir – dont les effets bénéfiques existent, encore une fois, de manière évidente : la construction de la conception contemporaine du welfare en dérive en bonne partie – possède en réalité une raison historiquement déterminée, et dont Foucault nous rappelle l’ambigüité.
Si l’on tente en effet l’analyse du cadre de rationalité politique dans lequel elle apparaît, la notion de biopolitique émerge avec la naissance du libéralisme. Ce libéralisme est économique (c’est-à-dire lié à une forme de production nouvelle, la production industrielle ; à une organisation du travail spécifique, celle de la structure de l’usine ; et à une pensée économique qui fait de la valeur d’échange et de la quantité de travail les deux éléments déterminants de la valeur d’une marchandise) ; mais il est également politique (pour faire en sorte que ce type de production croisse, il faut instaurer une conception du libre marché, c’est-à-dire préconiser un retrait, ou une suspension au moins partielle des interventions de l’Etat – précisément parce que pour laisser agir la « main invisible » du marché, il faut prendre garde à ne pas « trop gouverner »). La biopolitique répond donc à cette mutation, de deux manières.
D’une part, elle emprunte à cette nouvelle économie de la production sérielle des marchandises ses propres critères et les applique à sa gestion des hommes et des femmes. En somme : elle transforme son mode de gouvernement en une économie politique construite sur le modèle de l’économie libérale : il s’agit de maximiser les effets tout en réduisant les coûts, d’affirmer qu’on risque toujours de trop gouverner, en écho au libéralisme économique, et pourtant – malgré cela et en vertu de cela – d’obtenir des hommes, individuellement et ensemble, des prestations productives. De l’autre, puisqu’il s’agit de mettre les hommes au travail, il s’agit de rentabiliser au maximum ces mêmes prestations productives : il faut donc administrer non seulement leur temps de travail mais leur existence tout entière en fonction des impératifs de la production économique, dans la mesure où c’est toute l’organisation de la vie qui permet la maximisation de la production. L’hygiène, la démographie, l’alimentation, les mœurs, la sexualité : tout cela doit être contrôlé afin de permettre l’amélioration de la productivité des hommes – singulièrement, comme individus, et massivement, comme « populations », c’est-à-dire aussi comme force de travail.
Bien sûr, l’analyse « archéologique » de Foucault ne se borne pas à une description historique : par rebond, elle nous oblige à interroger la manière dont nos vies, en tant que potentiellement « productives » (de valeur économique), sont aujourd’hui redéfinies par une série de pouvoirs qui traversent leur matérialité quotidienne, alors même que l’économie et l’organisation du travail sont en pleine mutation, et laissent toujours plus de place à des formes de production de la valeur qui, bien loin des analyses archéologiques de Foucault, sont désormais cognitives, sociales, coopératives .
Aujourd’hui, la production de la valeur dépend en large mesure de l’interaction des hommes et des femmes, de leur activité libre et créatrice, de leur inventivité, des structures de réseau qu’ils réussissent à construire. Quelle biopolitique en assure-t-elle alors l’organisation, la rentabilisation et la captation ? Comment le capital construit-il des dispositifs de mise au travail de la socialité et de l’inventivité humaines afin d’en faire des sources de profit ? A travers quels biopouvoirs peut-il s’assurer de la mise au travail des existences, alors même que le lieu clos de l’usine, auquel la production industrielle était attachée, a aujourd’hui essaimé en une série infinie de contextes et de figures – formelles et informelles, spatialement mobiles et temporellement flexibles, précaires et intermittentes -, et que le temps de vie et le temps de travail tendent désormais toujours davantage à se superposer ?
Par ailleurs, cette archéologie interroge profondément une grande « lecture » de la biopolitique auxquelles on tend sans doute trop rapidement, aujourd’hui, à réduire l’enquête.
Celle-ci consiste en effet à « biologiser » la notion de vie sans tenir compte du fait que des « pouvoirs sur la vie » peuvent être tout aussi bien des « pouvoirs sur l’existence ». Bien entendu, la biologisation de l’idée même de vie est l’un des leviers sur lesquels se construit le discours biopolitique ; mais le levier n’est nécessaire qu’en ce qu’il permet paradoxalement de gouverner – au nom de cette « biologisation » – les existences dans leur dimension sociale, politique ou culturelle. Parler de détection précoce de l’asocialité chez les enfants de trois ans, n’est-ce pas pour les gouvernants, dans une sorte d’écho aux thèses lombrosiennes assez terrible, attribuer leur propre difficulté politique – à assurer l’intégration des individus dans la communauté démocratique des égaux – aux gouvernés eux-mêmes , c’est-à-dire enraciner par avance l’« intégration manquée » de certains individus dans le terrain biologique (une « anomalie comportementale » repérable dès les premières années de vie) qui serait dès lors désormais le seul responsable de tous les maux de la société ? En somme, la manipulation ultime de la biopolitique, n’est-ce pas de faire se recouvrir ces deux termes que la pensée grecque nous avait pourtant habitués à distinguer – la Zoè (la vie naturelle, biologique, animale) et le Bios (la vie politiquement et socialement qualifiée) ?[3] De rendre politiquement et socialement responsable la Zoè, alors même que nos existences (le Bios : notre vie quotidienne) sont mises à sac au nom d’une productivité elle-même en pleine redéfinition ? La crise financière est ainsi, pour certains, le dernier avatar d’un biopouvoir en mutation : comment gouverner les hommes et les femmes, alors même qu’ils sont devenus de plus en plus libres et indépendants, mobiles et productifs, reliés entre eux et en même temps autonomes, si ce n’est par l’hypothèque de leur existence dès la naissance ? Dans ce contexte, certains[4] n’hésitent pas à interpréter la récente crise des pays avancés non pas comme l’effet d’un système économique dévoyé par la finance, mais comme la mise au point d’un régime de gouvernementalité nouveau, fondé sur l’endettement, et touchant aux éléments les plus fondamentaux de l’existence – par exemple le logement (puisque la première bulle financière fut, aux Etats-Unis, celle des prêts immobiliers), ou la santé. Et l’on ne peut pas ne pas être attentifs (et sans doute impressionnés) quand l’on entend depuis quelques temps certains analystes annoncer que la prochaine bulle spéculative se prépare sur les prêts universitaires (et leur titrisation financière) – c’est-à-dire sur l’accès au savoir et à la formation[5]. La bulle annoncée est vertigineuse : 1000 milliards de dollars. L’homme endetté nouveau visage biopolitique du gouverné ?
[1] On aura peut-être reconnu, dans l’ordre de leur apparition, Giorgio Agamben (cfr en particulier : Homo Sacer I. Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, Seuil, 1997 ; Homo Sacer III. Ce qu’il reste d’Auschwitz. L’archive et le témoin, Paris, Payot-Rivages, 1999) ; la récente proposition de certains députés – récurrente depuis 2007 – d’introduire une enquête-diagnostic en petite section de maternelle afin de détecter de manière précoce les enfants asociaux et représentant potentiellement une menace pour le bon fonctionnement de la communauté ; enfin, les déclarations de Bill Clinton, le 26 juin 2000, à la suite de l’annonce de l’achèvement de l’ébauche de séquence du génome humain : Clinton avait alors parlé de « nouvelle frontière biopolitique ».
[2] Chez Foucault, le terme apparaît dès octobre 1974, dans le cadre d’une conférence faite au Brésil, à l’université d’Etat de Rio de Janeiro, publiée trois ans plus tard sous le titre : « La naissance de la médecine sociale ». Le texte est désormais repris in M. Foucault, Dits et Ecrits, Paris, Gallimard, vol. 3, texte n° 196. Foucault écrit alors : « Pour la société capitaliste, c’est le bio-politique qui importait avant tout, la biologie, le somatique, le corporel. Le corps est une réalité bio-politique ; la médecine est une stratégie bio-politique » (p. 210). Le terme deviendra central dans les analyses foucaldiennes de la fin des années 1970, en particulier dans les cours du Collège de France : voir à cet égard Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979, Paris, Gallimard, 2004.
[3] Le reproche a en particulier été fait à deux des plus importants et des plus féconds « lecteurs » de la pensée foucaldienne de la biopolitique : d’une part, Giorgio Agamben, dont l’usage du terme de « biopolitique » est retravaillé sans cesse par le thème, introduit à partir de références à W. Benjamin et à M. Heidegger, de la « vie nue » (Cfr. en particulier Homo Sacer I et Ce qui reste d’Auschwitz, op. cit.) ; de l’autre, Roberto Esposito, qui développe à partir du terme de « biopolitique » une analyse des paradigmes de contrôle des sociétés contemporaines fondée sur l’idée d’immunité – c’est-à-dire en reprenant la vieille idée moderne de la société comme corps, et en y greffant une biologisation du politique dont on ne sait jamais si elle vaut comme métaphore ou comme une description réelle (cfr. en particulier R. Esposito, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Turin, Einaudi, 2002 ; Bios. Biopolitica e filosofia, Turin, Einaudi, 2004, et en français : Communauté, immunité, biopolitique, Paris, Les Prairies ordinaires, 2010). Chez Agamben comme chez Esposito, la différence entre Bios et Zoè est soigneusement rappelée – mais la superposition des termes semble paradoxalement revenir en permanence dans leur propre discours. Sur ce point, je me permets de renvoyer à mon : « Identity, Nature, Life. Three biopolitical deconstructions », in Theory, Culture, Society, special issue : Michel Foucault, 2009.
[4] Voir à cet égard le livre passionnant de M. Lazzarato, La fabrique de l’homme endetté. Essai sur la condition néolibérale, Paris, Amsterdam, 2011.
[5] C’est par exemple très clairement ce qu’indique un article du New York Times en 2011 : http://www.nytimes.com/2011/01/09/business/09law.html?_r=2&. L’idée semble désormais reprise par les analystes économiques eux-mêmes : voir par exemple un récente article des Echos (juin 2013) : http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202836895106-nouvelles-tensions-aux-etats-unis-autour-des-prets-etudiants-576938.php.