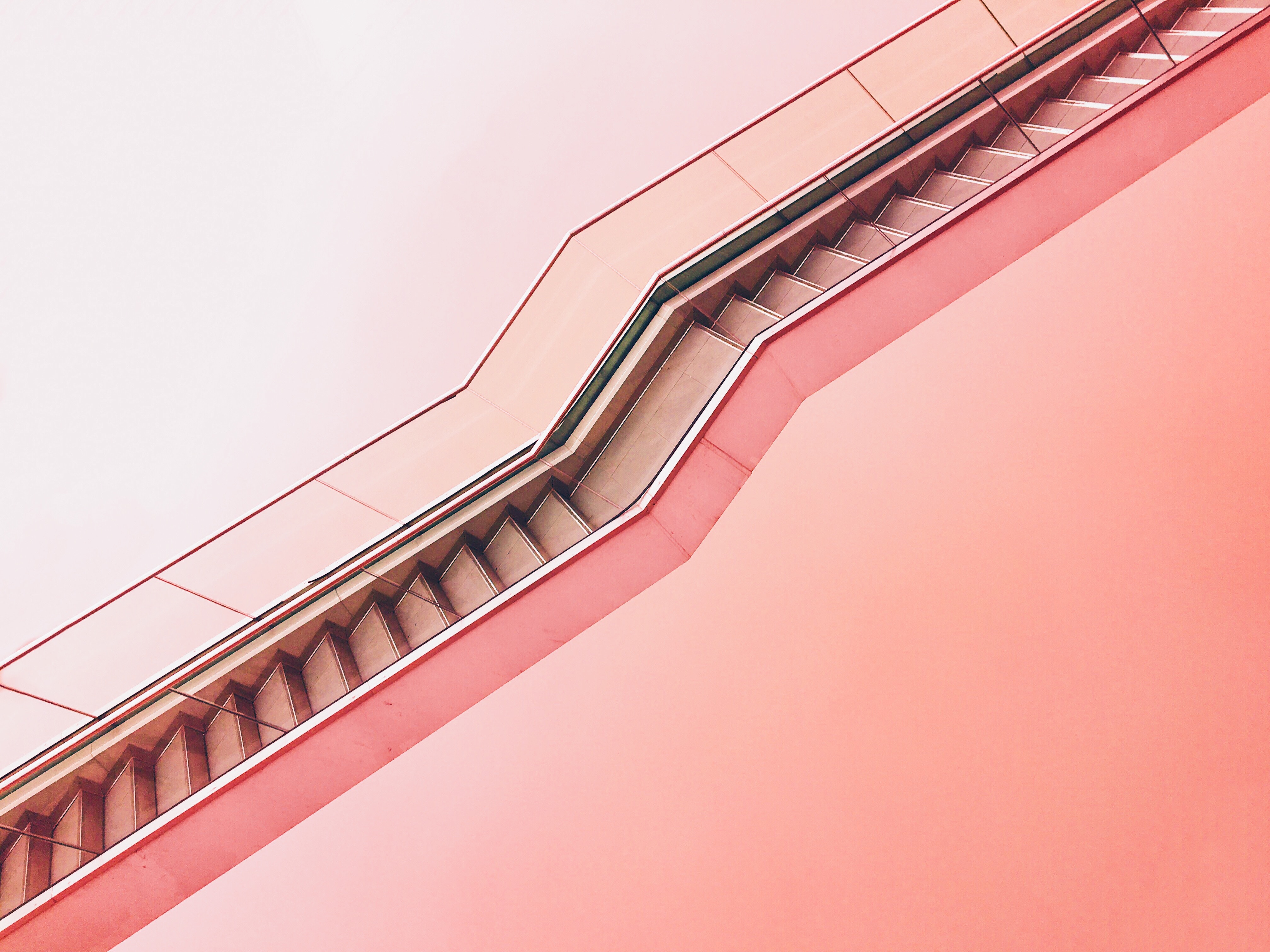Du prolétariat à la prolétarisation
Du prolétariat à la prolétarisation : vers une nouvelle critique de l’économie politique dans le contexte de l’automatisation numérique.
Anne Alombert. Doctorante à l’Université Paris Nanterre.
Les philosophes n’ont fait qu’interpréter diversement le monde, il s’agit maintenant de le transformer.
Marx, Thèses sur Feuerbach.
Je crois qu’on ne fait jamais de bonne politique en limitant le questionnement ou la demande de pensée. (…) Se poser plus de questions généalogiques (dans un style « déconstructeur ») sur l’origine de ces concepts, sur le poids de l’héritage, (…) cela change tout, et signale qu’on est prêt à changer, que la transformation est en train ou possible.
Derrida, Politique et amitié. Entretiens avec Michel Sprinker sur Marx et Althusser.
Cet ouvrage a pour but de fournir des armes conceptuelles, c’est-à-dire pacifiques, et d’ouvrir des perspectives d’actions fondées sur des arguments rationnels, c’est-à-dire politiques…
Stiegler, États de choc. Bêtise et savoir au XXIème siècle
Introduction
Dans États de choc. Bêtise et savoir au XXIème siècle, Bernard Stiegler propose de relire les travaux de Marx à la lumière de la question de l’extériorisation technique, afin d’élaborer une « nouvelle critique de l’économie politique[1] » susceptible d’affronter les enjeux économiques, technologiques et politiques du capitalisme contemporain. La question de la prolétarisation tient une place centrale au sein de cette relecture : nous tenterons tout d’abord d’expliciter les enjeux théoriques du passage de la question du prolétariat à celle de la prolétarisation, puis d’envisager les implications pratiques de ce geste, pour la transformation des sociétés automatiques contemporaines[2].
 Nous verrons dans un premier temps comment la question de l’extériorisation technique engage Stiegler à repenser la classe du prolétariat comme l’une des phases d’un processus de prolétarisation, au cours duquel les différents types de savoirs sont extériorisés dans des supports techniques, privant ainsi les individus de la possibilité de les exercer et de les transformer, donc de travailler et de s’individuer (I).
Nous verrons dans un premier temps comment la question de l’extériorisation technique engage Stiegler à repenser la classe du prolétariat comme l’une des phases d’un processus de prolétarisation, au cours duquel les différents types de savoirs sont extériorisés dans des supports techniques, privant ainsi les individus de la possibilité de les exercer et de les transformer, donc de travailler et de s’individuer (I).
Nous tenterons ensuite de montrer que les nouvelles conceptions de la technique, des savoirs et du travail qui émergent ainsi peuvent fournir des cadres conceptuels opérants pour appréhender les enjeux (psychiques, sociaux et politiques) des transformations technologiques et économiques contemporaines, et permettre d’ouvrir de nouvelles perspectives pour comprendre et intervenir dans l’évolution de milieux techniques devenus presque intégralement numériques et connectés (II).
I. De la classe prolétarienne au processus de prolétarisation généralisée : savoirs et extériorisation technique.
Dans la première partie d’un livre intitulé États de choc. Bêtise et savoir au XXIème siècle, Stiegler propose de dépasser la thèse de l’identification entre prolétariat et classe ouvrière, reprise par de nombreux marxistes[3]. Il soutient que si prolétariat et classe ouvrière sont bel et bien identifiés dans Le Capital, dans le Manifeste du parti communiste, Marx soutenait néanmoins que « le prolétariat se recrute dans toutes les classes de la population » : non seulement parce que ces « classes » disposent d’un trop faible capital et « succombent à la concurrence des grands capitalistes », mais aussi parce que « leur habileté est dépréciée par les méthodes nouvelles de production »[4]. Autrement dit, si la prolétarisation est bien due à l’impossibilité dans laquelle se trouve une classe de posséder les moyens de production, elle vient aussi du fait que la division industrielle du travail ôte toute « autonomie » et tout « attrait » à ces pratiques de production. Le travailleur devenu prolétaire est privé de la possibilité d’exercer son travail avec « intérêt » et « habileté », avec le « sens artistique » et l’attachement qui caractérisait l’artisan du Moyen-Age[5] . Il devient l’« accessoire des machines[6] », dans lesquelles les opérations de travail ont été extériorisées sous forme de « structures qui fonctionnent[7] ».
1. Les phases du capitalisme : la prolétarisation des savoir-faire, des savoir-vivre et des savoirs théoriques.
C’est ce qui conduit Stiegler à soutenir que « le prolétariat » ne constitue pas d’abord « la classe ouvrière ou laborieuse en général », mais bien le processus de « mise en extériorité du savoir par rapport au sachant »[8], que Lyotard voyait à l’œuvre non plus seulement à l’époque de la révolution industrielle à travers le transfert des « opérations manuelles » dans les machines de la « grande industrie »[9], mais bien à l’époque de la révolution informatique, à travers le transfert des « connaissances » dans les « machines informationnelles »[10]. Si bien que « si la classe ouvrière est la première classe à être touchée par la prolétarisation », Stiegler insiste sur le fait que cette « extériorisation des savoirs dans les machines et appareils[11] » n’a cessé de se poursuivre avec le « développement techno-scientifique[12] », et qu’elle ne touche aujourd’hui plus seulement les producteurs, mais aussi les consommateurs, les concepteurs et les décideurs[13].
A l’extériorisation des fonctions motrices dans les technologies mécaniques (machines) qui discrétisent les gestes, succède ainsi l’extériorisation des fonctions perceptives, sensibles et affectives dans les technologies audiovisuelles ou analogiques (radio, télévision, cinéma) qui discrétisent les fréquences sonores ou lumineuses, à laquelle succède enfin l’extériorisation des fonctions analytiques dans les programmes informatiques qui discrétisent les opérations mentales[14] et court-circuitent ainsi les pratiques délibératives. Si le capitalisme industriel du XIXème siècle se caractérise par la perte des savoir-faire des producteurs remplacés et désintégrés par les tâches spécialisées de la « grande industrie », le capitalisme consumériste du XXème siècle se caractérise quant à lui par la perte des savoir-vivre des consommateurs, remplacés et désintégrés par comportements standardisés prescrits par les médias de masse, et le capitalisme computationnel du XXIème siècle (parfois appelé « capitalisme cognitif ») par la perte des savoirs théoriques des concepteurs, remplacés et désintégrés par les calculs intensifs opéré sur les big data par les algorithmes[15]. Évidemment, tous ces effets se cumulent, et tandis que la prolétarisation des savoir-faire se poursuit aujourd’hui à travers le développement de la robotique, celle des savoir-vivre s’amplifient elle aussi à travers le contrôle des comportements exercés par les algorithmes à partir des traces laissées par les utilisateurs des média numériques[16].
Il ne s’agit donc plus d’identifier une classe prolétarienne, mais bien d’analyser les différents stades d’un processus de prolétarisation[17] durant lequel chaque évolution technique permet l’extériorisation d’un nouveau type de savoir, et engendre du même coup la possibilité de sa perte par les « sachants » qui l’exerçaient auparavant, et de son contrôle par les pouvoirs qui possèdent les dispositifs techniques innovants.
2. L’extériorisation pharmacologique des savoirs
Mais le fait de décrire les différentes phases d’un processus de prolétarisation aujourd’hui généralisé ne conduit pas pour autant à en affirmer l’inéluctabilité. Au contraire, selon Stiegler, c’est justement la fonction de l’idéologie que de faire croire au caractère inéluctable de la perte de savoir impliquée par chaque nouveau choc technologique[18] : il soutient quant à lui que si la mise en extériorité des savoirs dans les supports techniques est nécessaire, cela n’empêche pas nécessairement les individus psychiques de se réapproprier ces savoirs, à condition néanmoins que les individus ne soient pas soumis aux savoirs incorporés dans des supports (eux-mêmes appropriés par un pouvoir dominant), mais que ces individus puissent pratiquer ces supports afin de transmettre, partager, et transformer collectivement les savoirs qui y sont sédimentés.
La question de la prolétarisation devient donc celle du rapport entre « sachants » et « supports » : entre les individus (psychiques et collectifs) qui pratiquent les savoirs et les objets techniques au sein desquels seulement ces savoirs peuvent être conservés, transmis et partagés. Stiegler rappelle qu’une telle question avait déjà été posée bien avant Marx, par Platon lui-même[19] : si Platon n’évoque évidemment pas l’extériorisation et la décomposition des flux gestuels des ouvriers dans les machines industrielles, il décrit néanmoins l’extériorisation des flux de parole ou de mémoire à travers la technique de l’écriture, qu’il qualifie alors de « pharmakon », mot grec signifiant à la fois le remède et le poison. Il s’agissait ainsi pour Platon de souligner l’ambiguïté de l’ « art » de l’écriture : alors que cette nouvelle technique permet d’augmenter la mémoire et de retenir plus de choses grâce à leur fixation dans un support, elle a aussi pour conséquence de « rendre les âmes oublieuses » car devenues incapables d’ « exercer leur mémoire » et leur « jugement »[20].
Si la question de l’écriture n’est évidemment pas celle de la lutte des classes, elle est déjà chez Platon une question éminemment politique : en condamnant l’écriture, Platon entendait alors lutter contre la fascination et l’envoûtement que les sophistes parvenaient à exercer grâce à leur maîtrise des discours écrits, qu’ils utilisaient pour séduire les foules et influencer les comportements. La condamnation de l’écriture avait pour but de dénoncer ceux qui utilisaient cette technique pour exercer un pouvoir sur les âmes au moyen d’un « semblant » d’instruction, là où « l’art dialectique » défendu par Platon avait précisément pour rôle de fournir un véritable enseignement, c’est-à-dire, non pas d’utiliser les discours pour manipuler les foules, mais d’ « accompagner les discours de savoir », afin qu’ils puissent se voir appris et donc transformés par ceux qui les écoutent, et non seulement répétés[21]. Si Stiegler propose de « repenser la question du prolétariat comme celle du pharmakon[22] », ce n’est donc pas pour dépolitiser la question, mais bien pour suggérer le risque de perte de savoir inhérent à toute innovation technique, et souligner la tâche politique qui consiste à y remédier.
II. De la « révolution prolétarienne » à la « lutte pharmacologique contre la prolétarisation » : technologies de l’esprit et économie contributive dans les sociétés automatiques.
D’une certaine manière, cette ambiguïté de la technique et la lutte politique qu’elle implique semble se rejouer à l’époque de l’écriture réticulaire et numérique[23]. En effet, les technologies et les réseaux numériques sont bien à la fois ce qui rend possible une surveillance et une manipulation massive des foules connectées, et ce qui rend possible de nouveaux modes de partage et de constitution des savoirs, comme en témoigne l’encyclopédie en ligne Wikipedia fondée sur la contribution et la certification par les pairs, ou les pratiques issues du logiciel libre, fondées sur la coopération et la transformation des œuvres collectives[24]. La lutte politique qui correspond à cet état de fait technologique ne consiste plus à s’opposer au pouvoir des sophistes en mettant en œuvre un enseignement dialectique, mais bien à transformer le fonctionnement d’un système techno-économique au service du contrôle et de la consommation, pour le mettre au service des savoirs et de la contribution. C’est pour lutter contre la captation des données numériques et le téléguidage des comportements en vue de la consommation que Stiegler préconise la mise en œuvre de « technologies de l’esprit[25] » et l’expérimentation d’une « économie contributive ».
1. Les technologies de l’esprit : le milieu technique comme espace public et support de savoirs collectifs.
S’il semble indispensable de protéger juridiquement les données personnelles des individus tracés, dans La société automatique, Stiegler affirme surtout la nécessité de mettre les calculs algorithmiques au service des processus d’individuation psychique et collectif[26], c’est-à-dire, d’en faire non pas des moyens de contrôle et de mesure, mais aussi des supports de savoirs, c’est-à-dire d’interprétations, de controverses et de délibérations collective. En effet, selon Stiegler, l’apparition du web et d’internet constitue avant tout un bouleversement des dispositifs techniques de publication, qui appelle la constitution d’un nouvel espace public et une nouvelle chose publique[27]. Une telle perspective suppose d’inventer de nouveaux dispositifs et de nouvelles fonctionnalités, comme des langages d’annotation, des plateformes de partages de notes ou des réseaux sociaux délibératifs[28] , afin de permettre aux individus non pas d’abandonner inconsciemment leurs données personnelles aux mains des entreprises planétaires, mais de partager leurs pratiques et d’exprimer leurs points de vues singuliers (arguments politiques, jugements esthétiques, théories scientifiques) et de les confronter au cours de débats publics, entre pairs susceptibles de certifier les savoirs inédits qui seraient ainsi produits[29]. Il s’agirait donc de mettre en œuvre une pratique raisonnée des algorithmes, qui les mettent au service non pas du téléguidage automatique des foules connectées, mais de l’augmentation du « pouvoir de désautomatiser[30] » des individus.
Stiegler insiste sur le fait que la pratique d’un savoir (qu’il s’agisse d’un savoir-faire, d’un savoir-vivre ou d’un savoirs théorique) suppose toujours la capacité de désautomatiser de ceux qui le pratiquent : pratiquer un savoir ne revient jamais seulement à répéter les automatismes acquis et à appliquer les règles transmises, mais aussi toujours à désautomatiser ces automatismes et à transformer ces règles, ce qui revient à faire évoluer le savoir en le transformant par une pratique singulière, inédite et imprévisible[31].
2. L’économie contributive : valoriser le travail comme pratique de savoirs désautomatisables et singuliers.
Cette capacité à produire du nouveau, de l’inattendu et de la singularité à partir des automatismes intériorisés est ce qui fait la spécificité des activités travail[32], par opposition aux activités d’emploi : selon Stiegler en effet, là où le travail suppose que les individus transmettent et partagent leurs savoirs et les transforment collectivement, l’emploi repose sur l’acquisition de compétences standardisées et sur la « reproduction invariable d’automatismes sans la moindre possibilité de désautomatiser[33]». C’est d’ailleurs la raison pour laquelle un nombre croissant d’emplois se voient aujourd’hui menacés d’automatisation : toute activité qui repose sur des tâches routinières et prévisibles peut en effet se voir formalisée à travers des règles ou des programmes, qui seront ensuite implémentés dans des systèmes automatiques (mécanique ou algorithmique). Cela ne dépend donc pas du caractère manuel ou intellectuel de l’activité ou bien du secteur de la profession concernée : le développement de la robotique, des logiciels informatiques et de l’intelligence artificielle permettront d’automatiser tout ce qui, dans chaque profession ou activité, relève de la répétition du même (pour preuve, les traducteurs ou les juristes voient aujourd’hui leurs emplois s’automatiser). Seules la dimension de l’activité ou de la profession qui implique la production de nouveauté et de singularité (donc la désautomatisation des règles et la transformation des savoirs) ne pourra pas être automatisée.
C’est la raison pour laquelle, à l’époque de l’automatisation généralisée et des entreprises planétaires extraterritorialisées, Stiegler propose d’expérimenter un modèle économique fondé sur la valorisation des activités de travail, comprises comme des pratiques de savoirs, qui sont toujours locaux et contributifs. En effet, le partage et la transformation d’un savoir suppose toujours la contribution des différents participants, et non la séparation entre producteurs et consommateurs (sans quoi le savoir ne pourrait être partagé), et la constitution d’une localité – non pas au sens d’un espace mais au sens d’un lieu où quelque chose d’imprévu peut arriver (sans quoi le savoir ne pourrait pas être transformé).
Stiegler soutient en effet qu’en transmettant, en partageant et en transformant collectivement leurs savoirs, les individus produisent un nouveau type de valeur pour leur société : la valeur des savoirs est irréductible à la valeur d’échange comme à la valeur d’usage, puisqu’elle augmente à mesure que les savoirs sont partagés et pratiqués, et qu’elles ne diminue pas avec le temps[34] (contrairement à la valeur des marchandises, y compris des marchandises que sont devenues les informations[35]). Il soutient par ailleurs que la mise en œuvre d’un modèle économique reposant sur une telle valeur s’impose à une époque où l’automatisation menace un nombre croissant d’emplois, et où une « augmentation sans précédent de l’intelligence collective » (donc un partage des savoirs) semble requise pour faire face aux défis écologiques, économiques et technologiques contemporains[36].
L’économie contributive a donc pour fonction de remplacer progressivement le modèle dominant de l’économie des données consumériste : elle ne se fonde plus sur la redistribution de la richesse sous forme de salaire en vue d’augmenter le pouvoir d’achat des individus, mais sur la redistribution du temps rendu disponible par l’automatisation, en vue d’augmenter les savoirs (faire, vivre, théoriques) des individus. Le modèle de l’économie contributive a donc pour fonction de profiter du temps que les automates permettent de gagner dans la production, en le redistribuant équitablement aux citoyens, afin de libérer les individus d’un certain nombre d’emplois prolétarisants, et de leur donner la possibilité et le temps de travailler, c’est-à-dire de s’impliquer dans les activités contributives que constituent les différents types de savoirs.
Bref, face à l’automatisation progressive des emplois et la prolétarisation généralisée, il s’agirait donc d’inscrire la production et le partage de nouveaux savoirs au coeur de l’économie, et de réinventer le travail, en le comprenant et en l’exerçant non plus comme une simple « dépense de force » mais bien comme une activité qui consiste à « surmonter des obstacles » et à travers laquelle l’individu réalise sa liberté. C’est ainsi que le définissait Marx dans les Fondements à la critique de l’économie politique : il insistait alors sur la nécessité de distinguer le travail « forcé et imposé de l’extérieur » du travail « attractif » et « émancipé », à travers lequel l’individu effectue sa liberté[37]. On retrouve ici la distinction effectuée par Stiegler entre l’emploi, dans lequel des tâches prédéterminées sont imposées aux individus de l’extérieur en échange d’un salaire, et le travail, dans lequel les individus développent collectivement leurs savoirs et expriment leurs singularités en les faisant évoluer. Le travail que l’économie contributive a pour but de valoriser n’est donc pas le travail « forcé et imposé de l’extérieur » par la nécessité de survivre ou de subsister, mais bien le travail « attractif » et « émancipé », qui donne aux individus non seulement l’envie de vivre, mais aussi le « sentiment d’exister »[38]. La société contributive retrouverait ainsi l’un des objectifs de la société communiste, dans laquelle le travail ne devait plus constituer un simple « moyen de vivre », mais bien « le premier besoin vital »[39].
Conclusion
La question de l’extériorisation technique semble donc conduire Stiegler à repenser les questions du travail et des savoirs. Qu’il s’agisse de savoir-faire, de savoir-vivre ou de savoir théorique, Stiegler soutient que la pratique d’un savoir suppose toujours l’extériorisation de ce savoir dans un support technique, qui permet de le transmettre et de le partager, mais qui ouvre aussi le risque, pour les individus qui l’exercent, de ne pouvoir le ré-intérioriser, et de s’en voir ainsi dépossédé~s. La « mise en extériorité » du savoir dans le support peut donc inévitablement engendrer la perte du savoir par le « sachant » et la mise du « sachant » au service du dispositif technique « objectivant » le savoir vivant. L’individu se voit dès lors dans l’incapacité de transmettre, de pratiquer et de transformer son savoir : il devient l’employé d’un système exécutant des tâches qui l’empêchent de travailler. Marx avait bien décrit ce processus d’objectivation des savoirs dans les machines, qui dépossédait les ouvriers de leurs savoir-faire, les assujettissait au dispositifs techniques et les transformait en prolétaires. C’est ce qui l’avait conduit à assimiler la classe ouvrière au prolétariat, et à promouvoir la révolution prolétarienne comme seul moyen d’émancipation.
Mais depuis les analyses de Marx, le milieu technique s’est considérablement transformé. A l’époque du machinisme, de l’usine et de la grande industrie, a succédé celle des algorithmes, des plateformes et des entreprises planétaires extraterritorialisées : le processus de prolétarisation concerne non seulement les savoir-faire des ouvriers court-circuités par la nouvelle robotique, mais aussi les savoir-vivre des habitants court-circuités par les objets et les environnements connectés des smart cities, et les savoir théoriques, court-circuités par les calculs intensifs opérés sur des quantités massives de données. La question qui se pose alors pour lutter contre ce processus de prolétarisation généralisée est celle de comprendre comment faire de ces technologies de calcul des supports d’interprétation et de délibération collective, et comment passer d’un modèle économique fondé sur la captation des données et la consommation à un modèle économique valorisant les savoirs et la contribution. Stiegler répond à ces questions en proposant de transformer les technologies de contrôle en technologies de l’esprit, et d’amorcer la transition d’une économie consumériste vers une économie contributive.
Une fois le prolétariat ressaisi comme la phase d’un processus de prolétarisation aujourd’hui généralisé, la révolution ne s’apparentera donc plus au renversement d’une classe par une autre, mais au retournement d’une tendance en sa tendance contraire[40] : il ne semble plus s’agir de revendiquer la prise du pouvoir par le prolétariat et l’instauration d’une société (communiste) déterminée, mais de mettre en œuvre les conditions technologiques et économiques de possibilité de la déprolétarisation[41] , ce qui suppose une lutte pharmacologique sans cesse renouvelée.
[1]Voir B. Stiegler, Pour une nouvelle critique de l’économie politique., Paris, Galilée, 2009.
[2]Cet article a pour fonction de présenter la notion stieglerienne de prolétarisation et d’expliciter ses enjeux dans le contexte technologique et économique actuel : nous soulignerons donc les origines de cette notion dans le texte de Marx mais la question de la fidélité de l’interprétation de Stiegler au texte de Marx, qui mériterait d’être soulevée, ne sera pas posée ici. Nous nous contenterons de souligner la transformation du concept de prolétariat à celui de prolétarisation qui s’opère d’un auteur à l’autre. Cet article pourra donc servir de base pour soulever des questions plus fondamentales concernant le rapport de Stiegler à Marx et la fidélité / l’infidélité de sa lecture.
[3]« La classe ouvrière, pensions-nous alors, était la classe qui, formée par son organisation, désirerait s’élever et soulèverait avec elle la société au-dessus d’elle-même. Mais nous n’avions pas compris que la question n’était pas celle de la classe ouvrière, mais celle de la prolétarisation. (…) Les maoïstes ne voyaient pas eux-mêmes que la prolétarisation devait être pensée, au XXème siècle, à partir de la technique et du marketing, et comme perte de savoir en général, c’est-à-dire bien au-delà de la seule sphère de la production. Ils n’avaient pas compris la mutation consumériste du capitalisme survenue au XXème siècle, et que la pensée de Marx ne suffisait plus à analyser. », B. Stiegler, Mécréance et discrédit. t.3 L’esprit perdu du capitalisme., Paris, Galilée, 2006, p. 25.
[4]« Les petites classes moyennes de jadis, les petits industriels, les petits artisans et paysans, toutes les classes tombent dans le prolétariat ; en partie parce que leur faible capital ne leur permettant pas d’employer les procédés de la grande industrie, ils succombent à la concurrence avec les grands capitalistes ; en partie, parce que leur habileté est dépréciée par les méthodes nouvelles de production. De sorte que le prolétariat se recrute dans toutes les classes de la population. », K. Marx, Le manifeste du parti communiste, Paris, Editions sociales, 1986, p. 66.
[5]« De ce fait, on trouve encore chez les artisans du moyen âge un intérêt pour leur travail particulier et pour l’habileté dans ce travail qui peut s’élever jusqu’à un certain sens artistique étroit. Et c’est aussi pourquoi chaque artisan du moyen-âge se donnait tout entier à son travail ; il était à son égard dans un rapport d’asservissement sentimental et lui était beaucoup plus subordonné que le travailleur moderne à qui son travail est indifférent. », K. Marx, L’Idéologie allemande.
[6]« Le développement de la machinerie et la division du travail ont fait perdre au travail de l’ouvrier tout caractère d’autonomie et, par conséquent, tout attrait. L’ouvrier devient un simple accessoire de la machine, dont on n’exige que l’opération la plus simple, la plus monotone, la plus vite apprise. », K. Marx, Le Manifeste du parti communiste, op. cit., p. 64-65.
[7]« Ce qui réside dans les machines, c’est de la réalité humaine, du geste humain fixé et cristallisé en structures qui fonctionnent. », G. Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Aubier, 1958, p. 13.
[8]« Le prolétariat n’est pas du tout ce que croient Lyotard, Althusser et la pensée marxiste en général : le prolétariat est constitué non pas par la classe ouvrière ou laborieuse en général, mais par la mise en extériorité du savoir par rapport au sachant », B. Stiegler, États de chocs. Bêtise et savoirs au XXIème siècle, Paris, Fayard, 2012, p. 225.
[9]« La machine outil est donc un mécanisme qui, ayant reçu le mouvement convenable, exécute avec les instruments les mêmes opérations que le travailleur exécutait auparavant avec des instruments pareils. Dès que l’instrument, sorti de la main de l’homme, est manié par un mécanisme, la machine outil a pris la place du simple outil. (…) C’est précisément cette dernière partie de l’instrument, l’organe de l’opération manuelle, que la révolution industrielle saisit tout d’abord, laissant à l’homme à côté la nouvelle besogne de surveiller la machine et d’en corriger les erreurs de sa main, le rôle purement mécanique de moteur. », K. Marx, Le Capital, Livre 1, section 4, chap. XV, p. 465.
[10]« Avec l’hégémonie de l’informatique, c’est une certaine logique qui s’impose, et donc un ensemble de prescriptions portant sur les énoncés acceptés comme ‘de savoir’. (…) On peut dès lors s’attendre à une forte mise en extériorité du savoir par rapport au sachant, à quelque point que celui-ci se trouve dans le procès de connaissance. (…) Ce rapport des fournisseurs et des usagers de la connaissance à celle-ci tend et tendra à revêtir la forme que les producteurs et les consommateurs de marchandises ont avec ces dernières, c’est-à-dire la forme valeur. Le savoir est et sera produit pour être vendu, et il est et sera consommé pour être valorisé dans une nouvelle production : dans les deux cas, pour être échangé. Il cesse d’être à lui-même sa propre fin, il perd sa valeur d’usage. », J.-F. Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979, p. 14.
[11]« Pour penser l’individuation, Simondon donne un nouveau tour à la question de la prolétarisation : il en fait une question de désindividuation que produit une perte de savoir par une extériorisation de celui-ci dans machines et appareils. », B. Stiegler, États de chocs. Bêtise et savoirs au XXIème siècle, op. cit., p. 169.
[12]« Le développement n’est pas une invention des humains. Les humains sont une invention du développement. (…) L’espèce humaine n’est pas le héros de la fable. Elle est une forme complexe d’organisation de l’énergie. Comme les autres formes, elle est sans doute transitoire. D’autres formes peuvent apparaître, plus complexes, qui l’emporteront sur elle. C’est peut-être l’une de ces formes qui se prépare à travers le développement techno-scientifique dès l’époque où la fable est racontée. », J.-F. Lyotard, « Une fable postmoderne », in Moralités postmodernes, Paris, Galilée, 1993.
[13]« Rappelons tout d’abord que Marx ne dit pas que le prolétariat est la classe ouvrière : il dit que la classe ouvrière est la première classe à être touchée par la prolétarisation. Les prolétaires n’ont pas disparu : la prolétarisation, c’est à dire la perte des savoirs, a au contraire envahi ‘toutes les couches de la société’ : producteur, consommateur et concepteur/décideur. », http://arsindustrialis.org/prol%C3%A9tarisation.
[14]« La prolétarisation des gestes du travail comme ouvrage est la prolétarisation des conditions de subsistance du travailleur. La prolétarisation des sensibilités et des affects, et, par là, de la relation sociale – qui est ainsi remplacée par le conditionnement – est la prolétarisation des conditions d’existence du citoyen. La prolétarisation des esprits comme facultés noétiques de théorisation et de délibération est la prolétarisation des conditions de consistance de la vie de l’esprit rationnel en général, et de la vie scientifique en particulier (sciences de l’homme et de la société incluses) – par où la rationalité devient ce que Weber, Adorno et Horkheimer décrivirent comme rationalisation. », B. Stiegler, La société automatique t. 1 L’avenir du travail, Paris, Fayard, 2015, p. 42.
[15]« Après la perte des savoir-faire au XIXè siècle, puis des savoir-vivre au XXè siècle, le temps vient au XXIè siècle de la perte des savoirs théoriques – comme si la sidération était provoquée par un devenir absolument impensable. Avec l’automatisation intégrale rendue possible par la technologie numérique, les fruits les plus sublimés de l’idéalisation et de l’identification que sont les théories y sont réputés obsolètes – et avec elles, la méthode scientifique elle-même. Nous avons vu en introduction que c’est ce qu’affirme Chris Anderson dans ‘The End of Theory’ », B. Stiegler, La société automatique t. 1 L’avenir du travail, op. cit., p. 36. ; « Les savoir vivre sont aussi liquidés par des processus de captation de l’attention qui reconfigurent en les standardisant les patterns comportementaux. C’est alors le consommateur qui est privé de tout rôle inventif et il ne transmet plus aucun savoir vivre à ses descendants, pas plus qu’il ne reçoit ceux de ses ascendants puisqu’il est au contraire contraints de les abandonner pour s’adapter à ceux que le marketing conçoit avec l’aide des sciences sociales et cognitives – le neuromarketing étant le stade le plus avancé de cette dimension de la prolétarisation (…) En outre, les savoirs d’origine théoriques sont eux-mêmes prolétarisés, c’est-à-dire découplés de l’activité théorique – et c’est ce devenir que décrit la performativité telle que l’analyse La condition postmoderne. La destruction de la dimension théorique des savoirs formels consiste à transformer les formalismes en automatismes mis en œuvre pour augmenter les performances analytiques de ces formalismes, ce qui conduit à l’automatisation de l’entendement scientifique lui-même, qui s’autonomise ainsi de la raison, laquelle devient en cela rationalisation, c’est à dire causalité matérielle, formelle et efficiente sans causalité finale. Ainsi l’enseignement d’un savoir technologique purement procédural se généralise-t-il aujourd’hui, y compris dans les facultés de sciences, au détriment d’une connaissance historique et critique des théories qui furent à l’origine de ces formalismes. Les instruments scientifiques deviennent eux-mêmes des machines, auxquelles les scientifiques de plus en plus technologues et de moins en moins scientifiques doivent s’adapter sans plus avoir le temps de remonter aux axiomes et aux jugements synthétiques qui président à leurs mécanismes formulant des jugements analytiques. », B. Stiegler, États de chocs. Bêtise et savoirs au XXIème siècle, op. cit., p. 222.
[16]C’est ce processus qu’A. Rouvroy et T. Berns décrivent sous le nom de « gouvernementalité algorithmique » : A. Rouvory et T. Berns. « Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation. Le disparate comme condition d’individuation par la relation ? », Réseaux, vol. 177, no. 1, 2013, pp. 163-196.
[17]« Il faut revenir aux sources de la question de la prolétarisation chez Marx et Engels en se référant au premier texte où ils en déroulent le concept : le Manifeste du parti communiste. Il est alors parfaitement clair que ce qui définit la prolétarisation, c’est la perte de savoir, et non la paupérisation : c’est la perte du savoir tel qu’il est formalisé par la machine qui désormais le met en œuvre. Comme dit Simondon, la machine devient l’individu technique, cependant que l’ouvrier prolétarisé est désindividué. La prolétarisation, qui résulte d’une évolution de la technique relevant d’un processus de grammatisation, concerne « toutes les couches de la population », comme dit le Manifeste, et non seulement la classe ouvrière. Or, dans Le Capital, le prolétariat devient la classe ouvrière, ce qui est une contradiction : la classe ouvrière a un savoir-faire, le prolétariat n’a qu’une force de travail, et ce n’est pas du tout la même chose. Il y a donc une dérive sémantique chez Marx lui-même. Il travaille à ce moment-là pour les syndicats de Manchester, et il est en train d’armer la classe ouvrière, de constituer ce qui lui apparaît être le sujet révolutionnaire. À partir de là, il se prend lui-même au piège, et modifie sa propre lecture de lui-même. C’est ainsi que la classe ouvrière devient la « puissance du négatif » remis à l’endroit, c’est-à-dire la classe révolutionnaire. Ce qui n’était pas le point de départ, où c’était le prolétariat qui était la classe révolutionnaire précisément en tant qu’il n’était plus ouvrier, c’est-à-dire doté d’un savoir faire. (…) Ce n’est pas le manque d’argent qui fait la prolétarisation : c’est la perte de savoir, c’est-à-dire la dénoétisation, qui est à présent généralisée via les ‘big data’, le ‘deep learning’, etc. », G. Deslandes et L. Platrienieri, « Entretien avec Bernard Stiegler », Rue Descartes, vol. 91, no. 1, 2017, pp. 119-140.
[18]« Le processus de grammatisation comme source de la prolétarisation est inscrit dans une histoire géopolitique et économique où les pouvoirs qui en prennent le contrôle (…) tentent, à partir du moment où la grammatisation des corps rend possible l’organisation capitaliste et la rationalisation (…) de faire croire au caractère inéluctable et incurable de la perte d’individuation que constitue chaque nouveau stade pharmacologique. », B. Stiegler, Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue. De la pharmacologie, Paris, Flammarion, 2010, p. 87.
[19]« Cette mise en extériorité est ce que dénonce déjà Platon dans l’écriture en tant qu’elle est un pharmakon : cette dénonciation est le premier moment de la pensée du processus de prolétarisation. », B. Stiegler, B. Stiegler, États de chocs. Bêtise et savoirs au XXIème siècle, op. cit., p. 209.
[20]« …autre est l’homme qui est capable de donner le jour à l’institution d’un art ; autre, celui qui l’est d’apprécier ce que cet art comporte de préjudice ou d’utilité pour les hommes qui devront en faire usage (…) Car cette connaissance aura pour résultat, chez ceux qui l’auront acquise, de rendre leurs âmes oublieuses, parce qu’il cesseront d’exercer leur mémoire : mettant en effet leur confiance dans l’écrit, c’est du dehors, grâce à des empreintes étrangères, non du dedans et grâce à eux-même qu’ils se remémoreront les choses. Ce n’est donc pas pour la mémoire, c’est pour la remémoration que tu as découvert un remède. (…) Quant à l’instruction, c’en est la semblance que tu procures à tes élèves, et non point la réalité : lorsqu’en effet avec ton aide ils regorgeront de connaissances sans avoir reçu d’enseignement, ils sembleront être bons à juger de mille choses, au lieu que la plupart du temps ils sont dénués de tout jugement ; et ils seront en outre insupportables, parce qu’ils seront des semblants d’hommes instruits au lieu d’être des hommes instruits. », Platon, Phèdre, 274 e 275 b.
[21]« c’est quand par l’usage de l’art dialectique et une fois prise en main l’âme qui y est appropriée, on y plante et sème des discours que le savoir accompagne ; discours qui sont en mesure de se donner assistance à eux-mêmes ainsi qu’à celui qui les a plantés, et qui, au lieu d’être stériles, ont en eux une semence de laquelle, en d’autres naturels, pousseront d’autres discours. », Platon, Phèdre, 276 d.
[22]« Il y a été proposé (dans l’ouvrage intitulé Pour une nouvelle critique de l’économie politique) de repenser la question du prolétariat à partir de celle du pharmakon. », B. Stiegler, Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue. De la pharmacologie, Paris, Flammarion, 2010, p. 157.
[23]« Les technologies numériques de la traçabilité constituent le stade le plus avancé d’un processus de grammatisation qui commence dès la fin du Paléolithique Supérieur, à partir duquel l’humanité apprend à discrétiser et à reproduire selon divers types de traces les flux qui la traverse et qu’elle engendre : images mentales (inscriptions rupestres), discours (écritures), gestes (automatisation de la production), fréquences sonores et lumineuses (technologies analogiques d’enregistrement) et à présent comportements individuels, relations sociales et processus de transindividuation (algorithmes de l’écriture réticulaire). », B. Stiegler, La société automatique t. 1 L’avenir du travail, op. cit., p. 27.
[24]« Le mouvement du logiciel libre constitue une organisation industrielle du travail fondée sur la déprolétarisation, c’est-à-dire sur le partage des connaissances et des responsabilités, et par là, sur la reconstitution de milieux industriels associés – tandis qu’alors, l’industrialisation avait toujours conduit à la dissociation des milieux, c’est-à-dire à la désindividuation. », B. Stiegler, États de chocs. Bêtise et savoirs au XXIème siècle, op. cit., p. 213. ; « Le logiciel libre : fondé sur le développement et le partage des responsabilités et des capacités. (…) Ils coopèrent avec d’autres développeurs et alimentent ainsi leurs savoirs en même temps que celui de leurs interlocuteurs. Ils sont spontanément actifs, en attente de pouvoir faire ce que ce modèle leur inspire, et porteurs en cela d’initiatives sans que personne n’ait à exiger d’eux qu’ils le soient. », B. Stiegler, L’emploi est mort, vive le travail !, Paris, Mille et une nuits, 2015. Voir aussi B. Stiegler, Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue. De la pharmacologie, Paris, Flammarion, 2010, p. 94.
[25]« L’enjeu de la paix aujourd’hui est la transformation des armes de guerre que la technologie fournit au psychopouvoir inféodé au capitalisme financier en technologie de l’esprit au service des controverses logiques dans la paix civile », B. Stiegler, États de chocs. Bêtise et savoirs au XXIème siècle, op. cit., p. 146.
[26]« J’emploie ce mot d’’individuation’ pour expliquer le caractère ‘pharmacologique’ de l’Internet : l’Internet est à double face, il offre des possibilités nouvelles et absolument extraordinaires d’individuations, en même temps qu’il menace l’individuation en ses principes mêmes. », B. Stiegler, « Le blues du net » (http://reseaux.blog.lemonde.fr/2013/09/29/blues-net-bernard-stiegler/).
[27]« Quant à nous, les hommes et les femmes du 21e siècle, nous vivons une révolution de la publication : l’espace numérique est avant tout un processus de publication. Nous nous autopublions, volontairement ou non. (…) Le Web et l’Internet, disais-je tout à l’heure, sont des technologies de publication. Les technologies de publication sont à l’origine de ce que Platon appelle la πολιτεία [politeia, ndlr] que l’on traduit en latin par res publica. Pourquoi le traduit-on par res publica ? Parce que la politeia constitue une ‘chose publique’ comme nous l’avons vu tout à l’heure. Et la constitution d’une chose publique suppose une technologie de publication qui est à l’époque grecque l’écriture. Marcel Détienne a montré que la cité athénienne est une sorte de vaste machine à écrire dans le marbre dont sont faits les murs de la ville ; après chaque décision de la Βουλή [boulè, ndlr], des éditeurs de la loi manient le marteau et le burin pour graver la décision dans le marbre. (…) On entre dans la politeia, la citoyenneté, et on va vers la démocratie. Aujourd’hui, et avec le numérique, un tout autre dispositif de publication s’est mis en place. », B. Stiegler, « Le blues du net » (http://reseaux.blog.lemonde.fr/2013/09/29/blues-net-bernard-stiegler/).
[28]« C’est pourquoi il faut concevoir ce web sémantique automatique en relation étroite avec un web herméneutique désautomatisable (avec l’aide des automates sémantiques rendus possibles par le web sémantique), fondé sur
. une nouvelle conception des réseaux sociaux,
. un langage normalisé d’annotation,
. des communautés herméneutiques issues des divers domaines de savoirs constitués depuis l’origine de l’anthropisation, et comme modalités variées de la néguanthropisation.
Un tel bouleversement organologique devrait être mis en œuvre par l’Europe – où fut inventé le web, et dont il devrait fonder la stratégie de développement continental. L’Europe devrait projeter cette stratégie comme conflit des interprétations à l’échelle planétaire de la gouvernementalité algorithmique en vue de configurer une société automatique désautomatisable, c’est à dire à la fois critiquable, tirant un juste parti du web sémantique automatique, et désirable – parce que génératrice de disparations néguanthropiques. », B. Stiegler, La société automatique t. 1 L’avenir du travail, Paris, Fayard, 2015, p. 267.
[29]« Or celui-ci suppose ce processus de publication en tant qu’il rend possibles des controverses, c’est-à-dire la publication d’arguments contradictoires, ce que l’on appelle aussi le débat public, et qui est la règle fondamentale de tout savoir rationnel. La promesse du Web était de raviver le débat public, politique, scientifique ou esthétique. Mais cette promesse n’a pas été tenue. À partir du moment où Google, Amazon et toutes ces entreprises durent faire de la profitabilité avant tout, ils eurent tout intérêt à égaliser et niveler les données pour les exploiter avec des algorithmes écrasant les controverses au lieu d’en permettre la traçabilité et l’intelligibilité largement partagée. », B. Stiegler, « Le blues du net » (http://reseaux.blog.lemonde.fr/2013/09/29/blues-net-bernard-stiegler/) ; « A partir d’une plateforme de partage de notes, d’un réseau social herméneutique et d’un système d’aide à la discussion en ligne, il s’agit de créer par une pratique raisonnée des algorithmes des communautés polémiques et des controverses qui utilisent ces instruments d’interprétation pour pouvoir confronter idées, pratiques propositions en tous genres, par exemple des arguments politiques ou des jugements esthétiques, et qui, à travers ces confrontations produisent ce que dans le langage de la physique on appelle des structures dissipatives, de la néguentropie, c’est-à-dire du ressourcement constant. », B. Stiegler, L’emploi est mort, vive le travail !, Paris, Mille et une nuits, 2015.
[30]« Nous pourrions laisser avec grand intérêt les tâches de l’ordre des automatismes aux machines pour mieux permettre aux humains de retrouver l’importance, le sens du travail. Nous développons à l’IRI des systèmes qui reposent sur ces automatismes que l’on appelle les algorithmes, mais nous concevons ces automates en vue de les mettre au service d’une augmentation du pouvoir de désautomatiser de ceux qui les pratiquent. Nous travaillons à configurer de nouvelles architectures du web, ce que nous appelons le web herméneutique, qui repose justement sur la désautomatisation. », B. Stiegler, L’emploi est mort, vive le travail !, Paris, Mille et une nuits, 2015.
[31]« L’artisan au travail met en œuvre des automatismes qu’il a acquis durant son apprentissage, mais qu’il modifie par sa pratique, tout comme il modifie ses instruments, hérités des compagnons qui l’ont formé, et c’est en cela même par sa capacité à modifier des automatismes et donc à les désautomatiser, qu’il devient un homme du métier. Et ce que l’on appelle l’ouvrage dans le monde du travail est aussi le fruit de ce dépassement des automatismes issus du métier. Savoir faire un travail, c’est essentiellement avoir acquis des automatismes que l’on a tellement intériorisés que l’on en est devenu maître au point de pouvoir les désautomatiser. Travailler, c’est mettre en œuvre une faculté d’inventer à partir d’automatismes reçus que l’on a d’autant mieux intériorisés que l’on est capable de les désautomatiser. Un violoniste virtuose a acquis au cours d’un apprentissage intense des automatismes entièrement configurés par son instrument, et avec lesquels par là même il fusionne, ce qui fait en quelque sorte qu’il fusionne avec son violon, organe exosomatique autour duquel tous les organes endosomatiques qui constituent sont corps propre se sont réorganisés. Le virtuose devient artiste lorsqu’il s’avère capable d’inventer à partir de ces automatismes acquis un imprévu, une bifurcation, une interprétation au-delà des automatismes, et qui n’aurait sans lui jamais pu se produire : son incorporation des automatismes propre à l’instrument révèle alors sa singularité, tout aussi bien d’ailleurs que celle de son instrument. Les automatismes acquis par le travail sont alors tout entiers mis au service de cette désautomatisation que l’on appelle interprétation ou création. Le travail de l’artiste, ce qu’on appelle son œuvre, c’est de part en part ce qui résulte de cette désautomatisation. Et ce que l’on appelle l’ouvrage dans le monde du travail est aussi le fruit de ce dépassement des automatismes issus du métier. », B. Stiegler, L’emploi est mort, vive le travail !, Paris, Mille et une nuits, 2015.
[32]« Vous avez passez des années de votre enfance à acquérir toutes sortes d’automatismes qui sont aussi des savoirs – savoir-faire, savoir-vivre, savoirs enseignés, qui sont tous fondés sur l’acquisition d’automatismes. Ce sont ces capacités d’acquérir sans cesse de nouveaux automatismes au cours de l’éducation, tout aussi bien que de remettre sans cesse en cause les automatismes acquis, qui permettent d’inventer, de répondre aux imprévus, de transformer le monde, c’est-à-dire de le produire comme monde. », B. Stiegler, L’emploi est mort, vive le travail !, Paris, Mille et une nuits, 2015.
[33]« L’emploi est ce qui interrompt structurellement et radicalement ce rapport entre automatismes et désautomatisation au travail : tel qu’il est porté à son comble dans la conception taylorienne du ‘travail’ à la chaîne, il a ceci de spécifique qu’il soumet les femmes et les hommes à la reproduction invariable d’automatismes sans la moindre possibilité de désautomatiser. C’est en ce sens que l’emploi devient le contraire du travail. » B. Stiegler, L’emploi est mort, vive le travail !, Paris, Mille et une nuits, 2015.
[34]« Il faut produire une nouvelle organisation économique fondée sur une nouvelle forme de valeur : la valeur néguanthropique que nous appelons aussi la valeur pratique. J’appelle pratique la valeur qui ne se réduit ni à l’échange ni à l’usage : la valeur pratique est ce qui vaut par soi et qui ne s’use pas, constituant ce que l’on appelle le savoir, qui lui-même ne se dévalorise pas avec le temps, qui est inusable en ce sens, mais qui est par nature et structurellement partageable et partagé par les congénères comme à travers les générations, faisant l’unité de l’aventure humaine et ouvrant les perspectives de l’avenir que l’homme peut toujours projeter dans le devenir pour autant qu’il est capable de préserver ses capacités néguentropiques. (…) La valeur pratique ne s’use pas, ne se jette pas, est irréductible à sa valeur d’échange (à la différence de la valeur d’usage ou de la force de travail) et permet de valoriser le passé tout en se projetant dans l’avenir, et ce parce qu’elle est omnitemporelle. C’est cette valeur, qu’une nouvelle façon de redistribuer ce qui est gagné à travers l’automatisation, à savoir du temps, doit engendrer. (…) A l’inverse de la valeur pratique, la valeur d’usage se perd avec le temps et se dilue de façon inflationniste dans la valeur d’échange. Vous achetez des chaussures, vous les portez, elles se dévalorisent. Soit elles ne sont plus à la mode si vous êtes un consommateur parfait de votre époque, soit tout simplement les semelles s’abîment et vous êtes obligé de les jeter un jour ou l’autre. La valeur pratique en revanche, se développe et s’enrichit avec le temps en constituant du savoir. », B. Stiegler, L’emploi est mort, vive le travail !, Paris, Mille et une nuits, 2015.
[35]« Ce rapport des fournisseurs et des usagers de la connaissance a celle-ci tend et tendra à revêtir que la forme de celui que les producteurs et les consommateurs de marchandises ont avec ces dernières, c’est-à-dire la forme valeur. Le savoir est et sera produit pour être vendu, et il est et sera consommé pour être valorisé dans une nouvelle production : dans les deux cas, pour être échangé. Il cesse d’être à lui-même sa propre fin, il perd sa valeur d’usage. (…) Sous la forme de marchandise informationnelle indispensable à la puissance productive, le savoir est déjà et sera un enjeu majeur, peut-être le plus important, dans la compétition pour le pouvoir. Comme les États Nations se sont battus pour maîtriser des territoires, puis pour maîtriser la disposition et l’exploitation des matières premières et des mains d’œuvre bon marché, il est pensable qu’ils se battent à l’avenir pour maîtriser des informations. Ainsi se trouve ouvert un nouveau champ pour les stratégies industrielles et commerciales et pour les stratégies militaires et politiques. », J.-F. Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979, p. 14-15.
[36]« Les immenses problème qui surgissent dans l’Anthropocène et qui nous promettent à une échéance très courte (moins de cinquante ans) de terribles difficultés sur la Terre si rien ne change, ne pourront être surmontés qu’à la condition d’élever très sensiblement le niveau de l’intelligence collective. » ; « Face aux incroyables défis auxquels l’humanité est désormais confrontée, une augmentation et un partage sans précédent des savoirs et de l’intelligence collective sont les conditions sine qua non de sa survie. » ; « Pour résoudre ces immenses problèmes, il n’y a pas d’autre possibilité que d’élever l’intelligence collective en augmentant spectaculairement les savoirs partagés : ce que précisément l’automatisation rend possible. », B. Stiegler, L’emploi est mort, vive le travail !, Paris, Mille et une nuits, 2015.
[37]« Sans doute Smith a raison lorsqu’il dit que dans ses formes historiques : esclavage, corvée, salariat, le travail apparaît toujours comme un travail rebutant, comme un travail forcé imposé de l’extérieur, en face duquel le non-travail apparaît toujours comme la ‘liberté’ et ‘bonheur’. Cela vaut (…) pour le travail qui ne s’est pas encore donné les conditions subjectives et objectives (…) pour que le travail soit travail attractif, auto-effectuation de la liberté de l’individu, ce qui ne signifie en aucun cas qu’il soit pur plaisir, pur amusement… », K. Marx, Manuscrits de 1857-1858 („Grundrisse“), t. 2, pp. 101-102.
[38]Sur les liens entre déprolétarisation et sentiment d’exister, voir B. Stiegler, Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue. De la pharmacologie, p. 89, et plus généralement le §23 intitulé « La déprolétarisation ».
[39]« Dans une phase supérieure de la société communiste (…), l’asservissante subordination des individus à la division du travail aura disparu, et avec elle, l’opposition entre travail intellectuel et travail manuel ; le travail ne sera pas seulement un moyen de vivre, mais deviendra lui-même le premier besoin vital », K. Marx, F. Engels, Critique des programmes de Gotha et d’Erfurt, Éditions sociales, 1972, p. 32.
[40]« Ici, révolution ne signifie pas nécessairement barricades et prises de pouvoir : c’est le processus par lequel une époque révolue fait place à une nouvelle époque. Une révolution est en cela une modalité exceptionnelle de ce que Simondon appelle les sauts quantiques dans l’individuation, où ce sont les conditions même de l’individuation qui sont transformées. La question est alors de définir ce qui fait époque. », B. Stiegler, États de chocs. Bêtise et savoirs au XXIème siècle, op. cit., p. 230.
[41]B. Stiegler, États de chocs. Bêtise et savoirs au XXIème siècle, op. cit. « Marx commet une erreur radicale en supposant que c’est par la prise de conscience de sa situation prolétarisée que le prolétariat peut échapper à sa condition et non par l’élaboration d’un nouveau type de savoir qui n’est pas la science marxienne que recherche Althusser mais l’invention d’un nouveau processus d’individuation psychique, collective et technique, constituant un nouveau rapport à la technique, lequel est à l’horizon des propos de Simondon. (…) Cette proposition énonce un point de vue de pharmacologie positive particulièrement éclairant pour qui veut comprendre pourquoi et comment la rétention tertiaire machinique écrite et lue dans le silicium par les machines à lire et à écrire que sont les dispositifs et réseaux réseaux numériques contributifs ouvre précisément la possibilité de la déprolétarisation, non pas comme âge post-industriel, mais comme nouvel âge industriel. », B. Stiegler, États de chocs. Bêtise et savoirs au XXIème siècle, op. cit., p. 224 ; « C’est pourquoi nous faisons de la déprolétarisation généralisée l’enjeu fondamental de l’économie de la contribution. », http://arsindustrialis.org/prol%C3%A9tarisation.