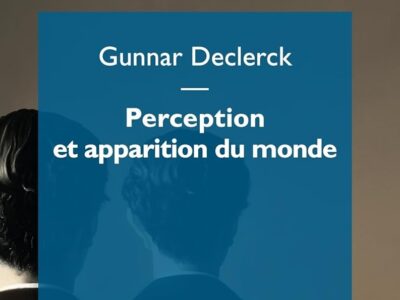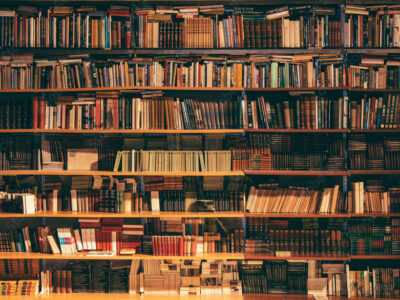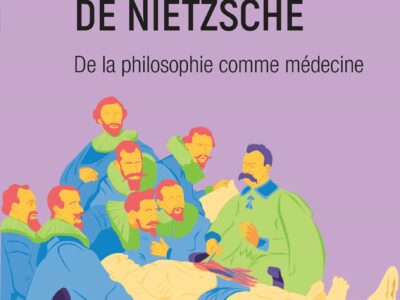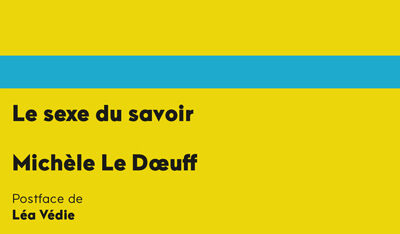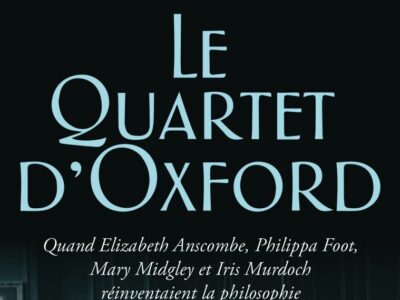Recension — Le spectre de l’addiction
Anne Fenoy est docteure en philosophie de Sorbonne Université. Sa thèse porte sur les défis épistémiques de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative aussi connue sous le nom de maladie de Charcot. Elle travaille aujourd’hui sur la catégorie de maladie rare, en tant qu’ingénieure de recherche au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Elle enseigne également à l’Université Jean Moulin Lyon III en tant qu’ATER en philosophie santé et environnement.
Le spectre de l’addiction. Neurosciences, philosophie, psychiatrie, sciences humaines…, Anthony Ferreira, Éditions Matériologiques, 2024
L’ouvrage est disponible ici.
Introduction
Qu’est-ce que l’addiction ? Comme souvent en philosophie, si la question de départ est courte, la réponse exige de longs développements. Dans un ouvrage de près de sept cents pages, Anthony Ferreira rend compte des différentes conceptions possibles de l’addiction, synthétisant un vaste « chaos conceptuel » (p. 9). Avant de se livrer à cette tâche philosophique lors d’une thèse soutenue en 2022, dont est issu l’ouvrage publié aux Éditions Matériologiques, Anthony Ferreira a obtenu un doctorat en neurosciences en 2006. Comme l’indique Denis Forest dans la préface de l’ouvrage : « Anthony venait à l’histoire et à la philosophie des sciences après avoir abordé la question de l’addiction dans le cadre du laboratoire et des protocoles expérimentaux » (p. 3). Ce cheminement intellectuel et son résultat sont d’une grande pertinence pour tous ceux et toutes celles qui s’intéressent à l’addiction.
L’ouvrage est touffu et dense. Il fait preuve d’une grande érudition. L’auteur présente diverses théories en les analysant et en les critiquant avec acuité. Cet ouvrage rend accessible un ensemble de connaissances précises et détaillées sur les différents modèles de l’addiction, les différentes théories et approches, dans « une attitude philosophique réconciliatrice » (Postface de Serge Ahmed, p. 641). Le lectorat, en fonction de ses opinions et croyances, préférera sans doute la synthèse de telle ou telle théorie sur l’addiction (plus ou moins morale, plus ou moins psychanalytique, plus ou moins neuroscientifique…). Anthony Ferreira nous prévient et nous oblige à aller voir au-delà de notre porte d’entrée privilégiée sur la thématique de l’addiction : « Nos discours à propos de l’addiction sont criblés de croyances fausses, d’idées énoncées sous couvert de science, que cette dernière n’a jamais prises au sérieux ou a démontré l’inanité. […] Alerté de notre tendance à préférer certaines options, il s’agit aussi de garder à l’œil nos préférences, de viser une certaine lucidité […] » (p. 636).
Dans une première partie composée de trois chapitres, l’auteur revient sur l’origine du concept d’addiction, sur l’histoire des voies explicatives et thérapeutiques, sur ce qui fait l’unité et la pluralité du concept. Dans une deuxième partie composée de quatre chapitres, l’auteur étudie les mécanismes sous-jacents à l’addiction. Cet effort de synthèse et d’analyse construit progressivement la proposition de thèses précises et argumentées pour « favoriser l’articulation harmonieuse des connaissances apportées par les différentes disciplines qui [s’] intéressent » à l’addiction (p. 632). Dans une troisième et dernière partie composée de cinq chapitres, l’auteur détaille les thèses qu’il défend et qui découlent de son enquête.
La genèse de l’addiction : enquête historique et diversité théorique
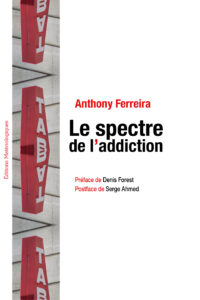 Dans une première partie composée de trois chapitres, Anthony Ferreira retrace la genèse du concept d’addiction. Dans le premier chapitre, le lectorat est invité à plonger dans l’histoire de la philosophie, de la religion et de la médecine, se rappelant la longue tradition des dialogues entre médecine et philosophie [1]. Comme l’indique l’auteur, « l’addiction touche à des pratiques, des conduites, des comportements, en rapport avec la tempérance et le désir, la consommation des objets convoités, hors de toute maîtrise. Or, la maîtrise de nos désirs, de nos appétits, intéresse, depuis toujours, les philosophes, les moralistes et les religions » (p. 25). Le lecteur ou la lectrice remonte alors dans le temps pour explorer des textes anciens. Les pratiques et les contextes sont également pris en compte. Anthony Ferreira détaille les différentes pratiques de consommation de drogue, à différentes époques dans différents espaces, rendant plus concrète l’histoire textuelle. Il identifie la naissance de l’addiction comme maladie dans le traité de Pascasius, un « médecin et philosophe flamand né autour de 1520 » (p. 33). Les siècles défilent ainsi que les conceptions de l’addiction : Benjamin Rush en 1784, le XIXème siècle et la prise en charge sociale où l’histoire littéraire rejoint l’histoire des idées avec la présentation des travaux de Zola, le XXème siècle et les Alcooliques Anonymes aux États-Unis… L’auteur dépeint un entrecroisement entre morale, religion et médecine tout au long des siècles, se concentrant sur l’espace européen, français et états-unien. Malgré l’intérêt indéniable de ce travail historique, certaines considérations rappellent une manière d’écrire l’histoire critiquée depuis longtemps en histoire des sciences et de la médecine [2] dont l’auteur est pleinement conscient. Il cherche « la paternité du concept d’addiction maladie » (p. 42) et souligne que Pascacius « semble bien être le premier à traiter d’une addiction comme d’une maladie, qui plus est une maladie de l’esprit dans un modèle explicatif qui fait la part belle à l’intrication corps esprit. Enfin, il propose un traitement par la parole. Il est tentant de voir, malgré les critiques de Canguilhem adressées à cette notion même, le précurseur de la psychanalyse » (p. 43). Comme indiqué par l’auteur lui-même, Canguilhem a démontré le caractère infécond d’une histoire des sciences recherchant des précurseurs [3]. Si le travail historique effectué demeure pertinent, sa mise en récit par l’auteur aurait mérité d’autres formulations pour éviter de risquer une représentation erronée du cours de l’Histoire.
Dans une première partie composée de trois chapitres, Anthony Ferreira retrace la genèse du concept d’addiction. Dans le premier chapitre, le lectorat est invité à plonger dans l’histoire de la philosophie, de la religion et de la médecine, se rappelant la longue tradition des dialogues entre médecine et philosophie [1]. Comme l’indique l’auteur, « l’addiction touche à des pratiques, des conduites, des comportements, en rapport avec la tempérance et le désir, la consommation des objets convoités, hors de toute maîtrise. Or, la maîtrise de nos désirs, de nos appétits, intéresse, depuis toujours, les philosophes, les moralistes et les religions » (p. 25). Le lecteur ou la lectrice remonte alors dans le temps pour explorer des textes anciens. Les pratiques et les contextes sont également pris en compte. Anthony Ferreira détaille les différentes pratiques de consommation de drogue, à différentes époques dans différents espaces, rendant plus concrète l’histoire textuelle. Il identifie la naissance de l’addiction comme maladie dans le traité de Pascasius, un « médecin et philosophe flamand né autour de 1520 » (p. 33). Les siècles défilent ainsi que les conceptions de l’addiction : Benjamin Rush en 1784, le XIXème siècle et la prise en charge sociale où l’histoire littéraire rejoint l’histoire des idées avec la présentation des travaux de Zola, le XXème siècle et les Alcooliques Anonymes aux États-Unis… L’auteur dépeint un entrecroisement entre morale, religion et médecine tout au long des siècles, se concentrant sur l’espace européen, français et états-unien. Malgré l’intérêt indéniable de ce travail historique, certaines considérations rappellent une manière d’écrire l’histoire critiquée depuis longtemps en histoire des sciences et de la médecine [2] dont l’auteur est pleinement conscient. Il cherche « la paternité du concept d’addiction maladie » (p. 42) et souligne que Pascacius « semble bien être le premier à traiter d’une addiction comme d’une maladie, qui plus est une maladie de l’esprit dans un modèle explicatif qui fait la part belle à l’intrication corps esprit. Enfin, il propose un traitement par la parole. Il est tentant de voir, malgré les critiques de Canguilhem adressées à cette notion même, le précurseur de la psychanalyse » (p. 43). Comme indiqué par l’auteur lui-même, Canguilhem a démontré le caractère infécond d’une histoire des sciences recherchant des précurseurs [3]. Si le travail historique effectué demeure pertinent, sa mise en récit par l’auteur aurait mérité d’autres formulations pour éviter de risquer une représentation erronée du cours de l’Histoire.
Dans le deuxième chapitre, Anthony Ferreira détaille davantage les différentes théories explicatives de l’addiction, toujours en suivant l’ordre chronologique d’apparition. L’auteur aborde deux modèles explicatifs, ancrés dans la psychanalyse et les neurosciences. Il présente les théories et les auteurs de la psychanalyse, la psychologie du moi, puis il rend compte de l’évolution américaine, de la psychologie comportementale et du cheminement progressif vers les neurosciences cognitives. Il développe la manière dont a été introduit le terme « addiction » en France, et compare notamment la France et les États-Unis, où les différentes visions de l’addiction sont en partie opposées. Il détaille ensuite la progressive neurobiologisation de l’addiction, jusqu’à parvenir au consensus dominant actuel, le « Brain Disease Model of Addiction » (BDMA), qui considère l’addiction comme une maladie chronique du cerveau, caractérisée par des modifications durables des circuits neuronaux impliqués dans le contrôle des impulsions, la récompense et la prise de décision. La critique de ce modèle structure en grande partie l’ouvrage. Loin de constituer une vaste liste à la Prévert, cette synthèse permet un état des lieux éclairé pour comprendre les thèses de l’auteur et leur inscription dans ces différents champs théoriques.
Dans le troisième chapitre émerge l’une de ses propositions, à savoir le fait de considérer l’addiction comme un spectre, une perspective qui permet de mieux rendre compte des diverses formes d’expression de l’addiction, en unifiant le phénomène autour d’un mécanisme commun à toutes ses manifestations. Cette proposition permettra notamment dans la partie suivante de critiquer le BDMA. Pour se faire, l’auteur donne un aperçu de l’évolution de l’approche diagnostique de l’addiction. Il revient en détail sur les évolutions des pratiques diagnostiques en psychiatrie à travers les différentes éditions du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM), un ouvrage de référence publié par l’Association américaine de psychiatrie (APA), qui décrit et classe les troubles mentaux afin d’unifier les critères diagnostiques [4]. Il précise également d’où provient la notion de spectre en psychiatrie qu’il reprend à son compte pour désigner l’addiction.
Analyser les impensés : la place du choix dans l’addiction
Après avoir proposé une unité à l’addiction en introduisant la notion de spectre, Anthony Ferreira s’attèle dans la deuxième partie, composée de quatre chapitres, à aborder une question qui hante l’histoire de l’addiction et les théories de l’addiction, une question fondamentalement philosophique, celle du libre arbitre et du déterminisme, liée au « mind body problem ». Il formule ainsi le « paradoxe de l’addiction » (p. 241) : « L’addiction soulève la question du mal, celui que l’on fait et celui que l’on se fait. Celle de la possibilité de, et des modalités pour, se faire, à soi-même, du mal. Peut-on considérer qu’il est possible d’agir ainsi en toute liberté contre son propre intérêt ? La qualification de maladie est une réponse possible au problème moral posé ; l’addict agit ainsi car il ne peut faire autrement. […] Or, remettant en cause le libre arbitre de l’addict cette réponse est inacceptable, pour certains, pour des raisons morales » (p. 241). Il s’agit de poser la question « de la nature et du mécanisme du choix » (p. 242).
En philosophe, Anthony Ferreira met en place une forme d’éclectisme, choisissant de prendre le meilleur de chaque approche et de chaque critique sans tomber dans la caricature. On apprécie notamment sa manière de reconnaître les apports et les limites des neurosciences dans le champ de l’addiction, se distançant du chant des promesses tout en reconnaissant les apports de la méthode scientifique. Deuxièmement, il analyse les impensés et les présupposés de certaines théories, notamment le BDMA, pour mieux cerner ce qui est pertinent ou non dans ce modèle explicatif, reprenant un geste classique de la philosophie. En résulte la présentation en quatre chapitres des différentes postures en présence et de sa proposition : (a) une présentation des théories sceptiques qui remettent en cause le déterminisme refusant aux personnes addictes leur libre arbitre, (b) une analyse des impensés du BDMA au sujet de la rationalité des personnes addictes et leurs critiques, menant à (c) une analyse fine du type de choix que constitue l’addiction et (d) la proposition de la considérer comme une forme d’acrasie, c’est-à-dire une faiblesse de la volonté, où l’individu agit contre son meilleur jugement.
Réponse à la question posée : définir l’addiction
Les quatre thèses qu’Anthony Ferreira défend sont les suivantes : (a) il fait de l’addiction un spectre, proposant une unité à ce concept malgré la pluralité des approches en permettant « d’organiser la cohérence [des] différents cadres théoriques » (p. 631). (b) Il défend l’idée que « le concept d’addiction est un concept utile et valable » (Ibid.), le replaçant « dans le giron de l’acrasie » (Ibid.) tout en le distinguant de cette dernière par « des caractéristiques spécifiques, comme sa récurrence, sa nature transgressive aux conséquences néfastes, le fait qu’à l’un de ses extrêmes il tend vers la compulsion qui le repousse hors de limites de l’acrasie » (Ibid.). Il conceptualise l’addiction comme un « choix spécifique » (p. 632) reconnaissant « une responsabilité de l’addict sans y ajouter un blâme outragé » (Ibid.). (c) Selon lui, « toute addiction est une addiction à un comportement » (p. 17), « il y a toujours un noyau comportemental dans l’addiction » (p. 632). (d) Il s’inscrit également dans un cadre pragmatique en précisant que « la question est moins de savoir si l’addiction est une maladie que savoir quand il est utile de dire à un addict qu’il est malade » (p. 632).
Ces thèses sont détaillées et justifiées dans la troisième et dernière partie de l’ouvrage où l’auteur revient point par point en cinq chapitres sur celles-ci pour répondre à la question « qu’est-ce que l’addiction ? », résolvant les enjeux moraux et épistémologiques posés par le « chaos conceptuel » autour de l’addiction. L’auteur propose une définition « purement descriptive » (p. 504) : « L’addiction peut se définir par l’envahissement préjudiciable par une activité d’abord vécue comme gratifiante, de la vie d’un individu qui ne réussit pas à réfréner sa tendance à s’adonner à cette activité malgré ce préjudice » (p. 503). En l’état des connaissances actuelles, les sciences biologiques ne permettent pas de proposer une définition réductionniste de l’addiction. Si l’auteur prend le temps de reconnaître les apports des sciences biologiques, il reconnaît leurs limites et propose une définition descriptive comprenant quatre dimensions : le degré d’envahissement, le degré de préjudice, le degré de participation à l’activité et le degré d’échec à se refréner (p. 504). Cette définition se veut heuristique en ce qu’elle est la plus générale possible et qu’elle pourrait « permettre d’explorer le phénomène plus avant » (p. 512). L’auteur prend ensuite le temps d’argumenter en profondeur pour tirer les conclusions et les conséquences du « retour de l’addiction dans le giron de l’acrasie » (p. 513), de l’unité de l’addiction, du fait que toutes les addictions sont comportementales, que l’addiction peut être désignée comme maladie au sens instrumental, et que le statut moral de la personne addicte relève de la responsabilité sans blâme d’Hanna Pickard. Ce cadre éthique reconnaît que les individus sont responsables de leurs actions, y compris en cas d’addiction, mais sans les stigmatiser ni les condamner moralement. Si ces conclusions changeront peut-être à l’aune de l’évolution des connaissances sur l’addiction, Anthony Ferreira se positionne en philosophe, au sens où, comme le rappelle le philosophe Fabrice Gzil, « en assumant le risque de prendre clairement position dans les débats contemporains, le [ou la] philosophe sait qu’il [ou elle] s’expose à ce que ses réponses soient discutées et critiquées. Mais c’est justement en prenant ce risque qu’il [ou elle] renonce à adopter une position dogmatique et qu’il [ou elle] peut, modestement, espérer contribuer à la réflexion collective » [5].
Conclusion
La vaste enquête d’Anthony Ferreira remplit parfaitement son rôle. La quantité de travail est impressionnante ainsi que la justification de chacune des propositions effectuées pour tenter de répondre à la question posée. L’ensemble de l’ouvrage est agréablement structuré et poursuit une argumentation satisfaisante. L’ouvrage constitue un incontournable pour qui s’intéresse à l’addiction en ce qu’il constitue une « synthèse inédite » (p. 8), pour reprendre les mots de Denis Forest dans la préface de l’ouvrage. L’objet de recherche « addiction » devient ici un objet pour la philosophie, et il y aurait, comme le souligne à juste titre l’auteur dans sa conclusion, deux pistes de réflexion pour poursuivre ce travail de recherche : « la question de la guérison et celle de la possibilité d’existence d’une addiction collective » (p. 633). Anthony Ferreira fait preuve d’originalité dans sa manière de faire de la philosophie sur l’addiction au sens où il se détache d’une tradition philosophique qui « s’est intéressée à l’addiction par le biais des comportements qui nous paraissent irrationnels, en miroir de la question fondamentale de la raison qui nous gouverne » (p. 13), la considérant comme « un exemple de faiblesse qui n’est jamais nommé par son nom mais par un nom qui rappelle l’objet visé par la conduite, l’ivrogne, l’héroïnomane » (Ibid.). Ce qui motive ici l’enquête philosophique est « l’absence de définition claire » (Ibid.) de l’addiction et une proposition de définition se fondant sur l’analyse des théories et des pratiques passées et actuelles autour de l’addiction.
Toutefois, la démarche n’est pas d’une grande originalité pour la philosophie contemporaine – malgré le souci de justification méthodologique de l’auteur (p. 13), au sens où il s’agit de définir un concept et de lui donner une unité. Comme souvent, la philosophie permet de favoriser les dialogues entre différentes manières de se représenter un phénomène complexe [6], [7]. Face à une impossible réduction des théories de l’addiction à une seule à l’aune de l’état actuel des connaissances, il s’agit d’« articuler ensemble les points de vue » (p. 14). La notion de spectre est aussi très présente dans la littérature médicale face aux défis posés par l’avancée des connaissances sur certaines maladies, y compris pour les maladies somatiques. De même que le pragmatisme dans l’analyse du concept de maladie, auquel l’auteur a recours, prend de plus en plus de place en philosophie de la médecine [8].
Même si l’exercice est classique, cela ne veut pas dire qu’il est aisé à réaliser, d’autant plus quand il articule autant de connaissances diversifiées sur une notion précise, ainsi que des considérations en philosophie des sciences, en philosophie morale, en histoire des sciences, en histoire de la médecine et en histoire de la philosophie. Le lectorat d’Anthony Ferreira saura lui reconnaître cette qualité de clarification qui pourra servir d’exemples pour d’autres études sur d’autres notions prises dans un « chaos conceptuel ».
Références
[1] Crignon, C., Lefebvre, D. (dir.), Médecins et philosophes : une histoire, Paris, CNRS Éditions, 2019.
[2] Absil, G., Govers, P., « Comment écrire l’histoire de la médecine pour les étudiants des sciences de la santé ? », Pédagogie Médicale, vol. 16, n° 1, 2015, pp. 9-22. DOI : 10.1051/pmed/2015015.
[3] Canguilhem, G., La formation du concept de réflexe aux XVIIe et XVIIIe siècles, in : Canguilhem, G., Œuvres complètes, tome II, Écrits de médecine et de philosophie : les thèses, Paris, Vrin, 2021, pp. 561‑836.
[4] Demazeux, S., Qu’est-ce que le DSM ? Genèse et transformations de la bible américaine de la psychiatrie, Paris, Ithaque, 2013.
[5] Gzil, F., La maladie d’Alzheimer : problèmes philosophiques, Paris, PUF, 2009.
[6] Lemoine, M., La désunité de la médecine : essai sur les valeurs explicatives de la science médicale, Paris, Hermann, 2011.
[7] Plutynski, A., Explaining Cancer: Finding Order in Disorder, New York, Oxford University Press, 2022.
[8] Schermer, M., Binney, N. (eds.), A Pragmatic Approach to Conceptualization of Health and Disease, Cham, Springer International Publishing, 2024.