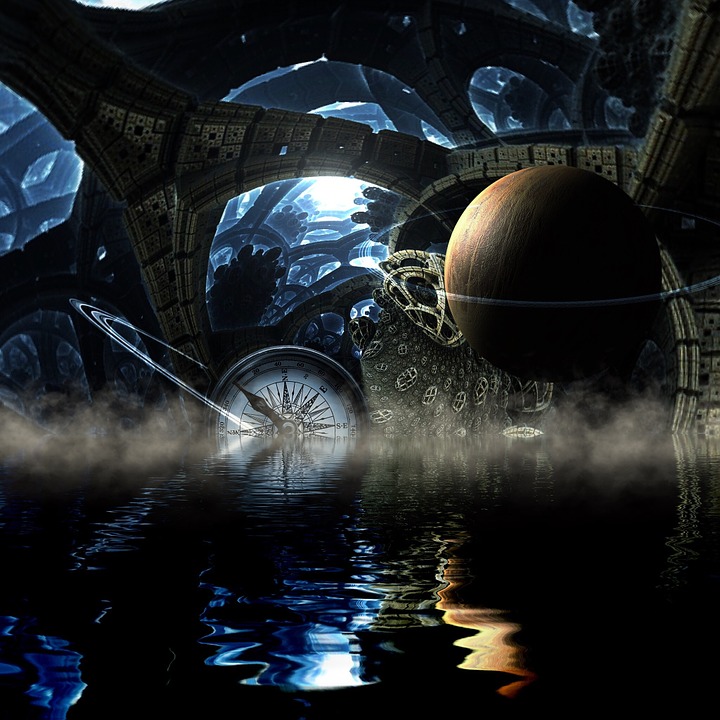Deleuze et le cinéma comme art critique
Dork Zabunyan – professeur en études cinématographiques à l’université Paris 8
Selon Deleuze, L’Image-mouvement et L’Image-temps sont des « livres de philosophie » ; le diptyque sur le cinéma possède en outre une réelle dimension politique qui marque un tournant dans le « devenir-révolutionnaire » défendu par son auteur. Il s’agit d’explorer ce « devenir » à la lumière d’une stratégie critique qui puise dans l’art du cinéma les conditions de son renouveau.
Les deux livres sur le cinéma de Gilles Deleuze ont eu un véritable effet sismique sur que l’on appelle les « études cinématographiques » – l’enseignement et la recherche en cinéma à l’université –, mais également sur la critique de cinéma, comme celle des Cahiers du cinéma, et jusqu’aux réalisateurs eux-mêmes, à l’instar de Manoel de Oliveira (qui avait exprimé le désir de rencontrer le philosophe pour parler avec lui du temps filmique). Trente ans après la publication de L’Image-temps, les répliques de cette secousse se font encore sentir, avec son lot de lectures enthousiastes (surtout chez les jeunes générations), de malentendus persistants (Deleuze aurait méprisé le vaste domaine de la culture populaire, au profit des seuls chefs d’œuvres du panthéon du cinéma), voire de flagrants dénis : par exemple, on pense que Deleuze propose une histoire du cinéma avec son diptyque sur le 7e art, alors que la première phrase de L’Image-mouvement est : « Cette étude n’est pas une histoire du cinéma ».
La réception des deux Cinéma – Cinéma 1 et Cinéma 2 – mériterait sans conteste une étude à part entière, en France comme à l’étranger, où les deux volumes sont devenus des classiques : en Italie, aux Etats-Unis, au Japon, etc.. Toutefois, il s’agira plutôt ici de mettre en lumière la dimension politique du diptyque de Deleuze, puisqu’une véritable stratégie critique irrigue ses textes sur le cinéma, y compris sa « lettre à Serge Daney » qu’il rédigea en 1986. Il faut rappeler que l’essai sur l’art des images en mouvement n’a nullement constitué un délassement ou une récréation pour le philosophe, encore moins – c’est là une hypothèse qui a pu être avancée – une espèce de régression sur un plan politique, si on le compare à certains livres en apparence plus « engagés » qui le précèdent (comme Mille Plateaux). Au contraire, il n’est pas exagéré de dire que L’Image-mouvement et L’Image-temps esquissent une reconfiguration du politique qui, loin de trahir sa bibliographie, la prolongent et la relancent sur une autre scène d’engagement, que Deleuze qualifie d’ailleurs de « révolutionnaire ».
Si nous pouvons nous revendiquer deleuziens aujourd’hui, dans la « civilisation de l’image » qui est la nôtre, c’est, entre autres, au regard d’une forme d’engagement inédite qui fut celle de Deleuze au milieu des années 1980. La portée contestatrice de l’essai sur le cinéma s’affirme surtout dans L’Image-temps, où se déploie parallèlement une orientation politique clairement posée par Deleuze. Elle s’énonce, on le sait, au chapitre 7 de ce second volume, intitulé « La pensée et le cinéma », et la tâche qui nous incombe alors est de retrouver le lien de l’homme et du monde. Ou plus exactement, la « croyance » en ce monde-ci, étant dit – c’est le « fait moderne » révélé par le cinéma après-guerre – que nous « nous ne croyons plus en ce monde. Nous ne croyons même pas aux événements qui nous arrivent, l’amour, la mort, comme s’ils ne nous concernaient qu’à moitié »[1]. Le moteur de cette croyance, c’est ce que Deleuze appelle le phénomène de voyance, c’est-à-dire la vision élevée à son exercice supérieur ; une vision en surrégime qui fonctionne sans les schèmes inoffensifs de la sensori-motricité, caractérisés par une reconnaissance automatique de ce qui nous entoure et par un jeu d’action et de réaction apaisant où se déroule la plus grande partie de nos existences. Deleuze prendra soin de repérer dans la modernité cinématographique tous les personnages qui – de la figure d’Irène (Ingrid Bergman) dans Europe 51 de Rossellini à La Femme du Gange de Marguerite Duras, en passant par le prince Salina (Burt Lancaster) dans Le Guépard de Visconti – sont tous devenus des voyants, et par la voyance ont su restaurer, de multiples manières, ce lien de l’homme et du monde.
Voir l’intolérable
Pour Deleuze, en réalité, cette tâche politique a pour vocation de sauver la signification du mot « révolution », de donner une nouvelle signification au « devenir révolutionnaire » à l’époque où il rédige ses deux Cinémas. C’est un aspect plutôt méconnu de son diptyque, sachant que le souci de réactualiser ce devenir trouve sa source chez les Romantiques anglais, principalement Samuel Coleridge et William Blake, tous deux cités à la fin de L’Image-mouvement puis au début de L’Image-temps[2]. Contemporains de la Révolution française, les deux poètes verront dans la Terreur qui suivra une trahison de cette révolution. Leur problème est le suivant, que Deleuze résume schématiquement ainsi : comment conserver encore un enthousiasme révolutionnaire, comment croire encore à la révolution, si la révolution est en définitive toujours trahie (hier en Angleterre, au 17e siècle, avec Cromwell, maintenant en France, après 1789) ? C’est là que nous retrouvons le phénomène de voyance, car Blake et Coleridge vont substituer à un action supposée renverser globalement un régime autoritaire, une vision supérieure qui entend révéler, à chaque fois localement, « l’empire de la misère », ou ce que Deleuze appelle encore un « intolérable » – une notion qui parcourt l’ensemble de L’Image-temps. Comme il l’écrit dans le premier chapitre de Cinéma 2 : « Le romantisme [anglais] se proposait déjà ce but : saisir l’intolérable ou l’insupportable, l’empire de la misère, et par là devenir visionnaire, faire de la vision pure un moyen de connaissance et d’action »[3].
Ce que ne dit pas Deleuze dans L’Image-temps, c’est que ce romantisme visionnaire est repris dans les années 1980 pour répondre à une autre trahison révolutionnaire qu’il observe durant cette période, à savoir la trahison de Mai 68, qui charrie dans ces années-là son lot de renégats et que Deleuze avait en détestation, lui qui déclare n’avoir « jamais renié Mai 68 »[4]. C’est sa manière à lui de sauver le « devenir révolutionnaire », en citant les Romantiques anglais et en faisant du cinéma moderne comme de Mai 68 un phénomène politique de vision – une « vision pure » ou supérieure, prélude à l’effectuation d’autres possibles. Car en quoi a consisté fondamentalement l’événement de Mai 68 ? « Il y a eu beaucoup d’agitations, de gesticulations, de paroles, de bêtises, d’illusions en 68, écrivent Deleuze et Guattari dans un texte daté de 1984 – « Mai 68 n’a pas eu lieu », paru dans Les Nouvelles littéraires, en pleine rédaction de L’Image-temps pour Deleuze –, mais ce n’est pas ce qui compte ajoutent-ils. Ce qui compte, c’est que ce fut un phénomène de voyance, comme si une société voyait tout d’un coup ce qu’elle contenait d’intolérable et voyait aussi la possibilité d’autre chose »[5].
Phénomène de voyance, romantisme visionnaire, vision de l’intolérable : cet aspect politique, « révolutionnaire » au sens où nous avons essayé de la définir chez Deleuze, détermine également la portée critique du cinéma, cette fois dans la relation que ce dernier entretient avec les autres types d’images en mouvement, comme celles de la télévision, de la vidéo, voire du jeu vidéo de nos jours ou encore des images qui sont disséminées sur internet. Nous avons affaire, dans L’Image-temps, mais aussi dans la « lettre à Serge Daney » mentionnée plus haut, à une véritable théorie critique dont nous ne soupçonnons sans doute pas toute l’importance pour notre présent ; si on la confronte à l’âge de l’image auquel nous appartenons, on y trouvera peut-être une raison supplémentaire de se revendiquer deleuzien aujourd’hui. Comme souvent chez le philosophe, la critique ne serait rien si elle n’était que réactive, si elle se positionnait uniquement contre, dans un rapport antagoniste qui placerait le cinéma au pied du mur : le cinéma contre la télévision, le cinéma contre les nouvelles images, etc. Deleuze n’a jamais cru en de telles oppositions, comme il n’a jamais adhéré à l’idée d’une hiérarchie entre un art du cinéma prétendu noble et la myriade d’images relevant d’une culture dite populaire. Il ne faudra jamais assez le répéter : cette distinction entre la haute et la basse cultures, si elle peut être effective dans les faits, n’est guère normative chez Deleuze, et l’élitisme présumé qui en serait la conséquence – c’est un reproche que les spécialistes de cinéma lui ont souvent adressé – ne tient pas une seconde si l’on considère l’attention concrète qu’il portait par exemple aux clips vidéo, aux sketchs de Benny Hill, ou encore aux play-back de Claude François[6].
Pas d’opposition de principe à la télévision, donc, qui intéresse Deleuze pour les virtualités créatrices qu’elle contient à un double niveau « audio » et « visuel ». À l’instar de la vidéo, comme le montrent les pages sur Michael Snow ou Nam June Paik en conclusion de Cinéma 2, la télévision constitue un véritable « relais » pour les cinéastes qui s’emparent de ces nouveaux médiums, comme en témoignent les films pour la TV de Rossellini (analysés dans le chapitre 9 de L’Image-temps, « Les composantes de l’image »), les essais filmés de Godard (comme Six fois deux, auquel Deleuze consacre l’un de ses premiers longs textes sur les images animées, sous la forme d’un faux entretien avec les Cahiers du cinéma paru en 1976 – « Trois questions sur six fois deux »). Toutefois, cet accueil, par les réalisateurs, d’autres types d’image s’établit en fonction d’une alternative qui peut paraître tout à fait néfaste au cinéma. En effet, soit le cinéma trouve dans ces images le terrain de nouvelles expérimentations, de nouvelles inventions, soit ces relais constituent une réelle menace à son existence, avec le risque que ceux-ci entraînent, ni plus, ni moins, la disparition du cinéma. C’est ce qui est posé par Deleuze dans les « conclusions » de L’Image-temps : « L’image électronique, c’est-à-dire l’image télé ou vidéo, l’image numérique naissante, devait ou bien transformer le cinéma, ou bien le remplacer, en marquer la mort »[7].
Même si Deleuze ne prend pas au sérieux l’idée d’une mort du cinéma – une idée « débile » selon lui –, il n’en reste pas moins que l’on retrouve cette alternative entre transformation et disparition du cinéma dans la « lettre à Serge Daney ». Elle s’exprime cette fois suivant une distinction conceptuelle qui mobilise deux genres de fonction de l’image : une fonction « esthétique » et une fonction « sociale », la première où la télévision est un vecteur de création pour le cinéma, la seconde, au contraire, où elle l’empêche d’avancer, de se transformer : « si le cinéma cherchait dans la télévision et la vidéo un “relais” pour les nouvelles fonctions esthétiques et noétiques, la télévision de son côté (malgré de premiers efforts rares) s’assurait d’abord une fonction sociale qui brisait d’avance tout relais, s’appropriait de tout autres pouvoirs aux possibilités de beauté et de pensée »[8]. La tâche des cinéastes n’est cependant pas de subir cette dichotomie relativement anesthésiante par ailleurs : comment faire en sorte que la « fonction sociale » mise en évidence ici ne triomphe au final sur la « fonction esthétique » abordée par Deleuze dans sa « lettre » au critique ?
C’est là que Deleuze va élaborer une notion mystérieuse qui semble être taillée pour notre temps ; une notion opératoire pour se repérer et trouver des outils à l’intérieur d’un âge marqué par un trop-plein d’images – un âge où, comme l’écrit Deleuze dans le sillage de Serge Daney, « l’image glisse toujours sur une image préexistante, présupposée, quand le “fond de l’image est toujours déjà une image”, à l’infini »[9]. Ce qui va permettre de nous orienter dans ce vaste magma d’images en apparence indifférencié, c’est le développement d’un « art du contrôle », expression étrange qui n’en possède pas moins une vocation programmatique, positive malgré les apparences. De quoi s’agit-il exactement ? Il s’agit de s’imprégner de la « fonction sociale » de la télévision, de s’immerger dans ses productions que l’on estime parfois médiocres ou écœurantes (le traitement de l’information dans un journal télévisé, par exemple), de suivre de proche en proche cette « froide organisation de la débilité du cervelet » que Deleuze entrevoit dans certains de ses programmes, par exemple dans ce qu’il appelle le « marché de la chansonnette », « crise d’épilepsie minutieusement contrôlée », qui n’est pas sans lien, d’après lui, avec les effets engendrés dans l’entre-deux guerre par les grandes propagandes d’État (la télévision comme nouveau fascisme ?)[10].
Retourner l’ennemi
Imprégnation, immersion, empathie presque avec l’insupportable : c’est là l’une des tâches du cinéma dans les années 1980 ; la condition de son nouveau combat comme le lieu où il conquiert une nouvelle dimension critique – par « retournement » de l’ennemi sur son propre terrain. Deleuze est très clair sur ce point : si la télévision est « la forme sous laquelle les nouveaux pouvoirs de “contrôle” deviennent immédiats et directs », alors il importe d’« aller au cœur de la confrontation, [en se demandant] si le contrôle ne peut pas être retourné, mis au service de la fonction supplémentaire [c’est-à-dire esthétique] qui s’oppose au pouvoir ». Avant d’ajouter – et c’est pratiquement un programme pour les cinéastes du temps présent : « inventer un art du contrôle, qui serait comme la nouvelle résistance. Porter la lutte au cœur du cinéma, faire que le cinéma en fasse son problème au lieu de le rencontrer du dehors ». D’où, aussi, cet état de « crispation » annoncé par Deleuze lecteur de Daney, cette série de « convulsions » entre l’art du cinéma et les images qui s’en distinguent, lesquelles peuvent tout à fait l’inspirer en retour, même si le cinéma garde cette possibilité de les retourner, de les renverser : moment « où le cinéma s’appuie pour se retourner contre le système qui veut le contrôler ou le suppléer lui-même »[11].
D’une certaine manière, le cinéaste se trouve dans la même situation que celle du peintre décrite au début du chapitre 11 de Logique de la sensation (« La peinture, avant de peindre… »). Il n’y pas de « surface blanche » pour le peintre, comme il n’y a pas d’écran immaculé pour le cinéaste ; l’un et l’autre affrontent toutes sortes de « données figuratives » avant de commencer à peindre une toile ou à tourner un film. Comme le soutient Deleuze dans sa monographie sur Francis Bacon parue en 1981 : « La figuration existe [sous-entendu : la figuration non artistique, non picturale] », « elle est même un préalable à la peinture » précise-t-il. De fait, « nous sommes assiégés de photos qui sont des illustrations, de journaux qui sont des narrations, d’images-cinéma, d’images-télé. Il y a des clichés psychiques autant que physiques, perceptions toutes faites, souvenirs, fantasmes »[12]. Et Deleuze remarque bien que ces « données figuratives », qui reposent sur des reproductions qui ne cessent de glisser les unes sur les autres, de circuler dans un vaste espace de signes visuels en tout genre, « ne sont pas seulement des moyens de voir », puisque « c’est elles qu’on voit, et finalement on ne voit qu’elles », rejoignant en ce sens les manières dont la « fonction sociale » de la télévision forcent notre regard, régentent notre vision[13].
« L’art du contrôle » suppose lui aussi que le réalisateur est environné d’images de toutes sortes : clichés audiovisuels, imageries dominantes, « nullité de la production cinématographique » ou télévisuelle, etc. Et c’est tout ce matériau d’images dans lequel il faudra qu’il s’immerge s’il veut parvenir à le « retourner ». C’est là que nous retrouvons le phénomène de la voyance, car de même que le voyant voit par-delà les clichés qui nous empêchent de percevoir littéralement les choses, le retournement dont il est question dans la « lettre à Serge Daney » implique de voir sans esquive l’intolérable, l’insupportable des « données figuratives » véhiculée par la télévision, la publicité, les mauvais films, etc. – si on veut parvenir à leur résister. C’est en ce sens que la position critique qui se dégage de cette stratégie de retournement, outre qu’elle échappe à toute lecture catastrophiste (le trop-plein d’images serait la cause d’une déréalisation du monde), ne repose pas sur une opposition frontale entre les médiums, dans la mesure où le cinéma se situe plutôt dans une zone d’indiscernabilité où l’abject côtoie le meilleur, où de l’abject même peut surgir le meilleur. Deleuze ne dit pas autre chose quand il déclare à Daney que dans le « maniérisme » en quoi consiste cette « convulsion cinéma-télévision » « voisinent le pire et l’espoir »[14].
Si l’on considère les auteurs cités par Deleuze dans son diptyque, l’un d’entre eux correspond parfaitement à ce retournement propre à « l’art du contrôle » qu’il appelle de ses vœux. Cet auteur est Federico Fellini. Au début de L’Image-temps, il analyse en effet les « visions » du cinéaste italien, visions de voyant, forcément, qui ont toujours fait preuve d’une certaine affection pour les états de corruption ou de décadence, que Fellini a toujours pris soin d’observer avec une faculté de voir indifférente à la dérobade ou à la dénégation, éprouvant au contraire une étrange sympathie pour ces états proches de la déroute affective ou existentielle. C’est ainsi que Deleuze écrit dans Cinéma 2 que les « visions de Fellini sont inséparables d’une “empathie”, d’une sympathie subjective (épouser même la décadence qui fait qu’on aime seulement en rêve ou en souvenir, sympathiser avec ces amours-là, être complice de la décadence, et même la précipiter, pour sauver quelque chose, peut-être, autant qu’il est possible…) »[15]. Deleuze ne cite pas Ginger et Fred de Fellini, qui sort sur les écrans la même année que L’Image-temps, mais voilà un « film sur la télévision », où la lucarne télévisuelle est presque de tous les plans – un film qui tente de la retourner sur son propre terrain, conformément à une posture souvent défendue par Fellini : « ce n’est pas un procès par un juge, c’est un procès fait par un complice ». Ginger et Fred : un film où coexistent bien « le pire et l’espoir », où la laideur du spectacle télévisuel est donnée à voir au spectateur sans qu’aucune leçon lui soit faite sur sa nullité, où même un peu de grâce est « sauvé » (chez les techniciens de l’émission « Ecco a Voi », que l’on aperçoit furtivement, ou chez celles et ceux qui y participent sans trop y croire, comme les personnages de Ginger Rogers et Fred Astaire, respectivement interprétés par Giuletta Massina et Marcello Mastroianni).
Il faut indiquer ici que le retournement de « l’art du contrôle » se distingue très nettement des stratégies de détournement que l’on peut trouver à l’œuvre dans les approches de type situationniste ou post-situationniste, lesquelles procèdent souvent par parodie ou moquerie de ce qui est dénoncé. Nulle dénonciation de ce genre chez Deleuze, à la recherche d’une posture critique plus sobre qui ne tombe pas dans les pièges du rire jaune ou de la raillerie. Fellini, pour revenir à lui, ne parodie pas la télévision, de même que Flaubert ne prenait pas la plume pour proposer un bêtisier de son temps. Deleuze insiste sur cette exigence de sobriété en divers endroits de son œuvre. Sur l’expérience de la bêtise et de sa reprise en art, en particulier dans les pages bien connues de Différence et répétition, il déclare ainsi que « la plus mauvaise littérature fait des sottisiers ; mais la meilleure fut hantée par le problème de la bêtise, qu’elle sut conduire jusqu’aux portes de la portes de la philosophie, en lui donnant toute sa dimension cosmique, encyclopédique et gnoséologique (Flaubert, Baudelaire, Bloy) »[16]. Ou encore dans Logique de la sensation, où la lutte contre les clichés ne peut se confondre avec le fait simplement de les parodier : « les grands peintres savent qu’il ne suffit pas de mutiler, malmener, parodier le cliché pour obtenir un vrai rire, une vraie déformation »[17].
C’est pourquoi le retournement invoqué par Deleuze est une tâche extrêmement difficile ; l’immersion, voire la « sympathie » avec l’ennemi en est la condition (nécessaire, mais pas suffisante), sachant aussi qu’il n’y a pas d’art du contrôle sans phénomène de voyance, puisque « c’est cela qu’il faut voir », justement – la décadence, la vulgarité, l’intolérable dans tous les cas. C’est pourquoi le cinéma comme « art du contrôle » est aussi bien, indissociablement, un art dangereux – pour le réalisateur qui le fait, pour le spectateur qui le regarde –, mais ce danger est le signe sans équivoque de son éternelle jeunesse, de sa fraicheur intempestive.
[1] L’Image-temps, Paris, Minuit, p. 223.
[2] Voir respectivement L’Image-mouvement, Paris, Minuit, 1983, p. 282 et L’Image-temps, op. cit., p. 29.
[3] Ibid.
[4] Comme il le déclare dans la brève notice biographique qui figure dans le n°257 du Magazine Littéraire qui lui est consacré (septembre 1988).
[5] Texte repris dans Deux Régimes de fous, Paris, Minuit, 2003, p. 215-216 pour la citation.
[6] Voir en particulier la « Lettre à Serge Daney : optimisme, pessimisme et voyage » (1986), repris dans Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, p. 108 et p. 103 : « la télévision a autant de fonction esthétique potentielle qu’un autre moyen d’expression », ainsi que « C comme Culture », L’Abécédaire de Gilles Deleuze, avec Claire Parnet (1988), disponible en DVD aux éditions Montparnasse.
[7] L’Image-temps, op. cit., p. 346. Sur ce point, voir Dork Zabunyan, Gilles Deleuze – Voir, parler, penser au risque du cinéma, Paris, PSN, 2008, p. 301-322.
[8] « Lettre à Serge Daney », op. cit., p. 101-102 pour la citation.
[9] Ibid., p. 107.
[10] Ibid., p. 109 et p. 106 pour la référence au fascisme.
[11] Ibid., p. 107 (« son » est souligné par Deleuze, nous soulignons les occurrences du verbe « (se) retourner ».
[12] Francis Bacon – Logique de la sensation (1981), Paris, Seuil, 2002, p. 84.
[13] Ibid., p. 86.
[14] « Lettre à Serge Daney », art. cité, p. 109.
[15] L’Image-temps, op. cit., p. 14.
[16] Différence et répétition, op. cit., p. 196.
[17] Logique de la sensation, op. cit., p. 85.