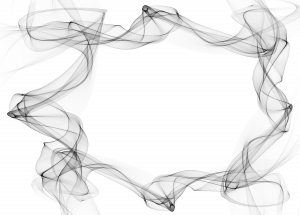L’épistémologie du cohérentisme et la notion de confiance épistémique.
Cet article a été publié dans le dossier 2014 – la confiance.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des contributions du dossier
Christophe Al-Saleh (Université de Picardie Jules Verne/ CURAPP-ESS [CNRS, UMR 7319])
1. La confiance épistémique est définie en dirigeant l’attention sur tous les cas où nous avons des connaissances parce que nous faisons confiance à certaines autorités (on définira ici une autorité comme une source d’informations considérée comme fiable). Si je lis le journal, et que je crois ce que j’y lis, c’est dans la mesure où j’accorde une certaine confiance au journal. On parle de confiance épistémique, pour distinguer la notion de la notion morale. Il s’agit d’une confiance qui concerne la fiabilité de ce mode de transmission des connaissances.
La théorie cohérentiste de la connaissance[1] insiste sur l’idée d’après laquelle c’est moins une relation de vérité et de justification terme à terme qui fonde l’efficacité de mes connaissances, que la cohérence d’un tissu, d’un schème, d’une conception globale (les termes pour désigner le sujet de la cohérence sont nombreux). L’argument massif des défenseurs du cohérentisme est qu’une conception cohérente qui me permet de former des croyances à propos du monde, et d’agir efficacement sur le monde, a de grandes chances d’être une conception vraie, et par-là même, de justifier les croyances, du coup vraies, qu’elle permet de former.
Le cohérentisme s’appuie pour l’essentiel sur l’intégration d’attitudes typiquement épistémiques comme les croyances. Mais il est du coup amené à réduire à peu près tout rapport au monde, du moment que l’on envisage ce rapport au monde comme pourvoyeur de raisons, et non pas simplement sous l’angle d’une relation causale entre le corps du sujet rationnel et son environnement, à un élément homogène à la croyance. Des notions de capacités qui seraient à la fois susceptibles de pourvoir des raisons tout en étant non-épistémiques, si le modèle de l’attitude épistémique est la croyance, sont, pour ainsi dire, étrangères au cohérentisme. Or, il semble, dans la mesure où il s’agit, dans son sens le plus ordinaire, d’une relation inter-personnelle, et où il est possible de parler d’une confiance aveugle, de prime abord difficile de se fonder sur le cohérentisme pour étayer une conception de croyances justifiées par la confiance épistémique, et, du coup, le cohérentisme serait partiel, et même parcellaire, en laissant sur le bord de la route ce qui constitue pourtant, comme le remarquent justement les épistémologues de la confiance, un très grand nombre de nos connaissances.
La présente contribution tente d’esquisser le cadre conceptuel et problématique rencontré dès lors que l’on envisage la possibilité de concilier la notion de confiance épistémique dans le cadre d’une épistémologie cohérentiste.
2. L’une des tâches de l’épistémologie est de déterminer les procédures qui peuvent être considérées comme justifiantes. Il s’agit des procédures qui peuvent être invoquées par un sujet pour justifier d’avoir une certaine croyance, c’est-à-dire une attitude propositionnelle envers un certain contenu.
La notion de procédure est ici entendue en un sens suffisamment large pour inclure des choses aussi diverses que la perception, l’observation, et, pour ce qui nous occupe ici, la confiance, ou, de manière plus générale, la déférence.
Toutefois, une théorie cohérentiste de la connaissance restreint la notion de procédure, car n’est admissible une procédure que dans la mesure où elle se traduit par une croyance. Un élément ne peut pas être considéré comme pouvant venir justifier un autre élément (c’est-à-dire une attitude propositionnelle comme une croyance) si il n’y a pas une homogénéité entre les deux éléments. Autrement dit, seule une croyance (ou, plus généralement une attitude épistémique) est susceptible de justifier (en d’autres termes de fournir une raison) à une autre croyance. On reconnaît là la formulation du cohérentisme propre à Davidson. Nous parlerons par la suite de principe de Davidson. L’un des objectifs de cet article est de se demander comment on peut concilier les notions relatives à l’idée de confiance épistémique dans un cadre qui reste fidèle au cohérentisme, ce qui reviendra également à se demander quels amendements un cadre cohérentiste peut admettre sans devenir autre chose.
Par ailleurs, on peut constater que certaines procédures n’engagent que le sujet, alors que d’autres procédures engagent au moins deux sujets, voire tout un groupe.
Si nous adoptons des expressions plus concises, pour mieux resserrer le cadre de notre réflexion, nous pouvons nous représenter les choses à l’aide des symboles suivants:
A(S, p) pour une attitude propositionnelle d’un sujet S envers un certain contenu propositionnel p.
# pour la relation de justification.
Par exemple, si nous considérons que S est justifié à croire que p parce qu’il a vu que p, nous pourrons écrire :
VISION (S, p) # CROIRE(S, p)
Nous pouvons donc nous accorder sur un schéma abstrait, que nous qualifions de schéma de la justification :
A (S, p) # B (S, p)
Nous pouvons noter trois idées à propos de cette notation et de ce schéma.
Tout d’abord, si nous tenons absolument à ce que ne figurent de part et d’autre de la relation de justification que des attitudes propositionnelles au sens strict, alors nous adoptons une conception strictement cohérentiste de la justification, le cohérentisme consistant en une stricte homogénéité des éléments qui interviennent dans la chaîne de la justification. Selon le principe de Davidson, rien ne peut justifier une certaine attitude propositionnelle comme une croyance sinon une autre attitude propositionnelle du même type. Rien sinon une autre croyance ne peut justifier une croyance. A strictement parler, la justification ne peut concerner qu’un seul type d’attitude propositionnelle, à savoir les croyances.
Ensuite, les divers constituants susceptibles d’entrer dans le schéma de justification doivent être compris comme étant des paramètres. Cela veut dire que l’extension de ces différents constituants n’est fixée que quand on a fixé la nature de la première attitude propositionnelle (bien sûr, cela suppose aussi qu’il peut y avoir divers types d’attitudes propositionnelles pertinentes pour entrer dans le schéma de la justification, ce qui entre en contradiction avec le principe de Davidson). Par exemple, si l’on envisage le schéma VISION(S, p) # CROIRE (S, p), alors il est bien évident que le contenu propositionnel p est fixé relativement à des paramètres qui concernent le sujet S. Il est absolument inévitable que des contextes obliques, voire opaques interviennent. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il ne faut pas voir dans ces schémas des formules susceptibles d’entrer dans des suites de formules logiques, qui s’alignent sur les canons des logiques extensionnelles standards.
Ce que ce schéma permet d’envisager, c’est l’interaction des constituants, une interaction dont on peut rendre compte en parlant de différents paramètres. La relation de justification est donc une relation qui doit avoir des paramètres. En particulier, plus on est prêt à abandonner le principe de Davidson et l’homogénéité des constituants susceptibles d’entrer dans un cadre normé par le schéma de justification, et plus il va falloir prendre en compte ce paramétrage de la relation de justification.
Enfin, On peut généraliser encore davantage le schéma, comme suit :
A (S, p) # B (S’, q)
Le schéma de justification est là entièrement généralisé, puisqu’il y a la possibilité que ce ne soit plus seulement les attitudes propositionnelles (ou autre chose) et les contenus propositionnels qui diffèrent de part et d’autre de la relation de justification, mais également les sujets.
Or, si on insiste sur le fait que, la plupart du temps, S ≠ S’, et si on met en évidence le fait que, le sujet à gauche (et même à droite) de la relation peut être un groupe, et non pas un individu, alors on entre dans les préoccupations de ce que l’on appelle l’épistémologie sociale.
3. Cependant, il n’est pas sûr que, à mesure que l’on s’éloigne du principe de Davidson, et que l’on prend en compte les exigences de l’épistémologie sociale, notre schéma puisse subsister, alors qu’il paraissait jusque là bien commode. A vrai dire, se demander comment envisager le cas de la confiance tout en conservant ou en abandonnant le schéma de la justification (l’abandonner voulant très certainement dire que l’on renonce à l’amender ou à le modifier car cela devient beaucoup plus difficile à faire que de l’abandonner purement et simplement et de rechercher autre chose), c’est se demander quelle est la nature de la confiance dite épistémique.
En effet, dans le cadre de la confiance dite épistémique, la confiance est dite pouvoir justifier certaines attitudes propositionnelles comme la croyance, des attitudes épistémiques. Or, la première chose, la plus évidente, que l’on peut remarquer, est que la confiance est une relation inter-personnelle. Et, plus important encore, si l’on prend ce sens inter-personnel de la relation de confiance comme irréductible et fondamental pour définir la confiance épistémique, alors il ne saurait être question d’envisager la confiance comme une attitude propositionnelle.
La première modification du schéma va être drastique, car elle va nous conduire à nous couper complètement du principe de Davidson.
En effet, on va se permettre de mettre à gauche du schéma d’autres symboles que ceux qui font référence à des attitudes propositionnelles.
CONFIANCE (S, S’, p) # CROIRE (S, p)
Ce qui veut dire que le fait que S fasse confiance à S’ quant au contenu propositionnel q justifie que S croie que p.
Pour ne pas renoncer à l’intégrité de notre schéma, on serait conduit à demander au principe de Davidson un peu de tolérance, car il faudrait trouver une lecture qui permette de ranger la confiance parmi les attitudes épistémiques comme la croyance, et, fondamentalement du même type que la croyance.
CONFIANCE (S, p) # CROIRE (S, p)
Mais cela ne suffit pas. Il faut indexer la confiance, en mentionnant à quel sujet ou groupe est arrimée cette confiance de S, par exemple ainsi :
CONFIANCES'(S, p) # CROIRE (S, p)
En résumé, si l’on veut conserver une image cohérentiste de la justification, tout en intégrant la notion de confiance épistémique, on a le choix entre deux approches, une approche conservatrice, qui cherche à traiter la confiance comme une attitude épistémique, mais qui va devoir faire avec une certaine difficulté, à savoir qu’il s’agit d’une attitude propositionnelle arrimée (d’une manière qui reste à préciser) à un autre sujet (qu’il s’agisse, d’ailleurs, d’un sujet collectif ou individuel), et une approche libérale, qui accepte de modifier le schéma de la justification, tout en conservant l’idée générale, en introduisant à gauche du schéma quelque chose qui n’est pas une attitude propositionnelle. Mais cela conduit à revoir la nature de la justification, car elle n’est alors plus du tout définie par le principe de Davidson.
4. Cette dualité des approches libérale et conservatrice permet de rejoindre une dualité, qui est sans doute plus large, car elle n’est pas attachée au cadre strict de la discussion du cohérentisme, à savoir la dualité entre une approche réductionniste et une approche non-réductionniste de la confiance épistémique[2].
Thèse anti-réductionniste : La confiance épistémique est une capacité sui generis à accepter que p est vrai simplement parce qu’on entend que p est vrai.
Thèse réductionniste : la confiance épistémique est le terme qui désigne la propension d’un sujet S, fondée sur des raisons non-confiantistes (au sens de la confiance qui est celui de l’anti-réductionnisme), à juger que p est vrai sur la base de l’engagement d’un sujet S’ que p est vrai.
Dans les deux cas, on remarquera, mais c’est un point qui était jusque là implicite dans notre raisonnement, que la confiance se distingue de la déférence aveugle à l’autorité, une capacité ou une propension n’ayant de sens, dans ce cas, que si elle peut s’exercer dans les deux sens (c’est le principe du two-way power), accepter que p ou ne pas accepter que p, juger que p est vrai ou juger que p est faux (ou s’abstenir de juger, d’ailleurs…).
L’approche conservatrice est anti-réductionniste. L’anti-réductionnisme consiste ici à ne pas traduire la confiance épistémique en autre chose qu’en une attitude propositionnelle. Est-ce que cela signifie pour autant, si l’on suit l’effet de miroir entre les deux dichotomies, que l’approche libérale soit réductionniste ? Oui, au sens où la confiance que S fait à S’ relativement à un certain contenu propositionnel va être le focus de l’explication épistémologique, au sens où il va falloir expliquer, et ce probablement en indiquant des procédures non-confiantistes, en quoi S a raison de faire confiance à S’ relativement à un certain contenu propositionnel.
Nous allons maintenant étoffer un peu les deux propositions, le libéralisme et le conservatisme, et montrer notamment leurs points faibles.
5. D’après la proposition libérale, il est possible de traiter la confiance que S fait à S’ relativement à un certain contenu propositionnel comme une relation inter-personnelle (c’est-à-dire a priori non pas comme une attitude épistémique) comme un élément justifiant, tout en se dispensant de l’idée que c’est parce qu’elle fournirait une croyance d’un certain type, susceptible ensuite de fournir une raison à une autre croyance. A vrai dire, dans ce schéma, c’est l’engagement du sujet S’ quant à P qui compte. C’est parce qu’il existe une relation de confiance entre S et S’ que S est prêt à croire que S’ sur la seule base de ce que, par exemple, S’ croit que p.
On pourrait penser qu’il s’agit là d’une sorte de transfert d’attitude propositionnelle. Cependant, à proprement parler, ce n’est pas l’attitude propositionnelle qui passe de S’ à S, il se trouve que S trouve une raison de renforcer épistémiquement une attitude propositionnelle déjà présente non pas seulement du fait que S’ croie que p, mais plutôt et surtout du fait que S fasse confiance à S’. La confiance est alors une propension à accepter que, parmi les raisons venant renforcer une croyance, puisse figurer la croyance d’un sujet S’ avec qui une certaine relation inter-personnelle de confiance est établie. La confiance n’est donc pas une capacité individuelle irréductible.
On peut expliquer que cette relation survienne, si un certain nombre de faits sont avérés ou constatables : S’ n’a jamais menti à S ; S’ est un expert reconnu sur le sujet ; S’ est un parent proche de S, etc. Dans tous les cas, la relation ne subsiste que pour autant qu’aucun événement ne vienne la perturber.
Comment est-il possible de concilier cette conception de la confiance épistémique avec une théorie cohérentiste de la connaissance ? Le principe de Davidson semble, à première vue, sérieusement malmené. Mais cela n’est peut-être qu’une apparence.
Après tout, Davidson n’a jamais dit que rien sinon une croyance de S n’était susceptible de justifier une croyance de S. Tout ce que l’on trouve dans le principe de Davidson, c’est que, de part et d’autre de la relation de justification, il doit y avoir une homogénéité. Si une attitude épistémique d’un certain type figure à droite, alors une attitude épistémique du même type doit figurer à gauche.
Est-ce là une voie qui s’offre pour concilier le principe de Davidson avec une attitude libérale ? Nous avons remarqué que l’attitude libérale est réductionniste. Elle ne reculera donc peut-être pas devant la possibilité de revoir le schéma de la confiance de manière à réduire cette confiance à un élément qui rentre dans le schéma de la justification tout en respectant le principe de Davidson…
Mais ce serait se tromper sur le sens que prend la notion de réduction quand il s’agit de la question de la confiance épistémique.
La réduction, ici, n’est pas, par exemple, celle dont il est question dans la discussion sur la relation entre états physiques et états mentaux. Dans la discussion sur la relation entre états physiques et états mentaux, le point de départ de la réduction est homogène ontologiquement au point d’arrivée de cette réduction. Les états mentaux sont des assemblées de propriétés (ou, respectivement, de prédicats, respectivement, de tropes) et les états physiques sont des assemblées de propriétés (ou, respectivement, de prédicats, respectivement, de tropes).
La réduction à laquelle adhèrent les libéraux, sur la question de l’intégration de la confiance épistémique à un cadre épistémologique cohérentiste, se fait entre un point de départ et un point d’arrivée qui sont hétérogènes ontologiquement. Ce qu’opère la réduction, c’est de montrer qu’une certaine prétendue capacité (la confiance épistémique comme attitude propositionnelle) n’est en fait qu’une relation inter-personnelle. Or, une capacité n’est pas une relation.
Reste alors au libéralisme de montrer en quoi une relation peut fournir une raison de croire. La stratégie est alors de montrer que la relation elle-même n’est justifiante que dans la mesure où elle repose sur un certain nombre de faits que S est censé connaître, ou tout du moins croire (plus ou moins explicitement) au sujet de S’.
Le schéma serait alors :
CROYANCE(S, [s’1, s’2, …, s’N])#CONFIANCE (S, S’, p) {1}
CONFIANCE (S, S’, p) # CROYANCE (S, p) {2}
Où [s’1, s’2, …, s’N] est un ensemble de faits qui ont une pertinence épistémique (autorité, véracité, etc.) du type de ceux que nous avons rappelé un peu plus haut.
Si nous acceptons que la relation de justification est transitive, alors, nous obtenons, à partir des relations 1 & 2 la relation 3 :
CROYANCE(S, [s’1, s’2, …, s’N])# CROYANCE (S, p) {3}
Cette formulation est idéale, car elle signe la possibilité de concilier le principe de Davidson et une notion de confiance épistémique, certes réduite. Si il n’y a pas de problème avec cette formulation, alors c’est que nous aurons eu raison de suivre la voie libérale.
Le problème est que tout repose sur la transitivité de la relation de justification, et sur l’acceptation, au moins transitoire, que le principe de Davidson peut être écarté (au moins dans la formule 1). Cette dernière difficulté n’est pas majeure. On pourra toujours dire que ce n’est qu’avant la réduction qu’on peut avoir l’impression d’une violation du principe de Davidson, et que c’est justement le rôle de la réduction bien opérée de nous montrer qu’il n’y a pas, en bonne analyse, une telle violation.
Par contre, l’autre difficulté, à savoir que tout repose sur la transitivité de la relation de justification, est réelle. Car il se pourrait bien qu’il ne soit pas du tout évident, qu’une telle relation soit transitive.
Les cas-Gettier[3] montrent que, même en acceptant un principe de clôture épistémique (si je crois que p et si je crois que [si p, alors q, alors je crois que q), qui est censé, justement, garantir cette transitivité, en la collant sur le schéma des inférences valides construit sur la notion d’implication matérielle, il n’y a pas du tout de transitivité de la justification. Certes, les cas-Gettier sont quelque peu artificiels. Mais leur valeur de contre-exemple est dans tous les cas probante s’il s’agissait d’affirmer qu’intuitivement ou a priori, la relation de justification est transitive.
Nous avons donc au moins une raison, certes négative, de ne pas trop nous engager dans la voie proposée par les libéraux pour résoudre la question de la conciliation d’une notion de confiance épistémique avec un cadre épistémologique cohérentiste.
6. Le conservatisme de l’autre approche est relatif au principe de Davidson. Si la confiance épistémique doit trouver une place dans une épistémologie cohérentiste, cela doit se faire dans le respect du principe d’après lequel rien ne peut justifier une croyance sinon une autre croyance, ou alors, une autre attitude épistémique qui entretient une relation directe avec la croyance. Le principe de l’approche conservatrice est donc de défendre une stratégie anti-réductionniste de la confiance épistémique, d’après laquelle la confiance épistémique est bien une capacité sui generis, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une capacité à adopter une attitude épistémique spécifique envers un contenu. Cette attitude épistémique spécifique peut se traduire par l’idée que « entendre, c’est croire ». Autrement dit, S ne croit pas, quand S’ dit que p, que p parce que S a une relation inter-personnelle particulière (la confiance) avec S’, ce qui est la base de l’approche libérale, mais plutôt, il y un certain nombre de sources qui sont telles que quand ces sources énoncent que « p », alors S croit que p, et S’ est l’une de ces sources. La confiance n’est pas définie comme une relation inter-personnelle, mais comme une forme particulière de réception du contenu que p. Normalement, on ne croit pas du seul fait d’entendre. La confiance épistémique, c’est justement le fait de croire du seul fait d’entendre, et surtout, d’avoir ainsi, prima facie, une raison de croire ce qui a été entendu, mais à la restriction près que les sources ne peuvent pas être n’importe lesquelles. C’est pour cette raison que la confiance épistémique doit être arrimée à des sources, ces sources étant, de manière privilégiée, des personnes ou types de personnes, ou bien des groupes de personnes ou types de groupes de personnes, si l’on veut conserver à la notion de confiance l’une des composantes importantes de son sens le plus courant, à savoir qu’il s’agit d’une relation inter-personnelle.
Ainsi, le principe de Davidson est respecté, et les considérations sur la transitivité de la justification ne parasitent pas la construction. Le problème posé par cette approche est différent de celui posé par l’approche libérale. Alors que, pour l’approche libérale, la nature réductionniste de sa stratégie n’était pas à prouver, cela n’est pas vraiment le cas avec l’approche conservatrice. On pourrait penser, en effet, que son caractère séduisant et simple vient, en définitive, de ce qu’il s’agit d’une approche réductionniste déguisée.
L’objection se présente comme suit. Dire que la confiance épidémique consiste à croire que p du seul fait d’entendre un certain type de personne, ou une personne d’un certain type de groupe, ou une certaine personne, ou une personne d’un certain groupe, dire que p, cela revient au bout du compte au schéma réductionniste. En effet, il est difficile de voir en quoi S sans la croyance minimale d’après laquelle « cette personne est fiable », peut être disposée à croire que p du seul fait d’entendre que p, avec les conditions d’arrimage que nous venons de décrire. Et c’est donc cette attitude propositionnelle qui est déterminante. La confiance épistémique ne constitue pas en tant que telle une capacité à adopter des attitudes épistémiques, de façon à être autonome par rapport à une autre croyance. Au bout du compte, l’approche conservatrice n’est donc anti-réductionniste qu’en apparence, et on en revient à l’approche libérale.
Cette objection met en question l’idée essentielle de l’anti-réductionnisme, à savoir le fait que la disposition à croire que p parce que l’on entend que p, selon les conditions d’arrimage pertinentes, quand elle s’actualise de la bonne manière, constitue une raison prima facie, de croire que p. Cette idée développe une analogie entre la confiance épistémique et la vision. La disposition à croire qu’il y a un chat sur le tapis parce que l’on voit qu’il y a un chat sur le tapis, quand elle s’actualise de la bonne manière, constitue une raison prima facie, de croire qu’il y a un chat sur le tapis. C’est là le contenu rigoureux de la notion d’une modalité prima facie d’une croyance dirigée vers un certain contenu propositionnel.
Est-ce que la confiance fait partie de ces dispositions ? Le réductionniste (et, donc, le partisan de l’approche libérale) pense que ce n’est pas le cas, et qu’il est nécessaire qu’une certaine croyance (la croyance dans la fiabilité de la source) garantisse la croyance finale, celle qui est l’objet de la confiance. L’anti-réductionniste (et, donc, le partisan de l’approche conservatrice) pense que c’est le cas. Cependant, nous ne disposons pas d’un argument direct en faveur de ce qui constitue le pivot de l’argumentation conservatrice, à savoir la validité de la thèse anti-réductionniste.
[1] Voir, pour l’exposition du cohérentisme qui correspond le mieux à notre propos ici, Donald Davidson, « Un théorie cohérentiste de la vérité et de la connaissance », dans B. Ambroise et S. Laugier, éds., Philosophie du langage. Signification, vérité et réalité., Paris, Vrin, p.305-337
[2] Pour cette distinction entre réductionnisme et anti-réductionnisme, classique en épistémologie de la confiance, voir G. Origgi, « Is Trust an Epistemological Notion ? », Episteme, Juin 2004, p.1-12
[3] Gettier est connu, pour avoir, en 1963, publié « Is Justified True Belief Knowledge?, (Analysis, vol.23, p.121-123)(traduit dans P. Engel & J. Dutant, éds, Philosophie de la connaissance. Croyance, connaissance, justification, Paris, Vrin, 2005), où il critiquait la définition traditionnelle de la connaissance comme croyance vraie justifiée, en construisant des cas où nous aurions toutes les raisons de penser qu’il s’agit de croyances vraies justifiées, mais où nous hésiterions à, voire refuserions de dire qu’il s’agit de connaissances. Ces contre-exemples ont été acceptés par la communauté philosophe comme montrant que la définition tripartite de la connaissance était, au mieux, insuffisante.