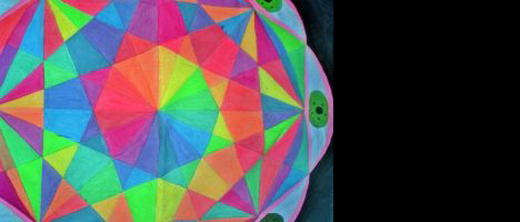L’identité de la personne malade d’Alzheimer face à la métaphore (2)
Cette semaine thématique est organisée en partenariat avec l’Espace national éthique Alzheimer et la revue Implications philosophiques
Les postures du soignant aimant et du soignant pratico-aidant : La vigilance affective et l’historialité ou la maladie d’Alzheimer comme métaphore et devoir d’amitié.
Lire la première partie
Si la personnalité est cyclique, se détériore, s’influence, qu’en est-il du récit qu’elle origine ? Si la mémoire s’efface, l’histoire tombe-t-elle dans l’oubli ?
De l’autonomie comme vigilance affective
à la reconnaissance aimante d’une fidélité historiale

Source : Stock.Xchng
Ce qui distingue la posture institutionnelle des postures aimantes et aidantes que nous allons présenter, c’est leur métaphore de l’autonomie.
Pour la posture instituto-démentielle, le sujet malade d’Alzheimer exprime seulement une autonomie physique et éxécutionnelle. Ce bas degré de l’autonomie le dépersonnifie. En effet, en l’absence d’une autonomie psychique, reste une « autonomie » de l’indifférence qui contribue à mystifier le sujet malade de « zombi ». A l’opposé de ce stigmate, la posture aimante reconnaît une autonomie existentielle qui présente l’homme avec la pathologie et l’ancre dans une histoire commune.
Clairement, d’un point de vue éthique, l’autonomie ne peut se limiter à la question de la compétence car, dans ce cas, l’homme vulnérable, dont les compétences sont réduites, ne serait plus considéré comme autonome. Or, la vie humaine est bruissement d’autonomie. Cette autonomie n’est pas physique ou animale mais attention existentielle, vigilance proprement humaine.
En effet, si la vulnérabilité psychique empêche l’autonomie de pensée et l’autonomie décisionnelle, elle maintient une autonomie affective, une autonomie partielle de volonté puisque le sujet reste en mesure de témoigner de ses préférences [par exemple, alimentaires ou vestimentaires], de vivre selon ses valeurs et convictions[1]. En effet, selon Schopenhauer[2], la volonté ne peut être malade. Elle est toujours en vigilance. Cette attention témoigne non seulement d’une présomption de compétence mais d’une capacité à être autrement. Le sujet malade n’est donc jamais qu’un incapable, il est « autrement capable »[3].
Dans ce cas, le sujet est autonome en ce sens qu’il est encore capable de valoriser. Certains sont aussi capables de continuer à vivre dans la fidélité des valeurs personnelles qui étaient les leurs [sensibilité à une cause spécifique, convictions religieuses, politiques, curiosité artistique, attrait particulier pour un domaine] ou d’en initier de nouvelles [attention portée à la nature]. Souvent, le sujet malade d’Alzheimer est encore capable d’accorder de la valeur à l’autre, de témoigner d’une émotion, d’une attention au monde qui l’englobe. Aussi, il témoigne d’une capacité affective, d’une moralité du sentiment qui permet de lui reconnaître une capacité à l’autonomie et un statut moral. En effet, la moralité n’est pas propre à la rationalité.
La continuité à la fois affective et « morale » [dimension sentimentale] du sujet affecté, seule la bienveillance du soignant peut en juger. C’est, plus spécifiquement, le soignant aimant, qu’il soit un proche ou un membre de la famille, et/ou le soignant amoureux, le ou la conjointe, qui sont seuls en mesure d’évaluer la transformation comme la fidélité morale et affective du sujet. En effet, à la fois spectateur et acteur de son histoire de vie, le regard aimant témoigne de celle-ci autant qu’il restaure la conscience d’être du sujet, la conscience d’être-en-récit. Incapable d’envisager sa vie comme un tout historique et n’ayant plus accès à ses souvenirs, le sujet n’a pas conscience de son propre récit de vie, il a tout au plus le sentiment d’une conviction profonde ou d’une préférence.
Lorsque l’individu n’est plus capable d’établir sa propre continuité narrative, de témoigner d’une fidélité affective à lui-même, lorsque la maladie affecte la personnalité du sujet au point que celui-ci puisse être totalement méconnaissable et ne plus avoir conscience de sa valeur, le regard du soignant aimant permet à lui seul de rétablir son identité personnelle.
En ayant cheminé à ses côtés, en partageant des souvenirs communs, il peut raconter leur histoire. En l’incluant dans son récit de vie, il s’inclut dans le sien et restaure par là même des moments de vie qui, mis bout à bout, reconstituent une partie significative de l’histoire de l’affecté. Même dans le cas extrême où le sujet malade va à l’encontre de ses préférences et principes passés, la posture aimante peut encore reconnaître un récit commun.
Ainsi, la posture aimante ou, plus encore, amoureuse reconnaît au sujet malade, la permanence d’une identité qui s’exprime à travers le récit de l’histoire vécue et partagée. Elle recolle les morceaux éclatés de l’identité en reconnaissant un changement de personnalité en même temps qu’une permanence de l’histoire vécue ensemble. Aussi, elle valorise le sujet qui se dévalorise, identifie le sujet affecté et ancre le sujet égaré en un monde commun. La posture du soignant aimant restaure l’identité personnelle du sujet malade.
Aussi, bien que l’une des composantes de l’identité personnelle soit affectée, la personnalité, la posture aimante considère le sujet malade d’Alzheimer comme une personne. En effet, si la personnalité permet de faire l’histoire [rencontre, tempérament, choix], c’est l’être qui permet d’être en histoire c’est-à-dire de pouvoir faire histoire indépendamment de la capabilité à s’en souvenir. Métaphoriquement, la personnalité est le tuteur de l’être ébranlé. L’identité essentielle est, quant à elle, le terreau qui l’origine et lui permet de se développer.
Si la part identitaire affectée par la maladie d’Alzheimer peut être remémorée à travers le récit et les souvenirs propres à l’aimant, l’identité essentielle demeure là appelant la reconnaissance du tout autre. En effet, la reconnaissance de la capacité de l’« autrement capable » à être historial requiert l’aide d’autrui[4].
De l’aide au soignant aimant
En terre vulnérable, l’écoute, l’entente et le regard portés sont précieux.
A l’opposé de la surdité et de l’aveuglement propre à la posture instituto-démentielle qui se représente immédiatement, sans détour ni profondeur la personne malade et la nie dans son hypostase, il y a la posture aimante.
Mais le soignant aimant n’est pas toujours présent. Toutes les familles ne sont pas solidaires. Certaines sont éclatées, dispersées, oubliées. Tout le monde n’a pas de proches. La solitude et l’isolement sont de véritables maux sociétaux. Aliénante et étouffante, insouciante et individualiste, la société isole. Dans ce contexte, la précarité, qu’elle soit physique, psychique ou financière, exclut et déshumanise.
Aussi, s’il est présent, le soignant aimant n’est pas toujours aidant. Fatigue, angoisse, culpabilité affectent l’aidant aimant. Celui qui ne souhaite pas ou n’est pas en mesure de recourir à une aide extérieure souvent très coûteuse, est continuellement sur le qui vive, pleinement dévoué au sujet malade. Étouffé par la gestion des tâches quotidiennes, la vigilance, la surveillance, le souci de l’être aimé, l’aidant aimant se vulnérabilise.
Souvent, prendre soin de l’autre[5] demande trop à l’aimant. Faire une toilette intime au conjoint malade ou au parent impacte l’intimité jusqu’à la relation aimante. En effet, la maladie affecte jusqu’à l’intimité du couple qui peut éclater à force de déséquilibre entre la posture de l’aimant aidant et de l’aimant dépendant. Parfois aussi, les proches du malade sont eux-mêmes tentés de faire leur deuil avant la mort, incapable d’aimer la personne telle qu’elle semble devenue.
Lorsque l’aimant le souhaite, il peut solliciter des soignant pratico-aidant qui lui viennent en aide et accompagnent le prendre soin du sujet malade.
Sous l’attribution de soignants pratico-aidant, nous regroupons les infirmiers, les paramédicaux (kinésithérapeutes, orthophonistes, psychologues) les médecins généralistes et spécialistes (gériatres, neurologues, psychiatres).
Comment dans la pratique, un soignant peut-il aider le sujet maladie d’Alzheimer ? Comment peut-il prendre soin de celui dont l’historialité, l’identité est affectée alors même qu’il lui est inconnu ? Comment reconnaître une identité à celui qui témoigne d’incohérence ou de démence, à celui qui ne peut raconter son histoire, qu’on ne peut situer dans une histoire ni dans notre histoire personnelle ? Comment reconnaître l’anhistorique et, plus justement, l’ « anhistorial » ?
De l’aide au soignant pratico-aidant
L’importance de la discussion entre les soignants pratico-aidant et les soignants aimant est fondamentale. La reconnaissance d’une méconnaissance de l’être aimé exprimée à travers le récit de l’aimant, promet au sujet malade la mise en regard d’un prendre soin par celui qui ni ne le connaît ni ne le situe.
Si le soignant aimant peut saper son identité en disant qu’il n’est plus le même [en comparaison avec l’avant connu], le soignant pratico-aidant ne peut le justifier, ce dernier lui étant inconnu. Par contre, il peut aller plus loin, adopter une posture institutionnelle et considérer que le sujet malade d’Alzheimer n’est déjà presque plus, ce qui rejoint la mystique du zombi. Pour se prémunir d’une telle fuite du regard, d’une mécanisation du geste et d’une stigmatisation nominale du mal [le Alzheimer], le soignant pratico-aidant doit-il tenir le juste milieu entre la posture institutionnelle qui « zombifie » et la posture aimante qui personnifie toujours déjà le sujet malade ?
Ce juste milieu, s’il en est un, trouverait son expression à travers la formule de « personne potentielle ». En effet, en raison de son émiettement identitaire, le sujet malade se voit parfois attribuer ce qualificatif. Communément attribué au fœtus, ce qualificatif exprime l’être en puissance, en passe de devenir une personne à part entière. Ce qui se fera juridiquement à la condition d’être né vivant et viable[6]. Dans le cas du sujet malade d’Alzheimer, parler de personne potentielle c’est donc considérer qu’il n’est pas une personne à part entière mais une chose signifiante et signifiée. C’est aussi peu justifié puisque le sujet n’est pas en passe de devenir une personne à part entière, rappelons qu’on ne guérit pas d’Alzheimer. Il est, à l’inverse du fœtus, d’abord un être en acte dans une situation actuelle d’Alzheimer potentiellement stagnante ou aggravante. Si du côté du fœtus, on parle d’être en puissance en passe de devenir une personne, du côté du malade, on parle d’être en puissance en passe de devenir une chose inerte cheminant vers la mort. C’est pourquoi, attribué au sujet malade, ce concept est insuffisant, stigmatisant, inadapté et dangereux.
Contre le « potentiel », la posture aimante reconnaît la personne réelle vulnérable c’est-à-dire une personne affaiblie, à la personnalité affectée et transformée dont l’être ébranlé mais toujours en vie reste maintenu dans son historialité. La maladie d’Alzheimer affecte formellement le sujet [ce qui me caractérise aux yeux des autres] mais point ontologiquement.
Aussi, la posture du soignant pratico-aidant ne peut tenir le juste milieu évoqué ci-dessus. Aucun compromis du regard n’est envisageable. L’identité personnelle demeure chez le sujet malade d’Alzheimer. Bien que vulnérable, il est toujours une personne et ce, en vertu de l’herméneutique selon laquelle l’identité essentielle est la partie fondamentale c’est-à-dire le nerf de l’identité personnelle.
Face à la souffrance, la reconnaissance d’« être-avec »
C’est en cheminant sur la voie de la reconnaissance que le soignant pratico-aidant adopte un regard adéquat à la fois médical et amical.
Prendre soin, c’est d’abord se retirer du monde environnant, faire abstraction de ses préjugés et mettre au second plan son savoir général. C’est porter un regard épuré et néantisé des préoccupations quotidiennes. Un regard compassionnel et responsable qui témoigne de la présence du soignant, de sa vigilance et de sa conscience pour ce que vit l’autre souffrant.
La reconnaissance de ce que vit l’autre de l’intérieur ne peut se faire sans qu’il soit considéré comme un tout historique empli d’étapes, d’épreuves, de continuité et de changements.
L’identité du sujet malade d’Alzheimer se pose non seulement en se différenciant des autres qu’il n’est pas mais aussi en se différenciant de celui qu’il était ou paraissait être aux yeux des autres. L’identité de l’être affecté se pose en se différenciant d’elle-même.
C’est en réalité la partie visible de l’identité qui est affectée. La personnalité est la face ouverte sur le monde de l’identité personnelle. Aussi, lorsqu’elle est ébranlée de l’intérieur, l’être représenté s’effondre. Attention, si la personnalité se donne à voir, elle n’en reste pas moins l’expression et l’enveloppe de l’être intime. En effet, la personnalité n’est que la partie visible d’un tronc commun d’humanité qui demeure permanent en soubassement : l’être.
Demeure à la racine de toute différence, un propre que nous partageons en commun.
Bien que différents, nous avons lui et moi en commun le monde dans et par lequel nous sommes, la manière d’être-au-monde, l’origine et l’histoire d’une vie. Bien que différent de ce qu’il était avant, le sujet malade d’Alzheimer a en commun avec soi, la permanence d’un moi qui le pose comme historial indépendamment de la conscience qu’il a de son histoire. L’identité historiale se pose comme une dialectique entre l’ipséité et la mêmeté, entre le soi et le moi que je suis tout à la fois.
Si nous sommes chacun pour soi, nous sommes aussi chacun par l’autre. L’identité est suspendue aux lèvres de l’altérité qui peut, selon le regard porté, la reconnaître aussi bien que l’annihiler. Aussi, le rapport à l’autre est primordial. Et, la manière fondamentale d’être dans le monde pour l’homme est ce que Heidegger appelle le « mit-sein » : être-avec.
« Etre avec les autres » c’est dans la société actuelle « être sous l’emprise des autres ». Cette emprise se traduit sous le pronom impersonnel « on ». Dans cette situation, Heidegger soutient dans Etre et temps que les autres nous empêchent d’accéder à nous-mêmes. On les rencontre là devant, dans la différenciation, la lutte, le rejet. A l’inverse, « être avec les autres » c’est dans l’état de vulnérabilité actuel du malade d’Alzheimer « être grâce aux autres » au sens non pas d’une dépendance vitale sans quoi l’être décèderait mais d’un besoin de reconnaissance historiale sans laquelle le sujet affecté ne pourrait être personnifié et restauré dans son humanité.
La vulnérabilité est bruissement d’être-en-vie, d’être-au-monde, d’être-avec. Le bruissement s’apparente, ici, au cri comme hymne à la vie. Elle est une plainte au sens où Ricœur l’entend c’est-à-dire appel à l’attention, au prendre soin. Le visage est aussi expressif et plaintif. Par lui, le sujet est toujours déjà en relation. Toujours sur le qui vive.
Même si la personne vulnérable n’est plus en mesure d’être un « je », elle reste un « tu ». Plus précisément, un « tu » as la responsabilité morale de me reconnaître en tant qu’être historial, un « nous » aussi [posture aimante] qui s’exprime à travers le récit de notre histoire.
Le regard soignant, par définition, vise la reconnaissance de l’identité de l’être affecté. Mais au cœur de la pratique soignante, il y a une ambivalence. On cherche à comprendre ce qui diffère pour le traiter en même temps qu’on vise à reconnaître l’invariant qui demeure semblable malgré la maladie. Aussi, il y a une difficulté. Si comme le soutient Ricœur l’identité narrative propre à la personne est assurée par la fidélité aux engagements pris vis-à-vis d’un autre, à la promesse tenue ou la parole donnée, qu’en est-il pour le sujet malade d’Alzheimer ? En effet, la difficulté à la fois réflexive et pratique réside dans l’attention à porter à un engagement antérieur, une promesse inactuelle, une parole oubliée. Lorsque l’être est affecté dans son ipséité, comment reconnaître, sous le changement de personnalité et l’oubli du passé, la permanence d’un propre commun, mémoire de l’essentialité ?
Le récit de l’aimant : un « discours » de reconnaissance historiale
Le récit de l’aimant est d’emblée obligeant moralement. Il impose au renoncement d’une tentation mystique de zombification. Aussi, il oblige le soignant à la reconnaissance de l’être affecté comme historial. En situant l’être affecté dans une histoire, qu’elle soit sienne ou celle du narrateur aimant, il humanise en même temps qu’il historialise le sujet malade.
Reconnaître l’historialité du sujet c’est reconnaître qu’il est une personne, un être humain. Tout être humain en acte [étant né vivant et viable] est une personne. Pour être reconnu en tant que tel, l’être en acte doit être là en un ici et maintenant, toujours dialectiquement dépendant de soin mais libre d’être indépendamment d’un autre. Cette dialectique existentielle témoigne du caractère transcendant de l’identité historiale.
L’identité historiale est à la fois charnelle et relationnelle. En tant que chair, l’être « est le sensible au double sens de ce qu’on sent et de ce qui est senti »[7]. N’ayant plus ou quasiment plus de sensibilité physique ou psychique, le sujet vulnérabilisé n’en est pas moins touchant-touché, affectif-affecté, souciant-soucié. La personne n’est autre qu’un être historial-historicisé. Son identité historiale exprime une essentialité qui se définit dialectiquement par une « immanence transcendante » c’est-à-dire un invariant en permanence ouvert sur la mouvance du monde et des autres.
Donc, pour citer Ricœur : « Le personnage conserve tout au long de l’histoire une identité corrélative de celle de l’histoire elle-même […] C’est l’identité de l’histoire qui fait l’identité du personnage »[8]. L’identité qui est la nôtre reste donc toujours la même puisqu’elle reste toujours déjà en liaison avec celle de l’intrigue historiale.
Mise en récit par ceux qui m’entourent, mes faits, mes gestes et mes pensées sont mémorisés, historialisés. Mon histoire personnelle est automatiquement imbriquée dans l’histoire d’un autre. L’histoire n’est jamais solitaire, elle est toujours déjà partagée.
Fort de ce partage, le soignant pratico-aidant doit pour prendre soin, reconnaître cet ancrage historial au sujet atteint de la maladie d’Alzheimer et le préserver. Pour cela, d’un point de vue médical, le récit de l’aimant est aidant puisqu’il précise le profil psychologique et historique du patient. D’un point de vue moral, le récit de l’aimant est obligeant puisqu’en présentant l’être affecté dans son historialité, il s’ajoute à l’exigence du regard et du visage.
Du parler originel et libre à la vigilance compassionnelle
En effet, déjà, le visage de l’autre éveille notre attention.
Aussi, le visage de l’autre vulnérable demande notre compassion.
La compassion est ce qui nous rend témoin de la souffrance d’autrui. Littéralement, selon le regard porté, elle exprime soit le partage soit l’apitoiement. Lorsque la vulnérabilité de l’autre est reconnue et nous éveille à la conscience d’une vulnérabilité commune, elle témoigne d’un partage, d’une disposition à l’empathie et, plus encore, d’une disposition ontologique à la sympathie. A l’inverse, l’apitoiement témoigne du maintien à distance de l’autre en souffrance. C’est à travers le jugement porté que s’exprime cette posture de protection de soi-même et de négation à la fois de ce que vit l’autre et de ce que nous avons en commun.
Or, la compassion a une dimension morale que n’a pas la pitié. Elle est d’emblée dénuée de préjugés et de représentations. Elle est une pure coprésence qui engage un « jeu de regards » à travers un effet de miroir. Le regard de l’autre me rend responsable de sa vie en m’imposant ce vis à vis. Donc, la compassion témoigne d’une amitié pour l’être affecté et traduit un sentiment de bienveillance vis à vis de sa souffrance. La compassion est vigilance. Aussi, la vigilance compassionnelle est espérance.
Par définition, l’être humain est dialectiquement être de soin et soignant.
Le prendre soin relève de notre ontologie. Nous sommes authentiquement dans le souci de l’autre. A travers cette posture qui nous concerne tous indépendamment de nos connaissances personnelles, qui est donc non proprement aimante mais « humaine », la vulnérabilité se révèle néantisante et humanisante. Elle n’est pas qu’une limite de potentialité mais action de néantiser le monde qui l’entoure pour se trouver en soi-même, action d’éprouver sa libre humanité. En cela, elle est témoignage intérieur permanent, forme d’autonomie première ou liberté transcendantale. Le mal lui-même ressortit à une problématique de la liberté. Il est lié au cœur du sujet, lié à l’énigme d’un surgissement intérieur et intime. Il est interpellation de ma liberté, puisement de ressources inédites, révélation de mes possibles.
Selon Levinas, la visée du soin est une visée de restitution du pouvoir être. Elle cherche à rétablir une forme d’autonomie première, toujours présente sur fond d’absence.
L’alliance thérapeutique, la conquête éthique
Que l’identité d’être constitutive de l’existence humaine soit assumée par la posture soignante [reconnaissance de sa libre permanence] ou niée par le regard instituto-démentiel [mauvaise foi], elle n’en demeure pas moins présente et invariante.
Tragiquement, la mauvaise foi fait foi dans l’Institution. Heureusement, la conscience du juste et du vrai demeure au cœur de notre sensation affective et s’exprime sous la forme de ce que nous qualifions la vigilance compassionnelle.
D’un côté, l’institution permet de poser un cadre d’accompagnement strict mais tend à nier ou réifier le sujet malade d’Alzheimer en recourant au stigmate de la mystification. De l’autre, le soignant aimant permet d’ancrer l’être affecté au sein d’une histoire vécue commune mais peut aussi s’embourber dans sa propre souffrance qui fait face à la violence du changement de l’être aimé jusqu’à pouvoir, dans certains cas, encourager sa propre zombification pour soulager sa peine.
Donc, étant mise en place au sein d’une institution, la pratique du soin, qui relève quant à elle d’une formation médicale, peut être influencée dans sa façon de concevoir et d’accompagner la maladie. Sans le récit de l’aimant toujours déjà aidant, le soignant pratico-aidant peut se laisser plus aisément porter par l’influence du regard instituto-démentiel. Bien qu’il soit d’abord un être de souci, il est aussi un socius. Si il est par nature disposé au soin, il doit parvenir, au sein d’un milieu institutionnel exigeant et avec le récit de l’aimant, à trouver un équilibre toujours précaire, toujours à conquérir. C’est l’équilibre entre deux postures «extrêmes », aimante ou amoureuse d’un côté, indifférente ou non soucieuse de l’autre. L’une implique le sacrifice, l’autre, le rejet. Entre ces deux, la posture du soignant pratico-aidant doit tenter par un saut métaphysique de tenir le juste milieu en adoptant une posture à la fois amicale et soucieuse. C’est en travaillant sur le lien que la posture de l’accompagnement soignant s’acquiert. C’est en cheminant vers une constellation de ces trois postures narratives que sont le « Il » [l’institution], le « Tu » [l’autre quel qu’il soit], le « Nous » [le soignant aimant, l’histoire commune] autour du « Je » affecté [sujet malade d’Alzheimer] que l’on permet l’inscription dans une histoire.
Seule une alliance des postures, preuve de sagesse éthique et pratique, peut s’avérer thérapeutique et rendre possible une résilience qui n’est autre que la traduction positive de la vulnérabilité.
La résilience ou la révélation du secret sur fond de pudeur
La résilience reconnaît la liberté, la « capabilité » de l’être affecté à s’ouvrir vers d’autres possibles. Elle exprime une « autre allure de la vie »[9]. La reconnaissance de cette dynamique rompt avec toute tentation de zombification.
Au travers de sa vulnérabilité, l’être est toujours en train de se déployer. Il est ce que Heidegger nomme le « wesen » c’est-à-dire l’être se présentifiant.
L’historialité déborde de sa vulnérabilité. L’histoire n’est pas annihilée par la maladie d’Alzheimer. L’histoire n’est pas cognitive. La mémoire s’efface et l’histoire s’oublie. S’il y a déchirement mémoriel, l’histoire n’est pas perdue ou effacée, elle est oubliée. S’ajoute à cet oubli, l’oubli institutionnel porté par une posture amnésique de survol.
A croire que l’identité historiale d’une personne relève uniquement de sa capacité à faire, à penser ou se remémorer, on tombe dans l’oubli [superficiel] de l’oubli [historial]. Or, gît au fond de l’oubli historial, une pudeur au parler originel. La pudeur dit toujours quelque chose. L’oubli n’est jamais que retrait.
En soubassement du retrait historial, qui relève de l’effacement mémoriel, demeure intacte la présence du secret attentionnel. En effet, au fond de l’oubli historial dont souffre le sujet malade d’Alzheimer, la vigilance émotionnelle se renverse en mémoire. Les capacités affectives, émotionnelles et relationnelles persistent sans être forcément perceptibles. Il y a toujours un déploiement sur fond de pudeur de la capacité à aimer.
Reconnaître cette pudeur de l’attention, c’est occuper une posture qui laisse être [gelassenheit], qui laisse se déployer la vérité de la situation c’est-à-dire l’effacement mémoriel en même temps que l’invariance historiale qui demeure en retrait en deçà de l’oubli.
« Notre exil [mnésique] est lui-même l’expression d’une pudeur, c’est une forme de marche vers l’origine qui implique en elle-même un détour. Ce n’est pas une marche directe mais une marche détournée, circulaire [plaintive au sens ricoeurien du terme] qui aspire d’abord à l’extrême dépaysement [méconnaissance, maladie], aspiration qui est voie d’initiation au secret [permanence de l’historialité propre à l’essentialité humaine] »[10].
La difficulté métaphysique posée par le sujet malade d’Alzheimer apparaît ici. Il est un fait, l’homme habite toujours déjà historialement le monde. Exilé, l’homme n’est jamais « ontologiquement » perdu puisqu’il est toujours déjà en route vers chez lui. Ce retour à demeure lui permet d’habiter le monde tel que l’entend Heidegger c’est-à-dire en ayant conscience de la vérité de sa condition d’être mortel. Or, comment sortir de l’exil et retourner à demeure lorsque la conscience de soi est affectée ? Comment le sujet malade d’Alzheimer peut-il encore habiter le monde ?
L’angoisse comme métaphore de l’être-en-récit et du faire récit
Le sujet malade perd progressivement la conscience du temps, des lieux, des dates, des visages, des noms etc., en même temps qu’il perd conscience de lui-même. A côté de cette déchéance, demeure le sentiment de vie et de mort. L’angoisse de solitude et de finitude anime encore le sujet malade. Pour l’existentialisme, l’angoisse est une expérience fondamentale et proprement humaine puisqu’elle interroge le sens de la vie, de notre existence au monde et du néant environnant.
Pour Heidegger, l’angoisse exprime notre être-au-monde. Elle est saisie du néant, témoignage de liberté et d’« ouvertude » du Dasein [l’être-là, le soi] vers le propre, vers le moi. Éprouver de l’angoisse permet la découverte authentique du monde comme monde[11]. Cette « capacité » témoigne de la vitalité du sujet et de son ancrage en un monde vécu.
Plus précisément, « L’angoisse devant la mort est angoisse « devant » le pouvoir-être le plus propre. […] Ce devant-quoi s’éveille cette angoisse est l’être-au-monde lui-même »[12].
L’angoisse devant la mort du sujet malade d’Alzheimer n’est de toute évidence pas la peur du décès [objet insaisissable consciemment], elle est abyssale et relève du sentiment d’être en un monde avec l’autre vers la mort.
L’être affecté par la maladie d’Alzheimer est l’« être-jeté-vers-sa-fin ». Heidegger n’entend nullement par là une fin ontique du type fin de la mémoire ou fin de la capacité à se mettre en récit et à se reconnaître à travers le récit d’un autre. Il comprend la fin en un sens ontologique c’est-à-dire la mort, la fin de tout récit personnel, la fin d’écriture de mon histoire. Quand le sujet ne sera plus là, seul persistera le récit de lambeaux propres à mon histoire, celui-là même que d’autres raconteront et qui me remémorera. Seul subsistera au « il est » préalable et que nous nous sommes attachés à présenter, le « il a été » remémoriel.
« Nous racontons des histoires parce que finalement les vies humaines ont besoin et méritent d’être racontées. Cette remarque prend toute sa force quand nous évoquons la nécessité de sauver l’histoire des vaincus et des perdants. Toute l’histoire de la souffrance crie vengeance et appelle récit » [13].
Du temps de vie comme du temps de mort, la fidélité que nous devons aux malades d’Alzheimer est narrative et historiale. Lui reconnaître une identité, c’est l’intégrer dans une communauté historiale, ma communauté historiale, le restituer dans son humanité, mon humanité.
L’identité du sujet malade d’Alzheimer ou l’appel à la reconnaissance amicale historiale
En soubassement de tout changement, il y a donc subsistance d’un lien historial existentiel et identitaire. De ce point de vue, la ressemblance et, à l’inverse, la méconnaissance ne sont pas des critères d’identité. La méconnaissance est toujours déjà co-naissance. Elle témoigne du maintien dans le changement de la promesse d’être autrement capable [identité qualitative], d’être-autrement-au-monde toujours Homme en vie [identité spécifique, existentiale, historiale]. C’est au nom de cette permanence que l’homme autrement capable et transformé par accident appelle une posture de l’accompagnement qui prenne soin de son ispéité et qui fasse sens de sa mêmeté. C’est-à-dire une posture qui prenne garde de son identité personnelle et qui saisisse “ une forme de permanence dans le temps qui apporte une réponse fiable à la question ‘Qui suis-je?’21 ”.
Notre herméneutique du sujet malade d’Alzheimer trouve cette réponse du côté de l’historialité indépendamment de toute aptitude mnésique. L’historialité dit le « maintien de soi » c’est-à-dire la promesse tenue d’être en un monde avec l’autre vers la mort. Et cette identité reconnue engage une éthique de l’attestation historique [je me souviens qu’il a été malade (mnésique)] et, plus encore, de l’attestation historiale [je me souviens qu’il était encore en vie, en récit et faisant récit (mémorial)]. Ainsi, historialiser l’être, c’est lui reconnaître l’humanité, l’ancrage en en un monde avec l’autre vers la mort. Plus qu’une existence narrative, le sujet malade d’Alzheimer a une vigilance narrative. Le sujet affecté continue d’écrire son histoire. Malgré le changement de style, l’intrigue demeure identique. Si il n’est plus en mesure de la raconter, il a pu la raconter, la partager, en témoigner et cette dimension sociable et soucieuse de l’histoire m’ancre dans la communauté de l’histoire humaine que traduisent les synonymes d’historialité et d’humanité.
Sans la reconnaissance de cette historialité, aucune posture ne peut éthiquement s’engager. Donc, toute alliance de postures ne sera éthique qu’à la condition d’ouvrir les yeux, de tendre la main et d’ouvrir le cœur. La reconnaissance de l’identité du sujet malade d’Alzheimer passe par la main tendue, à la fois geste amical et chair du panser. Aussi, l’éthique engage une posture de l’amitié. La maladie d’Alzheimer apparaît comme une provocation à penser plus [reconnaissance amicale historiale] pour panser autrement [prendre soin]. Tout être capable de se remémorer et de se raconter a une identité éthique qui l’oblige historialement à tendre la main.
Nous avons montré comment la métaphore de la maladie engage une posture de l’accompagnement qui affecte la métaphore de l’identité de la personne malade. Sans perdre de vue que si nous sommes tentés de faire de l’identité un concept qui accepte la métaphore, nous ne pouvons méconnaître essentialement, amicalement, historialement, la permanence d’un fond identitaire commun d’humanité qui, comme le visage Lévinassien, perdure dans sa vérité au cœur même de l’urgence et insolence des années, déclin de la beauté et rides de l’âge.
Auteur : Laura LANGE, doctorante en Philosophie, Chargée de mission à l’Espace Ethique Rhône-Alpes.
Co-auteur : Nicolas Kopp, Professeur de neuro-pathologie, Membre du Conseil Scientifique de l’Espace Ethique Rhône-Alpes, Coordonnateur du groupe de travail thématiques « Neuro-Ethique ».
Ce travail a été développé par Laura Lange dans le cadre de ses missions au sein de l’espace éthique Rhône-Alpes dirigé par le Professeur François Chapuis, comme de base de réflexion aux membres des groupes de travail thématiques « Neuro-Ethique » coordonné par le Professeur Nicolas Kopp, et « Vulnérabilité » coordonné par le Docteur Pascale Vassal.
Bibliographie :
– CANGHUILEM Georges, Le normal et le pathologique, Presses Universitaires de France – PUF, 31 janvier 2005.
– DESCARTES René, Discours de la méthode, Éditions Flammarion, 2000.
Méditations métaphysiques, Éditions Fernand Nathan, 2009.
– DURAND Guy, Introduction générale à la bioéthique. Histoire, concepts et outils. Montréal Fides 2005 ‘Des défis page 71.
– FLEUR Michel, Handicap mental : crime ou châtiment, Presses Universitaires de France – PUF, 18 mars 2009.
– FOUCAULT Michel, Les machines à guérir, Mardaga, avril 1995
– HAAR Michel, Le chant de la terre, Éditions de l’Herne, 1985.
– HEIDEGGER Martin, Être et temps (1976), §26, éditions Gallimard, Paris, 1986.
– KOPP Nicolas, PIERRON Jean-Philippe, THOMAS-ANTÉRION, Catherine, RÉTHY
Marie-Pierre, Alzheimer et autonomie, Paris, Les Belles Lettres, 2010.
– LEVINAS Emmanuel, Altérité et transcendance, préf. de Pierre Hayat, Éditions Fata morgana, 1995.
Ethique et infini, Éditions Fayard, 1982.
Le temps et l’autre, Éditions Presses universitaires de France, 1983.
Totalité et infini, La Haye, Éditions Martinius Nijhoff, 1961.
– MAISONDIEU Jean, Le crépuscule de la raison, comprendre, pour les soigner, les personnes âgées dépendante, Bayard Culture, Essais, 2001.
– MERLEAU PONTY Maurice, Le visible et l’invisible, Editions Gallimard, Paris, 1964.
– RICOEUR Paul, Du texte à l’action, Points (Seuil), 1998.
Le mal, Un défi à la Philosophie et la théologie, Edition Labor et fides, 2004.
La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil, 2000.
Parcours de la reconnaissance Trois études, Paris, Stock, 2004.
Soi-même comme un autre, Seuil, Poche, 1996.
Temps et récit 1. L’intrigue et le récit historique, Paris, Éditions du Seuil (coll. Points essais), 1983.
« Devenir capable, être reconnu », revue Esprit, n°7, juillet 2005.
« Le socius et le prochain », revue Esprit, 1954.
– SCHOPENHAUER, Le Monde comme volonté et comme représentation, Gallimard, 2009.
[1] Référence à l’analyse de la philosophe américaine Agnieszka JAWORSKA.
[2] SCHOPENHAUER Arthur, Le Monde comme volonté et comme représentation, Gallimard, 2009.
[3] FLEUR Michel, Handicap mental : crime ou châtiment, Presses Universitaires de France – PUF, 18 mars 2009.
[4] RICOEUR Paul, Parcours de la reconnaissance Trois études, Paris, Stock, 2004.
[5] Posture du care.
[6] Déclaration des droits de l’Homme de 1789 sous la formule « Les individus naissent et demeurent libres et égaux».
[7] MERLEAU PONTY Maurice, Le visible et l’invisible, Editions Gallimard, Paris, 1964, p.313.
[8] RICOEUR Paul, Soi-même comme un autre, Seuil, Poche, 1996, p.169-174, p.175.
[9] CANGHUILEM Georges, Le normal et le pathologique, Presses Universitaires de France – PUF, 31 janvier 2005.
[10] HEIDEGGER Martin, Être et temps (1976), §26, éditions Gallimard, Paris, 1986.
[11] « S’angoisser c’est découvrir originellement et directement le monde comme monde », Etre et temps, paragraphe 50.
[12] RICOEUR Paul, Temps et récit 1. L’intrigue et le récit historique, Paris, Éditions du Seuil (coll. Points essais), 1983, p.17.
[13] RICOEUR Paul, Soi-même comme un autre, Seuil, Poche, 1996.