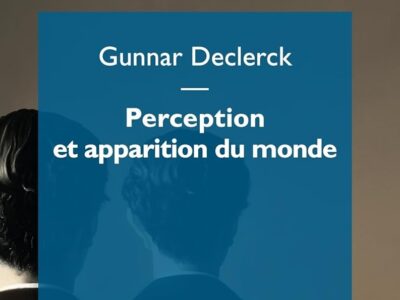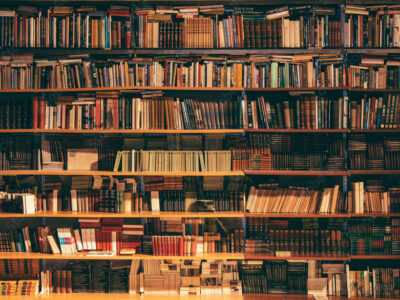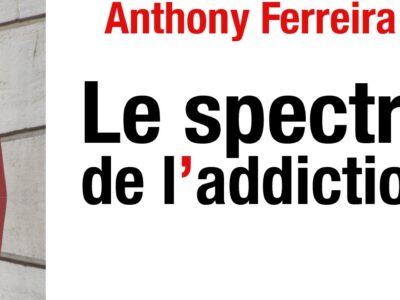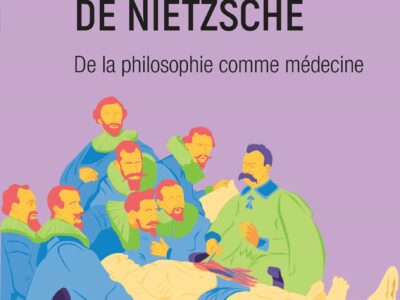Recension — Le sexe du savoir
Romain Vielfaure est normalien, agrégé de philosophie et doctorant (Université Paris Nanterre, laboratoire Sophiapol) sous la co-direction de Judith Revel et François Cusset. Sa thèse porte sur la réception des auteurs structuralistes et poststructuralistes français chez Judith Butler et Gayatri Spivak, et le conduit à forger le concept de complicité pour qualifier la particularité de la réception critique de la pensée française par les études de genre et postcoloniales.
Le Sexe du savoir, Michèle Le Dœuff, ENS Éditions, Lyon, France, 2023
L’ouvrage est disponible ici.
Le sexe du savoir, ouvrage de Michèle Le Dœuff publié pour la première fois en 1998 et paru en poche en 2002, fait l’objet d’une réédition aux Éditions de l’ENS de Lyon. Cette nouvelle édition, enrichie d’une postface de Léa Védie, contribue à rendre justice à l’importance de la pensée de Le Dœuff. Les thèses de l’autrice féministe française, qui se situent à l’orée de la troisième vague féministe (les études de genre apparaissant aux États-Unis au tournant des années 1990), ont en effet paradoxalement connu une plus grande audience dans les pays anglophones qu’en France. Une des raisons de cette minimisation française de la pensée de Le Dœuff tient sans doute au caractère atypique de son écriture pour le paysage universitaire français, « écriture volontairement marginale » note Léa Védie (p.295), notamment en ceci qu’elle alterne souvent études de textes philosophiques canoniques et anecdotes plus personnelles. Néanmoins, ce pas de côté formel ne doit pas mener à mettre de côté la rigueur analytique et conceptuelle de l’ouvrage, d’une grande fécondité. Dans la lignée de L’Imaginaire philosophique (1980) et L’Étude et le Rouet (1989), cette étude marque en effet la continuation de la mise en lumière de la « clôture masculine du savoir » (p.156).
 En introduction, Le Dœuff repart d’un ensemble de questionnements portant sur les rapports des femmes aux sciences. Alors même qu’en 1998 un tiers des scientifiques sont des femmes, l’autrice indique que la légitimité de leur accès au savoir est toujours remise en question. De même, la question de la place des femmes dans l’histoire des sciences et de la philosophie est encore le lieu de trop nombreux débats, et toute une partie de l’ouvrage est consacrée à l’étude de la pensée de philosophes femmes dont la portée a longtemps été minorée ; on note ainsi dès l’introduction la mise en avant d’une philosophe comme Christine de Pisan. Si Le Dœuff s’attaque à un certain nombre de résistances quant à l’accès des femmes aux sciences, elle bat également en brèche l’idée mise en avant par certaines féministes (parmi lesquelles Lorraine Code [1]) selon laquelle il y aurait une spécificité du rapport des femmes à la science. On a en effet pu défendre l’accès des femmes à la science via l’utilisation de traits essentialisants, par exemple en affirmant que l’empathie constitutive des femmes les mènerait à des découvertes scientifiques dont les hommes seraient incapables. Cet ensemble de questionnements est fondamental pour la philosophe, car il est au fondement d’un imaginaire, c’est-à-dire de représentations sur le travail scientifique ayant des conséquences réelles sur celui-ci. Or, un imaginaire scientifique exclusivement masculin peut avoir des conséquences désastreuses, et l’autrice met particulièrement en avant l’auto-censure des femmes désirant être scientifiques.
En introduction, Le Dœuff repart d’un ensemble de questionnements portant sur les rapports des femmes aux sciences. Alors même qu’en 1998 un tiers des scientifiques sont des femmes, l’autrice indique que la légitimité de leur accès au savoir est toujours remise en question. De même, la question de la place des femmes dans l’histoire des sciences et de la philosophie est encore le lieu de trop nombreux débats, et toute une partie de l’ouvrage est consacrée à l’étude de la pensée de philosophes femmes dont la portée a longtemps été minorée ; on note ainsi dès l’introduction la mise en avant d’une philosophe comme Christine de Pisan. Si Le Dœuff s’attaque à un certain nombre de résistances quant à l’accès des femmes aux sciences, elle bat également en brèche l’idée mise en avant par certaines féministes (parmi lesquelles Lorraine Code [1]) selon laquelle il y aurait une spécificité du rapport des femmes à la science. On a en effet pu défendre l’accès des femmes à la science via l’utilisation de traits essentialisants, par exemple en affirmant que l’empathie constitutive des femmes les mènerait à des découvertes scientifiques dont les hommes seraient incapables. Cet ensemble de questionnements est fondamental pour la philosophe, car il est au fondement d’un imaginaire, c’est-à-dire de représentations sur le travail scientifique ayant des conséquences réelles sur celui-ci. Or, un imaginaire scientifique exclusivement masculin peut avoir des conséquences désastreuses, et l’autrice met particulièrement en avant l’auto-censure des femmes désirant être scientifiques.
Dans le premier chapitre, Le Dœuff étudie comment deux modes de connaissance ont peu à peu été associés à deux sexes différents. Son geste premier est de rappeler que l’opposition entre rationalité masculine et intuition féminine n’existe pas de toute éternité, mais est au contraire historiquement située. Ainsi, chez des auteurs comme Descartes (notamment dans les Règles pour la direction de l’esprit), l’intuition a longtemps été considérée comme un mode important de connaissance, susceptible de s’articuler aux autres et pouvant même être considéré comme le parachèvement du processus de connaissance. Cependant, elle a lentement été reléguée au rang de mode de connaissance inférieur. Le Dœuff associe au Rousseau de l’Émile les premières dépréciations de l’intuition, sans pour autant qu’elle soit déjà jugée féminine. C’est la reprise de cette marginalisation de l’intuition dans le processus de connaissance par les romantiques allemands puis par Hegel dans la Phénoménologie de l’esprit qui aurait abouti à sa féminisation. Cette étude permet à la philosophe féministe de tirer la conclusion suivante : c’est parce que l’intuition était considérée comme sans intérêt qu’elle a été associée aux femmes. Une stratégie féministe qui consisterait à accorder à nouveau une place centrale à l’intuition dans le but de valoriser les femmes serait un échec, notamment parce qu’on courrait le risque d’un renversement : une fois l’intuition remise au goût du jour et la raison décriée, certains philosophes pourraient céder à la tentation d’allier désormais femmes et raison. C’est par exemple ce que fait Schopenhauer dans Le Monde comme volonté et représentation selon Le Dœuff. Penser résoudre le problème en redonnant ses lettres de noblesse à un type de connaissance particulier mène donc inévitablement à une impasse, le geste masculiniste inaugural consistant toujours à associer le type de connaissance le plus déprécié, quel qu’il soit, à la féminité.
Cette relecture du concept d’intuition dans l’histoire de la philosophie conduit également Le Dœuff à mettre en lumière la fécondité des écrits de la philosophe Gabrielle Suchon (1631-1703), en particulier le Traité de la morale et de la politique. Entre intuition et raison, Suchon emploie en effet le terme de « science infuse », définie comme un don de Dieu qui permettrait à certaines personnes, hommes comme femmes, d’avoir un accès privilégié à la science. Non seulement ce concept a permis à la philosophe d’affirmer « l’égalité cognitive des sexes dans l’inégalité des personnes » (p.33), mais il la conduit également à affirmer la possibilité voire la nécessité de l’autodidactisme des femmes scientifiques. Puisque ces dernières ont la science infuse, elles n’ont pas besoin de maître à penser, mais doivent de toute nécessité avoir un « accès personnel aux textes » (p.65).
Le Dœuff propose ensuite de relire des philosophes traditionnellement associés au masculinisme ou au féminisme, et de nuancer ces positions. Ainsi, si Poullain de la Barre (1647-1723) peut être considéré comme un penseur de l’égalité entre les sexes, il convient de mettre en avant l’absence de théorie du lien entre savoir et pouvoir dans son œuvre, absence qui rend impossible l’établissement d’une pensée solide de l’égalité d’après l’autrice puisqu’elle l’empêche de questionner l’accès des femmes au savoir. Inversement, si Platon est traditionnellement considéré comme un philosophe qui exclut les femmes de toute pensée philosophique, Le Dœuff constate que l’on a trop peu souligné que « La République reconnaît que des femmes peuvent être philosophes et participer, comme Gardiennes, au gouvernement de la Cité. » (p.79). Ces observations conduisent l’autrice à remarquer le fait que, pendant des siècles, les commentateurs de La République ont minimisé ces passages, voire les ont modifiés, Léon Robin refusant par exemple de traduire littéralement « femme philosophe ». L’étude précise des textes mène par conséquent l’autrice à observer la place particulière conférée par Platon aux femmes philosophes : certes, il affirme qu’elles existent ; « mais ensuite il ne fait jouer cette possibilité que dans la Cité idéale. » (p.82). On note ici comment l’introduction de problématiques féministes conduit la philosophe à relire l’histoire de la philosophie à nouveaux frais : « L’accès de femmes à l’enseignement de l’histoire de la philosophie a donc au moins l’excellent effet d’arracher à l’oubli des passages de vieux textes qui, bien que toujours réimprimés, n’ont jamais été proprement discutés. » (p.79). Cette relecture, bien qu’elle ait eu lieu en 1998, reste d’actualité plus de vingt ans plus tard, et mène le lecteur à considérer que les programmes scolaires de philosophie comportent encore très peu d’autrices, et que l’enseignement d’auteurs canoniques comme Platon ne prend toujours pas en compte ces considérations.
Le deuxième chapitre de l’ouvrage est le lieu de développements sur le Moyen-Âge et la Renaissance. L’étude féministe de l’histoire conduit Le Dœuff à repenser les bornes historiques elles-mêmes. En effet, elle avance que l’une des caractéristiques fondamentales du Moyen-Âge, contrairement à l’Antiquité et la Renaissance, est l’impossibilité totale pour les femmes d’accéder au savoir. Certes, l’immense majorité des femmes n’y avaient pas accès non plus durant ces deux autres périodes ; pourtant, il existait ce que l’autrice qualifie d’ « épiclérat lettré » : certaines femmes pouvaient hériter du patrimoine économique et culturel de leur père lorsqu’elles n’avaient pas de frère. Cet usage paraît disparaître après l’assassinat d’Hypatie en 415 à Alexandrie, puis resurgit au XVème siècle avec Christine de Pisan. L’autrice propose par conséquent de faire de ces deux dates celles du terme de l’Antiquité et du commencement de la Renaissance, moment à partir duquel on peut observer « l’Europe fourmiller de dames et de petites bourgeoises “nourries aux lettres” » (p.162).
Ce travail de réhabilitation conduit à nouveau la philosophe à relire des ouvrages canoniques, et à observer comment de nombreux philosophes ont pu demeurer aveugles au réel lorsqu’ils prenaient les femmes pour objet. L’autrice propose ainsi le concept d’acognition masculine pour rendre compte du phénomène qui pousse des hommes savants à opérer un déni de réalité à propos des femmes. Il en va par exemple de Spinoza qui, prétendant s’appuyer sur l’expérience, avance dans son Traité politique que les femmes ne peuvent diriger et que cela ne s’est jamais vu, alors même qu’Élisabeth d’Angleterre, Marie Stuart ou Christine de Suède avaient déjà régné. Le Dœuff s’intéresse également à tous les commentateurs de Spinoza, et s’étonne du fait qu’elle soit la première à s’intéresser à cette erreur manifeste. Ce déni de réalité n’est donc pas à penser comme l’erreur d’un homme seul, mais comme un aveuglement systématique face aux données historiques concernant les femmes. L’autrice s’adonne ensuite à une lecture similaire du Hegel des Principes de la philosophie du droit. Si Hegel reconnaît l’existence de femmes souveraines, il nie leur capacité à être de bonnes gouvernantes. Là encore, l’autrice prend un certain nombre d’exemples comme le règne de Marie-Thérèse en Autriche, pour montrer que cela est factuellement erroné, et note qu’aucun commentateur ne s’est étonné d’une telle assertion, que l’expérience contredit pourtant. Le concept d’acognition masculine paraît ici prendre tout son sens, en ceci qu’il met en lumière un continuum d’aveuglement masculin, y compris dans l’université contemporaine.
Le troisième et dernier chapitre de l’ouvrage s’ouvre sur la réaffirmation par Le Dœuff de son statut singulier dans la recherche féministe. Si elle étudie l’épistémologie en féministe, elle prend en effet ses distances avec le courant de la feminist epistemology (et notamment vis-à-vis de Carolyn Merchant [2]). Une nouvelle fois, ses réserves tiennent aux réflexes essentialisants qui parcourraient les thèses de ce courant d’après l’autrice. Elle reproche également à ces études d’oublier un certain nombre de données matérielles au profit d’un point de vue trop théorique et général : il faudrait plutôt « s’occuper directement de la sociabilité scientifique, des conditions de recrutement dans les laboratoires ou des discriminations au quotidien de la vie scientifique, aujourd’hui comme hier. » (p.196-197).
La singularité de cette position critique par rapport à la feminist epistemology conduit l’autrice à mettre en doute certaines lectures féministes d’auteurs canoniques. Elle revient sur la position défendue par Evelyn Fox Keller [3] à propos de Francis Bacon (dont Le Dœuff connaît particulièrement bien la pensée, pour avoir écrit sa thèse de doctorat à son sujet), position selon laquelle les idées virilistes de Bacon seraient au fondement de toute son épistémologie. Elle nuance fortement cette idée, qui s’appuierait sur des contresens de lecture. La philosophe en profite pour rappeler une distinction conceptuelle entre masculin et masculiniste, distinction déjà à l’œuvre dans L’Étude et le Rouet : une science masculine serait une science exclusivement constituée par des hommes ; elle deviendrait masculiniste si ceux-ci refusaient d’y intégrer les femmes. Les sciences traversées par des représentations masculinistes seraient aujourd’hui encore le lieu de ce que l’autrice appelle un « déni de mixité » : « il consiste à évoquer ou représenter un groupe, une communauté, un corps, de fait plus ou moins mixte, comme s’il était masculin en son entier et en son essence. » (p.227).
Le Dœuff s’intéresse ensuite longuement à la pensée d’un des auteurs que la tradition philosophique a pu retenir comme étant particulièrement ouvert à l’idée d’une égalité entre hommes et femmes : John Stuart Mill. Elle remarque que, lorsque la pensée de Mill sur les femmes est étudiée, le rôle de Harriet Taylor n’est quasiment pas mentionné. Taylor, philosophe et poète, a été la femme de Mill, et a écrit bien avant lui sur la même question. Elle est sans doute la personne qui a eu la plus grande importance dans la formation de la pensée de Mill. De l’aveu de Mill lui-même, plusieurs chapitres de De la liberté ont ainsi été coécrits avec elle. L’autrice dénonce à nouveau l’approche de nombreux commentateurs qui non seulement ont minimisé le rôle de Taylor, mais sont parfois allés jusqu’à affirmer que Mill se trompait lorsqu’il reconnaissait l’importance de sa femme dans l’élaboration de sa pensée. L’absence d’étude approfondie des liens philosophiques entre Taylor et son mari a également empêché de montrer en quoi la première a pu être l’autrice d’idées novatrices qui résistèrent au second, par exemple la thèse selon laquelle il était nécessaire de reconnaître et d’encourager la capacité d’initiative politique des femmes [4]. Mill semble ainsi avoir repris nombre d’idées de Taylor tout en édulcorant leur radicalité.
La comparaison que fait Le Dœuff entre les thèses de Taylor et celles de son mari lui permet de tirer certaines conclusions sur la notion même d’égalité, et son rapport à la différence. L’autrice prend ainsi ses distances avec le concept de différence au profit de celui de divergence. Celui-ci, plus fin et mouvant, autorise par exemple à penser dans certains cas non pas une différence entre hommes et femmes, mais une divergence entre les femmes elles-mêmes. Ainsi, l’analyse des élections de 1988 en France tend à montrer que, si le vote des hommes et des femmes au foyer a été sensiblement le même, celui des femmes ayant un emploi a divergé de ces deux groupes. Loin de mener à une identité, l’égalité entre les hommes et les femmes, ayant pour conséquence une plus grande indépendance de ces dernières, conduit donc à instaurer « une condition minimale de divergence » (p.279), et Le Dœuff conclut en avançant que le renforcement de cette condition minimale de divergence devra être assuré à l’avenir.
Le sexe du savoir constitue ainsi une importante mise en lumière de la clôture masculine du savoir, et fait apparaître l’immense richesse de la pensée de femmes philosophes longtemps oubliées. On pourra certes juger que cette relecture passionnante de l’histoire de la philosophie conduit parfois Le Doeuff à relire très sévèrement certains philosophes. Ainsi, Jacques Derrida, que Michèle Le Doeuff a rencontré dans les années 1970 [5], est qualifié dès l’introduction de « collègue qui n’a pas pris le temps de se renseigner » (p.10), et est considéré, à partir d’une lecture rapide d’Éperons, de philosophe anti-féministe. Or, il semble justement que cela soit une position que, dans cet ouvrage, Derrida prête à Nietzsche tout en prenant ses distances avec celle-ci, et avec le phallogocentrisme en général. L’autrice paraît considérer certains passages dans lesquels Derrida résume la pensée anti-féminine de Nietzsche comme des moments d’affirmation de thèses derridiennes. Cette lecture très hétérodoxe de Derrida surprendra sans doute d’autant plus si l’on considère que Le sexe du savoir a été écrit à la fin des années 1990, décennie au cours de laquelle les études de genre états-uniennes se sont fortement positionnées par rapport à cet auteur, en incorporant un grand nombre de ses idées [6].
Il n’en demeure pas moins que la lecture du sexe du savoir constitue un immense rappel du vaste travail historique à mener, et de l’importance de celui-ci pour les générations à venir de femmes scientifiques. Seule une lecture méticuleuse de l’histoire des sciences et de la philosophie permet d’un côté de mettre au jour les différents regards masculins, dénis de réalité et de mixité qui forment la clôture masculine du savoir, de l’autre de mettre la lumière sur les femmes de science méconnues, et ainsi d’ouvrir les sciences à une plus grande égalité, de telle manière que le savoir ne soit plus réservé à un seul sexe.
[1] Notamment dans L. Code, What can she know? Feminist Theory and the Construction of Knowledge, Ithaca, Cornell University Press, 1991.
[2] Voir par exemple C. Merchant, The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution, New York, Harper & Row, 1989.
[3] En particulier dans le deuxième chapitre de E. F. Keller, Reflections on gender and science, New Haven (CT), Yale University Press, 1985.
[4] Pour comparer leurs textes respectifs, voir J. S. Mill et H. T. Mill, John Stuart Mill et Harriet Taylor: Ecrits sur l’égalité des sexes, F. Orazi (éd.), Lyon, ENS éditions, 2014.
[5] Le Dœuff et Derrida ont fait partie du Greph, le Groupe de Recherches sur l’Enseignement philosophique ; voir B. Peeters, Derrida, Paris, Flammarion, 2010, p.342.
[6] Voir par exemple le travail de Gayatri Spivak. Éperons est particulièrement mobilisé dans « Feminism and Deconstruction », in G. C. Spivak, Outside in the teaching machine, New York, Routledge, 1993, p.126-130.