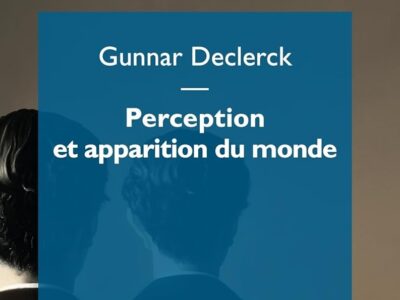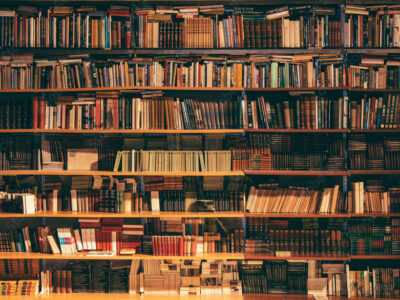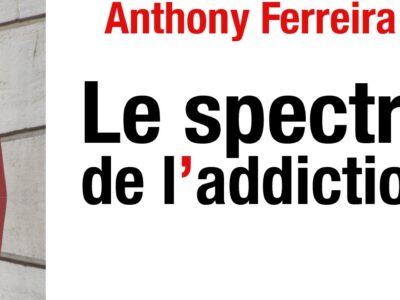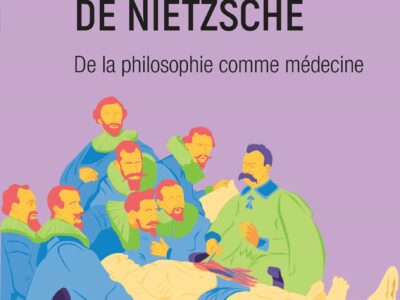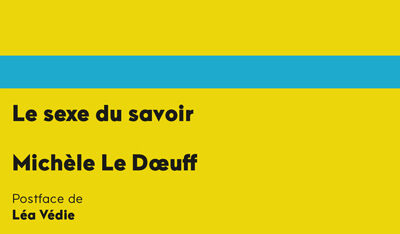Usages et mésusages du pouvoir : Butler lecteurice de Foucault
Diplômé en philosophie et titulaire d’un master en droits humains, François Fekete de Vàri a été assistant chargé d’enseignement et chercheur à l’Université libre de Bruxelles (PHI – Centre de recherche en philosophie) et à l’Université Catholique de Louvain Saint-Louis (SIEJ – Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques). Ses recherches portent sur la philosophie des normes, les études de genre et les théories de la reconnaissance.
Résumé
Le présent article étudie le rapport de filiation entre Michel Foucault et Judith Butler, sur la base d’une partie du corpus des deux auteurs. En dépit d’une apparente proximité, qui tient notamment à la place qu’occupe le premier dans le travail de læ second·e, à leur intérêt commun pour certains thèmes (sexe, genre, sexualité) et à une même préoccupation pour le pouvoir, on relève aussi un certain nombre de nuances, sinon de points de désaccord. En revenant sur la façon dont Butler lit Foucault, nous mettons ainsi en évidence une filiation plus contrastée qu’il n’y paraît au premier abord. Ce contraste, nous l’analysons à partir de trois concepts qui traversent leurs écrits et autour desquels se construit leur pensée : la norme et ses dérivés (normal, normatif, anormal) d’abord ; l’assujettissement, lui-même articulé à la notion de performativité, ensuite ; la loi et le pouvoir juridique enfin. Trois concepts qui sont aussi trois points de vue sur le pouvoir, trois perspectives critiques sur une même relation d’héritage et, par conséquent, trois lignes de pensée qui instaurent une certaine distance entre l’un et l’autre.
Mots-clés : Michel Foucault ; Judith Butler ; pouvoir ; norme ; loi
Abstract
This article examines the relationship between Michel Foucault and Judith Butler, on the basis of part of the corpus of both authors. Despite their apparent closeness, which stems from the place Foucault occupies in Butler’s work, their shared interest in certain themes (sex, gender, sexuality) and a shared preoccupation with power, there are also several nuances, if not points of disagreement. By looking back at Butler’s reading of Foucault, we can see a more contrasting lineage than might at first appear. We analyze this contrast on the basis of three concepts that run through their writings and around which their thinking is built: firstly, the norm and its derivatives (normal, normative, abnormal); secondly, subjection, itself linked to the notion of performativity; and thirdly, law and legal power. Three concepts that are also three points of view on power, three critical perspectives on the same relationship of inheritance and, consequently, three lines of thought that establish a certain distance between the two authors.
Keywords: Michel Foucault; Judith Butler; power; norm; law
I. Introduction : un héritage contrasté
Parmi les références qui traversent l’œuvre de Judith Butler, Michel Foucault occupe sans nul doute une place de choix. Celui dont on a fait outre-Atlantique un représentant majeur de la French Theory[1], cette « drôle de construction américaine »[2] qui a réagencé la vie intellectuelle française de la seconde moitié du XXe siècle, constitue pour læ philosophe états-unien·ne une figure à laquelle iel ne cesse de revenir au cours des années 1990 et jusqu’au début des années 2000. C’est le pouvoir tel que le conceptualise Foucault qui retient en particulier l’attention de Butler – dans la mesure notamment où il lui fournit un appui pour théoriser la construction du genre –, de sorte que c’est à partir de lui que s’établit un rapport de filiation entre cellui-ci et celui-là. Un véritable dialogue, posthume pour une part, s’instaure ainsi autour de l’élaboration foucaldienne du pouvoir, dont Butler reprend à son compte un certain nombre d’aspects.
Fidèle aux analyses de Foucault sur le fonctionnement du pouvoir moderne, Butler adhère d’abord à certaines distinctions introduites par lui entre la loi et la norme. En particulier, iel entérine le constat d’une amplification sociale croissante de la norme, doublée d’une diffusion capillaire, se substituant progressivement à la loi. Iel souscrit également à l’idée selon laquelle il faut envisager le pouvoir sous l’angle de son efficacité productive plutôt qu’à travers sa fonction prohibitive. Non pas que la norme soit nécessairement opposée aux formes légales du pouvoir : au contraire, Foucault repère nombre de mécanismes par lesquels la norme pénètre les codes juridiques et les législations. Néanmoins, alors que le pouvoir-loi se caractérise par une visibilité maximale, un fonctionnement vertical et une action négative – interdiction, censure, « puissance du “non” »[3] – la norme s’exerce sur un mode le plus souvent implicite, diffus, et se distingue par sa capacité à produire, c’est-à-dire à modeler des corps, à inciter des usages, à informer des pratiques ou à prescrire des conduites, mais aussi à créer du savoir et à essaimer des discours qu’elle déploie, distribue et multiplie dans le corps social. Autant d’aspects qui, pour Butler, circonscrivent les conditions de la reconnaissabilité et de l’intelligibilité culturelle, définissent la cohérence de la personne et délimitent le champ de l’existence sociale, là où les individus sont transformés en sujets.
En outre, envisagé depuis la problématique de la norme, le pouvoir vise la conformation des individus et la régulation de leur existence quotidienne. La norme « marque et effectue un déplacement d’une conceptualisation du pouvoir comme contrainte juridique à une conceptualisation du pouvoir comme (a) un ensemble organisé de contraintes et (b) un mécanisme régulateur. »[4] Exercée dans les soubassements de la société et « jusqu’à son grain le plus fin »[5], elle propage certains idéaux auxquels les individus sont contraints de se soumettre et qu’ils s’efforcent de satisfaire. De ce fait, elle contribue à produire celles et ceux qui en sont la cible et dont elle régule l’existence et les pratiques sociales. Pour Butler, qui suit en cela Foucault, le pouvoir n’agit pas simplement de manière négative, il ne se contente pas de poser des limites et d’énoncer des interdits. Il travaille à faire émerger les sujets qu’il contrôle ; il attache l’individu à lui-même et le soumet dans un même mouvement ; il « classe les individus en catégories, les désigne par leur individualité propre, les attache à leur identité, leur impose une loi de vérité qu’il leur faut reconnaître et que les autres doivent reconnaître en eux »[6]. C’est ce point que manifeste l’ambivalence de la notion d’assujettissement, dont Foucault ne manquait pas de relever la polysémie, et qui, selon la définition qu’en propose Butler, « dénote à la fois le devenir du sujet et le processus de la sujétion »[7].
Le présent article vise à investiguer plus avant le rapport entre les deux philosophes, sur la base d’une partie de leur corpus respectif : la première période intellectuelle de Butler, d’une part, allant des années 1990 jusqu’au début des années 2000, et ce que l’on a appelé le « second Foucault », dont les travaux des années 1975-76 en particulier constituent une référence majeure pour Butler. En dépit d’une apparente proximité entre les deux auteurs, qui tient notamment à l’abondance des références, à leur intérêt commun pour certains thèmes (sexe, genre, sexualité) et à une même préoccupation pour le pouvoir, on relève aussi un certain nombre de nuances, sinon de points de désaccord. En revenant sur la façon dont Butler lit Foucault, nous mettons ainsi en évidence une filiation plus contrastée qu’il n’y paraît au premier abord. Ce contraste, nous l’analysons à partir de trois concepts qui traversent leurs écrits et autour desquels se construit leur pensée : la norme et ses dérivés (normal, normatif, anormal) d’abord ; l’assujettissement, lui-même articulé à la notion de performativité, ensuite ; la loi et le pouvoir juridique enfin. Trois concepts qui sont aussi trois points de vue sur le pouvoir, trois perspectives critiques sur une même relation d’héritage et, par conséquent, trois lignes de pensée qui instaurent une certaine distance entre l’un et l’autre.
II. Variations sur la norme
Occupant une place tout à fait centrale dans l’ensemble du travail de Butler, la norme y est définie comme ce qui organise le champ social, ce à partir de quoi se construit un domaine de reconnaissabilité et d’intelligibilité culturelles et ce à travers quoi les individus se subjectivent et adviennent à l’existence sociale. Dans son ouvrage Défaire le genre, læ philosophe apporte un certain nombre de précisions sur la notion, qu’iel caractérise en l’articulant à celle de régulation sociale. Envisagée comme régulation, la norme gouverne « l’intelligibilité sociale de l’action » et « permet à certains types de pratiques et d’actions de devenir reconnaissables en tant que tels »[8] ; elle constitue un type de pouvoir social qui produit le champ intelligible des sujets et définit les « paramètres de ce qui apparaîtra ou non dans le domaine social »[9].
Cette capacité de délimitation s’explique par le fait que la norme établit un standard commun, le plus souvent implicite, qui s’actualise dans les pratiques sociales, se reproduit dans des actes et des rituels quotidiens et, in fine, contraint les actions, les comportements, les corps et les identités, de sorte qu’ils deviennent intelligibles et reconnaissables. De plus, le standard qu’elle met en jeu peut se comprendre comme idéal normatif, dans la mesure où il n’est pas seulement répété par ces actes, réinstitué en eux, mais aussi reproduit par des idéalisations qui s’efforcent de s’en rapprocher. Analytiquement dégagé des pratiques qu’il régule, il se donne à penser comme un idéal – potentiellement solidifié, réifié ou naturalisé – qu’il s’agit de satisfaire.
De ce point de vue, et bien qu’elle puisse être retournée contre elle-même et « resignifiée » dans sa répétition même[10], la norme remplit d’abord une fonction homogénéisante : elle fournit un standard social commun auquel les individus sont forcés de se conformer. Une telle conception, dont on peut souligner à la suite de Kathleen Ennis le caractère particulièrement lâche, s’apparente en définitive à une règle ou un principe de valorisation doté d’une dimension coercitive, qui s’impose aux individus depuis l’extérieur, les contrôle et les homogénéise[11]. Si bien d’ailleurs que la norme, notamment pour ce qui concerne le genre, semble recouvrir un ensemble relativement disparate d’éléments dont sont dépendants les groupes sociaux et qui peuvent inclure des lois, des codes moraux et des conventions sociales, de même que des manières d’agir, de penser, de sentir ou des représentations[12].
Le concept de norme tel que l’introduit Foucault n’a pas, en revanche, de portée si générale. Il s’inspire davantage de la pensée de Georges Canguilhem qui comprend la norme dans sa relation au multiple, au mobile, voire au chaotique, non seulement dans l’épaisseur biologique du vivant mais aussi sur le plan social. En effet, Canguilhem identifie dans la période qui a suivi la Révolution française un phénomène d’extension continu de rationalisation et de standardisation dans le champ de l’industrie, de la médecine ou encore de l’instruction. Selon Canguilhem, si le concept de norme recouvre à la fois le normal (être) et le normatif (devoir être), c’est dans la mesure où il porte en lui un principe d’unification du divers, imposant « une exigence à une existence, un donné, dont la variété, la disparate s’offrent, au regard de l’exigence, comme un indéterminé hostile ».[13] Ce faisant, la norme s’établit en opposition à ce qu’elle n’est pas, qui se situe à côté d’elle, en dehors d’elle, et qu’elle se propose ou se met en devoir d’intégrer. « Quand on sait que norma est le mot latin que traduit équerre et que normalis signifie perpendiculaire, on sait à peu près tout ce qu’il faut savoir sur le domaine d’origine du sens des termes norme et normal »[14]. La valeur de la norme s’apprécie par contraste avec ce qui lui échappe encore et qu’elle vise à absorber. Sa fonction, elle la tire de la mise en conformité de son envers perçu comme chaotique, l’hors-norme, auquel elle cherche à imposer son ordre interne ainsi qu’une nouvelle stabilité.
En référence notamment à Canguilhem[15], Foucault envisage la norme comme une technologie correctrice plus que comme un standard commun qui contraint les individus. Instrument de correction, la norme intervient directement sur les individus et exerce une fonction transformatrice sur son en-dehors, l’anormal : « il s’agit d’organiser le multiple, de se donner un instrument pour le parcourir et le maîtriser »[16]. Pour ce faire, la norme met en œuvre différentes opérations qu’elle déploie, articule et associe dans un même processus à visée normalisatrice[17] : comparer les conduites, performances, actes singuliers dans un ensemble qui les distribue et fournit le principe d’une règle à suivre ; différencierles individus les uns par rapport aux autres en fonction de cette règle (qu’elle fonctionne comme seuil minimal, moyenne ou optimum à atteindre) ; mesurer quantitativement ou hiérarchiser qualitativement les individus (leurs conduites, leurs performances, leurs actions, leur « nature ») ; homogénéiser en faisant jouer la valeur de la règle et la « contrainte d’une conformité à réaliser »[18] ; exclure après avoir tracer la limite qui définit la différence, « la frontière extérieure de l’anormal. »[19]. La norme use donc d’un ensemble de moyens de « dressage » et de micro-pénalité : règle, standard commun ou individuel, objectif, minimum ou optimum, moyenne, rang ou distribution, seuil ou limite sont autant de modalités dont aucune ne prévaut en définitive sur les autres. En outre, si, dans l’exercice de sa fonction correctrice, elle vise l’homogénéisation des individus – ce qui pourrait l’assimiler au standard commun –, c’est néanmoins toujours dans la mesure où elle les différencie, les mesure et les hiérarchise dans un même processus. Autrement dit, dans la mesure où elle individualise[20].
Aussi la norme est-elle, pour Foucault, plus locale, plus contextualisée, plus opératoire que chez Butler. Elle s’inscrit dans un vaste paysage de technologies de pouvoir, parmi lesquels des mécanismes de surveillance, des dispositifs de contrôle, des méthodes d’examen, la formation de savoirs et de discours d’expertise ou encore le développement de procédures d’aveu. En outre, elle ne représente pas seulement, ni d’abord, un standard commun qui se caractérise par sa répétition, définit un domaine d’intelligibilité et régule les comportements, les actions, les identités. « La norme, ce n’est pas simplement, ce n’est même pas un principe d’intelligibilité » ; c’est un élément de l’exercice d’un certain pouvoir qui « porte avec soi à la fois un principe de qualification et un principe de correction. »[21]. Elle est une technologie de pouvoir dynamique qui incorpore son dehors et le transforme.
Dans le commentaire qu’iel livre du travail de Foucault, Butler ne retient pas cette dimension du pouvoir. Iel insiste davantage sur l’idée que la norme instaure les cadres d’intelligibilité culturelle et, de ce fait, conditionne l’existence des sujets en tant qu’ils sont, ou ne sont pas, reconnaissables et intelligibles. C’est pourquoi, aussi, il en découle une conséquence importante quant au statut du non-conforme ou de l’anormal : tandis que Butler insiste sur la dimension excluante du pouvoir, qui produit en même temps un domaine d’inintelligibilité où se trouvent rejetés les sujets, corps et identités anormaux, Foucault souligne au contraire son aspect incluant : la norme absorbe son en-dehors chaotique. La norme n’est pas excluante en elle-même ; elle est plutôt un instrument correctif, une technologie opératoire de correction que Foucault fait voisiner avec le modèle de gestion de la peste (inclusion et mise en ordre) plutôt que celle de la lèpre (exclusion et rejet)[22]. Aussi l’exclusion sociale ne produit-elle pas, comme chez Butler, des êtres inintelligibles, abjects ou « irréels »[23]. Pour Foucault, la conséquence est exactement inverse : les anormaux (fous, homosexuels, malades, criminels, hystériques ou enfants pervers) représentent l’occasion d’un investissement accru et d’une intensification du pouvoir ; ils deviennent la cible d’un surcroît d’intelligibilité, d’individualisation et d’assujettissement, de sorte que, mieux définis et circonscrits, la norme les loge au centre de la société beaucoup plus qu’à ses marges. En ce sens, la définition du normal représente, pour Foucault, une émanation de l’anormal.
III. De l’assujettissement au performatif et retour
Autres éléments à partir desquels il est possible d’établir un contraste entre Butler et Foucault : la performativité et la subjectivation (ou la subjectivation par la performativité). Nous l’avons souligné, Butler voit dans la norme le principe à partir duquel le processus de subjectivation est rendu possible, ce dont rend compte la double signification du terme « assujettissement » : les individus se subjectivent dans la sujétion. Cette notion d’assujettissement, Butler la théorise notamment en référence à un passage, devenu célèbre, de Surveiller et punir dans lequel Foucault décrit la façon dont l’« âme » du prisonnier doit être reconduite vers ses conditions de production qui en dévoilent la véritable nature : résultat d’une technologie disciplinaire et instrument d’une anatomie politique, l’âme du prisonnier est « une pièce dans la maîtrise que le pouvoir exerce sur le corps. »[24]. Butler cite et commente ce passage à plusieurs reprises dans son œuvre[25], qu’iel réinscrit néanmoins dans son propre projet de dénaturalisation du sexe et de régulation du genre, ce à quoi la notion de performativité fournit, très tôt, l’assise théorique.
Bien qu’elle constitue un concept transversal de la pensée de Butler, la performativité ne bénéficie jamais d’une théorisation systématique et évolue au fil du temps et de ses publications, ce pourquoi elle échappe aux définitions préconçues. Butler en fait usage tantôt en référence à Austin[26], selon lequel certains énoncés, les performatifs, font ce qu’ils disent sous certaines conditions, à savoir un ensemble de conventions socialement instituées qui confèrent à l’énonciateur le pouvoir de faire advenir ce qu’il nomme ; tantôt à Nietzsche, qui soutient que les actes (l’activité, le faire) précèdent le sujet institué et le produisent : « “der Täter” ist zum Tun blos hinzugedichtet – das Tun ist alles [l’“agent” n’est qu’ajouté à l’activité – l’activité est tout] »[27] ; tantôt à Althusser[28] et à ses propositions sur l’interpellation, acte de discours adressé au sujet (Dieu nommant Pierre ou Moïse, le policier hélant le passant « Hé, vous là-bas ! ») qui l’anime et le fait exister ; tantôt encore à Derrida[29], dont la critique d’Austin insiste sur l’importance de la répétition : le pouvoir du performatif n’est pas joué une fois pour toutes car les actes dans lesquels il s’inscrit ont à être répétés, de sorte que chaque acte de discours contient en lui une chaîne d’actes antérieurs impliqués dans l’acte présent et qui s’y trouvent rappelés comme autant de citations.
A travers ces références, et tout en insistant par ailleurs sur la dimension matérielle et incarnée du performatif[30], Butler opère un certain nombre d’inflexions conceptuelles dont on peut sommairement souligner plusieurs aspects. Premièrement, iel cherche à repenser les catégories du sujet, de l’identité et du genre en dehors du cadre de la « métaphysique de la substance »[31]. Deuxièmement, et ce point est corrélatif au premier, dire du genre qu’il est performatif revient à s’opposer aux modèles du constat ou du dévoilement et à défendre l’idée selon laquelle il est produit par les actes dont on pense qu’ils le décrivent ou l’expriment. « De tels actes, gestes et accomplissements [enactments], au sens le plus général, sont performatifs, par quoi il faut comprendre que l’essence ou l’identité qu’ils sont censés refléter sont des fabrications, élaborées et soutenues par des signes corporels et d’autres moyens discursifs. Dire que le corps genré est performatif veut dire qu’il n’a pas de statut ontologique indépendamment des différents actes qui constituent sa réalité. »[32]. Le genre relève ainsi de la « métalepse »[33] : là où l’on croit voir une cause, Butler nous invite à appréhender un effet. Enfin, on ne saurait trop insister sur le fait que la performativité n’est pas un acte unique, mais une répétition, un rituel dont les effets sont produits, sédimentés et naturalisés à travers un processus temporel.
A partir de cet éventail d’éléments, on relève que le concept de performativité recouvre pour l’essentiel la façon dont nous avons envisagé le pouvoir à partir des normes et de la régulation. Au fond, qu’est-ce qui distingue la performativité de l’actualisation continue et répétée des normes dans des usages, des comportements, des discours ou des dispositions corporelles ? Le normatif et le performatif s’entremêlent volontiers dans le travail de Butler. Cellui-ci ne les différencie jamais précisément, de sorte qu’on pourrait considérer que les actes qui constituent performativement la réalité du genre représentent autant d’occasions où se réitèrent les normes, en tant qu’elles fournissent un standard commun qui régule l’action. De plus, en dépit du fait que Butler se réclame de Foucault, il semble que sa conception de la performativité s’apparente davantage au fonctionnement du pouvoir souverain, que Foucault entreprend pourtant de distinguer du pouvoir disciplinaire et normatif. Selon lui, le pouvoir souverain tient sa force et sa solidité non pas de son organisation interne, de l’articulation de diverses techniques de pouvoir (surveillance hiérarchique, sanctions normalisatrices, examens[34]) ou de compositions relativement stables, bien que dynamiques, de savoir-pouvoir inscrites dans des pratiques sociales déterminées, mais plutôt de sa relation à un acte fondateur du passé qui lui confère sa légitimité. C’est cet acte fondateur qui doit être réactualisé à travers des rites, des cérémonies et des symboles[35].
De même, la performativité, comme l’envisage Butler, requiert que soit citée et répétée rituellement l’adresse initiatrice du genre/sexe : le « performatif inaugural “C’est une fille !” », proféré par un·e médecin fait de l’enfant un sujet genré/sexué qui sera ensuite contraint de « “citer” la norme pour être toujours considérée comme telle et rester un sujet viable. La féminité est ainsi non le produit d’un choix, mais la citation contrainte d’une norme, dont l’historicité complexe est indissociable de relations de discipline, de régulation et de punition. »[36]. A plusieurs occasions, Butler confirme l’idée selon laquelle le genre/sexe est initié par un acte fondateur qui ouvre une chaîne de répétition rituelle et de citations contraintes. Variant les modalités de l’acte en question, iel réaffirme même dans une période intellectuelle ultérieure que sa « thèse […] est que notre genre a été établi, pour la plupart d’entre nous, par une personne qui a coché une case sur un document officiel »[37] (dossier médical, acte de naissance à l’état civil, livret de famille). En ce sens, la vie genrée dépend d’un événement inaugural qui, par la suite, est rappelé et soutenu par « un ensemble diffus et complexe de pouvoirs discursif et institutionnels », de sorte que « l’imposition psychosociale et la lente inculcation des normes »[38] nous affectent et nous produisent comme sujets. Le genre est, pour Butler, produit par des normes obligatoires qui exigent que les individus soient d’un genre/sexe bien défini, selon une organisation binaire, et qui « informent les modes vécus d’incarnation »[39]. Cet ensemble de précisions, s’il soutient adéquatement la description du performatif, nuance ainsi l’héritage foucaldien de Butler.
Peut-être le travail de Butler tient-il ici moins de Foucault que des auteurs, dont il a été fait mention, qui fournissent un appui théorique supplémentaire à la performativité – singulièrement Nietzsche et Althusser, avec lesquels Butler fait dialoguer Foucault. D’abord, pour ce qui concerne Nietzsche : lorsque Butler cherche à mettre en évidence le piège dans lequel certaines ontologies sont tombées en adhérant au langage non critique de la grammaire ; lorsqu’iel vise à débusquer les illusions qui nous font croire à une origine préexistante des catégories du sujet, du sexe ou de la substance ; lorsque, enfin, iel s’interroge sur la manière dont certaines configurations sociales ou culturelles en viennent à garantir leur pouvoir régulateur en dissimulant la genèse de leur production, iel définit sa démarche comme une enquête généalogique inspirée de la Généalogie de la morale[40]. Celle-ci ne consiste pas, comme on sait, à retrouver l’origine perdue du sujet, à dévoiler le véritable sexe qui se loge en chacun de nous, ni à mettre à jour l’authenticité du désir qui nous habite. Il s’agit bien plutôt de démystifier la métaphysique de la substance et de comprendre « les enjeux politiques qu’il y a à désigner ces catégories de l’identité comme si elles étaient leurs propres origine et cause alors qu’elles sont en fait les effets d’institutions, de pratiques, de discours provenant de lieux multiples et diffus. »[41].
Dans cette perspective, Butler se réfère explicitement à Nietzsche, auquel iel semble assimiler, un peu rapidement, le projet de Foucault qu’iel présente comme une version de la généalogie nietzschéenne. En outre, c’est encore en évoquant Nietzsche que Butler relit, dans Trouble dans le genre, la scène du prisonnier de Surveiller et punir sur le modèle de l’incorporation et de l’inscription : à travers l’âme, le pouvoir s’inscrit sur le corps des détenus, les marque et s’incorpore en eux, « comme [s’il] constituait leur essence même, leur donnait leur style et leur nécessité »[42]. Le pouvoir, à la fois tout à fait apparent et dissimulé, serait ainsi inscrit sur – et incorporé par – les corps qu’il assujettit. C’est en ce sens que Butler conçoit le genre comme l’inscription de la norme du sexe sur le corps, auquel la première confère sa cohérence et son intelligibilité, et l’âme comme l’idéal normatif répété, cité et matérialisée autour, à la surface et à l’intérieur du corps. Or, comme ne manque pas de le relever Kathleen Ennis, ce n’est pas tant le modèle de l’inscription qui est à l’œuvre chez Foucault dans Surveiller et punir que celui de la composition des forces corporelles par les disciplines[43]. Celles-ci visent à imposer un ordre aux multiplicités humaines inorganisées à l’aide d’une multiplicité de technologies, afin de les maîtriser, les soumettre et d’en maximiser l’utilité. Dans ce but, les corps sont rendus dociles à travers des procédures de répartition dans l’espace, de contrôle de l’activité, d’organisation des genèses et d’articulation concertée qui ne se confondent pas avec l’inscription d’une norme sur et dans le corps. Sans doute le modèle de l’inscription renverrait-il davantage, pour Foucault, à ce qu’il appelle l’« éclat des supplices »[44] et par quoi il désigne soit la manifestation flamboyante, sur le corps du supplicié, de la puissance royale, soit la démonstration publique, réglée et ritualisée, de la vérité du crime et de la procédure judiciaire qui l’a révélée.
 Par ailleurs, pour ce qui concerne Althusser, il est frappant de constater les points de convergences entre la conceptualisation du pouvoir par Butler et la façon dont Althusser décrit le fonctionnement de l’idéologie. En effet, dans sa célèbre étude « Idéologie et appareils idéologiques d’État », Althusser défend l’idée que la reproduction des conditions de la production est garantie notamment par la sujétion continue des individus, à laquelle l’Etat contribue de façon décisive. Deux types d’appareil d’État fonctionnent de concert dans ce but : le répressif, d’une part, fondé sur l’usage de la violence physique, qui inclut en particulier l’armée, la police, les tribunaux, les prisons, l’administration et le gouvernement[45] ; l’idéologique, d’autre part, qui fonctionne « de façon massivement prévalente à l’idéologie »[46] et qui comprend l’école, la famille, l’église, le droit, les partis politiques et les syndicats, les médias et le système culturel. Althusser estime que, malgré leur diversité et leurs apparentes contradictions, les appareils idéologiques d’État se trouvent unifiés sous l’idéologie de la classe dominante, soit la bourgeoisie. L’idéologie consiste en une représentation imaginaire, et donc illusoire, du rapport des individus à leurs conditions réelles d’existence et aux relations qu’elles impliquent. Cependant, selon Althusser, l’idéologie n’est pas d’abord ni surtout « idéale, idéelle [ou] spirituelle »[47]. Bien au contraire, son existence est toujours matérielle. Elle s’inscrit dans et se reproduit continuellement par les actes, les pratiques et les rituels associés à chacun des appareils idéologiques d’État (par exemple : agenouillement, signe de croix, mea culpa, discours verbal interne ou externe, etc.) et à partir desquels naissent les « “idées” et autres “représentations” »[48]. Or, en étant contrôlés par l’idéologie et en se soumettant à ses appareils d’État, les individus sont produits comme « bons » sujets et se subjectivent eux-mêmes dans le même mouvement. Ils sont assujettis ou, mieux, interpellés en sujets et soutiennent en retour le dispositif qui les produit. L’idéologie fait en sorte qu’ils « marchent tout seuls »[49] en les impliquant activement dans le processus de leur propre sujétion.
Par ailleurs, pour ce qui concerne Althusser, il est frappant de constater les points de convergences entre la conceptualisation du pouvoir par Butler et la façon dont Althusser décrit le fonctionnement de l’idéologie. En effet, dans sa célèbre étude « Idéologie et appareils idéologiques d’État », Althusser défend l’idée que la reproduction des conditions de la production est garantie notamment par la sujétion continue des individus, à laquelle l’Etat contribue de façon décisive. Deux types d’appareil d’État fonctionnent de concert dans ce but : le répressif, d’une part, fondé sur l’usage de la violence physique, qui inclut en particulier l’armée, la police, les tribunaux, les prisons, l’administration et le gouvernement[45] ; l’idéologique, d’autre part, qui fonctionne « de façon massivement prévalente à l’idéologie »[46] et qui comprend l’école, la famille, l’église, le droit, les partis politiques et les syndicats, les médias et le système culturel. Althusser estime que, malgré leur diversité et leurs apparentes contradictions, les appareils idéologiques d’État se trouvent unifiés sous l’idéologie de la classe dominante, soit la bourgeoisie. L’idéologie consiste en une représentation imaginaire, et donc illusoire, du rapport des individus à leurs conditions réelles d’existence et aux relations qu’elles impliquent. Cependant, selon Althusser, l’idéologie n’est pas d’abord ni surtout « idéale, idéelle [ou] spirituelle »[47]. Bien au contraire, son existence est toujours matérielle. Elle s’inscrit dans et se reproduit continuellement par les actes, les pratiques et les rituels associés à chacun des appareils idéologiques d’État (par exemple : agenouillement, signe de croix, mea culpa, discours verbal interne ou externe, etc.) et à partir desquels naissent les « “idées” et autres “représentations” »[48]. Or, en étant contrôlés par l’idéologie et en se soumettant à ses appareils d’État, les individus sont produits comme « bons » sujets et se subjectivent eux-mêmes dans le même mouvement. Ils sont assujettis ou, mieux, interpellés en sujets et soutiennent en retour le dispositif qui les produit. L’idéologie fait en sorte qu’ils « marchent tout seuls »[49] en les impliquant activement dans le processus de leur propre sujétion.
La conception du pouvoir, des normes et de la performativité de Butler fait directement écho à l’idéologie telle que la conçoit Althusser. L’élément de la représentation dans l’idéologie, sa matérialisation dans des institutions et des appareils d’État qui assujettissent et subjectivent les individus, ainsi que la répétition ritualisée des actes et des pratiques qui constituent sa réalité, rejoignent les éléments par lesquels Butler définit les normes et la performativité. Les normes produisent les sujets en les assujettissant à un standard commun d’où ils tirent leur intelligibilité et dans lequel ils se reconnaissent. De même, le genre, en tant qu’idéal normatif, se matérialise dans le corps auquel il fournit sa morphologie sexuée à travers un processus de répétition et une citation continue des normes. Les sujets genrés/sexués sont contraints de répéter l’« authentique » mascarade – pour ne pas dire l’idéologie – du genre et, de ce fait, prennent une part active dans leur propre assujettissement. Réinterprétant l’exemple du performatif inaugural dans les termes althussériens, Butler écrit ainsi : « Le médecin qui saisit l’enfant et prononce : “C’est une fille”, ouvre la longue chaîne d’interpellations par lesquelles une fille est transitivement faite fille : le genre est répété rituellement, et cette répétition génère […] un effet de fixation par sédimentation. »[50].
Or, comme le relève à nouveau Kathleen Ennis, et malgré l’interprétation selon laquelle « la doctrine althussérienne de l’interpellation plante clairement le décor des derniers développements de Foucault sur la production discursive du sujet »[51], il est clair que Foucault est en désaccord avec Althusser sur plusieurs points – et donc, en un sens, avec Butler[52]. D’abord, les appareils et dispositifs de pouvoir doivent être compris, pour Foucault, non pas à partir des représentations qu’ils génèrent, reconduisent et qui se matérialisent en eux, mais à partir des technologies de pouvoir qui les organisent. Ensuite, Foucault insiste non pas tant, comme le fait Althusser, sur l’organisation réglée des institutions et leur orientation vers une finalité spécifique (la reproduction des conditions de la production, l’idéologie de la classe dominante) que sur leur dynamise et leur mobilité internes, les rapports dissymétriques et pyramidaux sur lesquelles elles reposent et les procédures de surveillance, de sanctions ou d’examen qu’elles mettent en œuvre. De plus, Foucault ne retient pas la distinction introduite par Althusser entre, d’une part, un appareil répressif qui use de la violence physique et, d’autre part, un appareil qui se fonde sur l’idéologie : tout pouvoir a pour cible le corps. Enfin, eu égard à la subjectivation, Foucault conçoit toujours celle-ci en relation à l’individualisation et à la différenciation que le pouvoir normalisateur accomplit, comme nous l’avons souligné, là où Althusser et Butler insistent, quant à eux, sur l’effet d’homogénéisation de l’idéologie ou des normes de genre. Lorsque Foucault envisage la production des sujets, c’est toujours en relation à des procédures d’individualisation et en tant qu’ils sont corrélatifs des mécanismes propres au pouvoir disciplinaire. En revanche, il considère la sujétion et l’homogénéisation davantage comme des caractéristiques du pouvoir souverain, qui s’applique sans distinction à des groupes non individualisés et indifférenciés.
IV. De la loi : le pouvoir juridique
Pour terminer, on retiendra un dernier point de contraste entre Butler et Foucault, qui corrobore dans l’ensemble les éléments précédents. Ce point, qui est essentiel, consiste en ce que Butler ne renonce jamais au schème de la loi et au pouvoir juridique, notamment en référence à la psychanalyse, alors même que Foucault ne cesse de s’en distancier et d’y opposer d’autres types et d’autres modes de fonctionnement du pouvoir. A cet égard, il est surprenant de constater la constance avec laquelle Butler mobilise, dans Trouble dans le genre en particulier, cette modalité du pouvoir, y compris lorsqu’iel entreprend de commenter et d’interpréter le travail de Foucault – usant ou abusant de termes tels que « loi », « loi répressive », « loi juridique ». Or, si la loi et le pouvoir juridique opèrent à travers la prohibition, la censure ou, selon l’expression lacanienne, la forclusion, ils se caractérisent aussi par leur capacité productive. Pour Butler, et c’est en ce sens notamment qu’iel se réclame de Foucault, la loi est aussi productive ; le pouvoir juridique produit cela-même qu’il prohibe, censure ou forclôt. Ce point est particulièrement évident dans la façon dont la philosophe envisage la sexualité et sa relation au genre et au sexe.
La sexualité et les pratiques du désir doivent s’articuler, analytiquement comme sur le plan des pratiques, aux normes de genre, de telle sorte que le régime normatif d’assignation qu’est le genre, en tant qu’appareil régulateur qui « précède » le sexe, se trouve lui-même précédé par, ou au moins imbriqué dans, la sexualité dans sa forme hétérosexuelle, obligatoire et naturalisée, formant ce que Butler appelle une « matrice hétérosexuelle » dont la cohérence interne binaire exprime et reconduit un rapport d’alignement strict entre sexe, identité de genre et désir sexuel. La matrice requiert en effet d’incarner un (et seulement un) sexe, dont découlent normalement une identité et une expression de genre congruentes, auxquelles doit enfin correspondre un désir dirigé vers le sexe et le genre opposés. Organisation « chiasmique », s’il en est, selon laquelle hommes et femmes, mâles et femelles, sont ce qu’ils ne désirent pas et désirent ce qu’ils ne sont pas.
Si la fonction prohibitive du pouvoir entre en jeu dans ce dispositif, c’est dans la mesure où un tel partage dichotomique répond à un principe de régulation de la sexualité dont le motif se situe dans l’interdit culturel qui frappe le désir pour l’autre de même sexe et exige d’y renoncer. Se réappropriant un ensemble de concepts freudiens, Butler soutient alors que le sujet genré/sexué se caractérise par un affect particulier, la mélancolie, au sens où la mélancolie – par opposition au deuil qui autorise l’investissement de nouveaux objets (c’est le cas notamment pour l’Œdipe) –, indique le refus de la perte d’un objet aimé et désiré qui conduit à l’incorporation de cet objet comme composante du moi[53]. L’objet prohibé n’est donc pas abandonné, il est intériorisé par identification en tant que trait de la personnalité. Or, si l’objet en question est un autre sujet, celui ou celle de même genre/sexe, alors « la perte de l’autre que l’on désire et que l’on aime est surmontée par un acte spécifique d’identification visant à arrimer l’autre à l’intérieur de la structure même du moi »[54].
C’est pourquoi l’identité sexuelle – le genre/sexe que le sujet intériorise – est une identité fondamentalement hétérosexuelle, en ce sens que le désir et la prohibition de certains de ses buts en constituent les ressorts psychiques incorporés. Le sujet ne désire pas en fonction d’une identité préalable ni de quelque prédisposition naturelle enfouie en lui. A l’inverse, il intériorise ce dont l’accès est barré au désir et auquel il s’identifie. Le genre/sexe a partie liée avec la forclusion du désir et la perte de certains objets. L’identité du sujet relève, de ce point de vue, non pas d’une affirmation, mais une privation[55] : la privation du même genre/sexe comme objet de désir inaugure l’identification à ce même genre/sexe ; parallèlement, le désir pour l’autre genre/sexe travaille à le répudier en tant qu’objet d’identification, c’est-à-dire à s’en différencier. Ainsi masculin et féminin en viennent-ils à s’exclure mutuellement : chacun représente l’« identification répudiée »[56] de l’autre. Le dimorphisme sexué et la dualité des genres ne se donnent à penser qu’en relation à la complémentarité hétérosexuelle et à l’hétérosexualisation du désir. C’est ainsi que se renforce le caractère proprement mélancolique de la matrice hétérosexuelle où la masculinité et la féminité émergent comme « les traces du deuil absent et impossible d’un amour »[57] homosexuel perdu et désavoué ; où le phénomène mélancolique exprime un rapport de conséquence nécessaire promulgué par la loi culturelle prohibitive qui unit sexe, genre et sexualité au sein de la matrice.
Envisagée dans un cadre psychanalytique, la condamnation de l’homosexualité a des effets positifs et producteurs coextensifs à l’interdiction, ce pourquoi Butler en vient à contester « la réduction par Foucault de l’hypothèse répressive à une simple manifestation particulière du pouvoir juridique : une telle analyse ne [lui] semble pas prendre en compte les façons dont la “répression” opère comme une modalité du pouvoir producteur. »[58]. En d’autres termes, la loi sexuelle ne s’impose pas simplement de façon négative, elle produit cela même qu’elle proscrit. Mais inversement, ou de façon circulaire, son pouvoir lui vient des pratiques mêmes qui se trouvent sous son autorité. Que la loi se conçoive comme un pouvoir constitutif antérieur ne doit pas faire illusion : selon Butler, elle a besoin de ses multiples incarnations, invocations et citations pour exister, c’est-à-dire des actes qui ne cessent de la répéter – ce qui caractérisait, nous l’avons vu, et la norme et le performatif.
A nouveau, il faut insister ici sur tout ce qui sépare la position de Foucault de la lecture qu’en propose Butler. De façon générale, Foucault comprend la loi et le pouvoir juridique en un sens plus restreint, et sans doute plus littéral, que Butler. Ils correspondent pour lui au domaine de la souveraineté, tandis qu’ils sont pour ellui synonymes de norme et de régulation en général. Foucault distingue très clairement entre pouvoir productif, d’un côté, et pouvoir juridique et loi, d’un autre côté. Il ne considère pas qu’ils constituent les deux faces d’un même concept unitaire du pouvoir. D’ailleurs, le sort que Foucault réserve à la psychanalyse dans La volonté de savoir est très différent de l’usage qu’en fait Butler : tandis que le premier voit en elle l’héritière des procédures d’aveu et de confession chrétiennes, læ second·e continue d’en partager les prémisses théoriques et d’en déduire de nouveaux corollaires. Au fond, Foucault ne dépeint jamais la psychanalyse comme un exemple de pouvoir juridique, mais beaucoup plutôt comme une technologie qui s’inscrit dans les réseaux tactiques du pouvoir, en dépit, donc, de l’importance que le discours psychanalytique accorde lui-même à l’instance de la loi – qu’elle soit conçue comme constitutive du désir ou comme se surimposant à un désir qui lui est antérieur et qu’elle réprime après-coup[59].
Le « modèle stratégique »[60] que fait valoir Foucault n’accorde aucun privilège d’analyse à un point central ou un foyer unique d’où émanerait le pouvoir en priorité (l’État, la Loi, la Domination). Il repose sur quelques règles de méthode et propositions (exercice immanent et disséminé dans des foyers locaux, caractère strictement relationnel, variations continues, double conditionnement entre stratégies d’ensemble et foyers locaux, productivité et polyvalence tactiques des discours) d’où se dégage une analytique du pouvoir orientée vers un champ foisonnant, multiple, mobile de rapports de force. Si, de ce fait, la sexualité se définit comme « l’ensemble des effets produits dans les corps, les comportements, les rapports sociaux par un certain dispositif relevant d’une technologie politique complexe »[61], ce n’est pas en tant qu’effet d’une inscription sur et dans le corps ni en tant que matérialisation de l’idéologie. Le « dispositif de sexualité » désigne beaucoup plutôt le grand réseau de relations de pouvoir où s’entremêlent, selon différentes stratégies, des technologies de stimulation des corps, des incitations au discours, la formation de savoirs et de connaissances, le déploiement de techniques de normalisation, le renforcement des contrôles – mais aussi, inévitablement, des résistances : en vertu du caractère relationnel du pouvoir, « là où il y a pouvoir, il y a résistance »[62].
Ce modèle du pouvoir contraste avec le modèle du droit et le « juridico-discursif »[63], qui continue d’accorder un privilège au schème de la loi. Selon Foucault, celui-ci conserve un certain nombre de traits qui le distinguent du modèle stratégique : relation négative, instance de la règle, cycle de l’interdit, logique de censure, uniformité et statisme du pouvoir. Dans la mesure où Butler problématise les pratiques du sexe, du genre et de la sexualité depuis la perspective de ce que la loi exclut et marginalise, iel promeut au fond une version revisitée du juridico-discursif, quand bien même cette dernière aurait des effets producteurs irréductibles à la négation stricto sensu. La matrice hétérosexuelle se fonde sur la prohibition fondamentale et première de l’homosexualité, qui en constitue le « dehors constitutif ». En ce sens, elle ne s’apparente pas tant au dispositif de sexualité, tel que le définit Foucault, qu’au dispositif d’alliance, qui en est le pendant inverse et avec lequel le dispositif de sexualité entretient des rapports de coexistence, de recouvrement ou d’embranchement[64]. En effet, le dispositif d’alliance repose sur le partage entre le licite et l’illicite, le permis et le défendu ; il vise la reproduction des relations qui le composent et le maintien de la loi qui les régit ; il définit des statuts et organise les liens entre des partenaires bien établis. Tandis que « le dispositif d’alliance est ordonné sans doute à toute une homéostasie du corps social qu’il a pour fonction de maintenir »[65], d’où son lien privilégié avec le modèle du droit, le dispositif de sexualité a pour but « de proliférer, d’innover, d’annexer, d’inventer, de pénétrer les corps de façon de plus en plus détaillée »[66] et d’intensifier toujours son contrôle sur eux.
Foucault n’envisage jamais les sujets « hors norme » en tant qu’ils sont exclus par le pouvoir, censurés par la loi ou rendus inintelligibles par les normes[67]. A l’inverse, il se livre à l’analyse des processus par lesquels ils deviennent la cible du pouvoir, sont pris dans un réseau de rapports d’influence et de détermination, se trouvent inclus en tant qu’objets de savoir (et assujettis comme sujets du pouvoir) et, en définitive, émergent comme des « cas » saturés de pouvoir au sein du dispositif de sexualité. L’homosexualité, précisément, en fournit une illustration édifiante : articulée au phénomène de l’implantation des perversions et de l’investissement des sexualités alternatives, lui-même corrélatif du dispositif de sexualité, la figure de l’homosexuel émerge au XIXe siècle comme conséquence et support des relations de pouvoir et point d’appui pour leur extension. Il ne faut plus l’envisager seulement comme un sujet juridique dont les pratiques sexuelles (la sodomie) sont interdites par le droit, canon ou civil ; non plus seulement comme l’exemple d’une sexualité aberrante soumise à la pression d’un « illégalisme d’ensemble »[68]. L’homosexuel devient un véritable personnage. Il traîne désormais avec lui « un passé, une histoire et une enfance, un caractère, une forme de vie ; une morphologie aussi, avec une anatomie indiscrète, peut-être une physiologie mystérieuse. »[69]. Sa sexualité, telle un principe naturel actif, spécifie son individualité, caractérise sa personnalité, habite tous ses actes, se manifeste dans chacune de ses conduites. Et Foucault de conclure alors : « Le sodomite était un relaps, l’homosexuel est maintenant une espèce. »[70].
V. Conclusion : un mésusage de Foucault ?
Nous avons cherché à mettre en évidence une filiation contrastée entre Michel Foucault et Judith Butler à partir de trois angles d’approche, trois perspectives sur le pouvoir. Malgré le dialogue qu’iel engage très tôt avec Foucault, Butler semble ne pas retenir du travail de celui-ci un certain nombre d’éléments qui, pourtant, en définissent la spécificité et en constituent l’originalité.
D’abord, la notion de norme qu’iel élabore s’apparente à un standard commun et à un idéal normatif qui ont pour effet d’homogénéiser les individus auxquels ils s’appliquent et qui doivent les satisfaire. Le norme telle que Foucault la conçoit est, en revanche, plus dynamique : fonction transformatrice ou instrument de correction, elle s’accomplit dans une multitude d’opérations et vise non pas tant l’homogénéisation que l’individualisation des sujets.
Ensuite, la notion de performativité s’articule dans le projet de Butler à celle d’assujettissement, qui rend compte du double devenir du sujet (la subjectivation s’opère dans la sujétion). Nous avons montré que l’une et l’autre rejoignent au fond les éléments précédents dans la mesure où elles peuvent être conçues comme l’actualisation continue et répétée des normes dans des usages, des comportements ou des dispositions corporelles, selon le modèle de l’inscription (Nietzsche) ou du fonctionnement de l’idéologie (Althusser), desquels les propositions de Foucault se distinguent pourtant – voire auxquels elles s’opposent.
Enfin, la persistance du schème de la loi marque un dernier point de contraste. Alors que Foucault s’efforce de développer une conception du pouvoir neuve, qui s’écarte du pouvoir juridique (contrainte, censure, répression) et fait valoir notamment les notions de stratégie, de technologie, de relation et de résistance, Butler continue à faire usage de la loi, dont iel souligne néanmoins le caractère productif. La conséquence en est notamment que les sujets hors norme sont, pour l’un, surdéterminés par le pouvoir et inclus comme des « cas » au cœur du social ; tandis qu’ils se trouvent, pour l’autre, exclus et rendus abjects, sinon invisibles ou irréels.
Faut-il pour autant considérer que Butler fait un « mauvais » usage de Foucault ? D’aucuns y verront sans doute une lecture orientée – sinon erronée – par l’influence souterraine qu’exerce la psychanalyse sur le travail de Butler, ainsi que le modèle de l’inscription du pouvoir sur les corps et les psychés, la matérialisation de l’idéologie ou encore le processus de répétition qui se sédimente. Contre cette interprétation, nous voudrions plutôt insister sur la dimension fructueuse de ce « mauvais usage » de Foucault, à partir duquel Butler construit une pensée originale qui répond, semble-t-il, à ses propres problèmes. Après tout, comme læ philosophe ne manque pas de le faire remarquer, un « échec » dans la réalisation de la norme donne parfois lieu à un dénouement heureux, de même que les « écarts » peuvent aussi être producteurs.
[1] F. Cusset, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux Etats-Unis, Paris, La Découverte, 2005.
[2] J. Butler, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, La Découverte, [1990] 2006, p. 29.
[3] M. Foucault, La volonté de savoir. Histoire de la sexualité I, Paris, Gallimard, 1976, p. 113.
[4] J. Butler, Défaire le genre, Paris, Éditions Amsterdam, [2005] 2012, p. 67.
[5] M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, [1975] 2014, p. 242.
[6] M. Foucault, « Le sujet et le pouvoir », in Dits et écrits, vol. 2, Paris, Gallimard, 2001, p. 1046.
[7] J. Butler, La vie psychique du pouvoir. L’assujettissement en théories, Paris, Léo Scheer, [1997] 2002, p. 135.
[8] J. Butler, Défaire le genre, op. cit., p. 59.
[9] Ibidem.
[10] C’est là que Butler situe, dès Trouble dans le genre et dans ses travaux ultérieurs, le foyer de la résistance au pouvoir : la répétition différentielle ou itération, qui déstabilise les normes et font proliférer leurs effets.
[11] K. Ennis, Michel Foucault and Judith Butler: Troubling Butler’s Appropriation of Foucault’s Work, thèse de doctorat de l’Université de Warwick, Département de philosophie, 2008, p. 255.
[12] Ibid., p. 283, note 6.
[13] G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, Paris, PUF, [1966] 2013, p. 227.
[14] Ibidem.
[15] M. Foucault, Surveiller et punir, op. cit., p. 21 ; M. Foucault, Les anormaux. Cours au Collège de France. 1974-1975, Paris, Seuil-Gallimard, 1999, p. 46.
[16] M. Foucault, Surveiller et punir, op. cit., p. 174.
[17] Ibid., p. 214-215.
[18] Ibid., p. 215.
[19] Ibidem.
[20] On se souvient des différents types d’individualité que produisent les disciplines et dont Foucault dresse l’inventaire dans Surveiller et punir : individualité analytique et « cellulaire » corrélative de l’art des répartitions ; individualité naturelle et organique corrélative du contrôle de l’activité ; individualité sérielle et génésique corrélative de l’organisation des genèses ; individualité segmentaire et combinatoire corrélative de la composition des forces.
[21] M. Foucault, Les anormaux, op. cit., p. 46.
[22] Ibid., p. 40 et suiv. ; M. Foucault, Surveiller et punir, op. cit., p. 228 et suiv.
[23] J. Butler, Défaire le genre, op. cit.
[24] M. Foucault, Surveiller et punir, op. cit., p. 38.
[25] Voir notamment J. Butler, Trouble dans le genre, op. cit., p. 256-257 ; J. Butler, Ces corps qui comptent. De la matérialité et des limites discursives du « sexe », Paris, Éditions Amsterdam, [1993] 2009, p. 45-47 ; J. Butler, La vie psychique du pouvoir, op. cit., p. 135 et suiv. ; J. Butler, « Bodies and power, revisited », Radical Philosophy, n° 114, 2002, p. 13-19.
[26] Voir J. L. Austin, Quand dire, c’est faire, Paris, Points, [1962] 1991.
[27] F. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, cité dans J. Butler, Le pouvoir des mots. Discours de haine et politique du performatif, Paris, Éditions Amsterdam, [1997] 2004, p. 73. Voir aussi, pour une traduction française différente, J. Butler, Trouble dans le genre, op. cit., p. 96 : « l’“acteur n’a été qu’“ajouté” à l’acte – l’acte est tout ». C’est dans cette perspective que Butler conçoit le genre comme « un faire, mais non le fait d’un sujet qui précéderait ce faire » (ibidem).
[28] Voir L. Althusser, « Idéologies et appareils idéologiques d’État », in Sur la reproduction, Paris, PUF, 2011, p. 263-306.
[29] J. Derrida, « Signature événement contexte », in Limited Inc., Paris, Galilée, 1990, pp. 15-51
[30] Non sans une certaine originalité, Butler convoque une version « historicisée » de l’hylémorphisme aristotélicien en croisant celui-ci avec Foucault. Relativisant la vision d’une matière passive et informe soumise à l’empreinte d’un « schèma » actualisateur (J. Butler, Ces corps qui comptent, op. cit., p. 45), iel soutient que la matière doit être envisagée dans sa relation aux effets productifs et proprement matérialisants du pouvoir – de même que l’âme, envisagée comme instrument de pouvoir, produit et actualise, d’après Butler, le corps du prisonnier dans Surveiller et punir. En conséquence, iel redéfinit la matière comme « un processus de matérialisation qui, au fil du temps, se stabilise et produit l’effet de frontière, de fixité et de surface que nous appelons la matière » (ibid., p. 23). Le corps, la matière, la matérialité du corps ne sont jamais indépendants des normes et des actes qui l’investissent. Le corps, dans sa relation au pouvoir, est à la fois « the occasion and the condition of its productivity, where the latter is not finally separable from the former » (J. Butler, « Bodies and Power Revisited », op. cit., p. 187). La norme du genre/sexe peut alors atteindre le corps jusqu’à sa constitution matérielle, fixant certaines frontières corporelles et délimitant au fil du temps les zones qui formeront les traces, stables et « naturelles », du sexe.
[31] J. Butler, Trouble dans le genre, op. cit., p. 83 et suiv.
[32] Ibid., p. 259 (c’est l’auteurice qui souligne).
[33] Ibid., p. 35.
[34] M. Foucault, « Les moyens du bon dressement », in Surveiller et punir, op. cit., p. 200-227.
[35] K. Ennis, Michel Foucault and Judith Butler, op. cit., p. 223.
[36] J. Butler, Ces corps qui comptent, op. cit., p. 234.
[37] J. Butler, Rassemblement. Pluralité, performativité et politique, Paris, Fayard, [2015] 2016, p. 40.
[38] Ibid., p. 41.
[39] Ibidem.
[40] J. Butler, Trouble dans le genre, op. cit., p. 53, 89 et suiv.
[41] Ibid., p. 53.
[42] Ibid., p. 257.
[43] K. Ennis, Michel Foucault and Judith Butler, op. cit., p. 218.
[44] M. Foucault, Surveiller et punir, op. cit., p. 41 et suiv.
[45] L. Althusser, « Idéologies et appareils idéologiques d’État », op. cit., p. 274.
[46] Ibid., p. 276 (c’est l’auteur qui souligne).
[47] Ibid., p. 288.
[48] Ibidem.
[49] Ibid., p. 303.
[50] J. Butler, Le pouvoir des mots, op. cit., p. 77 (nous soulignons).
[51] J. Butler, La vie psychique du pouvoir, op. cit., p. 26.
[52] Sur ce point, voir K. Ennis, Michel Foucault and Judith Butler, op. cit., p. 248-250.
[53] Voir S. Freud, « Deuil et mélancolie », in Métapsychologie, Paris, PUF, [1917] 2010 ; S. Freud, Le moi et le ça, Paris, Payot & Rivages, [1923] 2010.
[54] J. Butler, Trouble dans le genre, op. cit., p. 148.
[55] M. Fœssel, « Malaise dans l’identification. La mélancolie du genre », in F. Brugère et G. Le Blanc (dir.), Judith Butler. Trouble dans le sujet, trouble dans les normes, Paris, PUF, 2009, p. 89-110.
[56] J. Butler, La vie psychique du pouvoir, op. cit., p. 206.
[57] Ibid., p. 209.
[58] J. Butler, Ces corps qui comptent, op. cit., p. 37.
[59] M. Foucault, La volonté de savoir, op. cit., p. 108-109.
[60] Ibid., p. 109.
[61] Ibid., p. 168.
[62] Ibid., p. 125.
[63] Ibid., p. 109.
[64] Ibid., p. 140.
[65] Ibid., p. 141.
[66] Ibidem.
[67] A l’exception peut-être de son ouvrage Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1972, où se trouve décrite la mise en place d’un régime d’exclusion et l’apparition des « anormaux » (les fous, bien sûr, mais aussi les débauchés, les libertins, les vénériens, les sodomites, etc.). En effet, la thèse sur laquelle repose le livre établit une opposition entre, d’un côté, le « Grand Renfermement » qui opère par la répression et impose le silence et, de l’autre, la liberté obtenue par la prise de parole et la transgression des interdits. C’est l’hypothèse notamment de Didier Éribon dans Réflexions sur la question gay, Paris, Fayard, 1999, p. 372 et suiv.
[68] M. Foucault, La volonté de savoir, op. cit., p. 108-109.
[69] Ibid., p. 59.
[70] Ibidem.