Comme l’eau au vase. Commentaires sur « Mariage et filiation pour tous » d’Irène Théry
Thomas Linard, ancien porte-parole de l’Inter-LGBT et spécialiste de la filiation, travaille sur les questions de genre, sexualités et LGBT.
[learn_more caption= »Résumé/Abstract »] La sociologue Irène Théry est communément perçue comme une scientifique engagée. Opposée à la fin des années 1990 au CUS, l’ancêtre du PACS, elle aurait su faire évoluer ses positions, et elle a acquis maintenant l’image d’une défenseuse du mariage pour les couples de même sexe, des techniques de procréation médicalement assistée et plus généralement des droits des LGBT. Cette nouvelle perception se fonde à la fois sur ce soutien actuel à ces revendications et sur son statut d’experte qui relèverait d’une forme d’objectivité apolitique. J’ai voulu interroger ses positions, notamment en matière de réforme de la filiation et de prétention à une expertise fondée historiquement et anthropologiquement, en mettant son dernier livre, Mariage et filiation pour tous, en discussion avec d’autres de ses écrits plus anciens sur le rôle du droit et sur sa conception des rapports entre le corps et l’identité ; avec L’Empire du ventre, le livre écrit par Marcela Iacub en 2004 sur l’histoire du droit de la filiation au XIXe et au XXe siècle ; et enfin avec d’autres propositions de réforme de la filiation. J’ai perçu une grande continuité dans ses positions, une fois celles-ci restituées dans leur contexte. On y retrouve notamment l’accent mis sur un nécessaire pluralisme dans les modes d’établissement de la filiation. Ce pluralisme qu’elle prône aujourd’hui fait écho à sa défense en 1999 du « pluralisme » dans les institutions servant à distinguer les individus en droit, et explique sa dénonciation de l’indifférentialisme, qui demeure au cœur de ses propositions et où il s’agit pareillement de promouvoir l’inscription de la distinction dans le droit et donc aussi dans la filiation.
Introduction
Tout en psychologie, notre droit matrimonial n’avait plus de place pour la donnée biologique, corporelle. Nul doute que le réalisme canonique ne lui ait inspiré quelque horreur. Le corps humain n’apparait pour ainsi dire jamais dans le code civil : l’homme y est personne, c’est-à-dire pur esprit.[1]
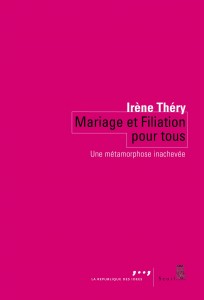 Le thème de la filiation et de sa réforme — la « filiation pour tous » — est un des axes principaux de Mariage et filiation pour tous, écrit par Irène Théry[2] (l’autre étant son regard de sociologue sur l’ouverture du mariage aux couples de même sexe). Ce ne serait guère exagéré de dire qu’il est un plaidoyer pour la réforme de la filiation qu’elle avait proposée, avec Anne-Marie Leroyer, dans le rapport Filiation, origines, parentalité[3], son ouvrage précédent. À sa lecture, une note, une simple note, qui serait passée inaperçue au plus grand nombre, peut pourtant être abordée comme une ouverture vers l’ensemble plus complet de ses propositions, notamment une question qui apparait comme un fil directeur de sa pensée : la nature de la relation entre le corps et l’âme. Nous verrons à quel point cette question est déterminante pour celle de la réforme du droit de la filiation.
Le thème de la filiation et de sa réforme — la « filiation pour tous » — est un des axes principaux de Mariage et filiation pour tous, écrit par Irène Théry[2] (l’autre étant son regard de sociologue sur l’ouverture du mariage aux couples de même sexe). Ce ne serait guère exagéré de dire qu’il est un plaidoyer pour la réforme de la filiation qu’elle avait proposée, avec Anne-Marie Leroyer, dans le rapport Filiation, origines, parentalité[3], son ouvrage précédent. À sa lecture, une note, une simple note, qui serait passée inaperçue au plus grand nombre, peut pourtant être abordée comme une ouverture vers l’ensemble plus complet de ses propositions, notamment une question qui apparait comme un fil directeur de sa pensée : la nature de la relation entre le corps et l’âme. Nous verrons à quel point cette question est déterminante pour celle de la réforme du droit de la filiation.
Cette note est à la page 64 et vient en appel de note de la phrase « on a tendance aujourd’hui à confondre filiation naturelle et lien biologique issu de la procréation ». Voici son contenu intégral :
Le livre de Marcela Iacub, L’Empire du ventre (Paris, Fayard, 2004), est entièrement construit sur la confusion entre enfant naturel et enfant biologique. Il a beaucoup contribué à disqualifier auprès des non-juristes l’une des plus importantes réformes de l’histoire du droit de la famille : la loi de 1972 établissant l’égalité des enfants naturels et légitimes.
Le livre de Marcela Iacub[4] est en réalité tout à fait majeur : il a déjà été critiqué d’un point de vue anthropologique, comme justement trop « enclos[e] dans l’étude de l’histoire du droit »[5], mais justement du point de cette histoire, pour nombre de spécialistes, il a permis de mieux comprendre le régime particulier de vérité qui avait cours au XIXe siècle et pendant une partie du XXe[6]. Ce qui, malgré le côté « provocant »[7] de certaines de ses analyses, devrait lui assurer un statut de livre incontournable, non escamotable. Manifestement, ce n’est pas le cas, et nous essayerons de voir pourquoi.
Une note dans son contexte
Une confusion entre l’enfant naturel et l’enfant biologique ?
Tout d’abord sur une supposée confusion entre l’enfant naturel (c’est-à-dire l’enfant né hors mariage, catégorie supprimée par la réforme de la filiation de 2005) et l’enfant biologique, voici ce qu’écrit Marcela Iacub :
À la différence de la maternité légitime, qui était un honneur, la maternité naturelle était une flétrissure. […] En fait, le régime spécial organisant l’établissement des filiations naturelles dans le Code de 1804, notamment leur caractère non automatique, qui les distingue fortement des filiations légitimes, s’explique par une exigence que les historiens de la famille d’aujourd’hui oublient trop souvent, mais qui était pourtant fondamentale aux yeux des rédacteurs du Code et des juristes du XIXe siècle : le caractère volontaire de toutes les filiations[8].
Ce caractère volontaire de toutes les filiations est illustré tout au long du livre. Ainsi, Marcela Iacub explique que la filiation paternelle ne s’embarrassait pas forcément de vraisemblance biologique : « Les reconnaissances paternelles, quant à elles, n’étaient tenues à aucune forme de vraisemblance »[9] et elle expose plusieurs cas de reconnaissances paternelles multiples (toutes valables en même temps) ou de différence d’âge « invraisemblable » (dont le cas d’un père parisien au début du XXe siècle moins âgé que l’enfant qu’il reconnait).
Qu’est-ce qui a donc pu motiver cette lecture si particulière d’un livre « entièrement construit sur la confusion entre enfant naturel et enfant biologique » ? Deux passages pourraient se prêter à cette interprétation :
une lutte ente le sang et l’institution, la vérité et les fictions […]. Cette guerre se conclura par la défaite du mariage, non parce que celui-ci aurait été aboli, mais parce que les procédures de vérité en cours pour les filiations naturelles allaient désormais être admises pour les filiations légitimes. […]
La période qui s’étend de 1900 à 1970 voit l’enfant naturel, et donc la filiation par le sang, s’attirer une position toujours plus importante[10].
Comment concilier « le caractère volontaire de toutes les filiations » et « l’enfant naturel, et donc la filiation par le sang » ? C’est que, pour Marcela Iacub, le mariage disposait d’un régime de vérité qui le rendait beaucoup moins dépendant des faits biologiques, au point qu’elle juge que le mariage fournissait « des techniques de procréation juridiquement assistée, puisqu’elles étaient inattaquables »[11].
Spécialement, elle s’attarde longuement sur les mécanismes juridiques qui rendaient inattaquable pour un couple marié la supposition d’enfant. Le cas typique étant un couple en mal d’enfant qui, par arrangements privés avec une femme enceinte ne souhaitant pas garder son enfant, se déclarait parents de l’enfant (alors que la paternité n’a jamais eu à subir un régime de vérité sévère, cela revenait concrètement à admettre une maternité fondée, non pas sur la vérité du ventre et de l’accouchement, mais sur la vérité d’une volonté et d’un engagement), la parturiente dissimulant son accouchement. Déjà au VIe siècle, le Digeste de Justinien condamnait cette pratique, qui resta condamnée pendant des siècles jusqu’au Code civil de 1804. Cette pratique restait condamnée dans le Code pénal, mais le Code civil, par des mécanismes juridiques[12] que Marcela Iacub détaille et illustre longuement[13], mettait les couples mariés à l’abri des poursuites et des rétractations. Et pour elle, cette protection est « paradigmatique du régime de vérité du Code napoléonien »[14].
Paradigmatique, car, si elle n’oublie pas les autres techniques juridiques permettant d’attribuer au couple marié des enfants que ce couple n’avait pas conçus (notamment pour le mari), elle les met en regard de l’exigence de vérité corporelle envers la maternité qui prévaut depuis 1972, à la suite de la réforme de la filiation du 3 janvier 1972 qui supprima cette protection contre les poursuites et les rétractations :
Cette réforme a créé un nouveau statut de la maternité dans le mariage : désormais, celle-ci devra être absolument vraie [c’est-à-dire : corporelle]. La supposition et la substitution d’enfant ne seront plus possibles. Bref, le véritable sens de cette réforme se repère par la façon dont elle a mis en place plusieurs dispositifs légaux qui ont rendu vraie, non négociable et d’une fixation automatique, la position maternelle dans le mariage[15].
D’où la « disqualification » de la loi de 1972 qu’Irène Théry reproche à Marcela Iacub. Cette dernière précise d’ailleurs au sujet de cette loi :
Il est vrai qu’elle a posé le principe d’égalité de tous les enfants, mais celui-ci n’a véritablement été accompli que trente ans plus tard, lorsqu’enfin les enfants adultérins ont pu accéder aux mêmes droits successoraux que les enfants légitimes ou les naturels simples[16].
Pour Irène Théry — mais sans indiquer sur quelle autorité elle s’appuie —, la supposition d’enfant n’a pas cessé d’être condamnée :
Le Code a ainsi déroulé le tapis rouge pour des carrières de séducteurs invétérés, sans parler des agressions et des viols envers les filles et femmes de condition sociale subordonnée […], le droit n’autorise aucun jeu avec la vérité de la procréation, au point que la recherche en maternité est expressément prévue par l’article 341 du Code civil. Pour elle, toute feinte est un crime gravement puni : le crime de supposition d’enfant (si la femme prétend faussement être la génitrice d’un enfant dont elle n’a pas accouché) […] Ici s’enracine l’immense drame des filles-mères du XIXe siècle[17].
Au-delà de la condamnation de L’Empire du ventre, les deux livres s’opposent en fait fondamentalement.
Deux récits diamétralement opposés
Ce sont véritablement deux histoires de la filiation que chaque autrice déroule. D’abord les méthodes s’opposent : Irène Théry écrit cette histoire sans s’appuyer sur des sources extérieures ou des recherches personnelles (sinon une source : Emmanuelle Saada, Les enfants de la colonie : les métis de l’Empire français entre sujétion et citoyenneté, 2007). Marcela Iacub s’appuie essentiellement sur ses propres recherches, qu’elle détaille abondamment. Elle dénonce d’ailleurs les épopées racontées sur cette histoire (ce qui à l’époque vise déjà probablement Irène Théry) :
De nos jours, l’histoire de la filiation se raconte comme l’épopée des filles-mères et des enfants naturels se libérant peu à peu de l’oppression du mariage. […] Le Code de 1804 […] offrait, certes, bien des rigueurs, mais il avait cette beauté rare de placer les volontés humaines au-dessus des faits naturels et des valeurs religieuses[18].
Ou encore :
Le mythe historique de la fille-mère séduite et abandonnée par quelque Marius irresponsable, et devant faire face seule aux rigueurs du Code et à la désapprobation de la société, est tellement essentiel à la légitimation idéologique que nous donnons à notre modernité familiale que nous en avons effacée de notre mémoire l’ensemble des dispositifs juridiques qui garantissait rigoureusement le caractère volontaire des filiations maternelles naturelles[19].
Et quand Irène Théry écrit que « [l’]égalisation des droits des enfants […] s’amorce en 1912, avec la fin de l’interdiction de recherche en paternité »[20], Marcela Iacub semble lui répondre par anticipation : « Le droit d’Ancien Régime qui ne brillait pas particulièrement par son caractère moins “patriarcal” que le droit napoléonien, admettait, lui, la recherche de paternité »[21]. Si elle reconnait que « le stigmate des filiations naturelles avait incontestablement des conséquences désastreuses sur les enfants qui étaient nés hors mariage »[22], elle détaille les mécanismes qui contrebalancent le récit classique :
l’interdiction d’entamer des actions en recherche de paternité n’empêchera pas la Cour de cassation, dès 1845, d’autoriser la condamnation, sous le fondement de la responsabilité civile, de l’homme qui, après avoir séduit dolosivement une jeune fille, l’avait abandonné — elle et son enfant[23].
Ainsi que :
Certes, le Code avait autorisé la recherche forcée de la filiation maternelle. Mais il se dressait tant d’obstacles sur la voie de cette action qu’elle revenait, au fond, à la faire reposer pratiquement sur la volonté de la femme[24].
Pour Irène Théry, l’établissement de la filiation organisée par le Code civil de 1804 reflète la hiérarchie des sexes : « Nulle part la hiérarchie des sexes n’est aussi forte que dans la filiation naturelle […] la mère est celle qui accouche »[25] et passe par « une opposition majeure entre les filiations maternelle et paternelle »[26]. Et c’est pour cela qu’elle affirme, comme si Marcela Iacub n’avait jamais écrit le contraire : « Ainsi, alors que la femme mariée n’a, pas plus que la femme non mariée, le droit de reconnaître pour sien un enfant qu’elle n’a pas procréé, le mari y est juridiquement autorisé »[27].
Ces différences structurent le récit respectif que Irène Théry et Marcela Iacub font de l’histoire de l’évolution du droit de la filiation en France. Et pour expliquer le point de vue d’Irène Théry, il me semble qu’il nous faut faire appel à d’autres de ses écrits.
Une pensée dans son contexte
De l’âme et du corps
Un des fils conducteurs de la pensée d’Irène Théry est la recherche d’un apport de la pensée anthropologique sur la question de la relation entre le corps et l’âme (ou identité, elle semble utiliser les deux termes comme équivalents — et cela ne lui sera pas reproché ici, comme il s’agit avant tout de comprendre le sens et la portée qu’elle attribue à ces termes).
Cette question, très ancienne, est déjà présente chez les premiers Pères de l’Église : L’Épitre à Diognète affirme que « l’âme est répandue par tous les membres du corps ». Pour Irénée de Lyon « les âmes ont la forme du corps qui le reçoit, elles s’adaptent comme l’eau au vase ». Certains Pères trouveront cette image trop fluide et diront que la relation de l’âme et du corps est comme celle de l’eau gelée dans un seau[28].
Ces conceptions de l’âme comme très liée au corps ne rencontreront une véritable opposition qu’après le Moyen Âge (après tout, une telle conception étayait l’ordre féodal et sa division entre nobles de naissance et roturiers de naissance). Le jurisconsulte Charles Loyseau (1566-1627), pour justifier que les non-nobles puissent être dotés d’un noble esprit et donc être apte à occuper charges et offices, promeut un lien nettement moins étroit entre l’âme et le corps, et écrit dans son Traité des ordres et simples dignités (1613) : « l’âme raisonnable des hommes, venant immédiatement de Dieu… n’a point de participation naturelle aux qualités de la semence générative du corps, où elle est colloquée ». Âme et corps étant ainsi moins dépendants l’un de l’autre, les parents ne peuvent que transmettre une noblesse corporelle. Leur âme venant de Dieu, un roturier peut avoir une âme très noble s’il plait à Dieu : à sa manière, cette conception nouvelle prépare les Lumières, la Révolution et l’avènement de l’idée d’égalité.
Le sujet de la relation de l’identité au corps est donc, et on le sait depuis longtemps, éminemment politique. Irène Théry a exposé sa propre conception dans Qu’est-ce que la distinction de sexe ?[29] Elle porte tout d’abord sa critique sur la conception chrétienne primitive où « [l’]on se met à considérer le corps comme le tabernacle de l’esprit, autrement dit comme une unité individuelle enclosant en lui une âme personnelle déposée par Dieu »[30], mais elle voit franchi un nouveau palier dans « les philosophies de la conscience des XVIIe et XVIIIe siècles (Descartes, Locke…) [qui] ont conçu l’opposition de l’âme et du corps », car leurs concepts gouverneraient encore « l’idéologie individualiste dans laquelle nous baignons »[31].
Elle met en avant positivement, par contraste, la conception des sociétés traditionnelles ou « sociocosmiques » :
… ces sociétés ne croient ni au « biologique » ni à « la différence sexuelle » ni à « la sexualité » comme à une sorte de socle originel ultime, une base en dernière instance. Elles ne séparent pas le corps et l’esprit, la nature et la culture, comme deux entités substantielles ou deux règnes séparés entre lesquels le problème serait de chercher l’articulation[32].
C’est pourquoi elle critique le concept de genre entendu communément par les études de genre, comme contraire à la vision uniciste de l’âme et du corps qu’elle veut mettre en avant :
On voit que le concept de genre est ici construit sur deux piliers : le premier est l’opposition fondatrice entre le sexe biologique et le genre psychologique/social d’un individu.
Le second est la définition de ce sexe et ce genre comme les marqueurs des identités respectives de deux composantes de la personne, son moi d’un côté (doté d’une identité de genre) et son corps de l’autre (doté d’une identité de sexe)[33].
Elle insiste sur l’apport des sciences sociales, qui permettraient de penser le genre différemment, comme un genre relationnel, alors que les conceptions opposées fonderaient la hiérarchie des sexes, notamment les « théories féministes “classiques” (y compris les plus radicales) » qui ne permettraient pas de rendre compte des « actions, représentations et valeurs des sociétés traditionnelles », car elles « supposent de tenir pour acquis qu’une personne est constituée d’un corps doté d’un sexe et d’un moi doté d’un genre » et elles laissent hors champ « l’étude sociologique des actions et des relations »[34].
Elle critique la conception moderne des sexes qu’elle estime fondée sur l’identité personnelle, et qui chercherait à expliquer la différence des sexes par la différence ontologique (justifiant en même temps leur hiérarchisation). Ainsi, cette conception prétendrait « qu’agir n’est au fond rien d’autre qu’une conséquence “dans le corps”, dont la cause est le “moi” (self) intérieur ». Mais, pour Irène Théry, les sciences sociales s’efforcent de « déconstruire ces conceptions radicalement antisociologiques et anhistoriques de la nature humaine universelle », et précisément les sociétés traditionnelles nous enseigneraient une conception fondée, non sur l’identité et l’ontologie, mais sur la relation : leurs « manières d’agir masculines ou féminines instituées […] disaient non ce que vous étiez, mais ce que vous deviez faire, non ce que vous alliez faire, mais ce qui était attendu de vous »[35].
Il y aurait donc bien une nature humaine universelle, structurée par la différence des sexes. Les sciences sociales permettraient de l’appréhender, mais cette différence serait relationnelle et non pas de nature ontologique comme des courants conservateurs le prétendraient, sans être non plus comme les théories féministes la concevraient, même les plus radicales, qui resteraient « engluées » dans une conception dualiste opposant le corps et le moi, l’identité.
Rupture ou continuité ?
On a pu prétendre, à la lecture de son opposition à l’époque des débats autour du CUS et du pacs et à celle de son approbation plus récente du mariage égalitaire, qu’elle avait « changé d’avis ». C’est là une lecture bien superficielle de ses arguments, ou même une absence de lecture tout court. Irène Théry, elle l’a dit et exposé alors, s’est opposée à certains aspects du projet de pacs pour des raisons qui ont trait à la filiation : elle voulait que les couples soient distingués en droit, mais surtout, elle craignait que les mécanismes d’établissement de la filiation s’appliquant au sein des couples de sexe discordant s’appliquent aux couples de même sexe : « J’étais déjà pour que ces couples aient les mêmes droits que les autres mais au travers d’une union civile. “Le cœur du mariage, ce n’est pas le couple mais la présomption de paternité”, disait Jean Carbonnier, le grand réformateur du droit de la famille. J’estimais donc, pour cette raison, qu’il n’était pas possible d’appeler “mariage” l’union d’un couple de même sexe »[36].
La question de la filiation étant souvent un impensé, un sujet défavorisé de la production intellectuelle, on peut comprendre que ses raisons n’ont pas été comprises. Mais elle défendait en réalité déjà ce qu’elle défend aujourd’hui : qu’il ne soit pas créé de « confusion » entre la filiation « charnelle » et la filiation « intentionnelle » — et en poussant l’interprétation un peu plus loin, bien qu’elle ne se soit jamais exprimée ainsi : qu’il soit reconnu qu’il y a de l’âme dans le corps.
Elle craignait que le pacs, et plus encore le mariage, en faisant bénéficier les couples de même sexe des techniques d’établissement de la filiation propre aux couples mariés, comme la présomption de paternité, engendre cette confusion ; elle ne le craint plus — d’où son apparent revirement. Mais ce n’était pas le centre de son opposition — revirement apparent, non qu’il faille douter de sa sincérité, mais parce qu’il n’y a de changement qu’à la périphérie. Au centre de son argumentation, il y a continuité.
L’ordre symbolique
Déjà en 1997, en s’opposant au CUS, l’ancêtre du pacs, elle mettait en avant l’idée que le droit doit assumer la fonction d’un ordre symbolique. Tout en assurant l’égalité, le droit doit distinguer entre les individus :
À travers le CUS, certains prônent l’indistinction en droit parce qu’ils souhaitent que les différences s’expriment dans les mœurs et la culture. Moi, je prône le contraire : reconnaître les différences dans l’ordre symbolique et, dans les mêmes quartiers, permettre à tous de s’asseoir aux terrasses des mêmes cafés. Il ne faut pas, sous prétexte de républicanisme, céder à la tentation moderne de la désymbolisation[37].
Dans « Pacs, sexualité et différence des sexes »[38], écrit en 1999, elle identifie les deux camps auxquels elle s’oppose. D’un côté les « organicistes » ou néo-organicistes :
La tentation que l’on pourrait nommer organiciste est justement celle qui considère que reproduction, sexualité, famille et organisation sociale des rôles sexués seraient une seule et même chose. Elle fait comme si les fictions symboliques qui inscrivent dans la signification la copulation et la reproduction ne faisaient que reconnaître un ordre naturel préexistant[39].
De l’autre côté, elle place à équidistance les « identitaristes » :
Pourtant, la confusion du sexué et du sexuel n’est pas l’apanage des homophobes. Elle est aussi, sous une autre forme, au centre de la rhétorique d’un courant militant qui, pour être peu nombreux, n’en a pas moins bénéficié d’une percée médiatique équivalente à celle du courant néoorganiciste lors du débat sur le Pacs : le courant identitariste[40].
Et ces identitaristes, dans une violente charge, sont accusés de promouvoir un « antirépublicanisme », puisque cet identitarisme demanderait au droit « d’abolir les distinctions symboliques ». Le projet qu’elle dénonce serait de concevoir le droit comme une simple « machine à distribuer uniformément les droits individuels » et non pas comme fondateur du « lien social, du sens et des valeurs ». Elle en conclut que l’identitarisme « peut aisément passer pour “universaliste” », mais elle en dénonce la fourberie, car il utiliserait « de façon politicienne la référence aux droits de l’homme »[41].
Plus spécifiquement, les identitaristes sont accusés de promouvoir l’indifférenciation en droit et elle dénonce la « confusion » au fondement de leur « rhétorique identitariste » : celle « du sexué et du sexuel ». Car dans cette rhétorique, il n’y aurait pas de dimension sexuée dans « l’ordre symbolique commun » (c’est-à-dire le droit)[42].
Et cette conception mènerait, par un « combat radical dont l’enjeu est l’effacement juridique de la différence des sexes », à « l’expulsion politique de l’hétérosexualité », à se débarrasser « de la nature », pour désincarner les individus, « c’est-à-dire des esprits dont l’enveloppe charnelle sera enfin tenue pour ce qu’elle est : du substrat biologique »[43].
Ainsi, pour se tenir à égale distance des deux dangers qui guettent, il faudrait distinguer et promouvoir l’inscription de la distinction dans le droit. Elle appelle pluralisme l’institution par le droit des modèles différents de prise en compte des couples et des filiations, quoique conférant les mêmes droits. Ainsi, elle croit déceler entre les deux courants qu’elle a identifié un point commun : le refus de ce « pluralisme ». Les organicistes ne voudraient qu’une seule institution pour le couple (le mariage) et une seule sexualité (la sexualité procréative), et ne pas reconnaitre d’autres formes (car ce serait « l’engrenage par lequel les formes inférieures d’existence se font passer pour les égales de l’accomplissement moral suprême »). Les identitaristes voudraient un seul mariage, qu’elle qualifie « d’asexué », une seule filiation (« asexuée » elle aussi) : leur refus de la distinction viendrait de leur volonté de remplacer « la sujétion au biologique par la toute-puissance de la volonté »[44].
En somme, il faudrait affirmer la pluralité des filiations et la dualité des sexes pour se prémunir des véritables dangers : la mixité (ou dualité) de la filiation qu’elle propose serait « une réponse aux tentations réductionnistes qui nous tirent soit vers le tout biologique, soit vers le tout volonté » qui indiquerait « par sa dualité le dualisme qu’elle refuse : celui de l’âme et du corps. Nous ne sommes ni de purs esprits, ni du substrat biologique ». Car, pour elle, on fait du biologique un « rien » lorsqu’on nie que l’engendrement serait chargé de signification. Et on fait du biologique un « tout » lorsqu’on assimile le parent au géniteur « à coup d’usage généralisé des empreintes génétiques »[45].
Quelle réforme de la filiation ?
Ces débats anciens restent présents dans la pensée actuelle d’Irène Théry puisqu’on retrouve dans Mariage et filiation pour tous sa dénonciation de « l’indifférentialisme » :
C’est ainsi que le juriste Daniel Borrillo, un des plus ardents défenseurs du dogme de l’indifférenciation […]. Au-delà, pour cet auteur, toute attention portée au corps est l’indice d’un « naturalisme » biologisant. La filiation devrait être redéfinie comme uniquement adoptive, car fondée exclusivement sur la volonté[46].
Concernant la filiation, le rapport d’Irène Théry et Anne-Marie Leroyer, déjà cité, contient un ensemble de propositions pour réformer le droit de la filiation en France, dont on pouvait déjà lire l’esquisse, pour certaines, dans un article d’Anne-Marie Leroyer paru en 2013[47]. La proposition centrale de cet ensemble est d’instaurer un mode d’établissement de la filiation propre, sui generis, à la procréation médicalement assistée (PMA ou AMP) avec don de gamètes (fort semblable aux règles d’établissement de la filiation par procréation médicalement assistée avec don de gamètes dont il est disposé aux articles 235-8 et 235-13 du livre II du Code civil catalan) :
instituer une « déclaration commune anticipée de filiation » au moment du consentement des parents d’intention à l’AMP. Ceci est l’une des propositions les plus importantes de notre rapport Filiation, origines, parentalité[48].
Une extension des modes existants à l’homoparentalité
Bien entendu, ce n’est pas la seule voie possible en matière de réforme de la filiation. Dans la procréation médicalement assistée par tiers donneur, il s’agit de personnes stériles devenant parents sans passer par l’adoption, et même plus précisément, en utilisant actuellement en droit français les mêmes mécanismes que la vaste majorité de la population : le simple fait de l’accouchement pour les femmes, la présomption de paternité (en cas de mariage) ou la reconnaissance (hors mariage) pour les hommes. Dans le cas des couples de sexe discordant, ces hommes et ces femmes peuvent passer pour géniteurs. Ce n’est plus le cas avec une procréation médicalement assistée pour un couple de même sexe, qui interroge ainsi la signification même des modes d’établissement, prétendument fondés sur des gènes communs entre parents et enfants. La PMA avec tiers donneur, et plus largement les LGBTparentalités — les formes diverses que prennent les situations de parentalités chez les personnes LGBT et les moyens d’y accéder — se révèlent donc porteuses d’une contagion révolutionnaire pour l’ensemble de l’ordre procréatif. Et certains pays ont tenté d’aménager ce potentiel, d’ouvrir la soupape, en prenant en compte la plus simple de ses formes : l’assistance médicalisée à la procréation avec tiers donneur pour les couples de femmes.
Pour prendre le cas de la Belgique, dont le droit partage avec le droit français le Code civil de 1804 comme constituant historique, la présomption de paternité[49] (qui attribue automatiquement la paternité à l’époux de la femme ayant accouché) a été étendue en 2014 en une présomption de coparenté pour la conjointe de la parturiente. La reconnaissance[50] (c’est-à-dire le mode traditionnel d’établissement de la filiation pour les personnes qui ne sont pas liées entre elles par le mariage) a de même été étendue aux couples de femmes non mariées.
Un mode d’établissement de la filiation sui generis pour la PMA avec tiers donneur
La chose ne surprendra personne ayant lu ses dénonciations de « l’indifférentialisme » citées plus avant : Irène Théry rappelle dans Mariage et filiation pour tous son opposition à cette extension d’un mécanisme propre aux couples de sexe discordant :
la présomption de paternité […] demeure une présomption de procréation […] Elle n’a pas d’application dans le cas des couples de même sexe[51].
C’est là un exemple de la remarquable continuité dans les positions d’Irène Théry : on se souviendra que, pour elle, il est impératif de distinguer entre les filiations, même si elles doivent conférer les mêmes droits. Elle condamne donc un mode d’établissement de la filiation où on ne distinguerait pas ce qu’elle nomme « filiation charnelle » (la filiation où l’on peut supposer, de par la différence des sexes, que les parents sont géniteurs de leurs enfants) et la filiation par PMA avec tiers donneur, comme le fait la loi belge. Car il s’agit, en distinguant ainsi, de montrer la part respective de corps et de volonté à l’œuvre pour faire advenir un enfant :
lorsqu’un couple fait appel à un tiers donneur […] ce couple, où l’un procrée et l’autre pas, unit au sein d’un même projet parental et pour que naisse un même enfant les deux valeurs que le débat français s’obstine à opposer. […] l’idéologie dominante […] tend systématiquement à les ramener soit du côté du tout biologique, soit, à l’inverse, du côté du tout volonté, quitte à imposer au réel de telles distorsions qu’il en devient irreprésentable[52].
Les « distorsions imposées au réel » seraient liées à des conceptions erronées de la nature humaine (erronées car non fondées sur les sciences sociales), « la conception dualiste de la personne qui domine aujourd’hui (un moi doté d’un genre et un corps doté d’un sexe) »[53], ou ignorant la valeur symbolique et instituante du droit :
C’est pourquoi penser qu’on peut trouver dans une certaine attitude psychologique de l’adulte envers l’enfant, le fondement universel de la filiation est une forme de naturalisme contemporain, méconnaissant le rôle fondamental de l’institution dans la vie humaine[54].
Et c’est aussi pourquoi un mode d’établissement de la filiation propre et réservé à la PMA avec tiers donneur, couplé avec la fin de l’anonymat des dons, permettrait d’identifier toutes les personnes ayant corporellement contribué à faire venir l’enfant au monde — d’où son insistance pour le droit d’accès aux « origines ». Elle propose ainsi la notion d’engendrement, comme étant à même de rendre compte de la globalité de son approche, où volonté et corps sont liés :
la notion d’engendrement est particulièrement heuristique, car elle permet de rendre compte d’une dimension essentielle de l’AMP avec tiers donneur, que manquent les descriptions fondées sur le « projet parental » entendu au sens de l’expression pure de la volonté. Comme nous l’avons rappelé plus haut, les deux valeurs que l’on présente systématiquement comme les plus opposées, les plus contradictoires, quand on cherche à définir le « vrai parent » en opposant le parent biologique et le parent social (psychologique), sont liées au sein d’un même couple, d’un même projet d’engendrement[55].
Plusieurs fois, elle insiste sur la proposition centrale du rapport de 2014, à chaque fois en insistant sur un nécessaire pluralisme dans les modes d’établissement de la filiation, qui fait écho à sa défense en 1999 du « pluralisme » dans les institutions servant à distinguer les individus en droit :
Le rapport Filiation, origines, parentalité dessine et détaille ce que pourrait être une réforme d’ensemble de la filiation instituant un droit « commun à tous et pluraliste » conforme aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle. […]
Pourtant, une réforme ambitieuse du droit de la famille, qui rendrait accessible à tous la nouvelle cohérence d’un droit de la filiation à la fois commun et pluraliste, est à notre portée[56].
Une filiation vraiment pour toutes et tous
Pour comprendre la portée de la réforme proposée, il faut la mettre en perspective avec d’autres propositions. Nous avons vu l’exemple du droit belge, nettement repoussé par Irène Théry, mais il est intéressant d’examiner ce qui se dessinait déjà dans L’Empire du ventre, où Marcela Iacub disait[57] : « les enfants trouvent fondamentalement leur origine dans la volonté de leurs parents de fonder une famille ».
Se faisant l’avocate d’un « modèle non corporel, intentionnel, de la filiation »[58], elle évoquait les impasses du droit de la filiation et voyait deux évolutions possibles : « S’ouvrent ici deux branches d’une alternative. La première consiste à poser un fondement non corporel pour toutes les filiations, maternités comprises : la volonté d’avoir un enfant. La deuxième est celle de la contrainte génétique prônée par le mouvement des origines »[59]. Pour la première branche de l’alternative, Daniel Borrillo, cet « ardent défenseur du dogme de l’indifférenciation » si l’on en croit Irène Théry, écrivait en 2012 une sorte de « cahier des charges » de ce que pourrait être une réforme de la filiation allant dans ce sens[60], et qui correspond à ce que j’ai essayé de rendre concret au travers de ma proposition de loi[61] : un système qui, ne regardant pas les personnes selon l’angle de leurs puissances corporelles, rend l’établissement de la filiation indépendante du genre, du nombre (pluriparentalité), de l’orientation sexuelle et de la situation matrimoniale des parents, ainsi que des modes de conception — pour aller plus loin que la seule prise en charge des PMA des couples de femmes ; tout en donnant la possibilité d’inscrire les noms de toutes les personnes ayant participé par leurs puissances procréatives à l’advenue de l’enfant, parce que cette connaissance n’a pas à mon sens à être vue comme menaçante pour la filiation.
En effet, j’écris dans l’introduction : « La filiation ne relève pas d’un ordre prépolitique, qu’il soit révélé, naturel ou anthropopsychologisant. Il n’est de filiation qu’artificieuse : le droit n’est pas le simple enregistrement de faits naturels ». Non que je veuille promouvoir dans le droit une conception spiritualiste des personnes. Mais je pense qu’il est bon que le droit fasse comme si les personnes étaient purs esprits. Attribuer des droits en fonction des puissances corporelles me semble donner à l’État des moyens de contrôle illégitimes. Marcela Iacub écrivait à ce sujet : « La volonté de vérité […] dit quelque chose sur la manière dont l’État s’attache aux corps, se les approprie, fait des puissances sexuelles et procréatrices quelque chose où se joue sa propre puissance… »[62].
Un projet politique non assumé ?
Un des enjeux du débat en matière de filiation est de savoir s’il existe une position neutre, naturelle, qui irait de soi. La proposition de réforme d’Irène Théry a ses vertus et ses faiblesses, et pourrait être discutée, comme toute proposition. Là où la démarche pose question, c’est dans le récit historique et anthropologique qui est invoqué pour la légitimer — alors qu’à priori elle n’en avait pas la nécessité —, comme si justement elle n’était pas un choix politique, mais relevait de l’évidence, du bon sens, de la force de ce qui, immémorablement, structure les sociétés : en somme, elle relèverait d’une nature supérieure, du pré-politique. Dans cette perspective, nous voyons que L’Empire du ventre est le gêneur, l’empêcheur de raconter des mythologies en rond.
Le refus de tenir le moindre compte des avancées dans notre connaissance de l’histoire de la filiation que L’Empire du ventre a apporté interroge. Plutôt que de lui accorder une place d’égal à égal dans le débat, et donc d’entreprendre la tâche, certes difficile, mais après tout pas impossible (pas forcément dans Mariage et filiation pour tous, assez vulgarisateur, mais, depuis 2004, une autre publication aurait pu s’atteler à cette tâche), de réfuter les affirmations gênantes par des contre-analyses des jurisprudences citées, ou la convocation d’autres jurisprudences à l’appui de thèses opposées, bref, plutôt que de proposer une démarche scientifique, il est choisi un dénigrement vite expédié en une note de bas de page. Ce contournement de l’obstacle ne plaide pas en faveur de la force et de la bonne assise des positions défendues par Irène Théry.
Mais d’un autre côté, comment pourrait-il en être autrement ? L’Empire du ventre était déjà en quelque sorte une réponse argumentée historiquement aux premiers écrits d’Irène Théry sur l’histoire de la filiation. Avec ses analyses historiques en face desquelles Irène Théry ne met rien de très étayé, le livre vient saper le fondement historique de sa démonstration : le droit de la filiation n’a pas été l’épopée d’une libération de la hiérarchie des sexes, il n’a pas toujours été fondé sur le régime de la vérité des corps, mais a su, à certaines époques, imaginer d’autres vérités, notamment celle du mariage, mais aussi celle de la volonté d’être parent. Et si la volonté transparait comme le fondement de toutes les filiations, se pose la question qu’Irène Théry redoute peut-être le plus que nous nous posions : pourquoi les distinguer ?
Et c’est peut-être en prenant conscience de l’importance structurante pour la pensée d’Irène Théry de sa conception des rapports entre le corps et l’identité, conception qu’elle adosse à une nécessité pour le droit de distinguer les individus, que l’on comprendra mieux la dimension politique de ses propositions en faveur d’une réforme du droit qui distinguerait les filiations et soulignerait les apports corporels et volontaires respectifs de toutes les personnes impliquées dans la venue au monde d’un enfant.
Ainsi, au rebours de l’invitation implicite à ne pas lire Marcela Iacub contenue dans la note de Mariage et filiation pour tous que je donnais en ouverture de cet article, je dirais qu’il faut lire Théry. Il faut restituer ses idées dans le projet qui est le leur. Et pour cela, il faut aussi lire Marcela Iacub.
[1] Jean Carbonnier, Terre et ciel dans le droit français du mariage, Paris, LGDJ, 1950.
[2] Irène Théry, Mariage et filiation pour tous : Une métamorphose inachevée, Paris, Seuil, coll. « La république des idées », 2016.
[3] Irène Théry et Anne-Marie Leroyer, Filiation origines parentalité : le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, Paris, Odile Jacob, 2014.
[4] Marcela Iacub, L’Empire du ventre : Pour une autre histoire de la maternité, Paris, Fayard, coll. « Histoire de la pensée », 2004.
[5] Fine Agnès, Martial Agnès, « Vers une naturalisation de la filiation ? », Genèses, 1/2010 (nº 78), p. 121-134, https://www.cairn.info/revue-geneses-2010-1-page-121.htm
[6] Comme par exemple Emmanuelle Saada, Les enfants de la colonie : les métis de l’Empire français entre sujétion et citoyenneté, Paris, La Découverte, coll. « L’espace de l’Histoire », 2007, p. 24.
[7] Nadine Lefaucheur, « Marcela Iacub, L’empire du ventre. Pour une autre histoire de la maternité, Paris, Fayard, collection « Histoire de la pensée », 2004, 359 p. », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, 2005 (nº 21), p. 318-324, https://clio.revues.org/1493.
[8] Marcela Iacub, L’Empire du ventre, op. cit., p. 103-104.
[9] Ibid., p. 176.
[10] Ibid., p. 126-127.
[11] Ibid., p. 76.
[12] Dont l’un (la possession d’état) n’était valable que pour la filiation légitime — la filiation des enfants issus des couples mariés. Cf. Thomas Linard, « Possession d’état », Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Possession_d%27état.
[13] Articles 322 ancien (« Nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance ») et 327 ancien (« L’action criminelle contre un délit de suppression d’état ne pourra commencer qu’après le jugement définitif sur la question d’état ») du Code civil. Pour un exposé plus détaillé : Thomas Linard, « Simulation d’enfant », Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Simulation_d%27enfant.
[14] Marcela Iacub, L’Empire du ventre, op. cit., p. 69.
[15] Ibid., p. 155.
[16] Ibid., p. 153.
[17] Ibid., p. 65.
[18] Ibid., p. 16-17.
[19] Ibid., p. 105.
[20] Ibid., p. 74.
[21] Ibid., p. 108.
[22] Ibid., p. 341.
[23] Ibid., p. 112.
[24] Ibid p. 115.
[25] Irène Théry, Mariage et filiation pour tous, op. cit., p. 64.
[26] Ibid., p. 98.
[27] Ibid., p. 67.
[28] Jean-Marc Lepain, Archéologie du royaume de Dieu, non paru.
[29] Irène Théry, Qu’est-ce que la distinction de sexe ?, Bruxelles, Yapaka, coll. « Temps d’arrêt », 2010, http://www.yapaka.be/professionnels/publication/qu-est-ce-que-la-distinction-de-sexe-irene-thery
[30] Ibid., p. 43-44.
[31] Ibid., p. 43-44.
[32] Ibid., p. 36-37.
[33] Ibid., p. 25.
[34] Ibid., p. 28-29.
[35] Ibid., p. 46-47.
[36] Christel De Taddeo et Irène Théry, « Le mariage n’est plus le socle de la famille », Le Journal du dimanche, 3 novembre 2012, http://www.lejdd.fr/Societe/Actualite/Le-mariage-n-est-plus-le-socle-de-la-famille-interview-573160
[37] Jacqueline Remy et Irène Théry, « Non au mariage bis des concubins ! », L’Express, 2 octobre 1997, http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sexualite/non-au-mariage-bis-des-concubins_491894.html
[38] Irène Théry, « Pacs, sexualité et différence des sexes », Esprit, nº 257, octobre 1999, p. 139-181, http://esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=9722
[39] Ibid., p. 157.
[40] Ibid., p. 162.
[41] Ibid., p. 162-163.
[42] Ibid., p. 165-170.
[43] Ibid., p. 170.
[44] Ibid., p. 170-171, 176.
[45] Ibid., p. 177.
[46] Irène Théry, Mariage et filiation pour tous, op. cit., p. 14.
[47] Anne-Marie Leroyer, « La loi nº 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Au passé, présent et futur », Recueil Dalloz 2013, p. 1697
http://www.dalloz.fr/documentation/lien?famille=revues&dochype=RECUEIL/CHRON/2013/0286
[48] Irène Théry, Mariage et filiation pour tous, op. cit., p. 115.
[49] Thomas Linard, « Présomption de paternité », op. cit., Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Présomption_de_paternité
[50] Thomas Linard, « Reconnaissance (droit de la famille) », op. cit., Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_(droit_de_la_famille)
[51] Irène Théry, Mariage et filiation pour tous, op. cit., p. 76.
[52] Ibid., p. 93.
[53] Ibid., p. 94.
[54] Ibid., p. 95.
[55] Ibid., p. 117.
[56] Ibid., p. 102, 123.
[57] Ibid., p. 191.
[58] Marcela Iacub, L’Empire du ventre, op. cit., p. 349.
[59] Ibid., p. 346.
[60] Daniel Borrillo, « Égalité des droits et critique de la norme familiale », La Revue des Droits de l’Homme, nº 2, décembre 2012, https://revdh.revues.org/217
[61] Thomas Linard, Filiation dès la naissance. Réflexions autour d’une proposition de loi tendant à réformer la filiation, Paris, UFAL, 2014, http://www.ufal.org/wp-content/uploads/2016/05/filiation-des-la-naissance_A4.pdf
[62] Marcela Iacub, L’Empire du ventre, op. cit., p. 65.














