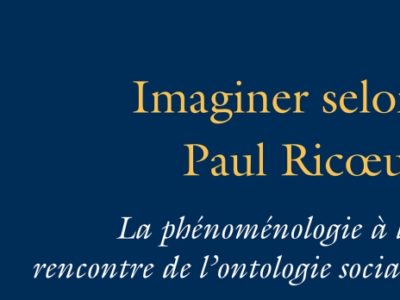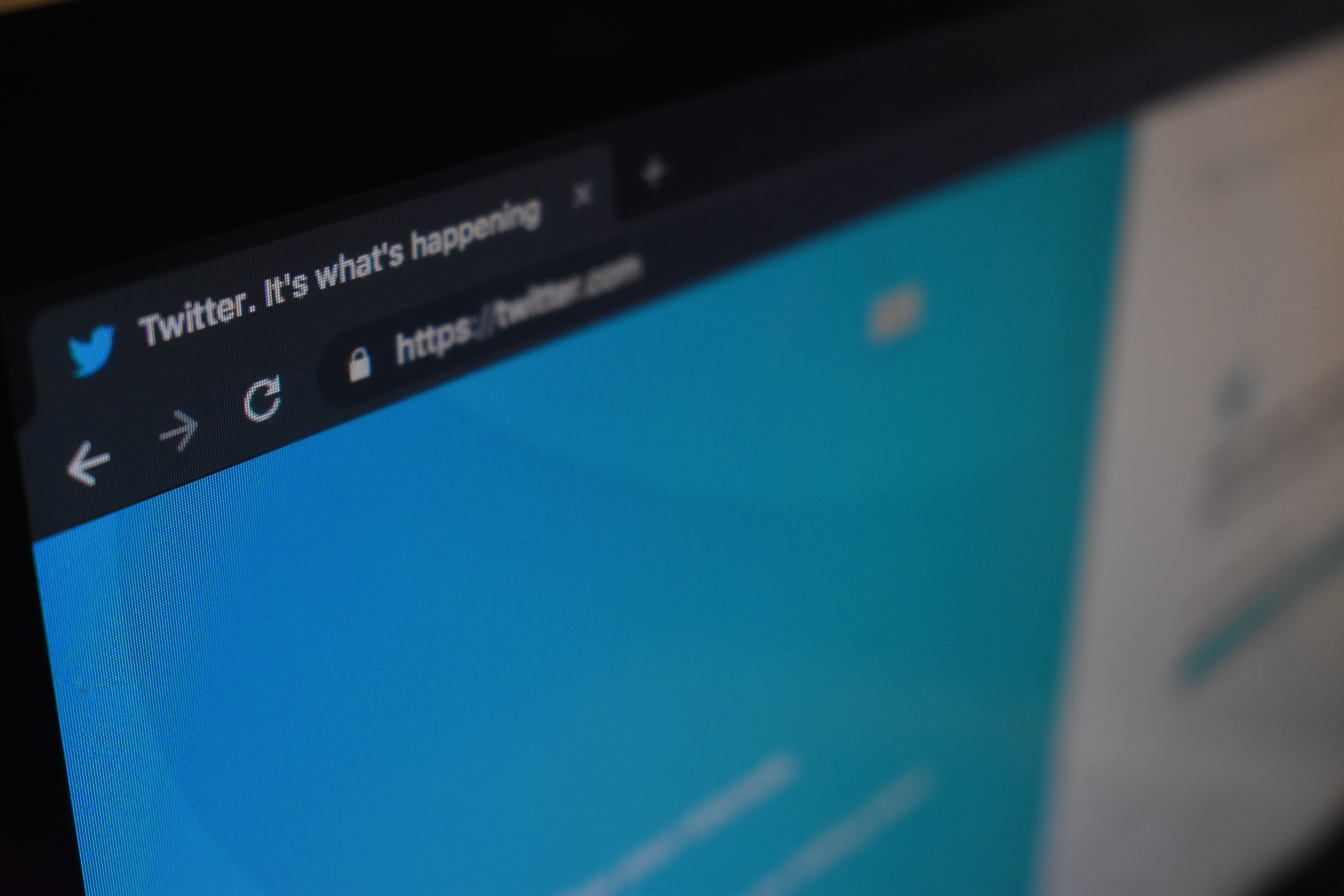Interview de Nicolas Floury, auteur de « De l’usage addictif »
[box] Par Margaux Merand (professeur de philosophie, rédactrice en chef adjointe de la revue Implications Philosophiques) et Mélanie Trouessin (docteure en philosophie)
** Nicolas Floury, avant de parler de votre ouvrage De l’usage addictif : une ontologie du sujet toxicomane, pourriez-vous nous parler de votre parcours intellectuel et clinique ? Comment en êtes-vous arrivé à travailler sur la question des addictions ?
Tout d’abord je tenais à vous remercier, Margaux Merand et Mélanie Trouessin, de m’avoir invité à avoir cet échange avec vous. Ayant lu votre thèse, Mélanie, j’ai tout de suite pensé que cet entretien pourrait être des plus féconds. Nous avons en effet eu le même objet d’étude, les addictions, mais nous avons abordé celles-ci d’une manière tout à fait différente.
Mon parcours a commencé par des études scientifiques, puis assez vite c’est la lecture de la psychanalyse qui m’a passionné. J’ai donc entrepris des études de philosophie afin de pouvoir lire Lacan avec rigueur. Je me suis ensuite formé en psychopathologie clinique, ce qui m’a permis de devenir psychologue. Le but était pour moi de pouvoir accéder aux hôpitaux psychiatriques afin de pouvoir fréquenter de près la folie. J’ai assisté à de nombreuses présentations de malades à Ville-Evrard et j’ai lu beaucoup de psychiatrie classique à cette époque (Magnan, Sérieux et Capgras, Clérambault, Kraepelin). En un mot, ma formation est d’abord scientifique, puis philosophique, mais le tout mis principalement au service d’une lecture fine de la psychanalyse.
J’ai ensuite passé du temps avec des toxicomanes en soin dans un centre parisien du quatorzième arrondissement. Mais la question des addictions me travaillait déjà depuis longtemps. Sans jamais avoir été moi-même toxicomane, j’ai eu dans mon entourage beaucoup d’amis qui, à la fin des années 90, sont morts d’overdose. Cela m’a permis de saisir ceci : c’est la répétition en elle-même, bien plus que la drogue consommée, qui est centrale dans l’addiction.
On devient addict, m’étais-je dit, non seulement quand on perd le contrôle, mais quand, de surcroît, on s’en aperçoit. C’est ce que vous dîtes vous aussi, Mélanie, dans votre thèse. On peut ainsi considérer que l’on est devenu un addict lorsqu’on a constaté que l’on ne peut plus s’arrêter de consommer alors que l’on en a pourtant réellement le désir. C’est quand on constate que l’on veut ce qu’on ne désire pas et que l’on désire ce que l’on ne veut pourtant absolument pas que commence l’addiction à proprement parler. Pragmatiquement, c’est quand, en se levant le matin, on se dit qu’on ne consommera plus jamais, mais alors vraiment plus jamais, mais que le soir-même on recommence. C’est ce que résume génialement Deleuze quand il dit que le problème de l’alcoolisme a tout à voir avec la quantité, puisque c’est toujours la question du dernier verre qui est en jeu. Pierre-Henri Castel parle ainsi, dans la même veine, de volonjouissance. Il caractérise par ce néologisme le conflit interne entre désir et volonté. Freud, déjà, avait perçu ce phénomène: c’est ce qu’il a nommé la névrose. Le toxicomane, me suis-je alors dit à cette époque, sans savoir que le constat avait déjà été fait par de nombreux théoriciens, est celui qui non seulement est pris dans ce conflit, mais qui, de surcroît, s’en aperçoit.
Ensuite, bien plus tard, m’est venu cet axiome, que mon essai ne fait que déployer et expliciter : est toxicomane celui qui, à force de répéter ses jouissances, en vient malgré lui à jouir de la répétition.
 ** À vous lire, il semblerait exister une rupture de nature entre les personnes addictes et non-addictes, comprise non pas par des prédispositions génétiques, mais par une nature ontologique distincte ? Donc les addicts le seraient en puissance, un peu dans la lignée de la littérature AA. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce point ; n’avez-vous pas le sentiment que postuler une essence du toxicomane peut pousser à la stigmatisation, au rejet de l’autre ?
** À vous lire, il semblerait exister une rupture de nature entre les personnes addictes et non-addictes, comprise non pas par des prédispositions génétiques, mais par une nature ontologique distincte ? Donc les addicts le seraient en puissance, un peu dans la lignée de la littérature AA. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce point ; n’avez-vous pas le sentiment que postuler une essence du toxicomane peut pousser à la stigmatisation, au rejet de l’autre ?
Oui, en effet, je pense que n’est pas toxicomane qui veut. Cela demande trop d’énergie, trop de courage, trop de travail. Le toxicomane est un travailleur acharné, il ne faut pas s’y tromper. Tout le monde peut néanmoins user de drogues et tomber dans l’abus, dans la dépendance, et devenir toxicomane. Il n’y a en ce sens à mes yeux aucune « rupture de nature » entre les toxicomanes et les autres. Ce que je propose ce n’est pas d’essentialiser une potentielle personnalité toxicomaniaque, mais, beaucoup plus simplement, de donner une définition ontologique du toxicomane. C’est-à-dire de dire quelque chose de l’être du sujet qui est devenu toxicomane. Je ne me pose pas la question de qui peut ou non devenir toxicomane. Cela ne m’intéresse pas du tout. Je donne juste un axiome qui me semble donner la clé de ce qu’est le toxicomane quand il l’est devenu. À aucun moment je ne me prononce sur ce qui ferait que certains seraient prédisposés à devenir toxicomanes et d’autres non. Je ne crois pas du tout par exemple qu’il existe des personnalités virtuellement toxicomaniaques.
Tout le monde ne peut pas devenir toxicomane, mais en même temps on peut tout à fait dire que tout le monde est d’emblée potentiellement addict. Mehdi Belhaj Kacem va jusqu’à dire dans sa préface que la société toute entière est dans l’addiction. Je suis tout à fait d’accord avec lui. Cela peut tout à fait se défendre. Il n’y a là aucun paradoxe. Nous sommes tous malades d’être parlants, dénaturés par le verbe qui nous prive de nos instincts. Pas de mode d’emploi en effet dans ses gènes, qui lui dicterait son rapport et au monde et à l’autre, pour celui qui parle. Nous tentons ainsi tous, lorsque le langage nous oppresse, chacun à notre manière, de nous en déprendre. En ce sens, le verbe est un virus et l’on ne peut pas à un moment de notre vie ne pas tout faire pour le combattre. Donc nous sommes tous potentiellement toxicomanes, néanmoins rares sont ceux qui trouveront la force de le devenir réellement. Je ne dis rien d’autre.
On m’a d’ailleurs plutôt reproché de faire l’apologie du toxicomane, d’en faire une sorte de héros. Pourtant, tout du long, je ne cesse de démontrer que la toxicomanie est une impasse.
Je respecte éminemment ce qui fait qu’un individu, un beau jour, décide d’user de la répétition comme telle pour tenter de se désaliéner du langage, de se défaire d’une langue qui le traverse de toute part et qu’il n’a pas choisie, d’une langue imposée par les membres de la cité et qui l’aliène. Je souligne juste que cela ne marche pas. On ne se soigne pas du virus qu’est le verbe par l’usage de la répétition qui est au cœur de l’addiction.
Ce que je dis, c’est que si le dessein du futur toxicomane, qui est de se sevrer du verbe devenu toxique, est tout à fait respectable, la solution qu’il choisit pour tenter d’y parvenir ne marche pas. Pour se défaire du verbe, lorsqu’il est perçu comme étant devenu virus, il faut user d’une tout autre stratégie. C’est ce que j’aborde à la fin de mon essai lorsque j’évoque les artistes.
Mehdi Belhaj Kacem a eu peur, en apprenant que je travaillais sur l’addiction, que je m’engage sur la voie du jugement moral. Il dit néanmoins très précisément dans sa préface que jamais je ne tombe dans cet écueil. Je ne parle d’ailleurs pas de toxicomanes mais de sujets toxicomanes. Je leur accorde donc chaque fois une dignité en tant que sujet. Je montre simplement que le futur toxicomane est l’anti-sujet par excellence. Il combat en effet en lui le sujet du langage, sujet qu’il s’est trouvé être bien malgré lui. Être le sujet du langage est en effet pour lui une chose littéralement insoutenable, un réel viscéralement insupportable.
Pour revenir à votre question, oui, je dis bien que certains ne pourront jamais devenir toxicomanes. Il ne s’agit pas pour autant d’essentialiser le toxicomane pour en faire un être à part. Mon dire ne s’inscrit donc pas du tout dans la lignée des AA ou des NA. Pour moi, être addict ce n’est en aucun cas être malade. Il s’inscrit plutôt dans le sillage de Cicéron, lorsqu’il dit, dans ses Tusculanes, que la dépression est une lâcheté morale et que seul le courage peut la surmonter. Je caractérise le toxicomane comme étant un être extrêmement courageux. Il cherche tout de même, cela crève les yeux, à se sortir, par un immense déploiement de force, d’une réelle impasse existentielle. Il combat son mal-être, et là est son courage. Sa spécificité réside en ce qu’il attribue son mal-être au fait qu’il soit parasité par le langage. Il mène à ses yeux un juste combat contre l’inauthenticité, contre les semblants. Il a bien saisi que dès lors que l’on parle, la vérité est menteuse. Il combat donc avec vigueur le monde des représentations. Tout son problème réside néanmoins en ce qu’il se trompe totalement d’armes.
En aucun cas, on ne peut donc trouver sous ma plume de quoi le stigmatiser. Je ne dis jamais par exemple qu’il est un être faible, manquant de volonté : poncifs bien connus.
** Dans la compulsion, le toxicomane se « désubjective » en devenant l’hôte anonyme de la « répétition » – il ne veut pas répéter indéfiniment la « jouissance », mais jouir de la répétition elle-même. Le toxicomane renonce à son existence subjective, et plus largement sociale, pour lui préférer une répétition aveugle qui n’a de terme que la « mort biologique ». Pourriez-vous revenir sur cette « jouissance de la répétition » et expliquer pourquoi elle caractérise selon vous l’addiction ? En quoi cela se différencie-t-il d’un désir suicidaire ?
C’est un désir suicidaire, tout à fait ! Mais alors au sens où c’est le désir de la mort de toute trace de sujet en lui. C’est un suicide non pas du corps mais de l’esprit qui est visé. Le toxicomane s’illusionne, il pense que « le grand midi » nietzschéen serait à sa portée s’il quittait le monde « second », le monde des représentations, que lui forge et lui impose le langage. S’il parvenait à ne plus être sujet, à ne plus être assujetti au signifiant, il redeviendrait un individu libre. Il vivrait enfin en harmonie avec la nature, dans un rapport enfin authentique au monde. Ce que ne voit pas le toxicomane, du moins lorsqu’il « entre en toxicomanie », comme quand on dit qu’on « entre dans les ordres », c’est que tuer toute trace de sujet en soi, ce n’est pas devenir un corps plein de vitalité enfin désintoxiqué du verbe et ainsi en prise directe avec le monde. Tout au contraire, c’est devenir une chose totalement mortifiée par la jouissance. Mortifiée par une sombre jouissance qui s’est alors sournoisement emparée de nous et cela bien malgré nous.
Il faut bien entendre que le toxicomane ne choisit pas de devenir le jouet du « jouir de la répétition ». Il décide simplement d’user de la répétition pour se séparer du langage, pour se couper du sujet du signifiant, pour se désabonner de l’inconscient. Il répète donc les jouissances de manière effrénée afin de se couper de lui-même tout comme du monde. Il veut se séparer du monde des semblants que lui impose le monde des représentations. Qui lui édicte les discours qui lui prescrivent arbitrairement ses liens sociaux. Néanmoins il se retrouve alors totalement pris au piège lorsque la pulsion de mort en vient à le hanter. Le piège, il ne l’a pas vu venir. La compulsion s’est emparée de lui sans qu’il la sente venir. Il ne l’a jamais voulue. C’est à ce moment précis qu’il devient toxicomane. Il se retrouve dès lors prisonnier du jouir de la répétition. Jouissance un peu énigmatique de prime abord, mais que nous explicitons rigoureusement dans notre essai. Disons que c’est un jouir qui, en effet, en vient à nous posséder comme son simple « hôte anonyme ».
Voilà du moins ma thèse. Et c’est précisément ce qui rend impossible l’utilisation de la toxicomanie lorsqu’il s’agit de vouloir s’émanciper du verbe.
** Vous dites à plusieurs reprises que « le geste devient plus important que l’objet ». Si l’on comprend que, pour vous, l’essentiel n’est pas dans l’objet de l’addiction puisque celui-ci ne définit pas l’essence du toxicomane, pouvez-vous préciser le rôle que joue le geste, voire le rituel, dans l’expérience addictive ? Comment relier ce geste et ce rituel à ce que vous appelez la « jouissance de la répétition » ?
Cela pourrait sembler un peu incongru mais je vais le dire ainsi : ce qui permet le mieux de saisir ce qu’il en est du rituel et du geste et donc de la répétition lorsqu’elle devient jouissance, c’est le masochisme. En effet, dans le masochisme (masculin) il s’agit de tout faire pour ne jamais jouir. Il faut différer, en gonflant le désir le plus possible, le moment terminal qu’est la jouissance. Autant dire qu’il faut pour cela instaurer un rituel, un scénario, un contrat, qui permettra de différer jusqu’à l’insoutenable la jouissance. C’est là que peut venir se loger la question du rituel lorsqu’il s’agit de l’addiction. Le rituel permet à la jouissance de venir se loger au sein de la répétition elle-même, qui a ainsi trait au geste et non plus à l’objet. Le toxicomane adore les rituels, il a toujours sa petite organisation, ses petites manies de consommation. Il ne sait pas qu’il ouvre ainsi, par ses immuables et incessants rituels, la porte au jouir de la répétition. Un jouir qui le rendra addict car la répétition aura alors eu prise sur son corps en l’aliénant pour de bon.
Le geste, quant à lui, prend selon nous racine dans l’onanisme, là-dessus nous suivons totalement Freud. Au fond, l’onanisme, lorsque du moins cela prend un versant quelque peu masochiste, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de gesticuler sans fin afin de garder la tumescence sans jamais jouir, cela forge la matrice même de la jouissance de la répétition. C’est le geste masturbatoire lui-même qui compte alors et non la jouissance qu’il s’agirait d’atteindre. Ce qui me semble vraiment sûr, c’est qu’à jouer un peu trop à ce petit jeu (où le but est d’atteindre le plus grand désir possible, à la limite de l’insoutenable), c’est bien souvent la répétition qui en vient à s’emparer du sujet. Il en devient alors un anonyme complétement désubjectivé, qui ne fait plus que jouir de répéter la répétition elle-même. « Jouissance de la répétition » est à entendre comme « jouir de répéter les répétitions », répétitions qui ne sont au fond que gestes.
Cela peut tout à fait s’écrire sous forme de scénario, tel un fantasme, et donc faire rituel. Cela se contractualise aisément, comme nous le prouvent les masochistes. Donc je dirais que le rituel est simplement davantage subjectivé que le geste. Il est le geste approprié par le langage. Il est le geste masturbatoire, qui est la matrice de la répétition et qui fait le cœur de l’addiction, mais sublimé par la grammaire. Il est vrai que dans mon livre je n’ai pas parlé du rituel. Votre question me le rappelle. J’aurais pu en parler en le définissant comme je viens de le faire. Le rituel, dans l’addiction, est la présence sublimée du geste qui est au cœur de l’addiction et supplante complètement l’objet qui permet la jouissance – ou bien l’acte agi, dans le cas des addictions comportementales.
** Si on se réfère à l’article fondateur de Joyce McDougall sur l’addiction, on voit notamment que celle-ci est comprise comme rempart, comme faisant « écran » à tout ou partie de la « vie affective » du sujet :
« [..] l’analyse de Mme X… et mon auto-analyse au moment où j’ai cessé de fumer me firent soupçonner pour la première fois que l’un des buts du comportement addictif est de se débarrasser de ses affects ! Bref, je me suis rendu compte que je mettais un écran de fumée sur la quasi-totalité de mon expérience affective, neutralisant ou dispersant ainsi une partie vitale de mon monde interne ! »
On pourrait dire, ainsi, que le toxicomane n’est pas nécessairement celui qui refoule le verbe mais ce qui n’est précisément pas verbalisé. Il y aurait une vie affective tenue à l’écart par la compulsion : vie que le sujet ne s’explicite pas dans le discours, dont les contours ne sont pas définis. N’est-ce pas cela, davantage que les mots eux-mêmes, que le toxicomane s’évertue à esquiver, en dressant entre ses affects et sa vie consciente une compulsion qui doit occulter toute introspection ?
Ce que vous dîtes présupposerait que les représentations et les affects ne soient pas en lien, qu’ils ne soient pas, toujours, articulés, extrêmement intriqués. La clinique démontre pourtant l’inverse. Le fantasme, par exemple, source d’affects s’il en est, n’est-il pas totalement structuré par la grammaire ? (Voir/être vu/se voir être vu, etc.)
Mon point de vue est que le toxicomane veut avant tout se couper de tout ce qui a trait au sujet justement dans l’espoir de retrouver une vie affective qui serait alors des plus intenses. Qui serait des plus authentiques car non médiée par des représentations. Le sujet dont il est question ici est le sujet complétement épuré, qui n’est plus même une substance, soit le sujet du cogito cartésien. C’est le sujet du signifiant, évanescent comme tel.
Dans les faits, se désubjectiver c’est néanmoins se priver d’un très grand nombre d’affects. Mais cela le toxicomane le découvre uniquement en chemin. L’intensité affectuelle d’une vie dépend du degré de subjectivation. Autrement dit, plus on a de mots à sa disposition plus on est capable de se laisser affecter, plus on ressent d’émotions. Autrement dit encore, les affects sont pleins de mots. Donc Joyce McDougall a tout à fait raison lorsqu’elle décrit phénoménologiquement ce qu’il en est pour un addict. Néanmoins, utiliser la drogue comme un anesthésiant pour se débarrasser de ses affects, cela ne définit pas le toxicomane tel que je l’entends.
Si certains usent de drogues pour émousser leurs affects, cela ne fait pas d’eux des toxicomanes. Un patient, par exemple, avalait des petites boules d’opium pour ne plus rien ressentir émotionnellement. Mais il n’était pas du tout pris dans une compulsion morbide à la répétition. Nous étions là en effet dans l’automédication, même si le sujet avait fini par demander de l’aide au centre de soins pour son sevrage, étant devenu physiologiquement dépendant aux opiacés. Il restait néanmoins tout à fait maître de ses consommations. Les toxicomanes dont nous parlons dans notre essai recherchent au contraire une intensification de leur vie affective. Comme le dit Tristan Garcia dans son essai sur l’intensité en évoquant mon travail, le toxicomane « répète son intensité de jouissance avant de ne plus parvenir à jouir que de la répétition elle-même, pris au piège de sa propre logique ». Il y a bien une recherche de plus d’intensité en effet chez le futur toxicomane tel que je le définis. Ils ne recherchent pas tant à anesthésier leur mal-être qu’à obtenir une vie plus intense et pensent qu’il faut trouver un moyen de se couper du verbe pour y parvenir. Mais et pour conclure sur votre question, je dirais que de toute façon pour ne plus ressentir d’émotions il faut aussi se désubjectiver. Sans la prise du signifiant sur nous, peu d’émotions. Cela se vérifie dans la psychose infantile parfois ou dans certaines formes de démences séniles. Quand on perd le Sujet, on perd les émotions. Pas d’affects chez l’humain sans langage pourrions-nous dire.
** Même si l’étiologie n’est pas l’essentiel, vous dites que « la toxicomanie est toujours une réponse à une difficulté sous-jacente ». Il s’agit d’un principe phare de la psychanalyse et de la théorie de l’automédication. Êtes-vous d’accord avec cette théorie, qu’en pensez-vous ? Ne seriez-vous pas d’accord pour réintégrer un élément pathologique dans l’addiction, parler de maladie secondaire par exemple ?
Être malade physiquement et utiliser la drogue comme pharmakon et du coup attraper l’addiction comme maladie alors que l’on voulait se soigner avec des drogues d’une douleur, bien sûr que cela existe, c’est même monnaie courante. Combien m’ont dit être devenus dépendants aux opiacés après les avoir utilisés à l’origine uniquement comme antidouleurs suite à une maladie grave par exemple. C’est l’ambiguïté que souligne d’ailleurs si bien le mot pharmakon: une drogue est toujours un médicament et un médicament toujours potentiellement une drogue. Poison et remède, remède mais poison. Cela est connu depuis toujours. Et dire que la drogue n’est jamais le problème mais toujours une solution, certes une mauvaise solution, simplement car elle ne marche pas, mais qu’il s’agit toujours d’une solution que l’on tente d’apporter à un problème, cela me semble aller de soi. Il n’y a pas de plaisir dans la toxicomanie, alors pourquoi y aller, si ce n’est pour tenter de soulager une douleur des plus profondes.
On peut certes être en proie à un conflit psychique interne, ce que Freud appelait une névrose et user d’une drogue pour son effet anxiolytique. Pour y trouver un apaisement. Dans ce cas la drogue est en effet un médicament qu’on s’auto-administre. Néanmoins jamais cela ne mènera à la toxicomanie telle que nous la définissons dans notre essai. Cela existe, l’automédication qui mène à l’addiction et donc je suis tout à fait d’accord pour parler de « maladie secondaire », mais ce n’est simplement pas de cette addiction-là dont je parle. On a là l’usage devenu abus et qui a pu rendre dépendant. Mais dans ce cas il ne s’agit pas à mes yeux de toxicomanie.
C’est pour cela que je dis que des toxicomanes il y en a très peu et que « ne devient pas toxicomane qui veut ».
Vouloir éradiquer toute trace de sujet en soi et en devenir malgré soi toxicomane ce n’est pas une pathologie, c’est simplement une erreur. La maladie que veut soigner le futur toxicomane est le fait d’être parasité par le langage. Il est devenu parlant par le truchement de la répétition. Il va alors, pour se guérir, réutiliser cette répétition originaire pour tenter de se défaire de l’ordre symbolique qui l’oppresse. Il va en somme utiliser le poison comme remède, soigner le mal par le mal. Mais la maladie qui consiste à être parlant est malheureusement incurable. On ne guérit jamais d’être parlant. Seule la mort biologique nous en délivre.
Nous l’avons dit, en aucun cas le toxicomane dont nous parlons ne cherche à tuer son corps biologique. Il veut se séparer de lui-même comme « esprit » pour se retrouver comme corps plein et entier. Le toxicomane, celui qui est le sujet de notre essai, aime la vie. Il l’idéalise même au point de l’aimer à la folie. C’est l’intensité, l’authenticité d’une vie naturelle, qui est sa seule visée et il est prêt à payer le prix fort pour l’obtenir. Une vie débarrassée de toutes les tricheries et de toutes les injustices. Une vie pure. En ce sens le toxicomane est un idéaliste.
Comme nous l’explicitons précisément dans notre essai, ce que veut le toxicomane, au fond, c’est que le rapport sexuel soit possible. Il a bien compris que pour qu’une telle chose puisse se produire, pour qu’une harmonie entre les sexes soit possible, il faudrait pouvoir faire taire toute trace de sujet en l’homme. C’est d’ailleurs un fait clinique connu : les toxicomanes « ne couchent qu’entre eux ».
** Dans la même veine, vous insistez à plusieurs reprises sur l’idée que l’addiction n’est pas une maladie mais un choix ou, plus précisément, une « obscure décision de l’être » Ne pensez-vous pas que la nature de l’addiction est plus complexe et qu’elle pourrait appartenir à l’une et l’autre de ces catégories ? Ou pensez-vous que cette opposition entre maladie et choix soit indépassable ? On pourrait, de plus, admettre que l’expérience addictive n’est pas monolithique et entièrement prévisible, mais comprend des stades d’évolution. Ne relève-t-elle pas d’une expérimentation dont certains dangers sont inattendus ? L’addiction serait ainsi un ensemble composite dont certains aspects sont générés dans et par la répétition du geste. De tels aspects, qui peuvent concurrencer les stratégies de contrôle du toxicomane, sont-ils réellement « choisis » dès le départ ?
« Une obscure décision de l’être » en effet. C’est une référence et à Lacan et à Sartre quant à leurs discours sur la folie. Le choix est au départ de se couper du monde des semblants, du monde des mensonges que nous fait le verbe quand il s’avère toxique. C’est ne plus vouloir de la vérité en effet toujours menteuse quand on est un être parlant. C’est enfin être dans un lien à l’autre où le discours ne serait plus du semblant. Là est la décision initiale du futur toxicomane. C’est une décision claire et distincte, prise presqu’en toute conscience.
Ensuite, que la jouissance de la répétition, la compulsion, soit la pulsion de mort freudienne, en vienne à nous hanter, ce n’est pas un choix du tout. À aucun moment. C’est toujours une conséquence totalement imprévue. C’est le début de l’addiction véritable et le début d’insoutenables angoisses et d’affres sans nom. Le toxicomane est, tel qu’on le définit, un être extrêmement subtil, il a identifié le problème et il a bien vu que le fait d’être parlant nous privait du rapport sexuel, de l’harmonie naturelle entre les sexes, induisait la castration, la division subjective, nous imposait une identité et par là-même ni plus ni moins qu’une destinée. Il pense qu’en utilisant la répétition des jouissances, il va se couper du verbe et retrouver un corps sur lequel le signifiant n’aurait plus prise. Il pense ainsi revenir à une vie véritable hors semblants. Là est son légitime et originaire choix.
Cela veut néanmoins dire qu’il est devenu toxicomane. Être devenu toxicomane sans s’en rendre compte n’empêche pas que l’on puisse extérieurement et phénoménologiquement décrire des stades qui mènent à l’addiction à proprement parler. La littérature abonde d’exemples décrivant cette phénoménologie d’une supposée escalade (usage, abus, dépendance par exemple). On deviendrait ainsi toxicomane en perdant le contrôle par palier. J’ai pour ma part une autre vision des choses. Je pense que l’on peut tout à fait et d’emblée devenir toxicomane, en ayant finalement consommé très peu en quantité et sur une très courte période. Parfois le jouir de la répétition saute sur son hôte très rapidement et sans crier gare. À l’inverse on trouve des usagers de drogues qui consomment des quantités complètement folles et pendant des années, mais qui ne deviendront jamais toxicomanes au sens où nous le définissons ici.
La solution choisie initialement est ainsi une impasse. Le choix d’être le pur jouet du jouir de la répétition n’existe pas. Car rares sont ceux qui reviennent de ce pays-là, le pays des toxicomanes véritables.
** Vous êtes ainsi relativement prudent lorsque vous utilisez des concepts tels que ceux de « choix » et de « volonté » : vous parlez de « choix contraint » ou « forcé » parce qu’il n’y a pas d’autre alternative. Mais si l’on prend le concept de libre choix au sens philosophique classique – sans autre alternative possible, on n’a effectivement pas le choix – alors il est difficile de comprendre ce que vous entendez par « choix » dans la toxicomanie. Ne pensez-vous qu’il faudrait faire usage d’une autre théorie de l’agentivité et du choix libre (conçu non plus comme un choix entre des alternatives possibles mais comme l’accord avec soi ou, pour le dire dans les termes du philosophe américain Frankfurt, comme « l’accord entre sa volonté immédiate et sa volonté réfléchie ou de second ordre ?)
Oui, je vois où vous voulez en venir. La question est complexe. « Je sais dans ma volonté réfléchie que je vais droit vers mon mal mais dans ma volonté immédiate je consomme tout de même », quelque chose comme ça. Encore une fois, pragmatiquement, cela donne : « je me lève le matin en me promettant de ne plus jamais consommer et le soir même je me shoote de nouveau ». Mais l’adage est déjà chez nos anciens et vous le citez à bon escient dans votre thèse, Mélanie : je vois où est mon bien mais je vais tout de même droit vers mon malheur.
« Une obscure décision de l’être » dis-je lorsque je parle du choix d’entrer en toxicomanie. Je reprends ainsi l’expression de Lacan sur la folie, qu’il qualifie en réponse à Sartre et contre l’organisme d’un Henri Ey, « d’obscure décision de l’être ». On ne choisit pas de devenir fou, car « n’est pas fou qui veut », mais c’est à la fois un choix profond du sujet et un refus farouche du monde tel qu’il est. Cette façon de parler de choix forcé c’est pour ne surtout pas décrire la toxicomanie sous les traits d’un quelconque organicisme. C’est Schelling que j’avais à l’esprit en disant cela. « L’homme est libre dans le bien comme dans le mal » et telle est l’essence de la liberté humaine. La psychanalyse m’a déniaisé pour toujours de toute croyance en une quelconque théorie du choix rationnel, fût-ce un choix qui mènerait à un supposé accord avec soi-même. Nos choix, ceux qui font notre destin, même s’ils sont libres, sont toujours contraints. Dans l’après-coup on s’aperçoit toujours qu’un choix immédiat avait comme sous-bassement un choix réfléchi.
Ce qu’il faut comprendre, mais l’expérience de l’analyse seule, peut-être, permet de prendre le recul nécessaire et de saisir la chose, c’est que tout cela est du ressort de l’inconscient. L’inconscient au sens de Lacan, c’est-à-dire au sens où l’on n’a pas un inconscient, mais où l’on est sujet de l’inconscient. La tragédie grecque, par exemple, qu’est-ce d’autre que le déploiement d’un choix qui s’avère toujours in fine avoir été un choix forcé ? Le choix est forcé car il est inconscient, il est immédiat et réfléchi en même temps car il est imposé par le discours de l’Autre. Soit le discours sur nous en tant que sujet du langage qui préexistait à notre naissance.
** Votre conceptualisation de l’essence du toxicomane vous semble-t-elle avoir une incidence pratique, des applications thérapeutiques possibles ? Préconiseriez-vous un type de prise en charge médicale ? Pensez-vous que cette conceptualisation pourrait avoir des effets sur nos représentations à l’égard des personnes addictes et si oui, lesquels ?
C’est l’enjeu de toute la dernière partie de mon essai, où l’on quitte quelque peu la métaphysique pour se tourner davantage vers le pragmatisme propre à la clinique. Ce que je propose, c’est d’apprendre aux toxicomanes que pour se passer du verbe, du « mauvais » verbe qui nous a fait si mal et nous a imposé une large part de notre destinée, il faut apprendre à s’en servir. Et là encore je tire cela de Schelling : le Verbe permet la Volonté, la seule volonté qui vaille, la volonté de créer et de faire œuvre. Je propose ainsi d’accompagner le toxicomane afin qu’il puisse parvenir à inventer sa propre langue. Afin qu’il apprenne autant que faire se peut à se recréer lui-même comme sujet. Mais un sujet qu’il aurait fait cette fois advenir et non plus un sujet qui l’assujettit malgré lui aux discours de la cité.
C’est ce que l’on peut tout aussi bien proposer lorsqu’il s’agit de prendre la folie sous sa garde. En somme, ma proposition thérapeutique pour sortir l’addict de ses chaînes, c’est de l’aider à devenir artiste. Et ce sont les artistes que je cite dans cette dernière partie du livre pour illustrer cela. Car ce que veut le futur toxicomane sans y parvenir, l’artiste véritable y parvient lui tout à fait. C’est donc à lui que j’ai laissé le mot de la fin. À Artaud et Joyce principalement. Ce n’est pas que le toxicomane n’aime pas jouer le jeu, c’est qu’il ne supporte pas de ne pas avoir inventé lui-même les règles. Pour l’artiste c’est exactement la même chose, sauf que lui invente de nouvelles règles qu’il impose alors au monde.
Mon travail, je l’espère, aidera à ce que l’on considère le toxicomane comme une personne extrêmement fine. Un sujet qui a identifié un problème tout à fait réel mais qui s’est simplement trompé de moyens quand il s’est agi de lui trouver une solution. J’aimerais que l’on ait davantage à l’esprit l’aspect extrêmement touchant du sujet qui n’est pas encore toxicomane mais qui prend le risque de le devenir pour se sortir de son aliénation. Il veut se singulariser, tout comme l’artiste, et cela est louable.
Ensuite, une fois dans l’addiction, c’est une autre affaire, car il faut aussi tenir compte de l’aspect physiologique de la chose. Le toxicomane use alors de toute son énergie pour obtenir les produits que réclame son corps. Toute la question est alors de savoir si l’on peut, une fois qu’il est arrivé à ce stade, le ramener vers le monde du sujet. C’est-à-dire si l’on peut lui montrer que le verbe n’est pas toujours un virus, mais qu’il est aussi ce qui permet d’atteindre le plus sublime en l’Homme. Il s’agit alors du verbe qui permet la création, mais aussi du verbe qui permet la plus pure singularisation. Il faudrait donc parvenir à lui montrer que le verbe est la seule chose qui lui permettra d’obtenir ce qu’il veut tellement : devenir singulier. Parfois, je l’avoue, je doute qu’une telle chose soit possible. Parfois une once d’espoir me traverse. Mais il ne faut pas baisser les bras devant la difficulté et il faut absolument continuer de prendre sous sa garde les sujets addicts en les prenant en charge au moyen de cures par la parole.
** Pour terminer, pourriez-vous nous dire quelques mots sur vos travaux actuels et vos futurs projets ?
Je travaille actuellement sur une métaphysique locale du Mal. Je tente de séculariser ce qu’il reste à mes yeux de bien trop religieux chez Schelling, tout en considérant qu’il est le premier à avoir vu que la philosophie ne pouvait plus avoir de fondement à proprement parler. Elle doit en effet désormais se fonder sur un sans fond. On est à présent, pour reprendre une expression de Reiner Schürmann, dans une « économie épocale » où l’Autre manque. Il y a une incomplétude du symbolique. C’est ce que nous ont démontré les mathématiciens du XXème siècle. Il ne nous reste donc plus qu’à forger des systèmes de pensée sous l’égide de cet oxymore : le principe d’anarchie. L’absence même de Principe permet par-là même de fonder à l’infini. Si « rien n’est tout » alors tout devient possible car l’on ne peut pas dire le vrai sur le vrai. Autrement dit, il y a une incomplétude structurale du symbolique qui fait qu’il n’y a pas de métalangage qui tienne. Mais c’est là une très bonne nouvelle. Cela permet qu’une infinité d’œuvres puissent surgir de toutes sortes de subjectivisations.
Donc, le verbe, s’il est parfois le mal, parce qu’il semble incapable de nous assurer un monde avec des assises fermes, est néanmoins précisément aussi le bien. Cela car il permet l’infinitisation de l’infini lui-même. Soit de penser qu’il y a une infinité d’infinis. C’est tout le travail du « dernier » Badiou, qu’il nous livre dans son dernier grand tome de métaphysique, L’immanence des vérités, que de nous le démontrer.
C’est parce que le Verbe est le principe d’anarchie comme tel qu’il est salvateur.
Pour faire le lien avec mon travail sur le farouche anti-sujet qu’est le toxicomane je dirais que le toxicomane voit le langage comme semblant mais qu’il ne voit pas le formidable potentiel de subjectivation qu’il recèle. La vérité est certes toujours menteuse lorsque l’on est parlant. En cela le toxicomane fait le bon diagnostic. Mais au lieu de s’en réjouir et d’apprendre à fonder sa vie subjective sur le sans-fond abyssal que le verbe nous ouvre par les grâces de l’infini, il préfère tout envoyer balader. Si le signifiant indéniablement tue la jouissance, il la produit tout aussi bien et c’est cela que le toxicomane ne voit pas. Il a saisi la source du Mal, mais il ne voit pas encore que le Mal est le Bien et rien d’autre.
Voilà, j’aurai à établir cela rigoureusement dans mon prochain ouvrage.
Je vous remercie pour vos questions extrêmement pertinentes car elles m’ont apporté ce que des questions peuvent apporter de mieux : une réelle remise au travail. J’ai en effet dû repenser les implications de certains de mes concepts et prendre un peu de hauteur afin de pouvoir vous répondre. Ce que j’espère, c’est l’avoir fait de la manière la plus claire qui soit.