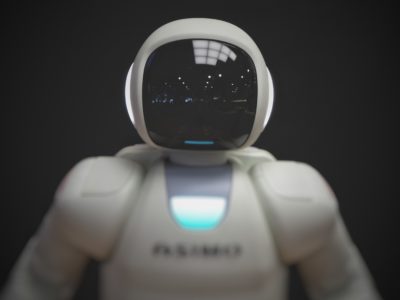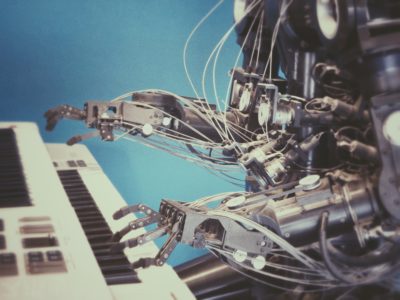L’éthique à l’épreuve de la fin de vie (1)
Eric Fourneret – Philosophe Centre de recherche Sens, Éthique et Société (CERSES) Université Paris-Descartes
Introduction.
Le progrès des techniques de réanimation, ou encore des techniques de transplantations d’organes, illustre l’ambivalence de l’extraordinaire développement de la biomédecine. Par exemple, si les progrès des techniques de réanimation permettent de sauver des vies, c’est aux prix parfois de handicaps sévères. Il n’est pas rare que la personne sauvée et ses proches vivent cette situation comme un fardeau et leur désespoir rappelle le principe très simple, mais très fort, selon lequel le techniquement possible n’est pas toujours le moralement souhaitable. Bien sûr, ce genre de situation est inévitablement plus complexe qu’il n’y paraît d’abord. Il y a dans ces cas précis une grande incertitude sur ce que deviendra la vie que l’on tente de sauver : s’il existe des situations tragiques où il aurait été préférable sans doute de s’abstenir, il en existe d’autres en revanche où l’on peut se réjouir de l’avoir fait.
Cette capacité, ou ce pouvoir-savoir faire sur la vie, se présente sous la forme d’une provocation de la nature, suscitant à la fois des espoirs et des craintes : par exemple, l’angoisse de vivre un jour une vie totalement dépendante d’un milieu artificialisé, à l’image de la plante artificialisée décrite par Simondon, et « qui ne peut exister que dans ce laboratoire pour végétaux qu’est une serre, avec son système complexe de régulations thermiques et hydrauliques »[1]. On dira tout simplement que ces nouvelles capacités appellent à être canalisées. C’est de la philosophie morale que l’on attend ce contrepoids, en éclairant l’homme sur qu’il convient de faire, sur les dilemmes à résoudre, les incertitudes à dissiper et les choix à effectuer. En d’autres termes, en cherchant à savoir ce qu’il faut faire pour bien faire, au moyen de systèmes de règles générales et/ou de principes cardinaux préétablis portant sur l’agir humain.
Mais alors que les situations de fin de vie sont tout d’abord des situations aux enjeux personnelles (il s’agit de vies individuelles et du respect de volontés individuelles), la question se pose de savoir si les règles générales, les principes généraux, sont des outils suffisants pour appréhender la dimension existentielle et particulière de ces situations. Si l’enjeu du jugement moral est d’appliquer des règles générales, des théories préalablement formulées alors, la pensée semble mal préparée à la confrontation à la réalité des fins de vie dans laquelle les circonstances ne sont jamais les mêmes et ou le concret déborde toujours la théorie. La critique des professionnels de santé à l’endroit des philosophes illustre cette difficulté d’une certaine philosophie à tenir ensemble le travail conceptuel et le réel. Alors que, par exemple, le philosophe se posera la question de savoir « Qu’est-ce que la dignité ? », le professionnel sait bien que la réponse nécessitera, de toute façon, d’être reconfigurée au chevet de la personne malade. Les concepts abstraits et les théories morales peu familières à l’esprit commun, suffisent-ils pour comprendre quels sont les enjeux particuliers d’une situation donnée ?
Pour tenter de répondre à cette question, le plan adopté sera simple. En premier lieu, il sera question de préciser quelques limites d’une certaine philosophie pour intégrer la perception du particulier comme une vive préoccupation de la pensée morale. Ensuite, il s’agira de montrer que l’examen d’une fin de vie, c’est considérer aussi ses traits particuliers qui peuvent échapper au raisonnement logique. Enfin, on développera une autre conception de la pensée morale où le particulier est justement une priorité.
Les écueils de la philosophie morale conventionnelle.
Face à ces situations complexes qui dépassent largement le cadre de l’éthique médicale traditionnelle, le besoin est fort de se doter de guides d’action. Ainsi, conjointement aux enjeux soulevés par le développement extraordinaire de la biomédecine, une démarche théorique et normative a vu le jour dans les années 1970. Il s’agissait d’une part de mettre en évidence les principes cardinaux dans un univers médical ; et d’autre part, d’établir des méthodes d’aide à la décision. Le principisme (mot français traduisant littéralement le mot anglais « principlism »), est sans doute la méthode la plus connue dans le milieu médical pour aider à la réflexion éthique et pour répondre à la question de savoir ce qu’il faut faire pour bien faire. Tom Beauchamp et James Childress sont les figures emblématiques de cette démarche, dont l’ouvrage Principles of Biomedical Ethics[2], est certainement le plus utilisé dans les instances éthiques médicales, et dans lequel l’autonomie, la non-malfaisance, la bienfaisance et la justice apparaissent comme le vocabulaire exclusif de la pensée morale.
Cette démarche pratique ne saurait faire oublier la philosophie morale dont la partition de tradition analytique distingue trois domaines d’investigation[3] :
— la méta-éthique, c’est-à-dire la description des jugements moraux, la signification des termes moraux, la véracité ou non des énoncés moraux, la réflexion autour de l’éventuelle objectivité des faits moraux ;
— l’éthique normative, en d’autres termes, ce qu’il convient de tenir pour de bonnes ou de mauvaises choses, de justes ou d’injustes choses ;
— enfin, l’éthique appliquée, c’est-à-dire, ce qu’il faut faire ou ne pas faire dans des domaines spécifiques comme dans les cas de réanimation[4].
Il n’est pas question de dresser une paroi étanche entre la philosophie analytique et les principes cardinaux cités ci-dessus. Il est évident, par exemple, que l’éthique appliquée et le principisme sont imbriqués lorsqu’on évalue des types d’actions, quand on ne le fait pas au moyen des grandes théories de la philosophie morale (éthique normative), c’est-à-dire, avec l’éthique de la vertu (attachée au caractère de l’agent moral), le déontologisme (centré sur les caractéristiques morales intrinsèques de l’action ou pour le dire autrement, sur la rectitude d’une action au regard d’une règle ou d’un principe, tel le principe d’universalité de Kant), et le conséquentialisme (considérant les seules conséquences de l’action).
Il n’est pas question non plus de dresser une paroi étanche entre les différentes théories morales décrites ci-dessus. En effet, leurs versions contemporaines s’impliquent mutuellement, comme l’ont montré Tom Beauchamp et James Childress[5]. Effectivement, il faut convenir avec eux qu’une situation peut impliquer plusieurs théories morales. Mais cela semble s’expliquer en partie parce que plusieurs principes éthiques sont impliqués, comme l’illustrent les situations de fin de vie où le principe de bienfaisance se trouve souvent en opposition avec celui d’autonomie : par exemple, comment respecter le bien-être de la personne malade qui refuse tout traitement contre la douleur ? L’intervention de plusieurs principes suppose de considérer les théories morales qui les ont engendrés.
Pour Clouser et Gert[6], ce type de raisonnement conduit à des contradictions :
Le langage du principisme suggère qu’il [l’agent] a impliqué un principe moralement bien établi et donc prima facie correct. Mais un regard plus proche de la situation montre qu’il a en fait examiné et évalué plusieurs considérations morales diverses, qui sont superficiellement interdépendantes et rassemblées sous un titre de chapitre portant le nom du principe en question
Ou de la théorie morale, pourrait-on ajouter. Aussi peut-on voir des ouvrages d’éthique résumer une problématique à une anthologie au moyen de quelques standards comme le déontologisme de Kant, l’utilitarisme de Mill, et bien d’autres encore. Ainsi, quand Beauchamp et Childress conseillent, en cas de problème insurmontable, de s’en remettre à la théorie morale la plus adéquate à la situation, ils semblent proposer de contourner les difficultés et de laisser l’agent moral faire son marché parmi les théories.
On pourrait sans doute trouver dans le contractualisme contemporain (Rawls, Gauthier)[7], une alternative à ces nombreuses difficultés. Mais il y aurait quelque chose de moralement problématique dans la relation de soins à ne percevoir ses semblables que dans un rapport instrumental au service de la satisfaction de ses propres besoins et intérêts. Il faut convenir en effet que l’idée de contrat correspond assez mal à la nature de la relation médicale en ce que, précise Corine Pelluchon[8], la relation de soin n’est pas une relation de réciprocité supposant l’égalité de partenaires[9]. De fait, le modèle contractualiste ne correspond absolument pas à la relation entre la personne malade et le professionnel de santé puisque ce n’est pas, au moins en principe, un service marchand entre les deux, mais une alliance thérapeutique qui assume la dissymétrie inhérente entre les acteurs impliqués (la personne malade est dépendante des compétences du professionnel de santé). De plus, le patient n’est pas toujours en pleine capacité de sa raison et de son autonomie (à l’image, par exemple, de l’affaiblissement cognitif irréversible d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer), comme le suppose l’idée de contrat chez Rawls et Gauthier. En d’autres termes, puisque « l’idée d’un contrat, même sous sa forme schématique minimale, implique toujours en premier lieu des relations d’égalité entre les agents »[10], la relation de soins étant toujours une relation asymétrique, elle ne peut pas être ramenée à une relation entre contractants, d’où la notion d’alliance.
De fait, appréhender les visions personnelles sur la façon de finir sa vie exclusivement au moyen de la philosophie morale analytique laisserait entendre qu’il existerait un idéal d’impartialité que la pensée pourrait atteindre au moyen d’une certaine technique philosophique s’inspirant de la science, c’est-à-dire en procédant par démonstration, justification et vérification[11]. Le paradigme de la philosophie analytique est emblématique de cet idéal en considérant que les conceptions personnelles de la vie morale peuvent être décomposées en éléments – comme en physique et en chimie, par exemple – et soumise à un jugement fondé en raison et accessible pour quiconque raisonnerait de la sorte, comme l’explique Murdoch : « Les arguments moraux sont possibles là où les gens ont des critères similaires d’application (c’est-à-dire, partagent les significations descriptives des termes moraux) et différent quant à la nature exacte des faits. »[12]
Cette approche se comprend par l’objectif traditionnellement visé de la pensée morale – et communément admis – auquel le philosophe Nowell-Smith fait allusion dans Ethics : « La philosophie morale est une science pratique ; son objectif est de répondre aux questions de la forme ‘Que dois-je faire ?’ »[13]. Vouloir réduire l’éthique à cette seule question, comme le font souvent les professionnels de santé dans les comités d’éthique locaux, conduit principalement à travailler sur les actes et les choix. Pour Murdoch, il en découle deux conceptions philosophiques dont l’une s’affranchit de la vie intérieure de chaque individu (par exemple, sa vision personnelle de la vie) ; et l’autre tient la morale pour ce qui guide nos choix par la spécification factuelle[14]. Ainsi, pour établir une recommandation verbale objective sur ce qu’il faut faire, c’est-à-dire une recommandation rationnelle et fondée sur des raisons universellement valides, cette philosophie use principalement de démonstrations s’inspirant de la science.
D’une certaine façon, cela reviendrait à prétendre qu’il existerait une objectivité morale, c’est-à-dire, ici, une pensée morale déconnectée de la dimension subjective que chacun fait de l’expérience morale, à l’instar des Principia Ethica de Moore[15]. Pour ce dernier, le travail de la philosophie morale est l’investigation sur ce qui est bien au moyen des énoncés moraux ordinaires. Pour Moore, donc, c’est là le travail du philosophe moral, c’est-à-dire d’examiner les énoncés qui font partie du réel et qui expriment une intuition de ce qui est bien[16]. Quels sont les points essentiels retenus pour cette investigation ? L’accent est mis sur les preuves de la véracité ou de la fausseté des énoncés ordinaires, mais aussi sur le repérage de leurs éventuelles confusions avec d’autres éléments, ce que Moore nomme le « sophisme naturaliste »[17]. Par exemple, ce qui est bien ne se confond pas avec ce qui est plaisant. Dès lors, une théorie ontologique et épistémologique se met en place à partir de laquelle se dessine l’objectivité morale : le bien ne s’assimile à rien d’autre ; n’importe qui peut y avoir accès puisque ce qui est bien, selon Moore, se connaît par intuition.
Ce n’est pas le lieu de proposer une critique générale de l’objectivité morale selon Moore. Retenons, car c’est pour la suite de notre propos l’essentiel, l’idée d’une méthode permettant d’examiner n’importe quelle situation avec la neutralité de la logique, une argumentation structurée, une démonstration suffisamment solide pour susciter l’adhésion. Une telle façon de concevoir la pensée morale a fait l’objet d’une sérieuse critique par Wittgenstein qui souligne, dans Le cahier bleu[18], l’obsession des philosophes pour la généralité :
Notre soif de généralité a une autre source importante : nous avons toujours à l’esprit la méthode scientifique. Je veux dire cette méthode qui consiste à réduire l’explication des phénomènes naturels au nombre le plus restreint possible de lois naturelles primitives ; et, en mathématiques, à unifier le traitement des différents domaines par généralisation. Les philosophes ont constamment à l’esprit la méthode scientifique, et ils sont irrésistiblement tentés de poser des questions, et d’y répondre, à la manière de la science. Cette tendance est la source véritable de la métaphysique, et elle mène le philosophe en pleine obscurité.
À suivre donc cette « soif de généralité », il est aisé de comprendre qu’un certain nombre d’aspects de l’expérience individuelle de la vie sont mis à l’écart, et les situations particulières passées au crible d’une pensée objectivante, théorique, neutre, planifiée, qui sépare – par méthode – la raison et le sentiment, le général et le particulier. Or, souligne Murdoch, cette approche se révèle moins convaincante « dès lors que nous prêtons attention à la notion d’ ‘être moral’, comme réflexion sur soi ou attitudes complexes envers la vie, qui sont continuellement montrées et élaborées dans le discours manifeste et intérieur, mais ne sont pas séparables en situation temporaires[19]. » On comprend donc à quel point la notion de « vie intérieure » soulignée par Murdoch (« Dans une analyse philosophique de la morale, quelle place devrions-nous donner à la ‘vie intérieure’ ? »[20]), remet en question cette technique philosophique (soucieuse de généralité) dans sa capacité à être attentive à d’autres aspects importants de la vie morale.
Il ne s’agit pas pour Murdoch de s’opposer à l’idée d’argumentation, ni d’adhérer à une philosophie qui se déguiserait en psychologie. Il s’agit d’être attentif aux visions particulières de la vie, c’est-à-dire aux visions personnelles qui guident nos choix. Or une conception de la pensée morale qui laisse échapper cette partie constitutive de la personne humaine, ne se prive-t-elle pas d’une aide précieuse pour comprendre les situations ordinaires de la vie qui plongent l’homme dans l’embarras ? Ainsi, sur des sujets de société majeurs, comme celui des conditions de la fin de vie, où les questions morales, à l’image de celles relatives à l’euthanasie, renvoient à des vies individuelles et des volontés individuelles, la question se pose de savoir comment accéder à ce qui est humainement important dans une situation particulière.
[1] G. Simondon, Du mode d’existence des objets techniques (1958), Paris, Aubier, 1989.
[2] T. L. Beauchamp, J. Childress, Principles of Biomedical Ethics. Fifth Edition, Oxford, Oxford University Press, 2001 (1979).
[3] Le descriptif qui est fait de ces trois domaines de la philosophie morale analytique ne prétend pas ici à l’exhaustivité.
[4] James Griffin, « Méta-éthique. Méta-éthique et éthique normative », in M. Canto-Sperber (dir.), Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale (1996), Paris, PUF, 2004, tome 2, p. 1246-1252.
[5] T. L. Beauchamp, J. Childress, op. cit.
[6] J. Clouser, B. Gert, « A Critique of Principlism », The Journal of Medecine and Philosophy, 1990, Vol. 15, n° 2, p. 219-236.
[7] Rawls, J., 2009 (1971). Théorie de la justice, trad. Audard, C., Paris, Points-Éssais ; Gauthier, D., 2000 (1986). Morale et contrat. Recherche sur les fondements de la morale, trad. Champeau, S., Liège, Mardaga, coll. « Philosophie et langage. »
[8] C. Pelluchon, L’autonomie brisée. Bioéthique et philosophie, Paris, PUF, 2009, p. 36-37.
[9] Sur la critique du contractualisme de Rawls au regard des situations de dépendance extrême, on peut se référer à Garrau, M., Le Goff, A., 2010. Care, Justice et dépendance. Introduction aux théories du Care, Paris, PUF-Philosophies ; mais aussi, Kittay, EF., « When caring is just and justice is caring : Justice and mental retardation », Public Culture, Vol. 13, N° 3, pp. 557-579.
[10] B. Williams, L’éthique et les limites de la philosophie (1985), trad. M.-A. Lescourret, Paris, Gallimard, 1990, p. 86.
[11] Laugier, S., 2001. « Pourquoi des théories morales. L’ordinaire contre la norme », Cités, Paris, PUF, 2001/1, n° 5, pp. 93-112.
[12] I. Murdoch, Existentialists and Mystics. Writings on Philosophy and Literature (1956), « Vision and choice in morality », Londres, Penguin Book, 1998, p. 81.
[13] A. J. Nowell-Smith, Ethics, London, Penguin Book, 1954, p. 319.
[14] I. Murdoch, op. cit., p. 79.
[15] G. E. Moore, Principia Ethica (1903), trad. M. Gouverneur, revue par R. Ogien, Paris, PUF, 1998.
[16] E. Halais, « Un tournant analytique en philosophie morale : Moore et Wittgenstein », in S. Laugier et S. Plaud ( dir.), Lectures de la philosophie analytique, Paris, Ellipses, 2011, p. 367-383.
[17] T. Baldwin, « Moore George Edward, 1873-1958. La philosophie morale de Moore et l’intuitionnisme », in M. Canto-Sperber (dir.), op. cit. tome 2, p. 1284-1287.
[18] L. Wittgenstein, Le Cahier bleu et le Cahier brun (1958), trad. M. Goldberg et J. Sackur, Paris, Gallimard, 1996, p. 58.
[19] I. Murdoch, op. cit, p. 81.
[20] Ibid., p. 78.