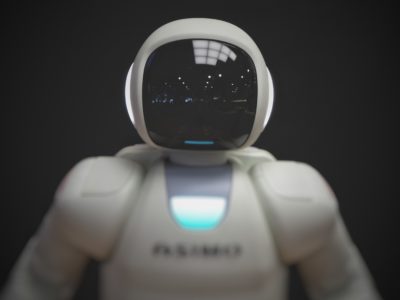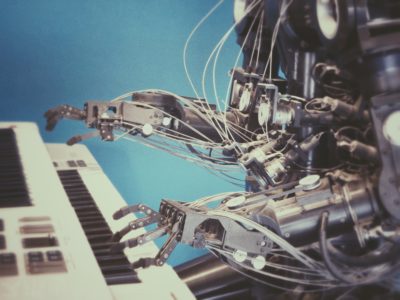Décider et faire (2)
Marta Spranzi – Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Décider et faire : le « savoir-comment-faire »
entre sagesse pratique, habileté et éthique du care
III. Le savoir-faire entre technique et éthique
Il a été remarqué qu’une des caractéristiques fondamentales du travail soignant est une forme de « savoir-faire », qui peut être décrit comme le niveau ultime de l’expertise, qu’on atteint après plusieurs stades d’apprentissage. Dans le savoir-faire propre d’un expert, les règles s’estompent en faveur des éléments situationnels qui prennent le dessus : plus un agent est expert, moins il a besoin de délibérer et de prendre consciemment des décisions. Le jugement moral expert est rapide et immédiat et ne se limite pas à percevoir les caractéristiques pertinentes d’une situation :
On atteint le niveau de l’expertise en développant des capacités interprétatives d’identifier la nature des situations pratiques ainsi que des réponses habiles à ce qui doit être fait, ainsi que du quand et du comment[1].
En invoquant l’approche de Dewey, Dreyfus met en évidence l’importance déterminante de l’expérience pour acquérir l’expertise. Dans les gestes impliqués dans la mise en œuvre d’une décision médicale, il y a en effet une multitude d’actions proches d’un savoir-faire détaché du raisonnement, surtout dans la phase experte. Dans le sillage de Patricia Benner[2] qui a appliqué la théorie de Dreyfus au savoir-faire infirmier, un article récent érige ce savoir-faire au statut d’une véritable intuition, comme une forme de connaissance certaine : « Dans ce contexte intuition signifie une conscience pré-cognitive et non discursive d’une situation ou d’une vérité »[3] . Cette intuition comprend : « (1) un savoir incarné ; (2) des perceptions sensorielles bien exercées à saisir les détails subtils de situations complexes qui évoluent rapidement ; (3) un réservoir conséquent de savoir conceptuel pertinent ; et (4) un bon nombre d’actions habituelles dont le but est d’atteindre les meilleurs résultats pour le patient »[4] . En effet, comme tout savoir « tacite », le savoir-faire est organisé de façon à atteindre un but : comme l’écrit Michael Polanyi qui l’a théorisée, toute connaissance tacite possède un élément fonctionnel qui relie le terme proximal de l’action — les différents détails des circonstances — et l’oriente vers un « terme focal », le but de l’action : au fur et à mesure que l’action se met en œuvre grâce au savoir-faire, les particuliers s’intègrent dans un tout, qui représente le but de l’action[5].
Le savoir-faire s’apparente ici à une forme de connaissance sui generis qui se fonde sur l’habitude et se passe du raisonnement et des principes généraux. Il peut être rapproché de ce qu’Aristote appelle une « habileté » et qu’il distingue de la sagesse pratique proprement dite (EN VI 13 1144a 23) : « L’habileté est la capacité de réaliser aisément des fins […] mais l’habileté en tant que telle est indifférente à la qualité de la fin »[6]. L’habileté est utilisée notamment dans les techniques et permet la bonne réalisation concrète d’un objet (poiesis). Toutefois, à la différence de l’action technique, le bien-fondé de l’action morale (praxis) est indépendant d’un résultat concret et repose plutôt sur la bonne disposition de l’agent, c’est-à-dire son caractère vertueux. Une habileté est donc un savoir-faire, mais non un savoir-faire spécifiquement moral, dans la mesure où il peut être utilisé pour n’importe quelle fin.
Mais ce savoir-faire relatif aux gestes techniques rejoint un savoir-faire proprement humain si la pratique soignante est définie non seulement comme une série de gestes techniques, mais comme une série d’interactions humaines signifiantes : les infirmières sont des « experts dans le care » en ce qu’elles possèdent une « habileté existentielle » fondée notamment sur la capacité d’empathie[7] :
La recherche en neurophysiologie contemporaine suggère très fortement que les humains ont une expérience directe d’autres personnes qui leur permet de saisir la signification d’une grande variété d’actions humaines, d’intentions, émotions, et sensations par une perception immédiate, non réflexive et non conceptuelle[8].
Mais le savoir-faire des soignants n’est qu’un outil du care, et cet outil n’est pas forcément utilisé dans la construction d’une relation éthiquement bonne. Afin d’intégrer la dimension du bien dans le geste technique lui-même, il faut passer du « savoir-faire » au « savoir-comment-faire ».
IV. Le tact et la dimension intrinsèquement éthique du « savoir-comment-faire » soignant
Le bien-être collectif qui est la visée du travail soignant se réalise surtout au travers des modalités particulières que prennent les actes et les gestes effectués au contact des autres ou en relation avec eux. Il suppose que ces gestes (techniques, relationnels et communicationnels) soient sensibles à leurs réactions éventuelles, et qu’ils y soient immédiatement ajustés. Le souci du bien des autres, ainsi qu’une attitude bienveillante, se traduisent par un savoir particulier qui incarne (embody) ce bien dans l’action elle-même quelle que soit sa nature[9]. La notion de « tact » est particulièrement appropriée pour décrire la dimension éthique du savoir-comment-faire — immédiate et loin de la décision morale.Voyons pourquoi.
Premièrement, le tact renvoie au sens du toucher. C’est la métaphore du toucher et non celle de la vision qui nous permet de comprendre la dimension éthique du travail des soignants. Il s’agit soit du toucher au sens propre du terme : le fait d’attacher un patient ou de le nourrir suppose un contact physique important et continu. Et, comme le dit bien Jean-Gilles Boula, « par le toucher, en effet, je ne puis être présent à l’autre sans l’être à moi-même, parce que le toucher est le seul des cinq sens à être réciproque »[10]. Comme l’écrit Merleau-Ponty :
La communication ou la compréhension des gestes s’obtient par la réciprocité de mes intentions et des gestes d’autrui, de mes gestes et des intentions lisibles dans la conduite d’autrui […]. Le geste est devant moi comme une question, il m’indique certains points sensibles du monde, il m’invite à l’y rejoindre[11] .
Deuxièmement, le toucher crée également un contact émotionnel : certains parlent pour les soignants de relations fondées sur le partage de la sensibilité et des émotions (« connaturalité affective »[12]). Le contact physique nécessaire du travail soignant atteint même la dimension du plaisir échangé. En commentant la façon dont des aides-soignants décrivent l’expérience d’un bain de serviette donné à une personne âgée en fin de vie, Pascale Molinier met en évidence le fait qu’on ne peut donner du plaisir qu’en trouvant soi-même du plaisir en faisant les gestes : « La personne qui réalise le bain de serviette doit aller faire des “papouilles”, c’est-à-dire être capable de communiquer avec l’autre à travers un certain toucher qui mobilise “la sensation de plaisir à donner” »[13].
Troisièmement, le même savoir-faire technique et relationnel peut se traduire par des modalités légèrement différentes : le savoir-comment-faire dans sa dimension matérielle relative au toucher ne peut pas répondre à des règles, même générales, mais demande une créativité presque infinie : « Les conditions pour constituer cette ambiance favorable sont délicates à constituer et non reproductibles systématiquement »[14].
Mais quelles sont les conditions de ce savoir-comment-faire ? Plusieurs pistes peuvent être, et ont été, explorées. Une première piste concerne la place des récits dans le travail soignant : en échangeant des récits ordinaires, qui mêlent l’expérience de la maladie et celle des autres petits évènements de la vie, le patient, les proches et le soignants partagent leurs vulnérabilités respectives : « Ces êtres vulnérables que nous sommes sont de surcroît tordus […] C’est de ces personnes tordues dont il s’agit de prendre soin, ceux qui en prennent soin n’étant pas moins tordus[15]. » Contrairement à ce qu’on considère d’habitude, la subjectivité du soignant est convoquée au même titre que celle du patient. L’empathie est un deuxième mécanisme qui permet d’ajuster son geste à l’autre, et il est souvent mis en avant : « L’infirmière fait l’expérience de cette compréhension empathique du patient comme phénomène moral ; rencontrer le patient de cette façon, fait surgir dans l’infirmière l’obligation morale de répondre à la situation du patient »[16]. Mais on peut creuser davantage cette dimension en parlant d’ « intimité » plutôt que d’empathie. D’après l’auteur qui l’a thématisée dans le cadre d’une éthique soignante, l’intimité vise à construire une éthique commune indissociable d’une « communauté de sensibilité »[17] dans une relation plus symétrique que l’empathie : « Par rapport à l’empathie, l’intimité a l’avantage d’inclure la façon dont la personne interagit avec les autres et non seulement ce qu’elle fait ». Au travers des paroles et des gestes échangés, on transmet aussi une attitude d’attention, de souci et de soutien ; ce qui compte est moins le contenu de ce qui est échangé que le fait même d’échanger : « Si ce que laisse paraître l’un est perçu par l’autre comme personnel et significatif, et que la réaction du second est jugée par le premier comme manifestant la sollicitude et l’approbation, il en résulte pour les deux parties un sentiment d’intimité[18]. »
Ce savoir-comment-faire a un nom qui en indique bien les caractéristiques : le tact. Il se manifeste dans les nuances des échanges et des gestes effectués et possède une dimension éthique immédiate et particulière. Premièrement, le tact peut être décrit comme une vertu mitoyenne entre morale et étiquette[19]. David Heyd, qui a consacré un article fondateur et original à cette question, écrit :
Le tact est une vertu typiquement sociale ou interpersonnelle. Sa valeur ne réside pas dans l’harmonie interne ou l’excellence de l’agent en tant qu’être humain, mais principalement dans le fait de faciliter les relations humaines […]. Il concerne la valeur de l’intimité, et exprime une attention personnelle à la singularité de la situation humaine[20].
Mais, deuxièmement, on peut aussi comprendre le tact comme un outil fondamental de tout art au sens esthétique du terme : dans le geste pratique et dans le déploiement de ses multiples modalités, l’éthique rejoint la problématique plus générale de la recherche de l’harmonie des formes et l’expression du goût et du désirable.
Conclusions
Le fait de percevoir les aspects pertinents d’une situation et de déterminer quelles actions réalisent le bien étant donné toutes les contraintes du contexte suppose un « savoir juger » qui s’apparente à la phronesis aristotélicienne et qui se déploie non seulement dans la décision relative à l’action, mais également à toutes les microdécisions qui permettent sa mise en œuvre concrète. Toutefois, comme l’indique la métaphore de la perception, dans le savoir juger l’acteur reste passif et ne fait que se représenter la question éthique et la résoudre intellectuellement. Or, les gestes du soin relèvent bien d’un savoir-faire, qui est différent du savoir juger et peut être compris par analogie avec la maîtrise de techniques d’artisanat qui comprennent une dimension corporelle et matérielle indépendante de l’intention. Par conséquent, la justesse de l’action soignante ne dépend pas seulement de l’intention de l’action, mais de la maîtrise des gestes effectués et de leur caractère approprié aux situations toujours changeantes du soin. Dans la mesure où le savoir-faire concerne également ce qu’on appelle les soins relationnels, il possède une dimension éthique intrinsèque : il permet de réaliser un ajustement immédiat non seulement entre soi et la situation, mais également et surtout entre soi et les autres. Cette capacité est essentielle pour s’acquitter des tâches de soins à la fois techniques et relationnels.
À son tour, ce savoir-faire n’est effectif que s’il s’accompagne d’un savoir-comment-faire encore plus difficile à observer et plus important. Si l’on substitue la métaphore du toucher à celle de la vision, la présence de l’autre devient plus proche et plus active : l’interaction engage à la fois la sensibilité et les émotions de toutes les parties concernées à égalité. Les trois dimensions de la narration, de l’empathie et de l’intimité nous permettent de passer du savoir-faire au savoir-comment-faire. Un auteur parle à ce propos de « savoir-y-faire » : « Le tact fait dépendre le savoir-faire du savoir-y-faire, par lequel le sujet humain fait vibrer la sensibilité singulière qui le fait naître au monde[21]. »
Mais le tact n’est pas uniquement important en soi. Les soignants et leur « savoir-comment-faire » apportent des éléments intéressants aux décideurs : les connaissances dites « supérieures » reposent parfois sur « la captation et la récupération de leurs savoirs pratiques »[22]. En d’autres termes, par le rapport intentionné et direct aux autres, les acteurs peuvent avoir des indications sur le bien-fondé de la décision qui a motivé l’action et ses gestes. C’est par le toucher que se manifeste la résistance de l’autre ou de la situation à celui qui agit. C’est ainsi que la réalité est appréhendée et que des informations essentielles qui mettent éventuellement en cause les décisions prises peuvent surgir. En effet, le savoir-comment-faire permet à la fois d’affiner le savoir-faire et de mieux ajuster le savoir juger aux circonstances changeantes de la situation : l’habileté technique et la phronesis restent inopérantes sans le tact. Le travail soignant est bien une exemplification de l’éthique du care, mais il nous permet et d’enrichir la réflexion éthique d’une dimension empirique essentielle et compléter l’arsenal des différents ingrédients de l’éthique, en mettant l’accent sur la dimension essentielle du tact. Il montre également qu’une décision avisée nécessite surtout une sensibilité particulière aux différentes résistances opposées par les personnes qui font l’objet de notre attention et par la complexité de la situation elle-même. Il arrive ainsi que la mise en œuvre d’une décision nous force à revenir non seulement sur la décision elle-même, mais également à redéfinir les concepts, les théories et les approches qui ont guidé notre réflexion, et à renouveler ainsi de façon originale nos outils de réflexion.
[1] H. Dreyfus et S. E. Dreyfus, « The relationship of theory and practice in the acquisition of skill », in P. Benner, C. Tanner, C. Chesla (dir.), Expertise in Nursing Practice. Caring, Clinical Judgement and Ethics, Springer, 2009, pp. 1-24, p. 22.
[2] P. Benner, De novice à expert. Excellence et soins infirmier, Paris, Masson, 2003.
[3] C. Green, « Nursing intuition », art. cit., note 14, p. 100.
[4] C. Green, ibid, p. 109.
[5] M. Polanyi, Personal Knowledge, Chicago, University of Chicago Press, 1962.
[6] P. Aubenque, La prudence chez Aristote, Paris, PUF, 1963, p. 61.
[7] H. Dreyfus et S. E. Dreyfus, art. cit., note 20, p. 21.
[8] C. Green, « Nursing intuition », art. cit., p. 98.
[9] Green définit le savoir infirmier comme un savoir « incarné ».
[10] J.-C. Boula, « De la dignité humaine dans les soins », Perspective soignante, n° 28, 2008, pp. 86-99, p. 98.
[11] M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, pp. 215-16.
[12] C. Green, art. cit., p. 10.
[13] P. Molinier, « Apprendre des aides soignantes », op. cit., note 4, p. 139.
[14] J.-C. Boula, art. cit., p. 14.
[15] P. Molinier, « Le care à l’épreuve du travail », art. cit., p . 306.
[16]T. Kirk, « Beyond empathy: clinical intimacy in nursing practice », Nursing philosophy, vol. 8, 2007, pp. 233-243, p. 234. L’empathie est un instrument souvent invoqué dans l’analyse de la relation de soins : « L’empathie déclenche pour le soignant un mouvement de décentrement par rapport aux logiques, nécessaires mais insuffisantes, de la science et de la technique médicales. Elle constitue un élément essentiel de la relation de soin qui répond à la nécessité d’allier à la connaissance médicale de la maladie, la compréhension et l’individualité du sujet malade. » (C. Lefève, « La relation de soin doit-elle être une relation d’amitié ? », in L. Benaroyo, C. Lefève, J.-C. Mino, F. Worms (dir), La philosophie du soin. Ethique, médecine et société, Paris, PUF, 2010, pp. 107-126, p. 117.) Voir aussi P. Nortvedt, « Sensitive judgment: an inquiry into the foundations of nursing ethics », Nursing ethics, vol. 5, 1998, pp. 385-392.
[17] T. Kirk, art. cit., p. 307.
[18] T. Kirk, art. cit., p. 236.
[19] Robert Audi parle aussi d’un « devoir de manières » à côté des grands devoirs éthiques comme le respect de l’autonomie, la bienfaisance et la véridicité (R. Audi, The Good in the Right, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2004, p. 182).
[20] D. Heyd, « Tact: sense, sensibility and virtue », Inquiry, vol. 38, n° 3, 1995, pp. 217-231, p. 227.
[21] J.-P. Resweber, Les gestes de soins, Strasbourg, Editions Le Portique, « Les Cahiers du Portique », 2003, p. 103. Patricia Ribault qui a travaillé sur le geste artisanal met également en avant la dimension intrinsèquement esthétique du savoir-faire technique (P. Ribault, « Du toucher au geste technique. La technè des corps », Appareil, n° 8, 2011, URL : http://revues.mshparisnord.org/appareil/index.php?id=1315, consulté le 20/4/2013).
[22] P. Molinier, « Désirs singuliers et concernement collectif : le care au travail », in V. Nurock (dir.), Carol Gilligan et l’éthique du care, Paris, PUF, 2010, p. 141.