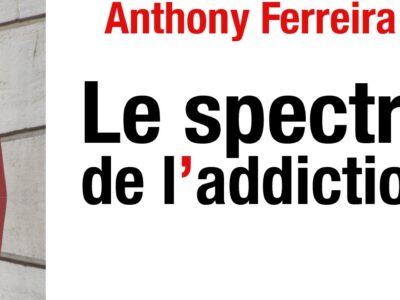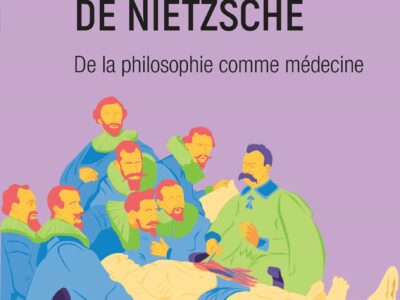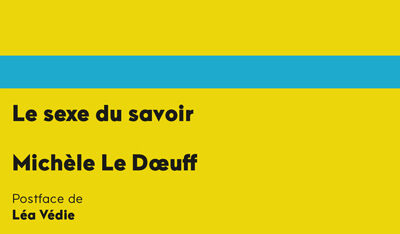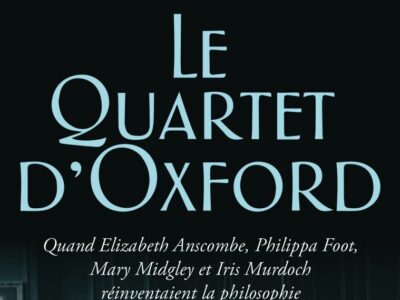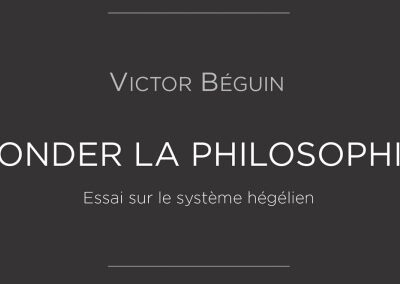Compte rendu critique – Moral feelings, moral reality, and moral progress
Blondine DESBIOLLES, agrégée et docteure en philosophie, membre associée de l’IRPhiL. Mes recherches portent sur la notion d’impartialité et sur la conflictualité des raisons, des valeurs et des normes, en métaéthique, en éthique et en politique. J’examine en particulier les composants rationnels et les prétentions normatives du jugement, de la justification et de la délibération, au sein des désaccords moraux. Ma thèse doctorale a porté sur l’analyse de ces points par Thomas Nagel.
Thomas Nagel, Moral feelings, moral reality, and moral progress, New-York, Oxford University Press, 2023, 71 pages, $ 24,95
L’ouvrage est disponible ici.
Résumé
Dans Moral Feelings, Moral Reality and Moral Progress, Thomas Nagel pose la question de la connaissance morale : pouvons-nous, à partir de nos intuitions et de nos jugements spontanés sur le bien et le mal ou le juste et l’injuste, accéder à des raisons morales vraies ? Et les corriger, le cas échéant, pour progresser moralement ? Les deux essais qui composent l’ouvrage défendent l’idée que cela est possible, et que le progrès moral consiste à découvrir ou à accéder à des raisons normatives vraies. Progresser sur le plan éthique, ce serait appuyer nos jugements sur des vérités morales ; corriger ainsi les erreurs ou approximations éthiques passées ou présentes ; et, là où elles manqueraient, adopter de nouvelles raisons morales. Toutefois, le progrès moral doit intégrer la pluralité et la diversité des jugements moraux, qui d’ailleurs dépendent des cadres de pensées au sein desquels ils prennent place. Nos jugements moraux peuvent être vrais ou faux, et évoluer ou être ajustés au fil du temps. Ils ne sont ni des illusions produites par nos émotions, ni des idéaux atemporels et absolus à atteindre une fois pour toutes. Ce sont des équilibres entre raisons, toujours localement définis, et accessibles à qui fait l’effort d’examiner les normes, valeurs et repères normatifs qui fondent nos jugements moraux.
Mots-clés : connaissance morale ; normativité ; raisons ; progrès ; épistémologie.
Abstract
In Moral Feelings, Moral Reality and Moral Progress, Thomas Nagel raises the question of moral knowledge. Could we access true moral reasons, beyond our intuitions and our spontaneous judgements on good and evil, right and wrong? Could we correct them, if need be, in order to morally improve? The two essays which make up the book argue that it is possible, and that moral progress is the discovery or the access to normative true reasons. Improving ethically speaking would therefore equates to basing our judgements on moral truths; to correcting past or present ethical errors or approximations; and where they would be lacking, to adopting new moral reasons. However, moral progress must accommodate the plurality and diversity of moral judgements, and their dependence to reasons and paradigms in which they take place. Our moral judgements can then be true or false, and they can evolve and be modified over time. They are neither illusions derived from our emotions nor timeless and absolute ideals to be achieved once and for all. They are reasons’ equilibriums, that are always locally defined and accessible to whoever makes the effort to look into the norms, values and normative standards that are the basis of moral judgements.
Keywords : moral knowledge; normativity; reasons; progress; epistemology
Introduction : un engagement réaliste et pluraliste
Pouvons-nous nous fier à nos jugements spontanés, en matière de morale ? Peuvent-ils être tenus pour des expressions ou des perceptions de la vérité ? Dans Moral Feelings, Moral Reality and Moral Progress [1], Thomas Nagel pose la question de la connaissance morale, c’est-à-dire du fait d’avoir des conceptions vraies au sujet du bien et du mal. Le titre même de l’ouvrage indique les trois préoccupations principales qui le structurent : la nature et le fondement de nos sentiments moraux, ou plus exactement, les « intuitions » ou jugements spontanés que nous avons en matière de moralité ; la question de la réalité et de la fiabilité de notre savoir moral ; la possibilité de penser l’évolution de nos idées morales comme un progrès vers la vérité.
Sur ces trois points, T. Nagel défend une thèse méta-éthique [2] qu’il a formalisée et défendue dès ses premiers ouvrages : le réalisme normatif. Il s’agit d’une déclinaison spécifique du réalisme moral, lequel affirme que des propositions morales vraies existent, par exemple « la douleur est un mal ». Ces propositions seraient objectivement vraies car indépendantes de nous, de nos esprits et de nos croyances. Pour le réalisme normatif, ces vérités morales ne sont pas des êtres, des choses ou des propriétés de choses : elles n’ont pas de réalité ontologique. Elles sont des énoncés rationnels que nous pouvons connaître objectivement, par la réflexion. Ce sont des raisons, qui ont la particularité d’être normatives. C’est-à-dire qu’elles ne décrivent pas des faits (« La torture est douloureuse »), ni ne recommandent des choix de façon prudentielle ou stratégique (« Si tu veux obtenir des informations, mieux vaut employer la persuasion que la force »). Elles énoncent des propriétés morales et des exigences objectives (« La torture inflige à autrui un mal qui le nie en tant que personne, et est immorale dans et par cette négation d’autrui ») qui, dès lors qu’elles sont saisies par la raison, doivent normer nos choix et nos actes.
 Pour T. Nagel, cette thèse peut rendre compte du pluralisme éthique, mais aussi des changements normatifs et institutionnels qui marquent le progrès moral. Son raisonnement, déployé à travers les deux essais qui composent cet ouvrage, s’appuie sur plusieurs éléments argumentatifs et conceptuels que nous proposons d’examiner en cinq étapes. « Gut Feelings and Moral Knowledge » part de nos intuitions morales, divergentes voire conflictuelles (I.), et défend la nécessité de préserver leur pluralité (II.). Cette irréductible diversité soulève la question de ce que pourrait être le progrès moral. Le second essai, « Moral Reality and Moral Progress », en examine alors les conditions et les formes possibles – dont celle d’une découverte de raisons morales vraiment nouvelles (III.). La question devient alors celle de la vérité de ces raisons, et de notre capacité à les connaître. T. Nagel y répond par deux thèses nouvelles (IV.) : l’accessibilité des raisons et le caractère local de la vérité. Progresser moralement, ce serait comparer les raisons éthiques dont nous disposons avec celles que les faits nouveaux nous rendent accessibles, et tâcher d’atteindre un équilibre réfléchi permettant de dégager des principes et des normes cohérents (V.). L’ensemble de ces thèses soulève quelques points de discussion critique (VI.), qui portent surtout sur la tentative, par T. Nagel, de penser un lien entre les raisons normatives et les faits, et de défendre ce faisant une conception locale de la vérité. Or, cela ne va pas de soi et complexifie plus encore la possibilité de parvenir à un équilibre réfléchi permettant le progrès moral.
Pour T. Nagel, cette thèse peut rendre compte du pluralisme éthique, mais aussi des changements normatifs et institutionnels qui marquent le progrès moral. Son raisonnement, déployé à travers les deux essais qui composent cet ouvrage, s’appuie sur plusieurs éléments argumentatifs et conceptuels que nous proposons d’examiner en cinq étapes. « Gut Feelings and Moral Knowledge » part de nos intuitions morales, divergentes voire conflictuelles (I.), et défend la nécessité de préserver leur pluralité (II.). Cette irréductible diversité soulève la question de ce que pourrait être le progrès moral. Le second essai, « Moral Reality and Moral Progress », en examine alors les conditions et les formes possibles – dont celle d’une découverte de raisons morales vraiment nouvelles (III.). La question devient alors celle de la vérité de ces raisons, et de notre capacité à les connaître. T. Nagel y répond par deux thèses nouvelles (IV.) : l’accessibilité des raisons et le caractère local de la vérité. Progresser moralement, ce serait comparer les raisons éthiques dont nous disposons avec celles que les faits nouveaux nous rendent accessibles, et tâcher d’atteindre un équilibre réfléchi permettant de dégager des principes et des normes cohérents (V.). L’ensemble de ces thèses soulève quelques points de discussion critique (VI.), qui portent surtout sur la tentative, par T. Nagel, de penser un lien entre les raisons normatives et les faits, et de défendre ce faisant une conception locale de la vérité. Or, cela ne va pas de soi et complexifie plus encore la possibilité de parvenir à un équilibre réfléchi permettant le progrès moral.
Nagel conclut modestement son livre sur l’idée que des révolutions morales, quoique nous ne puissions encore les imaginer, adviendront probablement.
I. Des intuitions morales en conflit
Dans « Gut Feelings and Moral Knowledge » [3], T. Nagel part d’un choix moral difficile qu’a eu à faire le philosophe Stuart Hampshire lors de la Seconde Guerre Mondiale, en France, pour les services de renseignement britanniques : mentir à un homme en lui promettant la vie sauve, tout en sachant qu’il serait exécuté à la fin de l’interrogatoire, pour obtenir des informations cruciales pour la Résistance. Un tel dilemme suscite des réactions morales et des sentiments moraux spontanés (gut feelings) qui peuvent varier du tout au tout selon les personnes. Comment alors déterminer ce qui est réellement bon ou mauvais ? Quelle autorité donner à nos jugements moraux spontanés ?
La difficulté est que nos jugements moraux peuvent mobiliser plusieurs types de raisonnements, qui ne posent pas les mêmes concepts et justifications de l’action morale. Les jugements « conséquentialistes » examinent les états de fait, les résultats, les conséquences d’un choix, pour déterminer si celui-ci est « bon » ou « mauvais ». Ils ont l’avantage de poser des valeurs claires et accessibles, comme le bon et le mauvais, le plaisir et la douleur, l’utile et l’inutile, par rapport auxquelles on peut assez aisément examiner ou prévoir les conséquences des actes. Les jugements « déontologiques », eux, se centrent plus sur l’inviolabilité morale des personnes, sur leur humanité, et mobilisent les critères de « juste » et d’« injuste ». Pour T. Nagel, les « contraintes » ou « restrictions » déontologiques [4] indiquent les limites de ce que je peux faire à autrui : elles excluent absolument de lui infliger du mal, quelles que soient les conséquences que cela pourrait pourtant avoir. C’est là le cœur même de l’inviolabilité des personnes, que T. Nagel place au cœur des droits humains fondamentaux. [5] Nos intuitions morales tendent à naviguer entre ces types de jugements et de justifications, pourtant incompatibles. Or leurs atouts et limites s’égalent ; on ne peut pas simplement trancher entre eux, et c’est pourquoi ils peuvent nous confronter à des dilemmes moraux, comme celui vécu par Hampshire.
On pourrait alors se demander si nos intuitions morales, qu’elles soient conséquentialistes ou déontologiques, sont en elles-mêmes fiables ou relèvent de confusions, voire d’illusions que l’on pourrait tout simplement éliminer. Deux approches, examinées par T. Nagel, développent cette piste critique. La première est formulée par David Hume [6], pour qui nos intuitions morales sur le bien et le mal découleraient de vertus et de règles « artificielles », c’est-à-dire définies de façon conventionnelle en vue de l’intérêt général. Nous aurions simplement intériorisé ces règles au point de ne plus en voir l’aspect conventionnel et conséquentialiste. La seconde critique est de type scientifique. Elle consiste, elle aussi, à considérer que les règles morales ont une utilité sociale définie en termes de conséquences, mais elle les explique par des impératifs évolutionnistes. Nos intuitions morales seraient ici produites par un instinct, lui-même créé par la sélection naturelle. Le problème est qu’il s’accompagne d’émotions qui peuvent être illusoires et confondantes, sans plus de lien avec la nécessité qui légitimerait, d’un point de vue conséquentialiste, nos réactions morales. Pour T. Nagel, ces deux critiques ont une certaine pertinence : le conséquentialisme de la règle [7], qu’elles ont en commun, explique nos intuitions morales et montre qu’elles ne sont pas en réalité fondamentales. Toutefois, il objecte qu’expliquer n’est pas éliminer, et que les intuitions déontologiques notamment résistent aux tentatives de réduction ou d’élimination.
II. L’irréductibilité du pluralisme moral
Nagel insiste à plusieurs reprises sur une différence fondamentale entre le raisonnement moral et le raisonnement scientifique en général. En sciences, nous observons et énonçons des faits à partir de notre interaction causale avec le monde, dont nous faisons partie. Mais en morale (comme d’ailleurs en mathématiques et en logique), nos intuitions et nos évaluations ne sont pas directement observables dans les choses ni explicables par les interactions causales entre les phénomènes. Elles reposent sur des raisons normatives, qu’on ne peut pas réduire à de simples énoncés de fait ou à des causes physiologiques ou psychologiques, sans perdre leur spécificité morale. De plus l’approche scientifique, en nous invitant à adopter un point de vue détaché et scientifique sur nos propres jugements, ne fait que déplacer le problème de la distinction entre apparence et réalité morales. Car le « point de vue de nulle part », d’ailleurs examiné par T. Nagel dans son livre éponyme[8], est certes un point de vue supposé être plus objectif, plus rationnel, plus extérieur que le point de vue purement personnel dont il est issu. Mais il inclut et subsume une multitude de perspectives et de degrés de subjectivité et d’objectivité. Or, pour décider depuis ce point de vue décentré lesquels des jugements moraux qu’il contient sont bel et bien vrais, il faut déjà décider des critères de distinction et de justification à employer : déontologiques ou conséquentialistes. Et ce sont ces critères qui font, précisément, l’objet de désaccords moraux. [9]
Par ailleurs, T. Nagel refuse l’idée que toute la moralité humaine puisse être entièrement ramenée à un seul type de valeur ou de fondement. [10] La reconnaissance impartiale et bienveillante des plaisirs et souffrances d’autrui peut certes constituer un fondement normatif important de la moralité, mais il n’est pas le seul. L’intuition déontologique vis-à-vis d’autrui ne s’y réduit d’ailleurs pas ; elle consiste à reconnaître, dans mon expérience subjective, les limites objectives que l’inviolabilité d’autrui impose à mes actions. [11] Les intuitions déontologiques ne sont donc pas aisément réductibles à des causes psychologiques ou naturelles, ni à des raisonnements conséquentialistes. Elles sont certes plus floues et difficiles à justifier que celles de type conséquentialiste, qui pourraient bien, au fil du temps, les supplanter. Mais T. Nagel considère que ce serait là perdre une facette précieuse de la moralité humaine. [12] Peut-on alors dépasser le conflit éthique entre ces deux types de jugements moraux, pour atteindre des principes et normes de conduite morale et ainsi progresser ?
III. Les conditions du progrès moral
Une première piste de résolution, qui apparaît dans les deux essais de l’ouvrage, repose dans le recours à la méthode de l’équilibre réfléchi. [13] Elle avait été proposée par John Rawls pour définir les principes de la justice comme équité. Il s’agit de confronter les principes généraux et les jugements « bien pesés » sur des cas particuliers, pour les ajuster progressivement les uns aux autres. Dans le cadre moral, cette méthode partirait des jugements intuitifs sur une question morale donnée, et élaborerait, par des aller-retours réflexifs et discursifs entre eux, un ensemble de principes et de jugements pouvant faire l’objet d’un accord raisonnable. Toutefois comme nos intuitions tant déontologiques que conséquentialistes sont également justifiables, mais incompatibles entre elles, T. Nagel souligne que ce n’est pas un mais deux équilibres réfléchis qu’il va falloir trouver. Cette méthode a l’avantage de pouvoir valoir aussi bien pour éclaircir des principes moraux déjà existants et disponibles, que pour réviser radicalement nos jugements et en élaborer de nouveaux. Toutefois, poser deux équilibres réfléchis ne résout pas la tension entre déontologie et conséquentialisme, mais au contraire les isole l’un de l’autre. Ne faudrait-il pas un troisième équilibre réfléchi, qui tâche d’ajuster les raisons dégagées par les deux premiers dans un nouvel ensemble unifié ? Sur ce point, l’essai « Moral Reality and Moral Progress » proposera bien plutôt une succession continue d’équilibres réfléchis, qui serait au cœur du progrès moral.
Nagel repart alors, dans le second essai de son ouvrage, de cette question de la définition du progrès moral. S’agit-il de découvrir des raisons qui avaient toujours déjà été vraies, ou de découvrir des raisons totalement nouvelles ? [14] T. Nagel considère que les deux sont possibles, ce qui implique un remaniement des composants dits « absolutistes» de son réalisme moral. Le réalisme moral absolutiste défend au moins une des deux thèses suivantes : les vérités morales sont objectives et indépendantes de nos croyances et attitudes à leur égard (objectivisme) ; elles peuvent faire l’objet d’un accord universel (universalisme). Si l’universalisme est correct, alors le progrès moral pourrait ressembler au progrès scientifique. Il consisterait en des changements non pas normatifs (puisque la ou les normes sont déjà vraies) mais factuels : il s’agirait de retirer, corriger ou élaborer les conditions qui permettraient aux normes d’être appliquées correctement à de nouveaux faits. [15] T. Nagel considère que c’est là parfois la façon dont nous progressons moralement, en découvrant ce qui était déjà universellement vrai. Mais si c’était la seule forme de progrès moral, le pluralisme moral serait réduit ; une vérité normative fondamentale unifierait tous les désaccords moraux, qui ne seraient que des égarements ou des tâtonnements.
Nagel va alors renoncer à la thèse universaliste, qu’il défendait dans ses travaux précédents [16], en envisageant que le progrès moral puisse aussi consister en une découverte réellement normative. On pourrait découvrir des raisons nouvelles, qui n’était pas accessibles ou déjà vraies auparavant, parce qu’elles sont liées à des faits et des conditions historiques particulières. Les vérités morales pourraient apparaître dans des contextes et des circonstances spécifiques, donc ne pas être universelles. Toutefois, T. Nagel maintient le composant objectiviste de sa thèse réaliste : les raisons normatives, qu’elles soient déjà vraies ou nouvelles, existent de façon objective et indépendante de nous. [17] Il faut donc clarifier, d’une part le fait que les raisons normatives nouvelles ne dépendent pas de nous, de nos croyances ou de nos attitudes, mais sont bien objectives et découvertes par nous ; et d’autre part, le fait que leur découverte puisse dépendre de conditions historiques et particulières.
IV. Accessibilité des raisons et vérité locale
La résolution de ces deux difficultés dépend de la thèse, défendue par T. Nagel, de ce qu’il nomme à la suite de Joseph Raz « l’accessibilité des raisons » [18]. Elle requiert d’abord que les raisons normatives puissent être saisies par quelqu’un : une raison n’existe pas si elle n’est une raison pour personne. Et pour pouvoir saisir une raison normative, la personne doit avoir une rationalité prudentielle et une rationalité morale. La première dépend de la capacité à se concevoir soi-même maintenant et dans l’avenir ; la seconde, qui en est en quelque sorte une extension, repose sur la reconnaissance de la réalité d’autrui et de sa capacité rationnelle égale à la nôtre. [19] Cela ne signifie nullement que les raisons dépendent de notre esprit. Pour T. Nagel, l’accessibilité désigne la capacité du sujet à comprendre qu’il a telle ou telle raison morale, et ce, quelles que soient ses croyances par ailleurs. Dans cette acception le contenu d’un énoncé moral n’est pas créé par les croyances, intérêts ou dispositions de l’individu ; il serait défini par les faits non-normatifs qui génèrent cette raison pour quelqu’un capable de la comprendre. [20] En revanche la saisie de la vérité objective de cet énoncé moral dépend bien de nos capacités rationnelles, et des structures de pensée dont nous disposons.
Or, tant les faits qui génèreraient les raisons que les conditions épistémologiques et morales pour accéder à ces raisons, sont historiquement, socialement, culturellement et institutionnellement situés. N’est-ce pas alors faire dépendre la vérité morale de paramètres variables, et donc embrasser le relativisme moral ? Pas tout à fait. T. Nagel rejette explicitement le « relativisme de la distance » [21], défendu par Bernard Williams, et maintient bien plutôt son engagement réaliste. Toutefois, il admet que la faculté universelle de la raison pourrait ne pas suffire à accéder à certaines raisons vraies. Il est certes possible que ce qui est vrai moralement le soit de façon générale : une raison normative pourrait être accessible à toutes les personnes rationnelles et morales, par-delà les contingences historiques de leur cadre de pensée. Par exemple, T. Nagel considère – contre B. Williams – que l’immoralité de l’esclavage était déjà accessible aux Grecs dans l’Antiquité, car même s’ils ne disposaient pas de l’idée moderne de justice, ils devaient avoir la capacité à se mettre à la place d’autrui et à saisir le caractère problématique de la relation maître-esclave. [22] Mais d’autres raisons morales ne pourraient être saisies qu’à partir de conceptions et d’idées qui dépendent d’expériences et de développements institutionnels, conditionnés dans l’espace et dans le temps. En ce sens, la vérité peut être non pas générale, mais locale. [23] Par exemple, la défense de la liberté d’expression dépend notamment de l’idée, propre à la modernité libérale, selon laquelle l’autorité politique n’est légitime que si elle est reconnue[24] par des citoyens qui se considèrent comme autonomes, égaux et rationnels. C’est cette conception de la légitimité et de l’autorité politiques qui justifie la restriction de la puissance coercitive de l’État, et permet ainsi de penser et de protéger la liberté d’expression individuelle. Le droit à la liberté d’expression n’aurait donc pas pu être pensé, même par un esprit brillant, en amont des développements institutionnels et politiques propres à la modernité.
Avec ces deux thèses, l’accessibilité des raisons et le caractère local de la vérité, T. Nagel complète mais remanie aussi notablement son réalisme normatif pour adopter un « réalisme normatif local » [25]. D’une part, il maintient le caractère indépendant, objectif et vrai des raisons normatives. Leur contenu ne dépend pas de nous, il est simplement compris par nous. D’autre part, la vérité de nos jugements et des normes dépend de leur adéquation aux questions et circonstances auxquelles ils répondent. En ce sens, les normes peuvent être normativement vraies, sans être pour autant atemporelles [26] ni universelles. Il se peut donc que ce que nous tenons pour une vérité morale puisse être révisé et remplacé par une autre tout à fait nouvelle ; le progrès moral serait bien, parfois, la découverte normative de raisons nouvelles.
V. Un progrès moral dialectique
Un tel progrès moral normatif, consistant à accéder à des raisons dont on ne disposait pas avant, se produit lorsque le développement des faits et des circonstances historiques, institutionnels, sociaux, nous confronte à un problème nouveau. T. Nagel considère que cela vaut notamment pour les vérités morales qui concernent la justice sociale, la sexualité ou les relations internationales [27] : elles n’apparaissent qu’avec le développement de conceptions et d’institutions politiques et sociales particulières. Cela implique que malgré tous les efforts de la raison et de l’imagination, nous ne pouvons pas anticiper certains changements moraux futurs [28] qui dépendent d’évolutions factuelles et normatives dialectiques encore à venir.
Nagel reprend alors la piste de l’équilibre réfléchi, mais en le pensant de manière à la fois plus étendue et plus continue. [29] L’équilibre réfléchi devient un processus sans cesse relancé d’ajustement, de disruption puis de dépassement des raisons. Celles-ci ne sont d’ailleurs plus uniquement déontologiques ou conséquentialistes. T. Nagel les ordonne en trois catégories, à savoir les raisons personnelles, les raisons impersonnelles et les raisons sociales ou associatives. Les raisons personnelles [30] sont celles qui norment mon action et ma façon de me rapporter à moi-même et à autrui ; elles incluent notamment les raisons déontologiques (qui m’indiquent ce que je ne dois pas faire à autrui, ce que je dois respecter de lui), mais aussi les « raisons d’autonomie» (des raisons d’agir liées à mes désirs, mes projets, mes fins personnelles) et les « raisons d’obligation» (qui concernent des devoirs spéciaux et positifs que j’ai à l’égard de certaines personnes avec qui j’ai une relation particulière). Les raisons impersonnelles sont des raisons qui valent pour quiconque et qui visent à normer des états de fait généraux, comme « il faut éradiquer la faim dans le monde » ; elles sont plutôt, quoique non exclusivement, conséquentialistes. [31] Les raisons sociales ou associatives mentionnées par T. Nagel dans « Moral Reality… » constituent un ajout par rapport à ses travaux antérieurs, et ne sont pas définies en tant que telles. Elles pourraient désigner des raisons intersubjectives, qui ne se réduiraient ni à des raisons personnelles étendues à autrui, ni à des raisons impersonnelles valant pour quiconque. Il pourrait s’agir ici des raisons concernant la solidarité entre les citoyens d’une nation, ou de celles propres, par exemple, aux relations de care.
Le progrès moral consisterait alors non pas à réduire ou éliminer cette diversité des perspectives morales, mais à les comparer entre elles [32] pour en dégager les raisons vraies et définir les principes généraux permettant de les équilibrer. Le but serait d’aboutir à un équilibre réfléchi des raisons et des principes, et à un accord raisonnable et justifié sur les normes devant régir les comportements individuels comme les décisions politiques. Ce cadre moral peut toutefois à son tour devenir insuffisant ; les principes et raisons qu’il définit peuvent alors constituer les jugements intuitifs de départ de la recherche d’un nouvel équilibre réfléchi, qui va le transcender. Le mouvement serait alors celui d’une dialectique entre les équilibres réfléchis locaux, permettant d’élaborer, sur les bases posées par les précédents, de nouveaux ensembles normatifs et institutionnels.
VI. Bilan critique
Nagel a le talent d’écrire de la philosophie analytique, même technique, même méta-éthique, avec une plume légère, claire et simple. Ses réflexions suivent un parcours discursif et progressif : les thèses et les arguments sont justifiés et affinés au fil des exemples mobilisés, des questions qu’ils soulèvent et des réponses qui peuvent être envisagées. Moral Feelings, Moral Reality, and Moral Progress estun ouvrage qui met ainsi en œuvre ce qu’il entend établir : à savoir prendre au sérieux nos sentiments et jugements moraux spontanés pour remonter, progressivement, à leurs conditions de vérité sur le plan éthique et méta-éthique. Il constitue en outre une refonte stimulante du réalisme normatif de T. Nagel, qui le dote de points d’ancrages locaux dans le tissu des faits et des développements historiques.
Les thèses qu’il déploie sont présentées dans deux essais très brefs, qui doivent donc faire l’économie de certains volets justificatifs ou explicatifs. Cela laisse plusieurs questions ouvertes. La première concerne sa thèse selon laquelle les faits généreraient les raisons normatives. Elle soulève le problème classique, pointé par David Hume, du passage de ce qui est à ce qui doit être, du fait au devoir. Comment un fait non-normatif peut-il produire une raison normative ? Les critiques subjectivistes et scientifiques répondent par la réduction, voire par la négation, de l’autorité et de la normativité spécifiques des intuitions et jugements moraux. Mais T. Nagel entend au contraire préserver la normativité et l’indépendance des vérités morales. En quel sens seraient-elles alors liées aux faits ? T. Nagel ne clarifie pas cette question et, par ailleurs, les réponses possibles ne sont pas très nombreuses. On pourrait envisager que les faits contiennent déjà des propriétés normatives ; mais alors les raisons seraient des propriétés de choses par exemple naturelles, ce que T. Nagel refuse (à la seule exception du plaisir et de la douleur, qui pourraient peut-être, selon lui, fonder des raisons). [33] Ou alors, il y aurait des faits en eux-mêmes normatifs. Mais lesquels ? En quoi seraient-ils déjà normatifs, ou plus normatifs que d’autres ? Cela reviendrait à présupposer une définition de la normativité susceptible de distinguer ces faits des autres, par une particularité soit ontologique – qui risquerait de ramener au réductionnisme naturaliste ou au relativisme -, soit épistémologique – mais laquelle ? On pourrait envisager que les raisons normatives émergent des faits ou leur sont parallèles – dans une application à la philosophie morale de thèses mobilisées en philosophie de l’esprit. Cette piste pourrait être assez proche de ce que T. Nagel envisage [34] : les raisons demeureraient purement épistémologiques, sans dimension ontologique, et apparaîtraient avec la présence des faits. Mais il n’entre pas dans l’explication de ce lien entre faits non-normatifs et raisons normatives, qui pourtant nous semble être la pierre de touche de son réalisme normatif local. Ce serait là un point crucial à définir pour consolider sa thèse, qui reste en l’état vague.
Nous laissons ce point de côté, pour apporter deux remarques portant sur les distinctions qu’il opère entre les raisons morales vraies. Tout d’abord T. Nagel maintient l’idée que les vérités morales existent, mais que certaines sont générales voire atemporelles, et que d’autres apparaissent de façon nouvelle, à partir de certains faits et conditions historiques. Mais dans ce dernier cas, peut-il encore s’agir de vérités, si elles ne sont pas générales et absolues ? Ne s’agit-il pas d’une dévaluation du concept même de vérité normative ? Il pourrait être à la fois plus clair et plus cohérent avec la visée réaliste de T. Nagel de distinguer, non pas deux types de vérités morales, mais deux façons de les saisir [35]. Il y aurait d’une part la découverte des raisons morales et des valeurs fondamentales qu’elles portent, comme la valeur égale de la vie des personnes, le droit de chacun à la liberté et au bonheur, ou l’autonomie individuelle. Ces principes moraux seraient vrais indépendamment de nous et des circonstances historiques, T. Nagel considérant qu’ils sont accessibles à quiconque serait doté d’une imagination interpersonnelle assez robuste. [36] Et il y aurait, d’autre part, la saisie et l’élaboration des conditions de leur application pratique aux cas particuliers. Il n’y aurait donc qu’un seul type de progrès moral, au sein duquel nous découvrons les principes vrais et les normes permettant leur mise en œuvre. Une telle interprétation nous paraît mieux soutenir le projet de « réalisme normatif local » de T. Nagel. Elle permet d’abord de maintenir le pluralisme moral, puisque poser des principes et des normes absolument vrais n’implique nullement leur réduction à un seul type de raisonnement ou de fondement. Elle permet aussi de penser l’immense variété de la compréhension des raisons morales et de leurs applications normatives qui, elles, seraient dépendantes de nos conditions historiques, sociales, politiques, etc. Nous mettrions ainsi en équilibre des principes généraux avec des applications particulières de ces principes, dans des circonstances et des faits donnés. L’évolution de ces circonstances et de ces faits donnerait lieu soit à un ajustement des normes pratiques, soit à la découverte de principes vrais qui n’étaient pas, jusqu’ici, accessibles à notre raison. La relativité serait uniquement du côté de l’application pratique des raisons normatives aux faits, ou de leur formalisation politique et sociale. La vérité morale ne serait alors pas si distincte que cela de la vérité scientifique.
Notre deuxième remarque concerne la mise en équilibre réfléchi des différentes raisons morales. Pour T. Nagel, d’une part les raisons personnelles, impersonnelles et sociales sont distinctes les unes des autres, d’autre part il faut résister aux tentations opposées soit de se libérer du point de vue impersonnel et conséquentialiste, soit de tout lui soumettre. Cela rend l’ajustement dialectique des différentes raisons normatives, dans chaque équilibre réfléchi, difficile à concevoir. Mais que les raisons soient distinctes et relèvent de perspectives morales différentes ne signifie pas pour autant qu’elles sont totalement incompatibles, ni qu’il faudra attendre des découvertes normatives pour l’instant inaccessibles. Elles pourraient, par-delà leurs particularités, converger en un accord normatif général. Le cas du harcèlement sexuel nous paraît révéler, contrairement à l’analyse qu’en propose T. Nagel [37], un équilibre réfléchi en voie de stabilisation.
Il s’inquiète en effet, en matière de mœurs sexuelles, d’une tendance répressive qui serait selon lui à l’œuvre, et qui consisterait à vouloir exposer et soumettre ce qui est d’ordre personnel et privé à des normes politiques, sociales et impersonnelles. Le danger serait, selon lui, que la distinction entre le privé et le public (qui est d’ailleurs au cœur de ses réflexions sur les droits en général [38]) se trouve effacée par la tendance à dénoncer et sanctionner de plus en plus de comportements et d’expressions d’intérêt sexuel. Il dénonce la confusion entre le harcèlement sexiste, qui enfreint les normes de justice sociale et peut donc faire l’objet de sanctions institutionnelles, politiques et sociales publiques, et les offenses sexuelles et les abus de pouvoir interpersonnels, qui devraient être jugés et punis sur le plan interpersonnel et privé. Autrement dit, T. Nagel refuse de considérer que tout le personnel soit politique. Or, il nous semble que ce qu’il dénonce ici comme une soumission des normes de conduite personnelles et interpersonnelles à des normes publiques impersonnelles, relève bien plutôt d’une convergence des raisons. Rappelons d’abord que parmi les raisons personnelles, T. Nagel inclut les raisons d’autonomie, qui soutiennent les préférences et les projets personnels, mais aussi les raisons d’obligation et les raisons déontologiques. Les orientations et expressions de la sexualité relèvent clairement des raisons d’autonomie, personnelles et privées, qui sont en ce sens à protéger. Mais la distinction entre le harcèlement sexiste, qui relève d’une injustice sociale, et les offenses sexuelles qui conserveraient une dimension personnelle [39] , nous paraît très discutable. Que les offenses soient sexuelles ne suffit pas à les relier à des désirs personnels ; en tant que violences, elles sont une violation injuste de la dignité, de l’égalité et de l’intimité d’autrui. Et si on considère que toutes les offenses sexuelles s’enracinent dans des rapports de domination sexistes et inégalitaires [40], alors elles ne sont jamais seulement des abus de pouvoir interpersonnels, mais toujours aussi des injustices sociales structurelles. Il y a toutefois bien des raisons personnelles mobilisables dans la question du harcèlement et des offenses sexuelles. Il s’agit des raisons déontologiques, qui identifient et condamnent comme injustes les actes bafouant l’inviolabilité et les droits fondamentaux des personnes. Que ces raisons soient personnelles et interpersonnelles ne signifie pas que les offenses doivent être traitées de façon strictement privée ou interindividuelle. Elles convergent bien plutôt avec les raisons impersonnelles et sociales, constituant ainsi un point de recoupement et d’accord autour de la condamnation des comportements sexistes. Ce qui inquiète T. Nagel, à savoir la domination du public sur le privé ou de l’impersonnel sur le personnel, serait en réalité le signe d’un effort de progrès moral, pour mettre en œuvre les normes morales condamnant les offenses sexuelles et clarifier les conditions de leur application aux cas particuliers : quels critères précis des abus, quelles circonstances, quelle considération des victimes, quelles sanctions, etc.
Nagel conclut modestement son livre sur l’idée que des révolutions morales, quoique nous ne puissions encore les imaginer, adviendront probablement. Son optimisme face au progrès moral à venir est encourageant, et soutenu par des propositions méta-éthiques et éthiques stimulantes. Leur esquisse, dans les deux essais qui composent cet ouvrage, appelle encore des approfondissements et peut-être des ajustements, que nous avons modestement suggérés. Mais il est certain que T. Nagel ouvre ici une réflexion qui rebat les cartes du réalisme moral : en renouvelant sa propre approche de la moralité et de ses fondements, il emprunte une voie étroite, mais originale, entre réalisme normatif et relativisme modéré. On ne peut qu’espérer qu’elle sera poursuivie dans un ouvrage plus conséquent.
[1] Nagel, Thomas, Moral Feelings, Moral Reality, and Moral progress, New York, Oxford University Press, 2023.
[2] L’éthique cherche à identifier et définir les valeurs et normes qui peuvent guident le choix et l’action bonne. Elle développe des cadres justificatifs et normatifs guidant le jugement, le choix et l’action éthiques. La méta-éthique, elle, analyse et explore les concepts fondamentaux de l’éthique : ce que c’est qu’une valeur éthique, ce qui fonde la motivation à agir moralement, ce qui peut rendre possible (ou non) la connaissance des concepts moraux, etc. L’éthique appliquée, enfin, consiste à appliquer le raisonnement éthique à des problèmes réels et des questions pratiques spécifiques à un domaine, un comportement, un enjeu : par exemple, l’euthanasie, la protection de l’environnement, l’intelligence artificielle, etc.
[3] Nagel, T., Moral Feelings, Moral Reality, and Moral progress, p. 1-4.
[4] Nagel, Thomas, Le point de vue de nulle part, (The View from Nowhere, Oxford, Oxford University Press, 1986), trad. S. Kronlund, Combas, L’Éclat, 1993. Voir également « La valeur de l’inviolabilité », Revue de Métaphysique et de Morale, La Philosophie morale de langue anglaise, 99e année, n°2, avril-juin 1994, pp. 149-166.
[5] Nagel, T., « La valeur de l’inviolabilité », op. cit. Pour T. Nagel les droits sont en effet de nature essentiellement déontologique, et ne peuvent être pensés de façon conséquentialiste. S’ils étaient de nature conséquentialiste, alors il serait parfois permis de bafouer les droits fondamentaux de quelqu’un pour produire un plus grand bien. Or, si les droits fondamentaux peuvent être suspendus, alors ils n’ont plus rien de fondamentaux, et nul n’est plus à l’abri d’abus.
[6] Hume, David, Traité de la nature humaine, livre III, partie 2.
[7] Le « conséquentialisme de la règle » considère que la moralité est fondamentalement une évaluation des conséquences bonnes ou mauvaises de nos choix ; mais plutôt que d’appliquer cette évaluation à chaque acte, il l’applique aux règles générales qui encadrent les actes particuliers.
[8] Nagel, T., Le point de vue de nulle part, op. cit.
[9] Nagel, T., Moral Feelings, Moral Reality, and Moral progress, p. 14-17.
[10] C’est une thèse qu’il défendait déjà dans Mortal Questions. Voir Nagel, T., Mortal Questions, “The Fragmentation of Value” (1e pub. 1979), New York, Cambridge University Press, 2010.
[11] Nagel, T., Moral Feelings, Moral Reality, and Moral progress, op. cit., p. 9-10.
[12] Ibid., p. 20-22.
[13] Ibid., p. 5-6, p. 16-17.
[14] Ibid., p. 23-25, p. 27, p. 49.
[15] Ibid., p. 28-29.
[16] Notamment dans Le point de vue de nulle part, op. cit., mais aussi dans Nagel, Thomas, The Possibility of Altruism, (1ère pub. Oxford, Clarendon Press, 1970), Princeton, Princeton University Press, 1978, et The Last Word, New York, Oxford University Press, 1997.
[17] Nagel, T., Moral Feelings, Moral Reality, and Moral progress, op. cit., p. 33-34.
[18] Ibid., p. 26.
[19] Ibid., p. 31-32 et p. 49-52.
[20] Ibid., p. 33.
[21] Ibid., p. 42-43.
[22] Ibid., p. 45-49.
[23] Ibid., p. 28-29.
[25] Ibid., p. 30.
[26] Ibid., p. 50.
[27] Ibid., p. 56-68.
[28] Ibid., p. 68-69.
[29] Ibid., p. 56 et p. 69.
[30] Voir Nagel, T., Le point de vue de nulle part, op. cit., chapitres VIII et IX.
[31] Voir Nagel, T., Mortal Questions, op. cit., “The Fragmentation of Value”.
[32] Nagel, T., Moral Feelings, Moral Reality, and Moral progress, op. cit., p. 43.
[33] Ibid., p. 35-36.
[34] Il a pu défendre, par ailleurs, le panpsychisme qui se rapporte à une forme d’émergentisme. Voir Nagel, T., Mortal Questions, op. cit., “Pansychism”.
[35] Nous remercions ici le relecteur ou la relectrice anonyme qui a proposé cette objection.
[36] Nagel, T., Moral Feelings, Moral Reality, and Moral progress, op. cit., p. 49.
[37] Ibid., p. 49-52.
[38] Voir Nagel, Thomas, Concealment & Exposure, Philosophy & Public Affairs, 1998, 27 (1), repris in Nagel, Thomas, Concealment and exposure and other essays, Oxford, Oxford University Press, 2002. Voir également Desbiolles, Blondine, « La liberté d’expression selon T. Nagel : un droit à la frontière entre privé et public », Revue de Métaphysique et de Morale, n°4/2022.
[39] Nagel, T., Moral Feelings, Moral Reality, and Moral progress, op. cit., p. 63.
[40] Voir notamment Garcia, Manon, La conversation des sexes. Philosophie du consentement, Flammarion, Champs Essais, 2023.