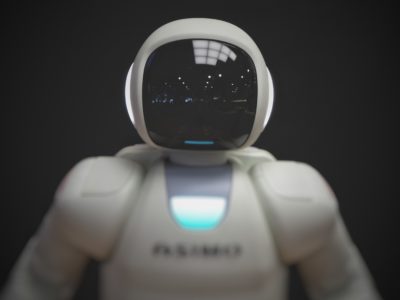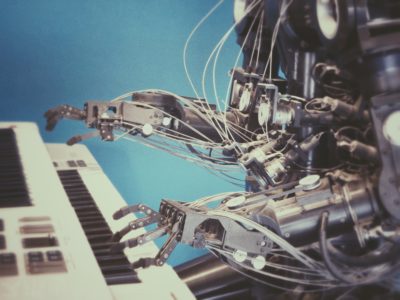Kant revu par la psychologie morale 1/3
À quoi peuvent encore servir les arguments transcendantaux ?
Marlène Jouan Université Pierre Mendès France, PLC, Grenoble
Une version plus courte de cet article a fait l’objet d’une communication à la journée d’études « L’argumentation en éthique » qui s’est déroulée le 23 novembre 2012 à l’Université Pierre Mendès France de Grenoble. Merci à Rémi Clot-Goudard et Stélios Virvidakis pour leurs remarques sur cette première version, ainsi qu’au comité de lecture d’Implications philosophiques pour celles relatives au présent texte.
L’objectif de cet article est d’examiner le fonctionnement et la portée d’un type spécifique d’arguments utilisés en méta-éthique et plus spécialement en psychologie morale, à savoir les arguments dits « transcendantaux ». Pour des raisons bien connues et sur lesquelles je reviendrai brièvement, c’est là un type d’arguments que l’on aurait un temps pu croire philosophiquement périmé. Force est toutefois de constater qu’il n’a jamais vraiment disparu de la boîte à outils de celui qui se demande si et en quel sens nous pouvons légitimement parler de la réalité du monde extérieur, et ce même au prix d’une réserve certaine quant à ce que l’on peut attendre de l’usage d’un tel outil, voire d’une révision complète de ce qu’exige la solution du « problème » de la réalité extérieure[1]. Une grande partie des débats qui ont dominé, à la fin du XXe siècle, la philosophie analytique de la connaissance, se structure ainsi autour de ce qu’on a pu appeler un « retour du refoulé transcendantal », manifeste dans l’usage du mot à défaut de la chose même[2]. Mais ces mêmes arguments connaissent en particulier, depuis les années 1990, une indéniable prospérité dans un domaine qui n’est pas leur terre native, celui de l’usage pratique et non pas théorique de la raison[3]. En les mobilisant soit explicitement, sous leur appellation d’origine, soit de manière plus discrète, on leur demande alors de nous aider à répondre à une question qui n’est pas si différente – et il se pourrait que là précisément réside la difficulté –, à savoir : en quel sens nous pouvons légitimement parler de la « réalité » des valeurs ou de la validité objective des normes morales ? Ce faisant, on formule des espoirs renouvelés dans l’entreprise d’une fondation rationnelle de la morale : cet usage des arguments transcendantaux s’inscrit très nettement dans un retour en grâce du projet des Fondements de la métaphysique des mœurs, quoique dépouillé entre-temps de quelques oripeaux métaphysiques.
Je ne ménagerai pas de faux suspense : l’intérêt des arguments transcendantaux déployés aujourd’hui en psychologie morale n’est pas qu’ils « marchent », qu’ils parviennent à faire ou à montrer ce qu’ils prétendent faire ou montrer. L’outil, aussi ingénieux soit-il, ne permet pas de construire ou de reconstruire l’édifice auquel on aspire. La raison n’en est toutefois pas le caractère inapproprié de l’outil en lui-même, mais le fait que l’édifice ne peut pas du tout être construit, que ce soit avec des arguments transcendantaux ou autre chose. Dans cette perspective, j’essaierai de montrer que l’examen de ces arguments en particulier a une portée plus générale quant au type de raisonnement que l’on peut sérieusement exploiter pour répondre à la question « Pourquoi être moral ? », et surtout pour élucider le besoin philosophique d’une réponse à cette question. Stélios Virvidakis, dans l’article qu’il a consacré à ces arguments il y a déjà une dizaine d’années, concluait sa présentation non par le constat de leur échec sans appel, mais plutôt par un diagnostic réservé. En tout état de cause, écrivait-il, c’est-à-dire pour peu que les doutes concernant leur validité et la plausibilité de leurs prémisses résistent à un examen plus approfondi, il serait toujours possible d’employer les arguments transcendantaux non pas dans l’idée d’obtenir par là « des solutions exclusives et définitives aux problèmes des théories normatives et métaéthiques, mais seulement afin d’élucider les relations de nos concepts centraux en philosophie pratique et d’explorer des interprétations complémentaires de nos principes moraux »[4]. J’insisterai pour ma part sur la contribution de ces arguments à l’élucidation, voire à la dilution, d’un débat très bruyant en psychologie morale, celui qui oppose, s’agissant des raisons d’agir, l’internalisme à l’externalisme. Ce débat permet en effet d’éclairer certains espoirs philosophiques mal placés que les arguments transcendantaux moraux sont loin d’être les seuls à entretenir, et que condense cette boutade de David Lewis : « Pourquoi se soucier de la valeur objective ou de la réalité éthique ? La sanction est que si vous ne le faites pas, vos états intérieurs ne mériteront pas d’être labellisés par la théorie de l’esprit (folktheoretical names). La menace n’est pas vraiment susceptible de frapper de terreur le cœur des méchants ! Mais qui a jamais pensé que la philosophie pouvait remplacer la potence ? »[5] Avant d’en venir là, je présenterai d’abord en termes assez généraux ce que nous promet l’usage moral des arguments transcendantaux par contraste avec leur usage classiquement épistémologique – lui-même loin d’être univoque et transparent. Suivra une « défense et illustration » de cet usage sous les auspices de Christine M. Korsgaard qui, dans l’objectif à la fois de compléter et d’amender la fondation kantienne de la morale, s’en revendique expressément, et dont la tentative a suscité une discussion abondante[6]. Je dégagerai enfin des objections qu’on peut lui adresser quelques enseignements quant à ce que l’on peut légitimement attendre de la philosophie morale.
I
Le « problème » philosophique auquel les arguments transcendantaux contemporains entendent apporter, si ce n’est la solution définitive et suffisante, du moins une contribution essentielle, est celui de l’incompatibilité apparente entre l’objectivité et le caractère pratique des jugements moraux. Sous cette forme technique, il ne s’agit rien moins que du problème cardinal de la méta-éthique, auquel s’ordonne une grande partie des stratégies argumentatives à l’œuvre dans ce qui est incontestablement, pour parler comme Kant à propos de la déplorable situation de la métaphysique, un « champ de bataille »[7]. Michael Smith offre une présentation claire des deux lignes de front :
L’objectivité des jugements moraux suggère qu’il existe des faits moraux, totalement déterminés par les circonstances, et que nos jugements moraux expriment nos croyances à propos de ce que sont ces faits. Ceci nous permet notamment de rendre raison des arguments moraux, mais laisse dans le plus grand mystère la question de savoir comment ou pourquoi le fait d’avoir une vision morale devrait avoir un lien spécial avec ce que nous sommes motivés à faire. Quant au caractère pratique des jugements moraux, il suggère précisément le contraire, à savoir : que nos jugements expriment nos désirs. Alors que cette thèse nous permet de rendre raison du lien entre le fait d’avoir une vision morale et celui d’être motivé, elle laisse dans le plus grand mystère la question de savoir sur quoi devrait porter un argument moral, le sens auquel la moralité est censée être objective[8].
On recourt à un argument transcendantal en ayant pour ambition de concilier les deux parties opposées et ainsi de vérifier l’hypothèse suivante : il est possible de défendre une certaine forme de réalisme moral sans pour autant renoncer à l’exigence humienne selon laquelle les jugements moraux ont ceci de spécifique qu’ils doivent pouvoir produire ou empêcher l’action[9]. Formulée de manière encore très vague, cette hypothèse laisse déjà entendre que les arguments transcendantaux moraux ont au moins un adversaire commun avec leurs homologues épistémologiques : le scepticisme.
Pour comprendre plus précisément ce qui fait à la fois leur intérêt et leur originalité, il ne sera donc pas inutile de décliner quelques observations de base concernant l’usage familier des arguments transcendantaux en philosophie de la connaissance. Trois questions sont ici pertinentes : a) Quelle est la fonction classique de ces arguments ou dans quel objectif sont-ils mobilisés ? b) Quelle est leur forme ou comment procèdent-ils ? c) Quel est le statut de la proposition ou de la présupposition dont ils prétendent établir la vérité ? Si les questions paraissent claires, les réponses le sont toutefois beaucoup moins, à tel point qu’on ne trouve en réalité guère d’ « observations de base » qui ne porteraient pas à contestation. Comme le remarque Sandra Laugier, « il est particulièrement difficile en effet, malgré (ou à cause de) toutes les discussions qui ont eu lieu à ce sujet, de savoir en quoi consistent les arguments transcendantaux »[10]. Sans me lancer dans l’exégèse des formulations kantiennes et post-kantiennes de ces arguments ni dans la « querelle » à laquelle elles ont donné lieu, j’en retiendrai ici simplement les caractéristiques que l’on retrouve peu ou prou dans leur nouvelle terre d’importation. Dans cette perspective, les trois questions énoncées ci-dessus sont à apprécier en regard du contexte dialectique ou défensif dans lequel, à tort ou à raison, les arguments transcendantaux sont habituellement mobilisés[11]. Directement ou indirectement, ces arguments visent alors effectivement, en connaissance comme en morale, à contrer la menace sceptique, c’est-à-dire à dissoudre les doutes que celle-ci soulève quant à la possibilité de démontrer la validité objective de nos énoncés descriptifs concernant les objets du monde extérieur, ou celle de nos énoncés normatifs et axiologiques concernant les actions à accomplir dans ce monde.
Pour préciser la nature de la menace, on peut repartir de la fameuse distinction de Kant, énoncée au § 13 de la Critique de la raison pure, entre les deux questions susceptibles d’être posées à propos des concepts qui, parmi ceux « qui forment le tissu très mêlé de la connaissance humaine », « sont destinés à un usage pur a priori » : l’usage des arguments transcendantaux tient pour acquis qu’une réponse à la « question de fait » (quid facti) ne suffit pas, et qu’il appartient en propre au philosophe de répondre à la « question de droit » (quid juris)[12]. Ce qu’on attend de lui, en effet, ce n’est pas qu’il nous montre comment nous en sommes venus par l’expérience à posséder et employer ces concepts, ou qu’il nous fournisse une explication empirique de leur genèse ou de leur formation dans l’esprit humain, mais qu’il nous dise de quel droit nous les possédons et les utilisons, autrement dit en quoi leur possession est justifiée ou en quoi il est légitime, et même indispensable, d’en faire usage. Cela revient à montrer, en l’occurrence, que sans ces concepts l’expérience ne serait pas du tout possible. Il n’en va pas autrement en morale, où les arguments transcendantaux entendent répondre à ce que Korsgaard appelle la « question normative » : « Quand nous sommes en quête d’une fondation philosophique de la moralité, écrit-elle au tout début de son ouvrage The Sources of Normativity, nous ne cherchons pas seulement une explication de nos pratiques morales », explication que le sceptique nous accordera volontiers. Ce que nous voulons comprendre, c’est « ce qui justifie les demandes qui nous sont adressées par la morale »[13], plus précisément ce qui justifie que nous nous soumettions à ces obligations même et surtout quand elles vont à l’encontre de nos intérêts personnels ou de nos inclinations égoïstes, et là bien sûr le sceptique ne nous suit plus. Par analogie avec la déduction transcendantale kantienne des concepts purs de l’entendement[14], ce qu’une déduction transcendantale de la normativité morale cherche alors à montrer, c’est que sans ces obligations l’action ne serait pas du tout possible[15].
Globalement, les arguments transcendantaux visent donc à établir les conditions de possibilité de certains aspects constitutifs de notre expérience ou de notre comportement, ou bien de l’usage de certains concepts (ou principes) théoriques ou pratiques fondamentaux, afin de défendre leur validité ou leur applicabilité contre des attaques sceptiques, que ce soit dans leurs versions conventionnalistes ou naturalistes. S’agissant de la morale comme de la connaissance, la stratégie déployée est la même et opère par l’absurde : il s’agit de pousser le sceptique dans ses retranchements en l’amenant à reconnaître que le défi qu’il lance, pour autant qu’il soit intelligible, ne peut que se retourner contre lui-même. Plus précisément : que sa seule position de sujet d’expérience ou d’agent présuppose la validité de la proposition qu’il nie, que sans les concepts ou les principes qu’il conteste il ne pourrait pas penser ou agir comme il le fait, et que, dès lors, son intervention se réfute elle-même. D’où la forme canonique des arguments transcendantaux : typiquement, ils ont pour prémisse une proposition (Y), laquelle est censée être indubitable et incontestable y compris par le sceptique lui-même (par exemple, que nous avons un accès direct à nos états mentaux, ou bien que nous agissons pour des raisons), et montrent qu’une autre proposition (X), que le sceptique conteste cette fois, ne formule rien d’autre qu’une condition nécessaire de possibilité de (Y), de sorte qu’on ne peut avoir (Y) sans (X). La conclusion d’un argument transcendantal – qui peut bien sûr comporter plusieurs étapes ou chaînons, dont chacun conduit au précédent de façon régressive – est donc, en principe, tout aussi indubitable et incontestable que sa prémisse. Si elle dit néanmoins quelque chose de plus que la prémisse, c’est en tant qu’elle dévoile les présupposés impliqués dans notre expérience ou notre comportement : les nécessités que les arguments transcendantaux forcent le sceptique à admettre et qui se transmettent à chacune des propositions intermédiaires sont, en principe encore une fois, des nécessités non pas empiriques mais métaphysiques ou grammaticales, non pas psychologiques mais normatives. Il n’est évidemment pas difficile de voir où le bât peut alors blesser : soit la prémisse n’est pas aussi nécessaire qu’elle n’en a l’air, soit on peut perdre – ou ne jamais atteindre – en cours de route le régime de nécessité et donc de validité convoité.
La célèbre objection soulevée par Barry Stroud, en 1968, contre les arguments transcendantaux, s’engouffrait précisément dans cette seconde faille : en montrant que ces arguments ne permettent pas de franchir le fossé entre ce que nous croyons ou tenons pour vrai et ce qu’il en est réellement du monde ou des objets du monde et de leurs propriétés, il soulignait que les « preuves » fournies par les arguments transcendantaux sont seulement épistémiques et que, quand bien même on ne pourrait faire autrement que d’avoir les croyances en question, elles n’ont aucunement la portée ontologique que, en les mobilisant contre le scepticisme, on souhaiterait leur conférer[16]. Bien sûr, l’objection ne tient que si l’on considère en premier lieu que les arguments transcendantaux sont par définition des arguments ontologiques, et qu’ils ont pour enjeu une justification du réalisme métaphysique. Si tel était le cas, un argument transcendantal aurait, comme le note Alain Boyer, « quelque chose de fascinant », dans la mesure où il serait « capable de dériver a priori une propriété ontologique du monde extérieur à partir de la seule présupposition d’un certain exercice mental que nous opérons avec succès »[17]. De fascinant ou bien d’un peu délirant, comme le suggère Stroud qui, près de trente ans après son article séminal, persiste et signe, en mettant particulièrement bien en avant la faiblesse modale de la déduction opérée par les arguments transcendantaux :
Même en admettant que les arguments transcendantaux nous permettent de comprendre à quel point le fait que nous pensions de telle ou telle manière requiert que nous pensions également de telles ou telles autres manières, et peut-être d’autres manières encore, ainsi que de saisir toute la richesse et la complexité des relations qui doivent prévaloir entre ces manières de pensée, comment pourrait-on montrer que des vérités sur le monde qui manifestement ne disent rien de la pensée ou de l’expérience humaine et n’ont pas davantage d’implication quant à ce en quoi consiste cette pensée ou cette expérience, sont des conditions authentiquement nécessaires de faits psychologiques, comme celui consistant à penser les choses ou à en faire l’expérience de telles ou telles manières, qui sont au point de départ de ces arguments ? Il semble qu’il nous faille trouver, et traverser, un pont de nécessité de l’un à l’autre. Ce qui constituerait un exploit tout à fait remarquable, et on aurait vraiment besoin d’une explication particulièrement convaincante pour montrer que toute cette affaire est bien possible[18].
Kant, en vertu de son idéalisme, pourrait bien sûr proposer une telle explication, puisque les « vérités sur le monde » évoquées par Stroud n’y sont pas des vérités qui concernent un monde complètement indépendant de l’esprit humain. Un réaliste à la Strawson en revanche, qui refuse de payer le prix de ces vérités – à savoir la distinction entre phénomènes et noumènes –, se trouve manifestement au pied du mur, incapable de prouver que les arguments transcendantaux parlent bien du monde et non de notre image du monde, quand bien même cette image ne pourrait pas être autre que ce qu’elle est de facto. Cela ne signifie évidemment pas que son exploration n’a pas d’intérêt. Si les arguments transcendantaux moraux devaient aussi succomber à l’objection de Stroud, il faudrait cependant reconnaître qu’ils n’ont effectivement pas d’autre utilité que de contribuer, comme le soutenait Stélios Virvidakis, à « élucider les relations de nos concepts centraux en philosophie pratique ».
À moins que l’alternative ne soit mal posée. On n’a pas manqué de rétorquer à Stroud, en effet, que les arguments transcendantaux ne sauraient échouer à proprement parler à nous assurer de l’existence des choses en dehors de nous, puisque ce n’est pas du tout ce qu’ils prétendent faire[19]. Bien comprise, leur portée est plus modeste : s’ils nous apprennent quelque chose, c’est seulement à propos du bagage cognitif et conceptuel qui doit être le nôtre pour que nous percevions et concevions le monde comme nous le faisons, et non pas à propos de ce que doit être le monde étant donné que nous le percevons ou le concevons de telle ou telle manière. En ce sens, les arguments transcendantaux sont bien plus des arguments anthropologiques que des arguments ontologiques. Comme le remarque Isabelle Thomas-Fogiel, « paradoxalement ce sont les sceptiques qui ont le plus ‟ontologisé” le débat en voulant à tout prix montrer que l’argument transcendantal ne permettait pas de lever le doute sur le monde extérieur », au point de lui donner « l’allure d’une querelle entre réalisme et anti-irréalisme, ce que la notion d’argument transcendantal n’appelait pas immédiatement »[20]. Mais si le faux procès est avéré en ce qui concerne l’usage épistémologique des arguments transcendantaux, l’est-il tout autant pour ce qui est de leur usage moral ? Comme je l’ai annoncé plus haut, celui-ci s’inscrit en effet clairement dans la « querelle entre réalisme et anti-irréalisme » qui irrigue organiquement la méta-éthique. Ainsi la tentative de Korsgaard de prouver que notre humanité a de la valeur, conclusion de l’argument transcendantal qu’elle déploie dans The Sources of Normativity, s’est-elle vu adresser des objections du même ordre que celle de Stroud, par exemple sous la plume de John Skorupski : « Il serait gratifiant de pouvoir démontrer, par les seuls pouvoirs de la philosophie, que l’on est important. […] Mais en l’absence d’un enchantement communicatif la démonstration paraît très peu convaincante »[21].
À cet égard, les arguments transcendantaux moraux sont pourtant, au premier abord, en bien meilleure posture que leurs pendants épistémologiques. Ils paraissent en effet d’autant plus efficaces qu’ils sont précisément mobilisés contre la défense d’un réalisme éthique substantiel[22], lequel fait dépendre la réponse à la « question normative » de l’existence « réelle », indépendante et – il faut bien le dire – profondément énigmatique, de faits moraux ou de vérités intrinsèquement normatives. Employés pour élucider ce à quoi nous sommes obligés ou contraints par notre seule rationalité d’agent, ces arguments sont ainsi solidaires d’un sain principe d’économie métaphysique, consistant à ne pas surcharger l’ameublement peut-être déjà douteux du monde, tout comme du principe dit de l’autonomie de la morale, entendu ici de manière minimale comme le refus de faire de l’éthique une simple branche de la connaissance, dans laquelle il s’agirait également de découvrir quelque chose du monde ou à propos du monde. Compris en ce sens, ce sont deux principes qui sont plutôt à porter à leur crédit et qui, comme le souligne Bernard Williams, infléchissent la position du « sceptique éthique » par rapport à son homonyme « traditionnel » : quand celui-ci interroge la prétention de notre savoir à la vérité, celui-là met en question la « force des considérations éthiques »[23]. De là cependant à soutenir que, dans l’usage pratique de la raison, la distinction entre la « réalité » et l’ « apparence » n’est plus du tout pertinente[24], c’est-à-dire que la validité des énoncés moraux est tout entière constituée par la nécessité qui serait la nôtre, en tant qu’agent et sous peine de ne plus être des agents du tout, de les accepter, c’est évidemment une tout autre affaire, qui attire l’attention cette fois sur la faiblesse de la prémisse des arguments transcendantaux moraux. À cet endroit, ils semblent en effet désavantagés par rapport à leurs devanciers. Stélios Virvidakis relève ainsi l’asymétrie suivante : alors que « le sceptique le plus obstiné », quand bien même il arguerait ensuite de son caractère purement privé, « ne pourrait pas facilement nier qu’il est, par exemple, conscient de son expérience subjective »[25], on voit mal en revanche en quoi nier qu’il doive agir pour des « raisons », si c’est le prix à payer pour ne pas se retrouver pris dans le filet des raisons morales, devrait entraîner l’amoraliste ou le nihiliste résolu dans une reductio ad absurdum. De fait, l’issue de la querelle méta-éthique du réalisme et de l’anti-réalisme dépend, pour une bonne part, de ce que l’on considère comme une raison d’agir.
[1] Pour une présentation de l’histoire des arguments transcendantaux et de leurs discussions contemporaines (des années 1960 à nos jours), voir R. Stern (dir.), Transcendental Arguments: Problems and Prospects, Oxford, Clarendon Press, 1999, Introduction.
[2] S. Laugier, « Langage, scepticisme et argument transcendantal », dans La querelle des arguments transcendantaux, Cahiers de Philosophie de l’Université de Caen, n° 35, 2000, p. 11-34, 21-22.
[3] On connaît bien sûr les reformulations de l’argument transcendantal mobilisées dans les années 1970 par l’éthique de la discussion, de manière paradigmatique par Karl Otto Apel (voir « Le problème de l’évidence phénoménologique à la lumière d’une sémiotique transcendantale » [1985], dans J. Poulain [éd.], Critique de la