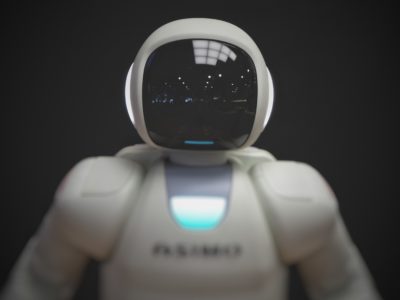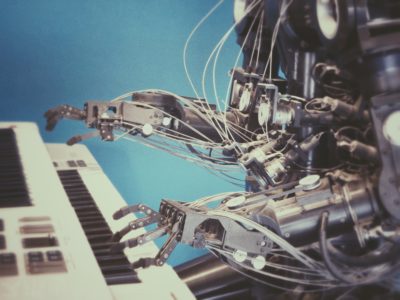Le courage d’éduquer 1
Le courage d’éduquer : pluralisme moral et éducation en contexte scolaire
Vincent Lorius Université Lyon 2
Introduction
Les rapports entre la société française et son école sont caractérisés habituellement par leur intensité. Celle-ci dénote, au-delà des désaccords substantiels concernant ses finalités et les moyens de les atteindre, l’importance des enjeux scolaires dans notre pays. Pourtant, à l’intérieur de l’institution scolaire, le découragement semble parfois être le sentiment dominant. De nombreux professionnels évoquent en effet les difficultés qu’ils ont à exercer leur métier en raison, entre autres, d’un tiraillement entre des attentes contradictoires (en provenance de l’institution, des parents…) et de la nécessité de prendre en charge des « usagers » dont les profils leur paraissent rendre parfois illusoire toute volonté de transmission dans un cadre scolaire. Parmi les nombreuses manières de décrire ce découragement, il est possible de l’envisager comme lié à un « déboussolement », une perte de repères professionnels et donc de le rattacher à un questionnement relevant de l’éthique, c’est-à-dire à une interrogation sur les « normes et des valeurs orientant l’action individuelle et institutionnelle » (Gaudet & Queniart, 2008, p. 7). Si l’on suit ce raisonnement, il peut alors être intéressant d’essayer de comprendre à quels cadres normatifs se réfèrent les éducateurs pour fonder leur action au quotidien.
Dans cet article, nous présentons quelques résultats issus d’une recherche en cours dont l’idée de départ est de tenter de caractériser, sur le plan éthique, les moments où les éducateurs scolaires ont le sentiment de faire preuve de courage professionnel. Selon nous, ce sont des moments qui sont susceptibles de rendre saillant ce que les personnes considèrent comme important sur le plan moral. Nous pensons, par ce moyen, pouvoir donner quelques éléments de réponse au questionnement suivant : quels sont les repères moraux mobilisés par les éducateurs dans les situations où ils jugent les routines professionnelles inopérantes ?
Notre étude permet de mettre à jour une pluralité de repères moraux mobilisés par les éducateurs scolaires, mobilisation rendue possible par des processus de pensée qui relèvent à la fois d’une forme de pluralisme se caractérisant par la diversité des présupposés moraux auxquels il est possible de les référer, et par un statut faible accordé aux obligations morales. L’intérêt de ces résultats est de remettre en cause la nécessité d’une liste finie de valeurs comme support et condition de l’éducation scolaire. Nous développerons au contraire l’idée selon laquelle une telle liste rend plus délicate l’apparition d’une intelligence des situations, facteur de lutte contre le sentiment de précarité morale qui semble toucher fortement les éducateurs.
Pour établir ces propositions, nous nous attacherons dans un premier temps à montrer en quoi le champ scolaire se caractérise par la primauté accordée à la conformité sur l’efficacité, avec comme conséquence une déstabilisation des acteurs scolaires. Nous présenterons ensuite quelques résultats empiriques indiquant la façon dont les professionnels parviennent, parfois, à combiner souci des conséquences de leur action et conformité institutionnelle, combinaison souvent associée au sentiment de faire preuve de courage professionnel.
I. L’institution scolaire ou l’abandon du souci d’efficacité
Sur le plan du sens de leur action, les explications traditionnellement avancées pour expliquer les obstacles rencontrés par les éducateurs sont de deux ordres. Le premier consiste à pointer la difficulté qu’il y a à s’entendre sur des définitions du bien (et donc en particulier du bien scolaire) au sein d’une société pluraliste, où même les modalités d’échange sur les désaccords axiologiques sont difficiles à établir. La deuxième explication est, en quelque sorte, le pendant institutionnel du constat précédent. Elle consiste à constater (regretter ?) le déclin du « programme institutionnel » scolaire (Dubet, 2002) qui permettait aux éducateurs de se considérer comme un corps de professionnels chargé de transmettre (des savoirs, des valeurs…) dans un positionnement à la fois légitime et spécifique. Quelle que soit la pertinence de ces deux registres d’explications, il nous semble possible de proposer une troisième hypothèse reposant sur l’observation d’un abandon de plus en plus marqué, au sein des services publics et en particulier du service public d’éducation, du souci d’efficacité de la prise en charge scolaire.
L’institution scolaire est concernée par les questions générales d’évolution des institutions et en particulier de l’évolution des modes de normalisation institutionnels. Sur ce point, nous rappellerons qu’il est possible de considérer que les normes institutionnelles n’ont pas forcément vocation à être des dispositifs de domination et d’inculcation de cadres, mais qu’elles peuvent être également, par leur stabilité, des ressources pour l’action des agents et des usagers (par exemple comme support à une dynamique permettant de « donner forme à l’interaction de l’homme et du monde » (Revault-D’allonnes, 2006, p. 251). De là, nous montrerons qu’à l’inverse de cette fonction stabilisatrice, de nombreux indices montrent que les normes professionnelles scolaires sont le but plus que le moyen des prises en charge. C’est cette réalité qui, à notre sens, est susceptible de générer une souffrance éthique des acteurs.
Il existe un consensus (Prairat, 2012, p. 38) pour reconnaître comme constitutifs de la norme les idées de régularité (la norme peut être appelée règle si l’on valorise ce critère), d’injonctions (de faire ou ne pas faire et c’est la fonction normative ou normalisatrice qui est ainsi décrite), de dimension collective (la norme ainsi caractérisée tend vers l’usage) et enfin de préconisations ni nécessaires ni impossibles (Ogien, 2012, p. 24). Ainsi définie, la norme peut être affectée d’une valeur libératrice, en particulier dans un cadre éducatif (Descombes, 2012, p. 70), au motif en particulier que son caractère stable tend à rendre le monde plus sûr. Le moyen de cette sécurisation est relativement établi : « Obéir à des normes ce n’est […] pas obéir à des règles abstraites et transcendantes mais à des comportements d’usage collectifs » (Prairat, 2012, p. 10). Il est donc possible de dire que « ce n’est pas la norme qui a autorité sur moi mais les autres au travers de celle-ci » (Go, 2012, p. 86). Cette proposition de H. L. Go met en lumière une idée centrale : la norme règle temporairement un conflit entre plusieurs manières de procéder. Elle travaille donc à organiser et stabiliser le monde et ceci explique sans doute en partie pourquoi les transgressions sont au final l’exception par rapport à des comportements adoptant massivement les normes (Prairat, 2012, p. 34). Comprendre la norme revient donc à « chercher à comprendre la nature des difficultés ou des conflits qu’elles doivent résoudre ou rendre moins dramatiques » (Canto-Sperber, L’inquiétude morale et la vie humaine, 2002, p. 51).
Pour T. Berns (2009), la conception des normes institutionnelles comme repères pour le déploiement de la vie sociale serait de plus en plus souvent caduque. Ce qui serait intériorisé aujourd’hui par les agents, ce ne serait pas la fonction de la norme mais la norme elle-même. Ce glissement se fait pour T. Berns selon un triple processus : l’abandon du politique, de l’objectif d’efficacité et le renforcement des processus d’autocontrôle. L’abandon du politique se manifeste pour l’auteur par le fait que
Le modèle n’est plus celui de commandements édictés dans des termes généraux et définitifs par des autorités considérées comme souveraines et douées de contrainte, mais celui d’une multiplicité de dispositifs de contrôle, de classements ou d’évaluation, souvent quantitatifs, qui émergent de la réalité même qu’il s’agit de réguler, qui sont spécifiques à un champ d’activité, qui sont eux-mêmes sujets à un marché, et qui accompagnent de manière constante et adaptable les acteurs concernés, sans même réclamer l’appui d’une sanction activée de l’extérieur (Berns, 2009, p. 7).
Il s’agit donc de gouverner à partir du réel et non plus de gouverner le réel ou le concret, avec l’idée que le concret et son gouvernement seraient des objets de décision : il s’agit de « gouverner sans gouverner » (Berns, 2009, p. 7) .Une norme efficace n’est plus alors une norme qui atteint son résultat, comme si celui-ci lui était encore extérieur, mais une norme qui réussit dans sa normativité même, qui fait de sa réussite normative sa seule question. En d’autres termes, « c’est la seule réussite du processus normatif lui-même qui serait en jeu » (Berns, 2011, p. 153). Pour T Berns, c’est là également le signe d’un abandon de l’objectif d’efficacité. En devenant fins plus que moyens dans les institutions, les normes mettent avant tout en demeure ceux sur qui elles portent, de rendre compte de leurs propres activités : « un des principaux outils normatifs est en effet le rapport, qui permet ensuite le déploiement d’autres pratiques normatives plus spécifiques comme l’évaluation, le classement, etc. Il y a là, semble-t-il, un fond commun à la plupart des contextes normatifs contemporains […] qui se déploie en exploitant d’une nouvelle manière le modèle de l’aveu ou de la confession » (Berns, 2011, p. 160).
Les indices de la place importante prise par ces phénomènes caractéristiques de la transformation des normes, de moyens de structuration de la vie commune en buts, peuvent en particulier se constater dans le domaine scolaire. Concernant les processus de régulation institutionnelle, il est en effet aisé de vérifier la multiplication des indicateurs de pilotage qui combinent des formes caractéristiques des normes telles que décrites plus haut. Ceux-ci sont nourris, justifiés, par des techniques statistiques, qui permettent de les présenter comme étant l’expression même de la réalité. De même, et c’est la manifestation de l’abandon du politique, l’efficacité tend dans ce processus à se confondre avec la conformité : ce qui est jugé, c’est l’adéquation des formes réglementaires et des mises en œuvre. Les nombreuses enquêtes générées par les échelons départemental, académique ou national sont caractéristiques de ce mode dans la mesure où les indicateurs portent sur ce qui est mesurable (en général les mises en œuvre) et non sur les effets qui le sont beaucoup moins aisément. Les retours des acteurs de terrain vers leur hiérarchie s’établissent d’ailleurs, comme décrit par T Berns, sur le mode de l’auto-censure dans un subtil jeu de la part de l’acteur pour comprendre quels résultats produire, non pas dans le but de décrire le réel mais de présenter ce dernier selon les attendus de la norme. On ne compte ainsi plus les établissements qui « trafiquent » les données des enquêtes lorsque, de celles-ci, dépendent les moyens attribués au fonctionnement.
D’autres effets pervers induits par ce mode de pilotage ont à voir avec la façon dont les « normes-buts » permettent d’influer directement et négativement sur les trajectoires scolaires des élèves. Prenons l’exemple d’un chef d’établissement qui, en tant que président d’un conseil de classe, est saisi d’une demande de redoublement par une famille. Indépendamment du jugement pédagogique qu’il pourra porter sur cette requête, il devra également prendre en compte le fait que sa réponse influera sur les indicateurs généraux de l’établissement qui doivent tendre vers la réduction du taux de redoublement. Ce deuxième aspect est susceptible de lui faire prendre une décision ne prenant que partiellement en compte l’intérêt de l’élève en question.
Nous pouvons donc proposer l’idée d’une double caractéristique de l’environnement normatif institutionnel dans lequel évoluent les éducateurs scolaires. En premier lieu, leurs actions sont référées à des normes considérées comme efficaces non parce qu’elles permettent d’atteindre un résultat mais jugées comme telles du point de vue de leur normativité même. Ceci est précisément l’opposé de l’idée selon laquelle se soucier d’efficacité c’est tenter de constater qu’une réalité extérieure est atteinte de manière optimale ou qu’elle peut être reportée à un projet et au déploiement minimal d’une série de moyens. Nous avons là le signe d’une normativité outrancière, sans limite (Berns, 2011, p. 153). Les résultats, de ce que l’on peut considérer comme une dérive, sur les pratiques, sont bien connus. Ils conduisent à ce que les personnes se préoccupent plus de la conformité de leurs actions que de leurs effets. La seconde caractéristique que l’on peut relever est l’acquisition, par les normes proposées par l’institution scolaire, d’un statut « tendanciel » (Berns & Pieret, 2011, p. 2) : il s’agit bien de « tendre vers » tel objectif chiffré, tel seuil minimal… qui représentent un horizon qui toujours recule. De là, on peut envisager le sérieux risque, pour les éducateurs, d’une déstabilisation morale induite par une soumission à des normes qui représentent un but à la fois impossible à atteindre et très faiblement en lien avec les finalités de l’institution.
Les caractéristiques du champ d’évolution actuel des éducateurs (abandon du souci d’efficacité, effondrement du programme institutionnel) peuvent faire craindre qu’ils soient placés dans une situation de « juge impuissant », dans le sens où « l’état des choses sociales qu’ils dénoncent continue de s’imposer comme une sorte de nature qu’on ne peut modifier que sur les marges » (Pharo, 2004, p. 388). Si l’on considère avec G. Le Blanc que le précaire est celui qui ne peut se positionner dans un jeu avec les normes pour construire et exercer son autonomie (Le Blanc, 2007), alors il est possible de soutenir que les éducateurs scolaires sont concernés par un risque de précarisation. En effet, au sein l’institution scolaire, les normes n’étant plus présentées pour ce qu’elles devraient être (un usage retraduisant un compromis communément admis sur des questions récurrentes concernant le vivre ensemble) mais comme des entités qui ne sont plus des moyens mais des buts, elles se prêtent plus difficilement à une interrogation critique. C’est bien ce phénomène que T. Berns pense voir à l’œuvre dans les institutions modernes et dont nous pouvons constater les traces à l’école.
Cette réalité entraine de fait un « décalage éthique » entre l’abandon institutionnel du souci d’efficacité et l’engagement moral de réussite envers les élèves dont relève la pédagogie. Se préoccuper d’éthique professionnelle dans le champ éducatif nécessite en effet de garder le « moment pédagogique » (Meirieu, 1995) en ligne de mire, comme à la fois la réalisation d’une promesse faite aux élèves (souci d’efficacité), d’un engagement loyal (conformité), avec comme conséquence un sentiment de cohérence. Cette « promesse pédagogique », et au travers elle l’engagement fait à soi-même autant qu’aux élèves et à l’institution d’une cohérence entre actes et discours, est à la fois le moyen et la manifestation d’une action qui se soucie effectivement des conséquences et donc de son efficacité.
C’est ce type de décalage éthique dont on peut trouver les effets dans les travaux portant sur l’analyse du travail éducatif. Ainsi, pour F. Lantheaume et C. Helou (2008), ce qui est à l’origine des souffrances enseignantes, c’est d’abord le sentiment de ne pas faire du « bon boulot » par rapport à l’idée qu’ils se font individuellement et collectivement du métier. Pour ces auteurs, le décalage existe en particulier par rapport aux recommandations des politiques publiques (comme le fait de devoir combiner des indicateurs quantitatifs et individualisation des prises en charge) et cela conduit à ce que les gens « trichent » pour défendre leur peau, y compris contre leurs propres convictions. Cette souffrance éthique relève moins du contenu des normes (ce qu’elles définissent comme compromis social à un moment donné) que de leur statut. Lorsqu’elles ne sont plus un moyen de sécuriser le monde mais une fin en elles-mêmes, elles contribuent au contraire à créer de l’incertitude dans la mesure où, pour les éducateurs en particulier, la variété des situations rencontrées imposerait un jeu qui permettrait d’éviter la précarité morale.
Par la nature de leur activité, les éducateurs sont dans la situation de « juges » qui doivent décider des normes à utiliser pour définir leurs objectifs et évaluer les conséquences de leurs actions. Lorsque la norme devient « non négociable » (c’est le cas par exemple des indicateurs de performance des établissements scolaires), il y a augmentation du risque « d’épreuves de professionnalité » (Ravon, 2008) qui se manifestent lorsque sont rencontrés des obstacles à l’exercice du métier (mise en évidence de l’impuissance à agir). Ces moments peuvent trouver des issues négatives (épuisement, désengagement, indifférence) ou des issues positives (une capacité de faire face). Dans le domaine scolaire, ces épreuves sont dues, au moins en partie, à une réalité qui induit la nécessité de choisir entre un « bien » et un autre « bien » (institutionnel, personnel, pédagogique). On voit par là que l’agir moral scolaire relève de la capacité de savoir ce qui est important, ce qui « vaut » dans la situation et ceci ne relève pas tant d’un savoir procédural que d’une attitude. Seule une mobilisation personnelle permet de découvrir, empiriquement, l’ordre des biens à chaque instant. Nous sommes bien là dans le domaine de l’éthique puisqu’il s’agit pour les professionnels de définir « des options axiologiques qui font sortir de l’indifférence, en valorisant un genre de vie qui paraît meilleur ou des actions qui sont jugées bonnes » (Pierron, 2012, p. 105). Ces moments d’épreuves éthiques et professionnelles renvoient à la capacité d’affronter une difficulté et donc probablement à une forme de courage. C’est cette possibilité que nous allons étudier dans la partie suivante par une discussion de cette notion.
II. Le courage d’éduquer
Aristote définit le courage à partir de l’émotion à laquelle cette vertu, pour lui, se réfère : la peur (Canto-Sperber, 2004, p. 422). Il existe donc pour lui des choses que le courageux sait redouter et d’emblée on perçoit que le courage se construit dans un lien étroit et paradoxal avec la prudence. C. Fleury le confirme, il n’est pas possible de penser qu’il suffirait pour être courageux de ne pas éprouver la peur, de la nier, car « nier la peur, lui refuser un droit de parole, c’est prendre le risque de vaciller bien plus, un jour sans raison apparente, avec fracas. C’est prendre le risque de chuter plus tard et de ne plus savoir pourquoi on a chuté. Alors vivre la peur devient la maxime du courage » (Fleury, 2010, p. 18). Il y aurait donc des peurs justifiées n’empêchant pas le courage et des actes qui sont hors du courage car relevant de l’insouciance ou de l’intempérance. Autant qu’à la peur, le courage est donc lié à la prudence et nous pensons avec A.-M. Drouhin-Hans qu’il y a un intérêt revenir à la phronésis, cette vertu intellectuelle dont parle Aristote, devenue la prudentia en latin et que l’on peut caractériser en, première approche comme « l’aptitude à discerner la droite règle dans les circonstances difficiles de l’action et qui consiste à passer d’un savoir constitué de normes et de connaissances théoriques à une décision concrète en situation » (Drouhin-Hans, 2009, p. 230). Cette composante prudentielle du courage est particulièrement adaptée à notre problématique dans la mesure où l’action de l’éducateur impacte des personnes qui ne peuvent que difficilement s’y soustraire et ceci induit de sa part un minimum de circonspection.
Pour mieux comprendre le sens de la phronésis, il est intéressant de s’intéresser à des termes qui lui sont proches mais distincts dans la pensée d’Aristote et en particulier de celui de technè. Si de nombreux lecteurs d’Aristote considèrent qu’il est important de réfléchir aux positionnements respectifs de la technè et de de la phronésis, c’est que les deux termes décrivent des actes soumis à la contingence. En cela, ils se distinguent de la pensée (sophia) qui concerne les idées générales : « La phronésis se sépare de la pensée de la sophia car elle se concentre sur le “cette fois-ci” de la situation concrète, sur son occurrence à chaque fois singulière, alors que la pensée vise à l’identique du même » (Moreau, 2009, p. 161). Mais, si l’action concerne à la fois la phronésis et la technè, cette dernière ne prend pas en compte son analyse morale : si la phronesis guide l’action pratique et singulière au plan téléologique en tentant d’établir le lien entre pensée et action, la technè la fonde en recourant aux lois générales de la causalité (Frega, 2006, p. 21). Cette différence nous paraît intéresser au premier chef l’analyse de l’activité éducative dans la mesure où il est manifeste que l’éducateur ne peut se passer de techniques, mais ne peut occulter non plus leur insertion dans un cadre téléologique référé aux finalités de l’éducation.
Si la technè est sans fondements axiologiques c’est en particulier parce que sa caractéristique est de se construire avec la possibilité de l’échec. La phronésis, au contraire, est incompatible avec l’idée d’une mise à l’épreuve. Considérer le courage comme relevant de la phronésis nous permet donc de comprendre ce que l’éducateur courageux doit prendre en compte eu égard à la dépendance de fait des usagers : si le courage a à voir avec le risque, il a tout autant à voir avec le refus de l’irresponsabilité. Il se caractérise donc par le « sens du risque » car il ne peut être assimilé à un calcul. La notion de phronésis décrit en effet un mode d’approche du réel qui « n’est pas une étude réfléchie de la situation ou une contemplation désintéressée (theoria), mais une mise en discussion continue de l’action pendant l’action elle-même, jusqu’à son achèvement : elle ne saurait se figer en compétence ou en aptitude, elle est indescriptible puisqu’inséparable de l’action où elle se développe » (Moreau, 2011, p. 95). La phronésis, et donc le courage, ne peuvent se réduire à des compétences pratiques ou réflexives. Ils caractérisent plutôt une attitude, une disposition à aborder de manière particulière les règles du choix (Aubenque, 2009, p. 34) qui permet de mettre l’action particulière à l’abri de l’errance axiologique.
Ce que nous permet de comprendre cette rapide étude de la conception aristotélicienne de la phronésis peut se formuler ainsi : si le courage est lié à la prudence, il est également action morale en situation. Les comportements relevant du courage éducatif ne sont donc pas seulement ceux qui font preuve d’une volonté d’affronter des difficultés, comme pourrait le laisser penser une approche sommaire de la notion : le courage ne peut être considéré comme une simple volonté de faire face. Le courage des éducateurs est un courage « prudent », au sens d’une appréhension du risque axiologique aussi bien que du risque de l’échec. Il ne nous paraît donc pas pouvoir relever des conceptions actuelles dominantes dans le champ sociétal. Plus encore, nous soutenons qu’il existe une sorte d’inversion de la signification du courage telle que nous la proposons par rapport à ses valeurs courantes. En effet, loin d’être considéré comme l’expression d’une morale personnelle en situation, certains indices montrent que, le discours actuel sur le courage fait de ce dernier une sorte d’injonction qui fait pression sur les individus. Celle-ci se traduit par une définition héroïque et méritante du courage (Berns, Blésin, & Jeanmart, 2010, pp. 12-13) que l’on retrouve chez la victime qui résiste, le pompier, l’entrepreneur, et dont la caractéristique commune est à la fois « capacité à se mettre en risque pour une cause qui les dépasse » (Berns, Blésin, & Jeanmart, 2010, p. 14) et un appel à une responsabilisation référée au culte de la performance. Les valeurs actuelles du courage posent donc ce dernier comme adhésion à des valeurs de l’époque (la valorisation de l’héroïsme, du mérite, de la performance) et aux types de comportements censés les actualiser.
Pourtant, une définition substantielle du courage, nous paraît interdire des conceptions ne se référant pas au sens de l’action engagée au regard des effets produits sur l’environnement. De ce point de vue, il est intéressant de prendre en considération les propositions de Dewey, qui reconnait au courage trois caractéristiques (Blésin, 2009). Premièrement, celui-ci est associé à la possibilité d’un commencement, d’un geste inaugural : le courageux se risque à introduire de la variabilité dans l’ordre existant. Deuxièmement, le courage est une mobilisation qui exprime à la fois la sincérité et la possibilité d’un impact sur le monde, au risque de bouleverser l’ordre établi. Pour Dewey, ces différents temps ne valent qu’en référence à un idéal qui n’est ni une option, ni un but ou une finalité qui seraient définis de façon externe à la situation et qu’il s’agirait de rejoindre. Il s’agit au contraire d’une « projection souhaitée de nos pouvoirs d’action » (Dewey, 1967, p. 70). C’est ce qui justifie la fonction d’un troisième moment du courage, celui de l’effort pratique (Dewey, 1976, p. 197). Ainsi, le courage a à voir avec l’engagement et la volonté sincère d’influer sur le cours des choses.
Ces éléments nous permettent de proposer le courage mobilisable dans le champ éducatif comme processus de positionnement face à des possibilités à reconnaître ou élaborer plus que comme adhésion a priori à un point de vue extérieur à la situation (bureaucratique, réglementaire…). En d’autre termes, les significations accordées habituellement au courage sont moins erronées que réductrices au sens où elles posent des manifestations possibles du courage (l’action, l’adhésion à des principes) comme des constituants.
Notre recherche consiste précisément à tenter, en prenant au sérieux une conception du courage défini comme capacité de lutter contre une simple soumission aux normes, de comprendre les repères mobilisés par les éducateurs, c’est-à-dire leurs préférences éthiques, lorsqu’ils considèrent faire preuve de courage professionnel. Nous considérons en effet que ces moments de courage constituent des « moments éthiques » où l’éducation scolaire devient un acte moral engageant la responsabilité de son auteur (Soëtard, 2011, p. 66). Or, ces instants où les acteurs visent à mettre en adéquation actes et arbitrages normatifs sont également des « moments pédagogiques » (Meirieu, 1995), tentatives sincères et fondées pour introduire une rupture dans la chaîne des causalités qui pèsent sur le devenir scolaire des élèves (Soëtard, 2011, p. 91). Le courage peut être conçu comme capacité de « rassembler ce qui est épars en soi » (Fleury, 2010, p. 48) pour résister à un ordre du monde que l’on trouve inopérant. Son actualisation est forcément, pour les professionnels, concomitant d’une cohérence retrouvée dans le passage à l’acte et dans le cadre d’une définition personnelle de ce qui mérite ou qui doit être fait.
(fin de la première partie)