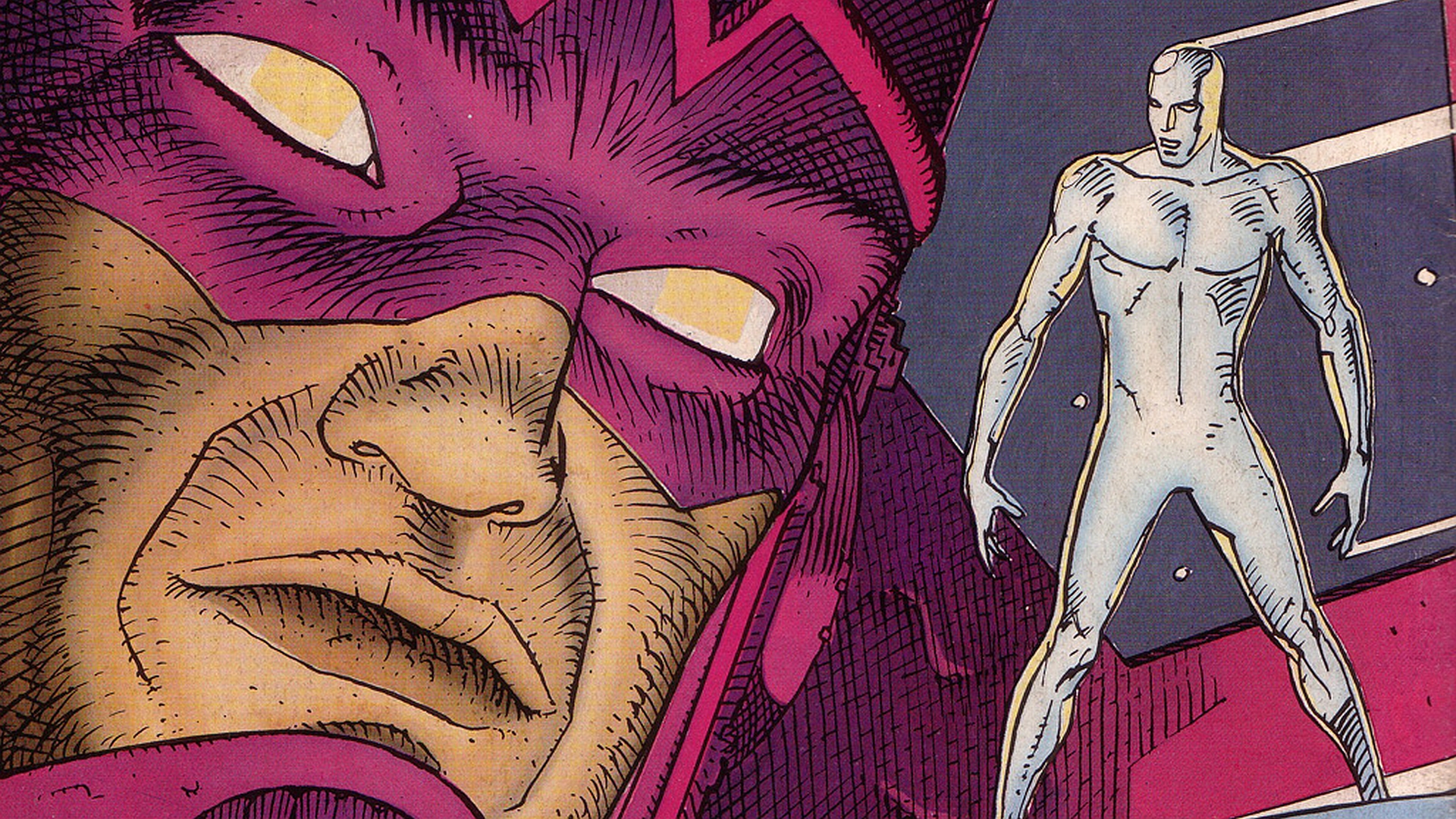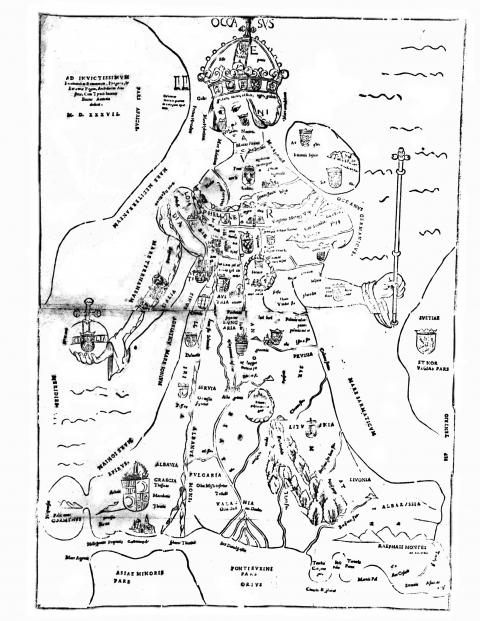Le rite entre sacré et saint
Marc de Launay (CNRS – Archives Husserl de Paris)
La vision générale des rites les réfère la plupart du temps à des pratiques cultuelles lato sensu propres à des sociétés régies par le « mythe », par la croyance en des forces agissant partout dans le monde (mana), par ce qu’on appelle l’animisme. Pareille préférence correspond d’ailleurs à la conception développée par Max Weber et découle tout naturellement de l’hypothèse d’un désenchantement progressif du monde à partir du moment où s’installe véritablement la rationalité comme orientation rectrice des cultures modernes. Le rite est ainsi essentiellement ou exemplairement perçu comme un aspect de la vision magique du monde[1]. Lorsqu’elle élargit sa conception du rite, la sociologie a, bien entendu, compris quelles pouvaient être ses fonctions sociales : établir une communication entre sacré et profane, définir négativement et positivement une communauté[2], collaborer à l’édification d’une institution « morale »[3]. Ainsi, s’installe l’habitude d’interpréter les rites à partir du sens fonctionnel ou allégorique qu’ils seraient supposés tenir d’une représentation générale du monde, préalable à l’élaboration de la série des pratiques censées la traduire ou la transposer dans une liturgie. Une interprétation mythique donnerait lieu à des rituels différents selon les interprétations qu’en produiraient les hiérarques. Tel rite accompagnant la naissance, l’entrée dans la communauté adulte, la mort, etc., serait expliqué en reconstruisant un corpus doctrinal où sa gestuelle, les ingrédients utilisés, seraient intelligibles. Or, d’une part, les modalités de cette transposition ou traduction ne sont pas interrogées, et, d’autre part, le caractère prescriptif des rites serait inévitablement déduit de l’« autorité » du corpus préalable, de sa vérité imposée ou partagée. On constate pourtant bien que partager une même conception du monde n’implique nullement d’en déduire des rites similaires, et leur variété ne tient pas seulement à des facteurs géographiques tenant séparées des cultures qui seraient dans l’impossibilité de communiquer. Même d’un point de vue purement fonctionnel, et s’il est possible d’identifier des « catégories » universalisables peu ou prou et qui sont bien des événements vécus par tous – naissance, vie, mort, etc. –, mais cette fonctionnalité ne livre à elle seule aucune interprétation spéciale de tel rite, une fois identifiée sa place dans le système des rôles.
On ne peut donc pas se contenter de constater l’existence de tel ou tel rite ni de l’interpréter en fonction de la seule sémantique de ses contenus, même si elle semble souvent satisfaire l’exigence d’intelligibilité. Varron, réfléchissant au sens du terme latin ritus distingue très judicieusement un sens ordinaire, tel usage cultuel fixé, et un sens second, qui désigne plutôt la « manière », le « style caractéristique », l’habitus spécifique, et qui, partant, renvoie à la notion générale de modalité, rompant avec la roideur de ce que transmet une tradition à titre prescriptif et impératif[4]. Il y a ainsi place faite à la part d’inventivité reconnue indispensable à l’apparition des rites, c’est-à-dire la part faite à cette histoire qui précède la descendance d’une tradition léguée dont l’héritage accepté dessine une autre historicité.
L’ethnologie a fourni des matériaux suffisamment abondants pour qu’on puisse inverser la manière de voir qu’on a indiquée : « On a souligné avec raison que dans le rapport entre le mythe et les rites, les rites sont premiers et le mythe postérieur. Au lieu d’expliquer la pratique rituelle à partir du contenu de croyance […] nous devons prendre le chemin inverse et comprendre ce qui dans le mythe appartient au monde théorique de la représentation […] comme une interprétation médiate de ce qui est immédiatement vivant dans l’action. [5]» Il y a, en effet, une différence manifeste entre le geste formel par lequel l’aruspice décide de découper une portion de ciel (templum) délimitée par les arbres d’une clairière (que figureront ultérieurement les colonnes des temples bâtis) et le contenu interprétatif de ce qu’il y contemplera. Le mythe résulte d’un processus qui repose sur une interaction constante entre des innovations pratiques, au terme d’un choix qui en exclut certaines et en retient d’autres, et les raisons avancées pour justifier ces choix, raisons qui sont alors les ébauches d’une sémantique plus générale aspirant à une cohérence. Avant d’être prescrit, le rite est construit, et sa prescriptibilité dépend d’une élaboration dont la principale orientation sera de masquer ou d’effacer les traces d’arbitraire au profit de sa justification motivée ; en outre, il faut bien que l’autorité des prescripteurs puisse sembler leur être supérieure, et qu’eux-mêmes puissent se présenter comme ses serviteurs[6]. Mais cela vaut pour le mythe, et ce serait une erreur que de croire valide l’extension à toute forme de « religiosité » considérée comme variation ou spécialisation dans un même ordre symbolique. Marcel Mauss avait lui-même reconnu, dans son Essai sur le don, que la caractéristique principale des rites sacrificiels se fondait sur la fonction de l’échange, mais que son expression do ut des ne pouvait plus rendre compte, par exemple, d’une prescription biblique aussi simple que l’aumône[7]. L’éthologie confirme cette priorité archaïque du rite sur le mythe, car la formation d’un rite peut s’observer même chez l’animal, en dépit de tout corpus théorique de représentation. Konrad Lorenz l’indique en décrivant la formation d’un « rite » chez une petite oie cendrée qui le considérait comme sa « mère » : suivant Lorenz dans sa maison, l’oie prit peur en passant brutalement de la lumière extérieure à l’ombre qui régnait dans l’entrée de la maison ; elle fit donc une sorte de demi-tour à 180° vers la lumière provenant de la fenêtre jouxtant la porte. Lorenz l’appelant pour la rassurer la fit se retourner de nouveau et finalement le suivre. Par la suite, Lorenz observa que jamais l’oie n’entrait dans la maison sans accomplir un petit demi-tour, peu à peu transformé en pas de côté. Un jour, l’oie suivit Lorenz directement sans accomplir ce mouvement, et sa frayeur se déclencha quelques pas après, lui imposa de faire demi-tour et de rentrer à nouveau dans la maison, mais en accomplissant alors le rituel du pas de côté. On comprend bien que la non-observance du « rite » déclenche le souvenir de la peur initiale avec autant de force puisque ce dernier la réactualise au sens propre, et la fonction d’abréaction d’un tel rite est patente. Ce qui est plus remarquable c’est précisément d’observer chez un animal la capacité à élaborer une technique de protection en l’absence de tout instinct et de tout élément prescriptif ; il s’agit bien d’une invention d’ordre symbolique, même si pareille distance prise par rapport à une peur reste de part en part « utilitaire » ou relève d’une « économie psychique ». Néanmoins, l’obscure « compréhension » du fait que la non-observance du « rite » est aussi terrible que la peur initiale qu’il a permis de surmonter ne s’inscrit jamais dans l’ordre de ce qui sera héréditaire : « Les rites culturels de l’homme qui se forment au cours de l’histoire […] ne sont pas incorporés dans le patrimoine héréditaire ; ils sont transmis par la tradition et chaque individu doit les apprendre à nouveau. Si l’on tient absolument à établir une frontière entre l’“animal” et l’homme, c’est là qu’on pourrait précisément la voir. [8]» Car il y a encore loin entre le geste maniaque qui est la transposition en symptôme d’une peur et le rite dont l’élaboration suppose à tout le moins qu’un langage permette sa transmission et sa réception instruite. Sous une première forme, le rite est conçu pour en quelque sorte « agir » sur ce qui suscite la peur, voire sur la peur elle-même pour peu qu’elle soit « personnifiée », mais cette version « mythique » du rite présuppose la plénitude substantielle d’un monde compris comme totalité dotée en toutes ses parties de forces équivalentes dont les manifestations sont indifféremment polymorphes. De ce point de vue, le rite est lui aussi une action dont les effets se feront inévitablement sentir dans la totalité, et sont censés y déclencher en retour d’autres effets prévisibles, d’abord utiles. Cette économie générale est également celle qui est prêtée au langage où les noms peuvent alors être investis de certains « pouvoirs ». Rite et « charme » vont de pair. Pareille conception pourrait fort bien perdurer, et l’a d’ailleurs fait très longtemps, mais elle est victime de sa réussite, c’est-à-dire de sa répétition : non pas que les échecs répétés des prédictions ou des rituels aient conduit ceux qui les pratiquaient à douter de l’efficacité générale de ces rites ou à mettre en cause les présupposés plus fondamentaux de leur vision du cosmos ; c’est plutôt que la répétition et le souci même de bien faire ont suscité une émulation qui détournait peu à peu de la finalité des rites au profit de leur forme. Les préoccupations sont alors d’un genre tout différent puisqu’elles gravitent précisément autour de questions formelles, dont le premier effet est de faire passer les problèmes prescriptifs au second plan par rapport à une interrogation sur l’adéquation entre le contenu du rite et sa justification « théorique » ou son contenu de représentation. En outre, le polymorphisme présupposé entre nécessairement en contradiction avec l’unité partout requise dans les rites et qui est gage de leur efficacité. Les métaphores homériques sont peut-être la trace de cette crise et laissent entrevoir une première phase de la dialectique du rite. Sa résolution n’est pas un dépassement synthétique, mais l’apparition d’une création culturelle tout à fait neuve, une poésie totalement affranchie de finalités prescriptives, faisant des « dieux » les acteurs, au même titre que les héros, d’une geste particulière. Répéter des syntagmes liés, comme le fait Homère – « Briséis aux bras blancs », par exemple – fait ironiquement se fissurer le substantialisme initial : d’une part, la caractéristique « ontologique » s’estompe au profit de la réussite linguistique (celle, notamment, de la métaphore « l’aurore aux doigts de rose »), d’autre part, la répétition en tant que telle d’une formule qui n’a plus rien de rituel met en quelque sorte à nu la compulsivité rituelle, la régressivité maniaque du rite magique : « En fait, la nouvelle idéalité, la nouvelle dimension de l’esprit qui s’ouvre grâce à la religion, n’attribue pas vraiment à l’élément mythique une nouvelle “signification” : il serait plus exact de dire que la religion introduit dans le domaine du mythe l’opposition entre la “signification” et l’“existence”. [9]» On comprend très bien que la lutte contre l’« idolâtrie » vise essentiellement cette spécificité propre au mythe qui consiste à ne pas distinguer la représentation concrète du divin et sa divinité même. Mais un pas supplémentaire est franchi lorsque la critique du mythe parvient à maturité : les éléments de la conscience mythique sont réemployés contre les présupposés de cette conscience même, et la possibilité de les utiliser à des fins qu’elle ne pouvait ni concevoir ni intégrer présuppose un arrière-plan instrumental qui permette de réaliser ce contre-emploi. Sans la « poésie », le langage n’eût pas acquis cette capacité de convoquer des segments narratifs mythiques pour les réagencer dans une composition très subtile qui les met sans cesse en porte-à-faux. Le processus se développe aussi bien chez Hésiode, dans sa Théogonie, que dans la Bible, mais avec cette différence essentielle que, dans le premier cas, les effets culturels de ce travail du langage contre le mythe débouchent sur les prodromes de la « philosophie » ; dans le second, sur une orthopraxie radicale : « Dans le rituel, il n’y a rien de lumineux, aucune idolâtrie ; c’est une distance prise dans la nature à l’égard de la nature. [10]» La theoria philosophique scrute la physis pour en déduire ce que devra être l’ethos humain – l’imitation de l’harmonie cosmique devient la règle. Dans l’univers biblique, la réflexion se concentre exclusivement sur les agissements humains pour en déduire des rites justifiés par l’articulation de l’éthique sur l’histoire et sur celle d’un peuple. La prééminence accordée au langage de manière si nette[11] a pour conséquence que « l’avènement de l’Écriture n’est pas la subordination de l’esprit à une lettre, mais la substitution de la lettre au sol »[12], et qu’ainsi le rite « pénètre les gestes matériels de l’existence », mais « détournés de leur finalité naturelle vers le symbole »[13].
En tant que telle, la subordination du monde vécu à des rites, qui prennent en considération ses moindres aspects et semblent alors la corseter de règles, n’offre pas immédiatement de garantie définitive contre le retour plus ou moins insidieux du substantialisme mythique. Et c’est bien pour cela que les rites, dont la Bible nous raconte comment ils s’instaurent et s’établissent, ne sont pas des décrets dont l’évidence et l’autorité eussent été à ce point écrasantes d’évidence qu’elles se fussent imposées sans lutte. Au contraire, les « récits » – les formes allégoriques adaptées à la communication intelligible de processus complexes – qui rendent compte du bouleversement qu’a dû être l’abandon du mythe et la crise que fut certainement le passage à des rites dont la signification était si différente, ne cessent de décrire des tentations régressives. On ne peut pas manquer d’interpréter dans ce sens le fait que les Tables ne peuvent parvenir au peuple hébreu sans avoir d’abord été brisées[14], sans que ce dernier ait été tenté, Aaron lui aussi, par la fabrication d’une idole ; au moment même où Aaron et ses fils, Nadab et Abihu, pratiquent les premiers sacrifices, ces frères succombent à la tentation archaïque d’infléchir le rite en revenant à sa finalité théurgique, et le « feu étrange » ou « étranger » (les deux valeurs sont sans doute également présentes) qu’ils allument les dévore aussitôt[15]. Plus remarquable encore, dans cette perspective, l’une des prescriptions portant sur la construction du coffre destiné à contenir les Tables : le « propitiatoire », qui en sera le couvercle, aura la forme d’un rectangle, et chacune de ses largeurs supportera une tête de chérubin dont les ailes étendues perpendiculairement aux largeurs couvriront le bord des longueurs[16]. N’est-il pas surprenant que réapparaisse deux « figures » sculptées sur le coffre destiné à protéger les commandements dont le deuxième interdit toute représentation (Ex. 20, 4) ? Que font là ces chérubins ? Ils sont le rappel de Genèse 3, 24 : les chérubins sont placés à l’est de l’Éden pour en interdire à tout jamais l’accès. Plus précisément, ils n’apparaissent qu’en raison d’un possible désir d’éternité qui surgirait chez les hommes après qu’ils se furent approprié le fruit de l’arbre de la connaissance de bien et mal. Or ils ont bien cru s’approprier le savoir touchant à la distinction des valeurs fondamentales sans comprendre que c’était sur un mode régressif : la manducation. Trait mythique courant qui consiste à s’approprier les vertus supposées des animaux (peut-être d’autres hommes) en se nourrissant de leur chair. Cette appropriation régressive rappelle l’un des présupposés fondamentaux de la conscience mythique, et qui consiste à se croire devenir ce dont on s’est emparé, grâce à la métamorphose que l’on suppose avoir de ce fait subie par la magie d’une incorporation. Détenir le savoir non pas de ce qui est bien ni de ce qui est mal, mais de ce qui en est le degré supérieur – leur différence –, voilà qui permet de se croire divin et, partant, soustrait au temps. Mais il n’existe aucun moyen « formel » de dissuader quiconque d’aspirer à l’« éternité » : il faut alors avoir recours à des figures apotropéiques concrètes, dont la présence est également une leçon sur l’impossibilité, reconnue vraisemblable, d’en finir à jamais avec les mythes[17]. Du même coup, c’est avec les moyens légués malgré tout par les représentations mythiques qu’il faut édifier de quoi résister à leur charme ; et le rite prend tout son sens dans la perspective historique où il répète que le dépassement de la conscience mythique est bien un processus, que ce dernier est inachevé, et qu’il se confond en quelque manière avec une sortie continuée d’Égypte : « Le rite juif n’est peut-être que cela ! La passion se méfiant de son pathos, devenant et redevenant conscience ! [18]»
Exode 24, 7 donne une indication précieuse quant à la manière dont le rite accompagne d’emblée la réception même des Tables : non seulement Moïse prépare la lecture qu’il va en faire par une disposition sacrificielle, chaque tribu devant procéder à un holocauste (ola : réparation de fautes commises en pensée) et à des shelamim (actions de grâce) ; mais une fois la lecture faite, le peuple dit unanimement « néassé vé nishma – « nous ferons et nous entendrons », dans cet ordre, c’est-à-dire dans un ordre où l’agir précède l’écoute obédiente et réflexive. L’étude, suspension de l’action, n’a lieu qu’à shabbat, au terme de la semaine, et achève la durée des jours ouvrés. La priorité du faire n’instaure pas ainsi une préséance d’ordre pragmatique, mais souligne que les commandements n’ont pas de sens à être d’abord contemplés si leur accomplissement devrait ainsi être différé ; car ce dernier vaut en permanence et s’impose également au temps de l’étude – la résonance de cette priorité règle jusqu’à l’usage du langage parlé : « La parole est de l’ordre de la morale avant d’être de l’ordre de la théorie. [19]» De même qu’il est impossible de penser un commandement ou une prescription sans se poser la question des conditions de son accomplissement ou de son application, savoir l’accomplir ou l’appliquer ne peut pas obéir à des règles qui seraient elles-mêmes prescrites, car on aurait alors affaire à un syllogisme ou à un regressus ad infinitum : il faudrait imaginer des règles fixant l’application des règles, puis encore d’autres règles fixant l’application des règles déterminant celle des autres, etc. Le rite s’accompagne donc d’une « loi orale » qui, Levinas le dit bien, « est une casuistique » : « Elle s’occupe du passage du principe général incarné par la Loi à son exécution possible, à sa concrétude. Si ce passage était purement déductible, la Loi, comme loi particulière, n’aurait pas demandé une adhésion à part. Mais il se trouve – et c’est là la grande sagesse dont la conscience anime le Talmud – que les principes généraux et généreux peuvent s’investir dans l’application. [20]»
Nombre de rites, outre la fonction évidente d’assurer la cohésion d’un groupe en lui proposant des signes de reconnaissance différentielle, jouent le rôle plus généralement didactique de transmission sélective d’une nouvelle conception de l’histoire : « Ce n’est pas parce que Israël a miraculeusement survécu qu’il s’arroge une liberté à l’égard de l’histoire. C’est parce que, d’emblée, il a su refuser la juridiction des événements, que le judaïsme s’est maintenu comme une conscience, une à travers l’histoire.[21] » Le rite est, en effet, conçu pour être, dans cette perspective, une « temporalisation du présent » référé en même temps à un passé qu’il rappelle et à un avenir idéal qu’il espère[22]. Ce n’est nullement un hasard si le récit de la prescription de porter des « franges », en Nombres 15, s’accompagne d’une double injonction divine : « Vous vous souviendrez de tous les commandements divins pour les mettre en pratique » et « Soyez saints ! » L’impératif confère au présent un statut paradoxal : il n’y a pas d’accomplissement au « présent », mais l’accomplissement lui-même devient l’articulation actualisante du passé sur l’avenir – ne rien oublier, tout espérer. Ce n’est pas le présent de l’accomplissement qui compte, c’est l’accomplissement qui affranchit des liens du présent. Et la « sainteté » qui est exprimée comme un impératif, précisément, n’a rien d’actuel ni d’effectif – les franges ne sont pas des amulettes qu’on pourrait imaginer dotées de charmes. Immédiatement après le récit de cette prescription a lieu la révolte de Qora’h dont le principal argument consiste à brandir, face à l’assemblée des Lévites comme à l’encontre de Moïse, un mot d’ordre qui déborde largement la contestation du « pouvoir » de ce dernier : « Nous sommes tous saints ! » Qora’h veut confondre, en un précipité de type apocalyptique, être et devoir-être. Il préfigure de manière emblématique toutes les critiques faites au « légalisme » juif, et il est aussi l’anticipation des faux messies. D’ailleurs, le texte biblique est, à cet égard, d’une clairvoyence qui stupéfie : le châtiment divin qui s’abat sur Qora’h n’épargne ni ses conjurés ni sa famille ni ses enfants, donc ; or, en Nombres 26, 11, lors du recensement qui clôt le séjour des Hébreux au désert, on peut lire qu’en dépit de ce châtiment brièvement rappelé, « les fils de Qora’h ne moururent pas » – la critique biblique rationaliste aura beau ne pas manquer cette bonne occasion de prendre les rédacteurs en flagrant délit d’inconséquence, c’est elle qui se révèle peu perspicace : les rédacteurs avaient fort bien compris que les prescriptions rituelles susciteraient périodiquement des mouvements tentés d’en secouer ce qu’on a appelé le « joug ».
Il existe enfin d’autres prescriptions rituelles d’un genre particulier puisqu’il ne s’agit plus, à travers elles, de tenir en lisière des survivances mythiques ni de résumer la reconstruction d’un événement qui marque une étape dans l’émancipation par rapport à la conscience mythique. Il s’agit des ‘houkim dont Levinas, après Hermann Cohen[23], souligne la spécificité en s’inscrivant lui aussi dans une longue tradition où figure Ibn Daoud, Maïmonide, Bakhya, Jéhouda Halevy : « À côté des mishpatim, lois de justice où tous se reconnaissent, il y a les ‘houkim, lois injustifiables qui font la joie du Satan quand il se moque de la Thora. Il prétend insensé et tyrannique le rituel de la “vache rousse” dans Nombre XIX. [24]» Parmi les ‘houkim, en effet, figure la prescription apparemment arbitraire du sacrifice d’une vache rousse, loi considérée comme « perpétuelle pour les enfants d’Israël et pour les étrangers séjournant parmi eux ». Or il n’y a aucune justification ni mémorielle ni fonctionnelle d’un tel sacrifice. Hermann Cohen avait bien perçu que les rites constituaient un « système symbolique » où le renvoi de chaque prescription à l’ensemble des commandements était la première distinction fondamentale, parce que d’ordre strictement formel, d’avec l’univers substantialiste des pratiques rituelles mythiques. Levinas poursuit dans cette voie en soulignant que le « symbolisme du rite ne serait pas une quelconque déficience du connaître, mais un surplus, à mi-chemin entre signifiance du signifié et son accomplissement »[25]. Les ‘houkim ne relèvent plus d’un jugement déterminant qui réfèrent les mishpatim à des « cas », mais de jugements réfléchissants qui établissent un rapport entre la pratique en général et ses fins, qui, donc, mettent en évidence la nécessité comme telle des rites dont le fondement ou la justification échappent au concept. Un rite ne repose sur aucune règle comparable à celle qui permet d’établir un lien entre des connexions strictement causales, mais résulte d’une interprétation qui en fait un « symbole de la moralité » ; les ‘houkim révèlent la présence d’une « esthétique » du rite en se signalant par une différence d’ordre face aux autres prescriptions : ils témoignent d’une présence irréductible du formel sans laquelle le casuel risquerait de dériver vers le fétichisme de l’observance ou la confusion entre rite et causalité, instrumentalisant peu ou prou la ferveur et le salut. Bien des aspects, dans le rituel du shabbat, offrent la préfiguration d’un monde réconcilié, mais d’autres consistent simultanément à présenter cette anticipation sous un éclairage qui interdit précisément la fascination idolâtre de cette image – la lumière des bougies du shabbat doit rester modeste. Le rite est la résolution de la contradiction vécue du temps : il se répète pour constamment interdire la croyance en une fin de l’histoire, mais permettre toujours le refus d’un présent du monde.
[2] C’est-à-dire par délimitation, différenciation, voire singularisation (ce que les autres communautés ne font ni ne pratiquent) et par identification (dotation d’un contenu positif de règles).
[3] Cf. É. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Alcan, 1912, p. 428, 464 et 497. Voir aussi M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, Mohr-Siebeck, p. 403.
[4]
Varron, de Lingua latina, VII, 88.
[5] E. Cassirer, Philosophie des formes symboliques, vol. II, Paris, Éd. de Minuit, 1972 (trad. J. Lacoste), p. 6à sq.
[6] Cf. E. Cassirer, Philosophie des formes symboliques, vol. II, op. cit., p. 270 : « Chaque nouvelle forme de sacrifice et de prière dévoile un nouveau contenu du divin et de l’humain, et une nouvelle relation entre eux. Seul le rapport de tension réciproque qui s’instaure entre eux donne à chacun d’eux son sens et son caractère […] la conscience donne à l’opposition entre Dieu et l’homme une formulation toujours plus précise pour trouver ainsi les moyens de la dépasser. »
[7] M. Mauss, Essai sur le don, Paris, PUF, 2007 (« Quadrige »).
[8] K. Lorenz, L’Agression. Une histoire naturelle du mal, Paris, Flammarion, 1968, p.78-80 (trad. V. Fritsch).
[9] E. Cassirer, Philosophie des formes symboliques, vol. II, op.cit., p. 280.
[10] E. Levinas, L’au-delà du verset, Paris, Éd. de Minuit, 1982, p. 173.
[11] Cf. E. Levinas, Hors sujet, Cognac, Fata Morgana, 1987, p. 195 : « Pas un verset, pas un mot dans l’Ancien Testament qui ne soit ouvert sur ce monde qui enveloppe le lisible. » Plus nettement encore : « Le commandement plutôt que la narration constitue le premier mouvement allant vers l’entendement humain ; est, de soi, le commancement du langage. », L’au-delà du verset, op. cit., p. 174.
[12] E. Levinas, Difficile liberté, Paris, Albin Michel, 1963, p. 165.
[13] E. Levinas, Noms propres, Paris, LGF, 1987, p. 18.
[14] Exode 32, 19.
[15] Lévitique 10, 1-2.
[16] Exode 25, 18-21.
[17] Cette concession à l’univers mythique ne va cependant pas jusqu’à reconnaître une force magique réelle à ces figures qui n’ont plus la valeur d’authentiques talismans vecteurs d’effets matériels, car ce ne sont que des symboles dont la fonction est celle d’un rappel et d’une injonction déjà abstraits. Cf. E . Cassirer, Philosophie des formes symboliques, vol. II, op. cit., p. 284 : « Car si [la nature] est conservée dans un domaine bien défini, elle doit, pour être conservée, être en même temps anéantie, c’est-à-dire dépouillée de ses déterminations matérielles et, par la référence à l’opposition du bien et du mal, renvoyée dans une tout autre dimension de la pensée. »
[18] E. Levinas, Difficile liberté, op. cit., p. 17 ; cf., également, p. 145 : « Le judaïsme tout entier, par-delà son credo et son ritualisme – au moyen de sa foi et de ses pratiques – n’a peut-être voulu que la fin des mythologies, des violences qu’elles exercent sur la raison et qu’elles perpétuent dans les mœurs. »
[19] Ibid., p. 21.
[20] E. Levinas, L’au-delà du verset, op. cit., p. 98.
[21] E. Levinas, Hors sujet, op. cit., p. 93.
[22] E. Levinas, Hors sujet, op. cit., p. 194 : « Les pratiques sont insérées par l’interprétation dans la texture des événements. »
[23] H. Cohen, Religion de la Raison, Paris, PUF, 1994, p. 487 (trad. A. Lagny et M. de Launay).
[24] E. Levinas, L’au-delà du verset, op. cit., p. 97 sq.
[25] E. Levinas, À l’heure des nations, Paris, Éd. de Minuit, 1988, p. 178 sq.