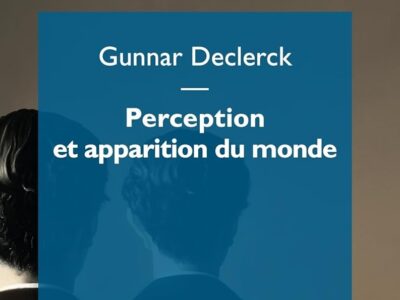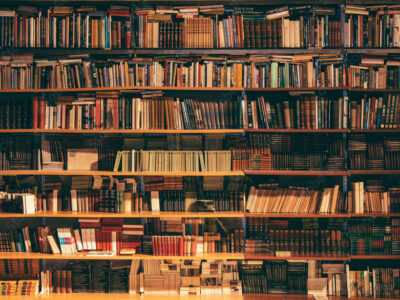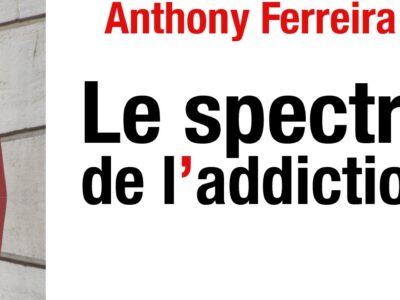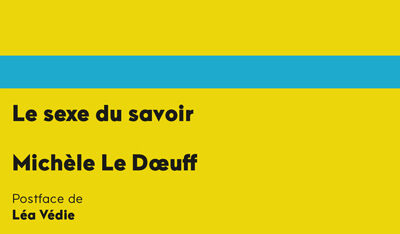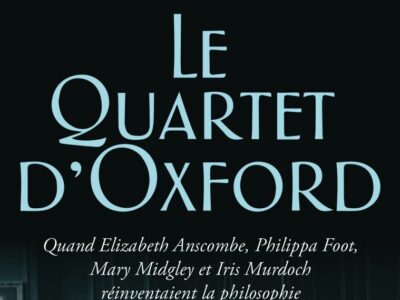Recension – La pharmacie de Nietzsche : de la philosophie comme médecine
Gaël Brulé est professeur associé à la haute école de santé de Genève. Il s’intéresse aux liens entre société, santé et bien-être. Il a écrit une trentaine d’articles et de chapitres d’ouvrages collectifs et six livres dont le dernier Le coût environnemental du bonheur est paru l’année dernière. Il est co-rédacteur en chef de la revue Sciences & Bonheur.
La pharmacie de Nietzsche : de la philosophie comme médecine, Jonathan Daudey, éditions de l’Harmattan, 2023.
L’ouvrage est disponible ici.
Introduction
La pharmacie de Nietzsche, ouvrage de Jonathan Daudey paru en 2023 aux éditions de L’Harmattan interroge les liens entre santé, maladie et culture en s’appuyant sur la pensée nietzschéenne. Partant de la célèbre formule d’Alfred North Whitehead selon laquelle « toute l’histoire de la philosophie n’est qu’une suite de notes de bas de page aux dialogues de Platon »[1], Jonathan Daudey examine la persistance du dualisme platonicien dans nos institutions de pensée et de santé. Chez Platon, la philosophie est chargée de guérir les âmes, tandis que la médecine s’occupe des corps. Nietzsche, quant à lui, rejette ce dualisme en dénonçant son impact sur la modernité : une apathie généralisée, une complaisance morale, et une déconnexion du sensible. Cette approche prend tout son sens à l’heure où les troubles psychiques se multiplient, où la surmédicalisation des comportements fait débat, et où les politiques de santé publique suscitent de vifs débats politiques, économiques et éthiques. L’ouvrage se distingue par sa capacité à déplacer le regard en rejetant une conception biomédicale de la santé au profit d’une approche philosophique, culturelle, existentielle. Cette approche, nourrie par le corpus de textes tels qu’Aurore, Ainsi parlait Zarathoustra ou Le Gai Savoir, permet d’aborder la maladie non pas comme un simple dysfonctionnement, mais comme une expression nécessaire de la vie. La présente recension met en avant trois points saillants à propos du livre de Jonathan Daudey : le rôle du philosophe-médecin, les nouvelles définitions de santé et une perspective critique sur les apports du livre.
Le philosophe-médecin au centre
La phar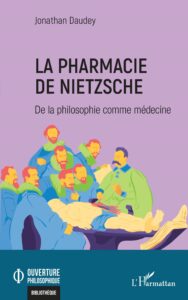 macie de Nietzsche s’intéresse principalement à la figure du philosophe-médecin[2], inspirée de Nietzsche, qui interprète les symptômes des individus et des sociétés pour proposer des remèdes adaptés aux maux de son époque et de la nôtre. Ce philosophe-médecin, loin d’être un simple observateur, est un acteur engagé, repensant la maladie et la santé non en termes de simples dysfonctionnements ou d’équilibre à restaurer, mais comme des forces dynamiques et créatrices. L’ouvrage de Jonathan Daudey propose ainsi autant une philosophie de la médecine qu’une médecine de la philosophie, dans l’esprit de la maxime nietzschéenne selon laquelle « la philosophie est la médecine de l’homme » (p.11).
macie de Nietzsche s’intéresse principalement à la figure du philosophe-médecin[2], inspirée de Nietzsche, qui interprète les symptômes des individus et des sociétés pour proposer des remèdes adaptés aux maux de son époque et de la nôtre. Ce philosophe-médecin, loin d’être un simple observateur, est un acteur engagé, repensant la maladie et la santé non en termes de simples dysfonctionnements ou d’équilibre à restaurer, mais comme des forces dynamiques et créatrices. L’ouvrage de Jonathan Daudey propose ainsi autant une philosophie de la médecine qu’une médecine de la philosophie, dans l’esprit de la maxime nietzschéenne selon laquelle « la philosophie est la médecine de l’homme » (p.11).
L’auteur élabore un programme ambitieux pour le philosophe-médecin : « rendre la santé, donner un avenir, permettre la croissance, affirmer la puissance, revitaliser la vie ». Cette vision s’oppose à l’idée d’une santé comme état stable, et met en avant une approche agonistique, où la santé se définit par le mouvement, l’adaptation et la transformation. Nietzsche affirme ainsi dans Le Gai Savoir (§120) : « Il n’y a pas de santé en soi, et toutes les tentatives pour la définir ainsi ont échoué lamentablement. Ce qui importe ici, c’est ton but, ton horizon, ce sont tes forces, tes impulsions, tes erreurs, et notamment les idéaux et les phantasmes de ton âme, pour déterminer ce qui, même pour ton corps, constitue un état de santé. Ainsi, il est d’innombrables santés du corps »[3].
Cette approche s’écarte des critiques traditionnelles de la biomédecine et de la médecine moderne, en mettant en lumière la dimension métaphysique de la maladie. Pour Nietzsche, la maladie n’est pas un simple écart à corriger, mais une expression nécessaire de la vie, un terrain d’expérimentation et de dépassement. Comme il l’écrit dans Le Gai Savoir (§4) : « Que je n’oublie pas, pour finir, de dire l’essentiel : on revient régénéré de pareils abîmes, de pareilles maladies graves. » Cette perspective est proche de celle des présocratiques, pour qui la santé est une force en perpétuel devenir, une capacité à surmonter la souffrance et à se réinventer.
Si Nietzsche met en avant le philosophe-médecin, il ne néglige pas la figure complémentaire du médecin-philosophe, qui interroge les normes médicales et les cadres épistémologiques de la santé. L’ouvrage de Jonathan Daudey croise cette analyse avec la philosophie du soin développée par Georges Canguilhem et prolongée par Céline Lefève (2014), qui insistent sur la médecine non seulement comme une science du vivant, mais aussi comme un art du soin[4]. Cette perspective éclaire d’un jour nouveau la vision nietzschéenne de la santé, en montrant que celle-ci ne peut être réduite à un état fonctionnel, mais doit être pensée comme une dynamique évolutive, influencée par le contexte et l’individualité du patient.
Vers de nouvelles définitions de santé ?
L’auteur, en s’appuyant sur Nietzsche, propose de redessiner les contours de la santé. Pour Nietzsche, la santé est une capacité à répondre aux exigences de son propre paysage motivationnel, ce qui rompt avec les modèles médicaux traditionnels qui conçoivent la santé comme l’absence de maladie. Dans cette optique, la maladie elle-même devient un levier de transformation et de dépassement, une condition pour la création de nouvelles formes de vie et de sens. Ainsi, plutôt que de chercher à éradiquer la souffrance, Nietzsche propose de l’intégrer et de l’utiliser comme moteur de croissance personnelle et spirituelle. L’Amor Fati, concept clé de Nietzsche, illustre cette idée : il ne s’agit pas seulement d’accepter son destin, mais de l’aimer et de l’embrasser pleinement, y compris dans ses aspects douloureux (« Amor Fati : que ce soit dorénavant mon amour ! […] Je veux même, en toutes circonstances, n’être plus qu’un homme qui dit oui ! »[5]). L’on retrouve alors, dans les discours contemporains sur la santé mentale, le développement personnel ou encore les politiques néolibérales de santé, les concepts de résilience et d’adaptation, érigés en impératifs individuels face à des environnements instables[6]. Malgré les critiques répétées de Daudey sur « la » définition de la santé, force est de constater qu’elles ont largement évolué depuis Nietzsche[7]. Il y a eu un premier déplacement, d’une conception purement objective de la santé à une approche plus subjective. Un second glissement s’est opéré du modèle négatif de la santé – défini comme « le silence des organes »[8] vers une définition positive, comme « un état complet de bien-être »[9]). Enfin, la santé tend aujourd’hui à être pensée de manière dynamique, comme « la capacité à s’adapter et à s’autogérer face aux défis sociaux, physiques et émotionnels »[10]. Ainsi, les définitions dominantes de la santé semblent avoir pris à bien des égards une direction nietzschéenne.
L’ouvrage de Daudey ouvre également une réflexion plus large en transposant cette approche au niveau culturel. Il reprend l’idée nietzschéenne que la culture moderne est elle-même pathogène, générant des formes de vie affaiblies et normatives. Qui d’autre que le philosophe-médecin peut se pencher sur une « pathologie culturelle ou civilisationnelle » (p.35) ? Nietzsche lui-même appelait à la venue d’un tel penseur dans Le Gai Savoir[11]:
« J’en suis encore à attendre la venue d’un philosophe médecin, au sens exceptionnel de ce terme – dont la tâche consistera à étudier le problème de la santé globale d’un peuple, d’une époque, d’une race, de l’humanité – qui un jour aura le courage de porter mon soupçon à l’extrême et d’oser avancer la thèse : en toute activité philosophique il ne s’agissait jusqu’alors absolument pas de trouver la “vérité”, mais de quelque chose de tout à fait autre, disons de santé, d’avenir, de croissance, de puissance, de vie… »
Ici aussi, l’on pourrait rétorquer que ce changement se déploie actuellement dans les institutions onusiennes, nationales et cliniques, comme en attestent l’émergence de concepts comme la santé globale, la santé communautaire, ou encore les concepts de « une seule santé » intégrant sous le même toit santé humaine, santé des animaux et santé du vivant de manière générale. La « santé environnementale » qui a émergé des conférences de l’OMS en 1994 va vers une inclusion et une réintégration de l’environnement, du vivant et de la vitalité dans les définitions de santé.
Un horizon prometteur… à traduire en actions concrètes
Le livre de Jonathan Daudey propose indiscutablement un espace de dialogue fécond entre philosophie et santé (que ce soit la santé de la culture ou la culture de la santé). En s’autorisant des allers-retours entre philosophie et médecine (et non juste l’analyse ou la soumission de l’un à l’autre), l’auteur permet au lecteur de prendre de la hauteur sur ces frontières, multiples et mouvantes, et invite à imaginer un ailleurs à la fois pour la philosophie ou la médecine. L’auteur insiste sur la manière dont la pensée nietzschéenne peut nourrir une critique contemporaine des politiques de santé publique et des modèles médicaux dominants. Les évolutions récentes témoignent d’une tension au cœur des conceptions contemporaines de la santé. Si certains déplacements (définition plus subjective, dynamique et individualisée de la santé) semblent s’inscrire dans une direction proche de celle esquissée par Nietzsche, des tendances dominantes demeurent largement tributaires d’un héritage platonicien : la quête d’un idéal de bien-être normé, la technicisation croissante des pratiques médicales, ou encore la surmédicalisation de comportements déviants. Le paysage actuel de la santé publique se déploie donc entre ces deux pôles (normatif et vitaliste) dont le rapport de force reste à interroger. Jonathan Daudey montre que la santé, dans la perspective nietzschéenne, ne saurait se réduire à un état d’équilibre imposé de l’extérieur, mais doit être comprise comme un processus créatif et dynamique. Ce faisant, il interroge la place de la médecine préventive et du bien-être holistique dans un monde où la normalisation de la santé tend à réduire la singularité des individus. Il apparaît clairement que toute tentative de consolider ou de réajuster l’échafaudage philosophique actuel, largement hérité du platonisme, demeure insuffisante, comme en attestent les images du marteau du médecin (là pour casser) et du bâton de dynamite, qui ne laissent aucun doute quant aux intentions de l’auteur.
Pour autant, l’on peut s’interroger si l’approche de Jonathan Daudey débouchant sur un programme large et généreux, sans s’encombrer des aspérités du réel, n’est pas elle-même… platonicienne. Sans aller jusqu’à construire une « feuille de route » que les philosophes ou médecins actuels pourraient utiliser, il aurait sans doute été possible d’imaginer que l’auteur s’appuie sur deux ou trois exemples saillants montrant comment concrètement ce plan peut être mis en œuvre. De quoi la surmédicalisation est-elle le symptôme ? Si les institutions de santé actuelles, chargées de réparer les corps ou les esprits, normatives et guidées par des réponses technologiques, sont “platoniciennes”, à quoi ressembleraient des institutions nietzschéennes ? Comment le culte de la performance peut-il être vu comme le signe d’un problème culturel ? De tels exemples concrets de pratiques médicales auraient permis de préciser comment le paradigme normatif dominant peut être dépassé. Certaines approches alternatives, comme les médecines intégratives ou les modèles de soin centrés sur le patient, pourraient être mises en dialogue avec cette perspective nietzschéenne.
L’auteur propose une remise en question radicale du système de santé actuel, ce qui peut amener des améliorations mais ce qui soulève également des questions sur les alternatives proposées et les risques d’une rupture avec les institutions existantes. Penser le changement demande également de panser les changements induits. Pour l’heure, si selon Daudey, « les médecins se pavanent mais ne guérissent pas » (p.196), ils restent celles et ceux vers qui les populations se tournent en cas de maladie. Enfin, la souffrance et l’adversité ne sont pas également réparties dans la société, et tout le monde n’a pas les mêmes ressources pour en faire un levier de transformation. Dès lors, si l’idée de résilience et d’affirmation de soi est porteuse d’une dynamique puissante, elle ne saurait se substituer à une réflexion sur l’accessibilité des soins et les conditions structurelles de la santé. Si une réflexion exigeante sur la santé et les systèmes de santé est salutaire, jeter le bébé avec l’eau du bain n’est peut-être pas la solution à privilégier.
Références
[1] WHITEHEAD, Alfred North. Process and Reality: An Essay in Cosmology. Édition corrigée par David Ray Griffin et Donald W. Sherburne. New York : Free Press, 1978, p. 39.
[2] DAUDEY, Jonathan. La pharmacie de Nietzsche : De la philosophie comme médecine. Paris : L’Harmattan, 2023, p. 14, citant DELEUZE, Gilles. Nietzsche et la philosophie. Paris : Presses universitaires de France, 1962. Voir Kritische Studienausgabe (KSA), vol. 3, p. 347. [Note : Le philosophe nietzschéen adopte plusieurs rôles : médecin, artiste et législateur.]
[3] NIETZSCHE, Friedrich. Le Gai Savoir, § 120. Cité par DAUDEY, Jonathan. La pharmacie de Nietzsche : De la philosophie comme médecine. Paris : L’Harmattan, 2023, p. 42.
[4] CANGUILHEM, Georges. Le Normal et le Pathologique. Paris : Presses universitaires de France, 1966. Voir aussi LEFÈVE, Céline. « De la philosophie de la médecine de Georges Canguilhem à la philosophie du soin médical ». Revue de métaphysique et de morale, vol. 82, n° 2, 2014, p. 197-221.
[5] NIETZSCHE, Friedrich. Le Gai Savoir. Paris : GF-Flammarion, 2007, § 276, p. 225-226.
[6] ILLOUZ, Eva et CABANAS, Edgar. Happycratie : Comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. Paris : Premier Parallèle, 2018
[7] BRULÉ, Gaël, Le coût environnemental du bonheur, Lausanne : Épistémé, 2024.
[8] LERICHE, René. « De la santé à la maladie, la douleur dans les maladies, où va la médecine ». Encyclopédie française, vol. 6, 1936, p. 16-1.
[9] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Constitution of the World Health Organization. New York : World Health Organization, 1946. Adoptée par la Conférence internationale de la Santé, New York, 19-22 juin 1946, entrée en vigueur le 7 avril 1948. La définition citée provient du préambule : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »
[10] HUBER, Machteld, Jan André KNOTTNERUS, Lawrence GREEN, Henriëtte VAN DER HORST, Alejandro R. JADAD, Daan KROMHOUT, Brian LEONARD, Kate LORIG, Maria Isabel LOUREIRO, Jos W.M. VAN DER MEER, Paul SCHNABEL, Rod SMITH, Chris VAN WEEL et Henk SMID. « How Should We Define Health? ». BMJ, vol. 343, 2011, d4163.
[11] NIETZSCHE, Friedrich. « Préface de la deuxième édition ». In Le Gai Savoir. Paris : GF-Flammarion, 2007, p. 24. Cité par DAUDEY, Jonathan. La pharmacie de Nietzsche : De la philosophie comme médecine. Paris : L’Harmattan, 2023, p. 13-14.