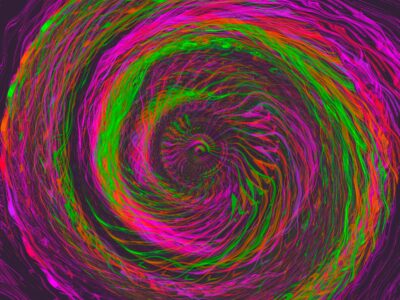Recension – Philosophie du souvenir. Le temps et son double
Arnaud Miranda est ATER et doctorant en théorie politique à Sciences Po (CEVIPOF, EDD). Sa thèse, dirigée par Julie Saada et Jean-Yves Pranchère, est consacrée aux pensées contemporaines de la décadence. Ses recherches portent aussi sur l’intérêt de l’histoire conceptuelle et de l’herméneutique pour la science politique. Sur un sujet proche de cette recension, voir : Arnaud Miranda, « Qu’est-ce que la décadence ? Réflexions épistémologiques sur une figure du temps », Alkemie, vol. 27, Paris, Classiques Garnier, 2021.
Avishag Zafrani, Philosophie du souvenir. Le temps et son double, Paris, Presses Universitaires de France, 2023, 244p.
L’ouvrage est disponible ici.
Après un premier ouvrage académique consacré à Ernst Bloch et HansJonas[1], issu de sa thèse de doctorat, Avishag Zafrani propose avec Philosophie du souvenir un véritable essai philosophique. À travers une écriture riche de références éclectiques, l’auteur nous invite à la suivre dans une méditation toute personnelle sur la temporalité. Comment notre manière de figurer le temps détermine-t-elle notre rapport au monde et à l’action ? L’ouvrage est construit autour de quatre chapitres, qui forment ensemble une sorte de typologie comparative des modes d’expérience du temps. Loin de prétendre à une élucidation ontologique de la nature du temps, A. Zafrani propose plutôt d’étudier la pluralité de ses figurations. Chaque paradigme se dévoile selon un imaginaire qui lui est propre, une certaine « perception métaphorique » (p. 22) qui implique une mise en récit singulière du passé. Or c’est précisément sur ce rapport à l’antériorité que s’élabore la thèse de l’auteur : au temps de la décadence s’oppose un temps du souvenir et de la vision qui, contrairement à la paralysie nostalgique et étouffante du premier, laisse une place salutaire à l’action.
La première figure[2] étudiée est celle du « temps gnostique ou décadent » (p. 23). Si A. Zafrani, en lectrice de Jonas[3], trouve dans la gnose antique le paradigme d’une dépréciation systématique de l’existence, elle se penche d’abord sur l’idée générale de décadence. Celle-ci « figure un trait psychologique rémanent de notre attitude vis-à-vis du temps et du monde » (p. 25). En cela très proche de Jankélévitch[4], l’auteur la décrit comme l’identification du temps de l’âme et du temps du monde « à partir de l’horizon triste de la mort » (p. 24). Néanmoins, la décadence « ne s’accommode pas indéfiniment des eaux obscures » mais « aspire au contraste » (p. 24). Ce qu’A. Zafrani déplore, ce n’est donc pas la décadence en tant que telle, mais sa systématisation philosophique par le gnosticisme : « il faut distinguer la conscience de la mort […] d’une mort dominant la matière de l’homme et de l’univers » (p. 27). Le gnosticisme, c’est la décadence érigée en prisme d’interprétation de la réalité. Pour le gnostique, le monde est une « prison cosmique » (p. 26) et le temps « une chute perpétuelle » (p. 29). Au sein de ce monde déchu, « l’existence dans sa totalité est coupable […] de sorte que la chute n’est pas un événement mais structure toute une ontologie » (p. 34). Comment penser la condition humaine dans ce monde déchu ? A. Zafrani décrit la condition du gnostique comme un exil perpétuel, idée qui rappelle les remarques lumineuses de J.-L. Vieillard-Baron au sujet de la décadence[5]. Le gnostique est un exilé dans la mesure où il considère comme perdu tout accès à l’éternité. S’offrent alors à lui deux options : l’ascèse ou la transgression, la « sainteté érémitique » ou l’ « hédonisme décadent » (p. 43). Notons que l’auteur restreint l’usage spécifique du terme « gnosticisme » au mouvement de l’Antiquité tardive. Elle en retrouve cependant des « traces » bien plus tard dans l’histoire de la philosophie, comme chez Pascal ou Marx où se rejouent selon elle certains « motifs gnostiques » (p. 45). Ces traces ne sont que des épiphénomènes. Plus inquiétante semble aux yeux de l’auteur « la résurgence de la pensée gnostique au XXe siècle », qu’elle associe à un « courant “antimoderne” » constitué en « réaction au progrès de la raison » (p. 53). Cette perspective réactionnaire serait susceptible de réactiver une métaphysique deshumanisante au profit d’un discours qui pourrait « tout à fait séduire et nourrir des ressentiments politiques » (p. 61). Le danger de cette réaction politique ne réside pas dans la crainte d’une décadence future, mais précisément dans l’idée que « la ruine a déjà eu lieu » (p. 66). Il s’agit moins d’une peur de l’avenir que d’une « détestation de ce monde » (p. 66), rendant par définition impossible la reconnaissance d’un monde commun. Le véritable danger de la pensée décadente est de vouloir « conformer le monde à sa ruine », c’est-à-dire « soit de le détruire soit d’entretenir le désir de le voir s’effondrer » (p. 68). Contre cette approche étouffante du passé, « il faut ainsi trouver des brèches et des respirations » (p. 70), espaces que le reste de l’essai tâche d’explorer. 
L’auteur s’intéresse ensuite au temps grec, qu’elle associe au temps de la réminiscence. Le passage du temps gnostique au temps grec peut se lire au regard de leur rapport à la décadence. En effet, si le temps grec « connaît le sentiment de décadence », il ne peut en souffrir car il repose sur « une ontologie ordonnée et harmonieuse » (p. 75). Dans cette perspective, le temps est un reflet de l’éternité, ce qui n’implique aucune « dégradation ontologique pour l’homme » (p. 81)[6]. Contrairement au désespoir du gnostique, le grec trouve une orientation éthique dans la contemplation. Cette méditation théorique permet d’accéder à l’éternité par le biais de la réminiscence. L’auteur définit la réminiscence comme une forme d’éros, « un effort dirigé vers reliaison, l’attachement, l’unité » (p. 87). En ce sens, la réminiscence entretient un lien avec la décadence, puisque l’unité a été rompue. Néanmoins, le rapport à l’unité n’est pas un rapport romantique ou nostalgique, c’est avant tout un rapport théorique : « Platon n’habite pas le monde en poète, mais en concept » (p. 89). Selon A. Zafrani, ce rapport réminiscent au passé a des implications politiques. Par exemple, l’idéalisme de la République est une manière pour Platon de rompre avec l’anacyclose[7], « de suspendre les effets délétères du temps » pour concevoir « l’utopie première de la philosophie politique » (p. 99). L’auteur identifie aussi ce temps de la réminiscence chez Aristote, mais c’est surtout avec la lecture de Plotin qu’elle en trouve le paradigme. Chez Plotin, la contemplation « renverse l’image de [la] chute », c’est par elle que « la pensée rejoint l’unité antérieure » (p. 116). La réminiscence est poussée bien plus loin qu’un simple effort éthique, elle est « l’aboutissement d’un désir prédestiné de l’être qui attend de retrouver son identité originelle » (p. 116). La lecture de Plotin permet bien de comprendre en quoi le temps grec se distingue du temps gnostique. La réminiscence n’est pas simplement une réaction humaine face à la décadence, mais se confond avec le mouvement de l’être lui-même. En ce sens, le temps grec, parce qu’il repose sur « l’admiration du cosmos éternel », « conjure [le] pouvoir du temps » (p. 118). Il annihile la nostalgie par la réminiscence. Penser en grec, c’est trouver dans le monde sensible les traces de l’éternité.
Le temps grec pourrait suffire à contrer le temps gnostique de la décadence. Cependant, depuis la naissance des religions monothéistes, en raison de leur construction narrative, nous ne pouvons nous passer de l’histoire. Or le temps de la réminiscence, dans sa quête de l’éternité, n’est pas un temps historique. Pour penser un temps historique qui ne soit pas décadent, A. Zafrani distingue un troisième rapport au temps qu’elle nomme le temps juif du souvenir. Contrairement au temps grec, le temps juif est « empreint d’une ligne temporelle issu d’un monde créé, les traces deviennent des signes d’une antériorité temporelle » (p. 122). Néanmoins, ces traces ne mènent pas vers une origine fantasmée, elle « disent un excédent du passé, ce qui diffère sensiblement du passé-refuge » (p. 122). Dans la pensée juive, « le temps apparait comme une spirale qui grossit et mûrit des possibilités non explorées […] léguées à une postérité chargée de poursuivre un mouvement dont la force ne s’est pas épuisée » (p. 122). La temporalité dans la pensée juive est une épreuve de ce qu’il y a de passé et d’à venir dans le présent. C’est un temps de « l’aura » au sens de Benjamin[8], c’est-à-dire une « contraction du temps, qui va du proche au lointain » (p. 125). En ce sens, il est bien un temps du souvenir, mais celui d’« un souvenir sans douleur » (p. 125). Pourquoi ce souvenir n’est-il pas une nostalgie ? À travers une lecture de Lévi-Strauss[9], la figure de l’exode émerge pour faire sens de ce rapport « sans algie » au passé. L’exode figure l’intuition que « la connaissance du lointain, le dépaysement radical, finit par renvoyer à un soi qui se dévoile et se rappelle à des attaches persistantes » (p. 131). Le retour à soi n’est donc pas un retour aux origines, c’est une reconfiguration narrative par le souvenir. Aucune nostalgie, mais bien « la quête d’un autre temps qui est un temps retrouvé » (p. 132). Si le temps juif s’exprime par la narration, c’est une narration bien particulière. Il ne s’agit « pas simplement de ramasser des souvenirs, mais d’en donner la perspective et la mélancolie » (p. 142). Cette mélancolie implique une forme d’indétermination : il faut que « l’éclosion du sens se renouvelle et se maintienne » (p. 142). Le temps du souvenir est une mémoire rituelle, comme une herméneutique ininterrompue qui confèrerait au souvenir une actualité toujours renouvelée. Le temps juif est une « matière vivante, faite de thèmes inachevés » (p. 143). Cette image d’un « temps inassouvi » (p. 159) révèle l’espérance propre à la mélancolie du temps juif, par opposition à la nostalgie du temps gnostique. En ce sens, le temps juif est « une rétrospection qui contient un recommencement » (p. 179). Cette image de l’inachèvement révèle la signification politique profonde du temps juif : il nous rappelle la fragilité inhérente à toute communauté historique, la précarité de ses fondements, son incertitude, la menace constante de sa dissolution.
L’essai aurait pu se conclure sur cette description du temps juif du souvenir comme dépassement du temps nostalgique de la décadence, mais aussi – dans une moindre mesure – du temps grec de la réminiscence. Néanmoins, A. Zafrani ajoute une série de réflexions regroupées dans un chapitre consacré au « temps philosophique » (p. 181). L’auteur propose notamment une réflexion sur les conséquences éthiques d’une présence de l’antériorité par le souvenir. Comment ne pas « dévaloriser le passé » sans « mépriser le présent » (p. 192) ? Quelle place donner à la liberté tout en pensant la tradition ? Comment accepter une certaine critique de la rationalité abstraite sans souscrire à une approche antimoderne repliée dans un passé fantasmé ? L’auteur introduit ici la notion de rythme[10] pour faire sens de la temporalité à l’échelle existentielle. Le rythme de l’existence exprime une « distance entre moi et le monde », mais c’est une distance qui rend la « circulation possible » (p. 206). Notre conscience de la temporalité est certes le signe qu’une « ondulation primitive du monde » (p. 203) se joue en nous. Mais notre conscience n’est pas un simple reflet du monde, notre temporalité agit aussi comme une recomposition de l’antériorité par le souvenir. Ainsi, le rythme exprime cette « dialectique […] entre le monde et la conscience du monde » (p. 205). Le rythme implique une forme de distance, au creux de laquelle réside un « espace de liberté », une « respiration » (p. 206). Retournant à Jonas, A. Zafrani considère que cette « question de la liberté ouvre un enjeu éthique particulier » (p. 216). Cet enjeu est celui d’une responsabilité de l’art. La « vision », qui consiste en une refiguration esthétique du temps, engendre à la manière du rythme un espace de liberté. Elle crée elle-même « un mouvement double de l’être-au-monde, d’approche et de distanciation salvatrice » (p. 217). Le sentiment du sublime agit ainsi à la manière du souvenir. Il donne l’impression d’un « premier regard sur les choses, en quelque sorte perdu et occulté, que nous souhaiterions retrouver » (p. 220). Mais cette mélancolie du sublime n’a rien de réactionnaire, au contraire, elle nous incite à un « renouvellement des formes de l’existence » et, par-là, à nous libérer « des formes dans lesquelles notre pensée se fige, s’isole et s’aliène » (p. 220). Pourquoi passer par l’esthétique pour figurer le temps philosophique ? Le propre de la temporalité est d’excéder toujours son appréhension par le concept. Un détour par l’esthétique permet de comprendre que « l’image du temps […] n’est pas un reflet du temps, mais contient du temps » (p. 221). L’image du temps, que l’auteur saisit notamment à partir de l’œuvre du cinéaste Tarkovski, « permet de retrouver le temps perdu » (p. 223). Il y a ainsi un enjeu éthique dans la figuration esthétique du temps : la vision et le rythme ouvrent un espace de liberté dans lequel s’ouvre une réinvention de nos formes d’existence. L’art nous figure une « extra-temporalité », une « sortie du temps », un « hors de l’histoire » qui n’est jamais une volonté de fuite » (p. 226). Il nous confère une vision dans l’écrin de laquelle se noue une possibilité d’agir.
L’essai d’A. Zafrani ouvre la voie à des recherches passionnantes sur l’esthétique de la temporalité. Si les trois premiers chapitres tiennent toutes leurs promesses, en offrant une conceptualisation claire des différentes modalités de notre rapport au passé, le dernier est peut-être un peu court pour exploiter la diversité des enjeux qui y sont présentés. Peut-être faut-il lire ce dernier chapitre comme une manière de transition : partant d’une esthétique comparée du temps, l’auteur pose les jalons d’une phénoménologie du rythme et de la vision que la forme de cet ouvrage ne permettait certainement pas d’approfondir.
Nous suivrons avec enthousiasme le développement de ces réflexions qui viendront sans doute enrichir et décloisonner les études sur le rythme. En ce sens, l’ouvrage nous semble faire signe vers un dialogue avec les philosophes bachelardiens comme Jean-Jacques Wunenburger et Pierre Sauvanet[11], avec la rythmologie de Pascal Michon[12], mais aussi avec certains chercheurs d’inspiration deleuzienne[13]. En particulier, signalons les travaux récents de Manola Antonioni qui, dans un ouvrage collectif, propose d’explorer l’hypothèse d’une choréopolitique[14].
[1] Avishag Zafrani, Le défi du nihilisme. Ernst Block et Hans Jonas, Paris, Hermann, 2014.
[2] Si les figures étudiées sont associées à des théories historiquement situées, elles ont vocation à être comparées de manière synchronique.
[3] Hans Jonas, La Religion gnostique, Paris, Flammarion, 1978 ; Hans Jonas, La gnose et l’esprit de l’Antiquité tardive, Milan, Mimesis, 2017.
[4] Vladimir Jankélévitch, « La décadence », Revue de métaphysique et de morale, n°4, 1950, pp. 337-369.
[5] Jean-Louis Vieillard-Baron, Le problème du temps. Sept études, Paris, Vrin 1995, p. 162. Ces réflexions sur la décadence proviennent d’une présentation intitulée « Décadence historique et déchéance ontologique », prononcée lors du colloque La décadence. Mythe, réalité ou idéologie ? à l’Université des sciences sociales de Grenoble les 28 et 29 avril 1983.
[6] On peut songer ici aux analyses de Rémi Brague dans La sagesse du monde (Le Livre de Poche, 2002), qui oppose le cosmos harmonieux du Timée au monde chaotique des Gnostiques.
[7] L’anacyclose est une théorie de la succession des régimes politiques. Platon la développe au livre VIII de la République.
[8] Walter Benjamin, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique [1939], Paris, Payot, 2013.
[9] Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Paris, Plon, 1955.
[10] A. Zafrani semble s’intéresser à la notion par l’intermédiaire de sa lecture de Bergson et Bachelard. À ce titre, voir Bachelard, La dialectique de la durée [1936], Paris, PUF, 2022 ; en particulier le chapitre VIII (« La rythmanalyse »). L’excellente introduction critique proposée par Elie During dans la réédition de 2022 souligne comment la pensée bachelardienne du rythme se construit avec et contre Bergson.
[11] Ils avaient notamment créé le GRYPH (Groupe « Rythmes et Philosophie ») en 1995 au sein du Centre Bachelard à l’U. de Bourgogne. Citons l’ouvrage collectif issu de cette collaboration Rythmes et philosophie (dir. J.-J. Wunenburger et P. Sauvanet), Paris, Kimé, 1996. Si le groupe n’existe plus, des publications récentes montrent l’héritage de ce renouveau des études philosophiques du rythme : Rythmanalyse(s) : Théories et pratiques du rythme. dir. J-J. Wunenburger et J. Lamy), Lyon, Jacques André, 2018.
[12] Au-delà de ses propres travaux, Pascal Michon a développé la plateforme Rhutmos qui recense l’actualité des travaux sur le rythme (voir rhutmos.eu)
[13] Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980. Voir le chapitre sur la ritournelle.
[14] Manifeste pour une politique des rythmes (dir M. Antonioli, G. Drevon, Luc Gwiazdzinski, V. Kaufmann et L. Pattaroni), Lausanne, EPFL, 2018.