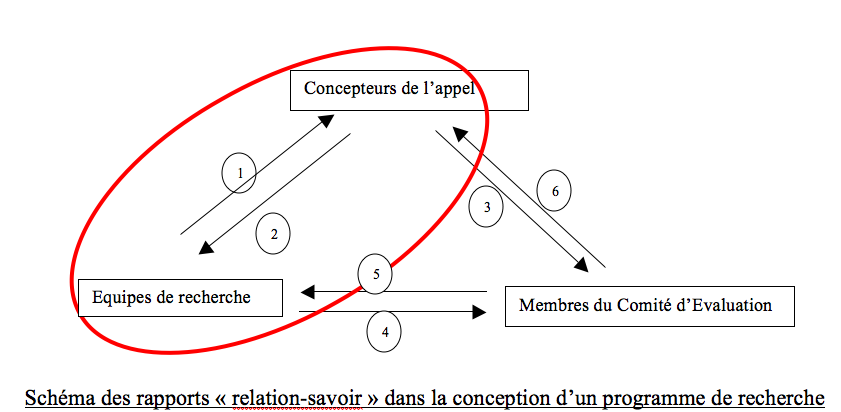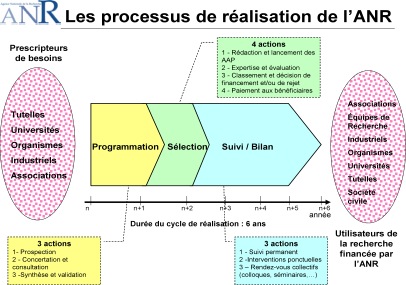Un nouveau régime de production des savoirs (II)
Adeline Barbin (Phico/nosophi, Université paris 1)
3. Complexifier l’analyse
Malgré ces difficultés et obstacles liées aux objectifs mêmes des STS, il existe depuis plusieurs années maintenant une réelle volonté d’un certain nombre de chercheurs de ce courant de s’emparer de la question des effets de la libéralisation économique sur la recherche scientifique. Je souhaite revenir ici et dans la partie suivante sur quelques acquis de ces travaux propices à éclairer les changements auxquels sont confrontées les universités et les chercheurs.
Le poids des structures et de certains acteurs
La théorie de l’acteur-réseau n’apparaît que comme l’exemple paradigmatique de l’ontologie sociale des STS qui les conduit à mener leurs analyses dans le cadre de notions universelles (traduction, hybridation, translation, enrôlement, etc.) et au détriment à la fois des spécificités socio-historiques de chaque cas et des structures collectives existantes (relations sociales, formes de pouvoir, secteurs, etc.). Il y a dans cette métaphysique du social beaucoup d’insistance ou d’optimisme concernant la redéfinition permanente des réseaux. Il existe pourtant des limites à la recomposition : la société se compose également de structures « lourdes », pérennes, aux logiques propres et difficiles à modifier. Face au réagencement, il existe les systèmes, au sens habermassien du terme, c’est-à-dire des domaines d’activités qui ne sont pas régis par des logiques dialogiques.
En somme, il manque à ces ontologies du social le temps long de l’histoire, l’« épaisseur » qui est celle des acteurs humains et qui fait qu’ils n’ont pas tous le même poids. La théorie de l’acteur-réseau et les approches interactionnistes rappellent à juste titre que les actes de connaissance et les objets techniques sont contingents, qu’ils sont soumis à une part d’indétermination et offrent donc une prise aux capacités d’action, notamment sociales. Mais de la contingence des actes cognitifs, on ne peut pas en venir à faire comme si les réalisations scientifiques et techniques étaient nimbées d’une sorte d’aura de possibles illimitée, absolue. A la notion de contingent, sans doute vaut-il mieux alors substituer la notion d’arbitraire, de manière à faire entrer dans la réflexion la question du pouvoir. Pour cela, il est nécessaire de réintroduire dans ces études une approche plus complexe du politique et du social. Le paradoxe est que cette insuffisance des STS est sans doute l’héritage du rejet de la division mertonnienne entre les influences externes et internes à la science dans le but de l’étudier dans et avec son contexte[1]. Si ce rejet fut fondateur pour le domaine des STS, il semble également être la cause de la difficulté à ne pas considérer les évolutions économiques en cours depuis les années 1970 comme un simple facteur parmi d’autres.
Le temps long de l’histoire
Le premier acquis que permet le fait de toujours penser la recherche dans son contexte est de ne jamais oublier le temps long de l’histoire. C’est ce qui permet de ne pas voir partout des bouleversements radicaux ou, au contraire, de ne pas nier systématiquement que quoi que ce soit ait changé, pour s’attarder sur ce qui distingue réellement les différents régimes de production des savoirs. Rappelons donc que les pouvoirs politiques et économiques ont mobilisé la recherche pour leurs objectifs depuis au moins le XVIe siècle. Les mathématiques accompagnèrent les changements sociaux et économiques de la Renaissance en développant la science de la navigation, la cartographie ou encore l’organisation des fortifications ; au XVIIIe siècle, la science fut mobilisée pour améliorer l’utilisation des ressources naturelles et favoriser la richesse des nations[2]. Soulignons également que la méfiance vis-à-vis des résultats scientifiques et de leurs conséquences n’est pas propre à notre époque : l’histoire des mobilisations de populations ne permet pas de conclure qu’il a existé un public passif parce que confiant dans les autorités scientifiques auquel se substitueraient aujourd’hui des individus alertés par les dangers des innovations techno-scientifiques.
De même, il n’y a pas lieu de soutenir que l’Etat, après s’être impliqué dans l’organisation de la recherche à l’époque de la Seconde guerre mondiale, s’est aujourd’hui retiré de ce domaine, le laissant aux mains du privé. D’une part, le processus de nationalisation de la science a commencé il y a 150 ans lorsque « la science est devenue tellement centrale pour la sécurité nationale, le développement économique et l’identité, qu’elle est devenue une partie des attributions normales de n’importe quel Etat[3] ». Il est vrai que cette nationalisation a atteint son paroxysme à l’époque de la guerre froide. Mais, et d’autre part, il serait inexact de considérer qu’elle n’a fait que reculer depuis. Que les financements publics soient en recul par rapport aux financements privés (mais pas nécessairement en valeur absolue[4]) ne signifie pas que l’Etat ne soit plus un acteur majeur du champ de la recherche sous de multiples formes. La recherche scientifique étant toujours un élément déterminant dans la puissance des nations, l’Etat, notamment dans les pays les plus puissants, continue de constituer un interlocuteur central pour les entreprises de son territoire et avec les autres nations et leurs propres entreprises. Si son rôle évolue progressivement, il reste néanmoins celui d’un acteur de poids.
4. Les caractéristiques de l’actuel régime de production des connaissances
La valeur de la science
Est-ce à dire que rien n’a réellement changé ces dernières décennies ? Là encore, rappelons ce que nous avons évoqué plus haut : que la science ait toujours été liée aux pouvoirs politiques et économiques ne signifie pas que la nature et l’organisation de ces pouvoirs n’ait pas de conséquences pour elle. Dominique Pestre propose une périodisation en trois temps afin de situer chacun des régimes de production des connaissances que nous avons connus depuis le 16e siècle. La première période s’étend du XVIe au XIXe siècle où la science s’organise autour de sociétés savantes, qui se veulent autonomes et conçoivent la connaissance comme un bien en soi sans que pourtant tout en étant pourtant liées aux pouvoirs temporels et engagées dans le processus le développement des techniques. La seconde période (1870-1970) voit l’Etat devenir un acteur structurant du domaine de la recherche. Cela va de pair avec son développement comme puissance militaire et comme Etat social. Les entreprises privées sont loin d’être absentes de ce second tableau, mais ce n’est pas contradictoire car tous ont, à ce moment, des intérêts communs.
La troisième période commence avec la transformation entreprise par le capitalisme dans les années 1970 à la suite des vagues de contestation des années 1965-1975 et a eu pour résultat de substituer un nouveau système de régulation politique et social à celui de l’Etat-providence. Le rôle de l’Etat s’est trouvé de plus en plus contesté en même temps que les financements privés dépassaient pour la première fois de puis longtemps les financements publics, et l’organisation de la recherche s’est modifiée de manière à la relier directement à l’innovation industrielle. Afin que la science puisse devenir un bien commercial et financier, deux mouvements se mirent alors en place : le premier concerna le changement du régime de la propriété intellectuelle. D’une façon qui peut sembler paradoxale, ce régime était moins contraignant à l’époque de la guerre froide. Il ne fallait certes pas échanger les informations avec l’autre côté du mur, mais à l’Ouest, et notamment aux USA, la diffusion des connaissances afin de favoriser le développement des technologies était considéré comme essentiel. La volonté de rendre la science monnayable mit un terme à cette situation. Le deuxième mouvement, moins souvent mentionné, fut celui de l’apparition d’acteurs supranationaux et notamment de l’OMC, qui jouèrent et jouent toujours un rôle considérable dans l’unification des règles de brevetages et de commercialisation de la science.
Il est intéressant de constater que Philip Mirowski, s’intéressant à la périodisation qu’il est possible de distinguer aux USA concernant les régimes d’organisation de la science, parvient sensiblement aux mêmes conclusions que Dominique Pestre sur la dernière période. Il la fait commencer à peine plus tard (1980) mais met l’accent sur les mêmes phénomènes : modifications du rôle de la propriété intellectuelle ce qui limite la diffusion du savoir et entraîne un rétrécissement de la sphère publique du savoir, et rôle de l’OMC dans le processus de commercialisation de la science. Il y ajoute le questionnement sur la raison d’être des universités et les incertitudes sur le statut des enseignants-chercheurs alors que la séparation entre les activités d’enseignement et de recherche conduit à un nombre croissant d’enseignants non-titulaires.
Une réorganisation nécessaire dans une société de la connaissance ?
Ces évolutions vers une diminution de la sphère du savoir public ne sont-elles pas inéluctables et, surtout, nécessaires dans une société dite de la connaissance, dont la croissance même donc reposerait sur la commercialisation de ce bien ? Rien n’est moins sûr. Prendre au sérieux le fait que science, politique et économie ont toujours été mêlées, c’est en effet s’interroger sur cette expression, devenue banale, de « société de la connaissance ». Sommes-nous plus une société de la connaissance aujourd’hui qu’auparavant ? Les siècles précédents n’ont-ils pas également été marqués dans leur développement par des innovations scientifiques et techniques ? C’est ce que soupçonne Dominique Pestre lorsqu’il souligne que ce qui importe n’est pas le savoir lui-même mais la manière dont il est mobilisé :
Ces savoirs très en amont nous apparaissent comme directement “productifs” non seulement car ils ont une efficacité directe (cela existait déjà avec les lasers et la physique atomique dans les années 1950) mais surtout car les régulations qui entourent leur mise en œuvre ont changé. Parce que l’on a modifié les règles de propriété intellectuelle et ouvert une capacité d’action nouvelle à certains types de capitaux [comme le NASDAQ], on a fait que le savoir plus abstrait devienne un facteur financièrement visible et direct de production[5].
C’est pourquoi il est possible à la fois de souligner que ce que Gibbons et Nowotny nomment mode 1 de la science autonome et mode 2 de l’hybridation entre science publique et science privée ont toujours cohabité, même s’ils n’étaient pas exactement identiques à ce qu’ils sont aujourd’hui et, d’autre part, que le mode 2 veut aujourd’hui imposer ses objectifs au mode 1. A quoi il faut cependant ajouter que le mouvement de commercialisation des sciences n’est pas homogène partout dans le monde et dans toutes les disciplines et qu’il n’est pas nécessairement absolument hégémonique. Il est globalement vrai par exemple, et c’est plutôt une bonne chose, que la notion de coproduction trouve un sens différent dans notre époque, avec la place qu’occupent la société civile et les ONG. Il peut aussi être noté que des « contre-tendances » existent : depuis la fin des années 1990 réapparaît la conscience de la nécessité d’investir aussi à long terme et de ne pas lier aussi fortement recherche publique et recherche privée. Dans le même esprit, on peut citer le cas de la détection génétique du cancer du sein étudié par Maurice Cassier et Jean-Paul Gaudillière[6] : le monopole du test du dépistage du cancer du sein par Myriad Genetics a été largement contesté – et contourné – tant aux Etats-Unis qu’en France. Ce que nous montrent ces éléments, et particulièrement ce dernier exemple, au-delà de l’existence d’alternatives, c’est que nous avons affaire à des choix politiques. Ce ne sont qu’eux qui peuvent permettre de trancher la tension entre la logique de commercialisation de la science et la logique d’un savoir public et d’innovations socio-techniques soumises à l’ordre collectif de la décision.
CONCLUSION
Par sa capacité à replacer les changements dans le temps long de l’histoire et à préciser les effets des modifications de contexte sur le type même de connaissances produites, le champ des Science, Technique et Société peut constituer un outil fort utile pour penser les évolutions que subissent actuellement les universités et le domaine de la recherche scientifique en général. Un tel apport suppose cependant que soit complexifié l’ontologie sociale que sous-tend la plupart des études et que soit formulée une théorie politique qui permette d’articuler les analyses micro-sociales et macro-sociales afin de ne pas perdre cette aptitude à prendre en compte les actions des individus et le phénomène de contingence tout en devenant capable de l’articuler aux pesanteurs de structures et aux inégalités de pouvoir. J’ai ici largement mobilisé les travaux de Philip Mirowski et Dominique Pestre qui s’emploient à cette tâche. D’autres existent également, qu’il serait trop long de citer.
Leurs résultats sont et seront d’autant plus importants que la défiance du public envers les sciences et les innovations techno-scientifiques relève moins, comme on se plaît souvent à le dire, d’un illettrisme scientifique et d’un obscurantisme coupable, que d’une suspicion fondée sur l’expérience envers ceux qui les développent et qui se retranchent derrière le secret industriel, les brevets et la nécessité d’un retour sur investissement[7]. La réorganisation de la recherche étend donc ses effets bien au-delà de la communauté des chercheurs.
[learn_more caption= »bibliographie » state= »open »]
Bloor David. Sociologie de la logique : les limites de l’épistémologie, traduit par Dominique Ebnöther, Pandore, Paris, 1976.
Collins Harry M., « An Empirical Relativist Programme in the Sociology of Scientific Knowledge », pp.85-113, in Knorr-Cetina Karin (dir.), Mulkay Michael Joseph (dir.), Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science, Sage Publications, London ; Berverly Hills, 1983.
Etzkowitz Henry, « Innovation in Innovation: The Triple Helix of University-Industry-Government Relations », Social Science Information, janvier 2003, vol. 42, no 3, p. 293-337.
Gaudillière Jean-Paul, Cassier Maurice, « Recherche, médecine et marché : la génétique du
cancer du sein », Sciences sociales et santé, 2000, vol. 18, no 4, p. 29-51.
Latour Bruno, Nous n’avons jamais été modernes : essai d’anthropologie symétrique, La Découverte, Paris, 1997.
Marris Claire, « La perception des OGM par le public: remise en cause de quelques idées reçues », Économie rurale. 2001, vol. 266, no 1, p. 58-79.
Martin Ben, Nightingale Paul, Yegros-Yegros Alfredo, Science and Technology Studies: Exploring the Knowledge Base, Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo, 2011, Working Papers on Innovation Studies 20111004.
Mirowski Philip et Sent Esther-Mirjam, « The Commercialization of Science and the Response of STS , in Society for Social Studies of Science, The handbook of science and technology studies, Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, 2008, p. 635-689.
Pestre Dominique, Introduction aux « science studies », La Découverte, Paris, 2006.
———, « Regimes of Knowledge Production in Society : Towards a more political and social reading », Minerva, 2003, no 41, p. 245-261.
———, Science, argent et politique : un essai d’interprétation, Paris, INRA, 2003.
Rebecca Lave, Mirowski Philip, Randalls Samuel, « Introduction: STS and Neoliberal Science », Social Studies of Science, septembre 2010, no 40, p. 659-675.
[1] C’est l’hypothèse proposée par Rebecca Lave, Mirowski Philip, Randalls Samuel, « Introduction: STS and Neoliberal Science », Social Studies of Science, septembre 2010, no 40, p. 659-675.
[2] Ces exemples sont extraits de Dominique Pestre, « Regimes of Knowledge Production in Society: Towards a more political and social reading », op. cit., p. 247-248.
[3] Ibid., p. 250.
[4] Voir le graphique 26.1 proposé par Mirowski Philip et Sent Esther-Mirjam, « The Commercialization of Science and the Response of STS », op. cit., p. 670.
[5] Pestre Dominique, Science, argent et politique : un essai d’interprétation, Paris, INRA, 2003, p. 107.
[6] Gaudillière Jean-Paul, Cassier Maurice, « Recherche, médecine et marché : la génétique du cancer du sein », Sciences sociales et santé, 2000, vol. 18, no 4, p. 29-51.
[7] Marris Claire, « La perception des OGM par le public: remise en cause de quelques idées reçues », Économie rurale, 2001, vol. 266, no 1, p. 58-79.