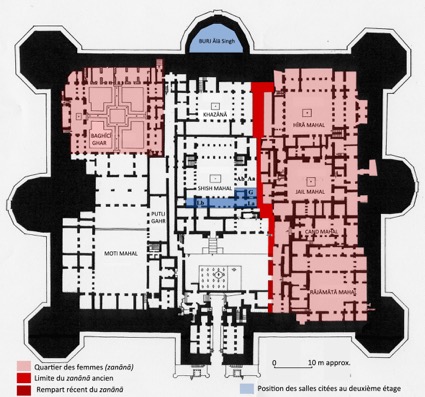L’art tribal indien
Raphaël Rousseleau est professeur à l’université de Lausanne et chercheur associé au Centre d’Etude de l’Inde & Asie du Sud (CNRS/EHESS) à Paris. Ethnologue spécialisé dans l’étude des populations dites tribales de l’Inde, il a travaillé notamment sur la contextualisation de l’art de ces minorités pour une bourse post-doctorale et dans des recherches collectives auxquelles il a participé (musée du quai Branly 2006-7, ANR Himalart et projet SOGIP) ainsi que dans le cadre d’une équipe de recherche du CEIAS qu’il a co-dirigé avec Catherine Servan-Schreiber sur les ‘industries culturelles indiennes’.
L’art « tribal indien (adivasi) /vernaculaire contemporain » à travers ses théoriciens : J. Jain, J. Swaminathan, A. Garimella.
L’art contemporain extra-européen est aujourd’hui reconnu comme une catégorie à part entière. Pourtant, comme l’a souligné J.-L. Amselle (2005) au sujet de « l’art africain contemporain », cette notion cache un nœud conceptuel qui n’est ni aussi simple, ni aussi politiquement correcte qu’on le présente généralement. À plus forte raison, la même question peut être posée, au sujet d’un art contemporain, qui n’est pas seulement indien, mais aussi tribal ou « indigène » (âdivâsî). L’Inde possède, en effet, une frange de sa population rurale que la Constitution du pays nomme officiellement les « tribus répertoriées », et qui préfère souvent se dire adivasi. Depuis des siècles, des membres de ces groupes réalisent, ou font réaliser selon leurs vœux, des peintures et des sculptures que l’on qualifie par conséquent « d’art tribal de l’Inde » ou « art adivasi ». Cette notion peut paraître ainsi aussi évidente que celle, par exemple, d’art aborigène pour l’Australie et suscite un intérêt croissant, dont témoigne l’exposition Autres Maîtres de l’Inde, au musée du quai Branly (Printemps 2010, après une précédente à la Halle Saint-Pierre en 2007, pour nous limiter à la France). À y regarder de plus près, pourtant, le contexte indien se montre très différent de la situation australienne. Dans ce dernier cas, l’art aborigène s’oppose directement à l’art occidental colonial. Dans le cas indien, en revanche, l’art tribal ne se distingue pas seulement de l’art occidental, mais aussi d’autres formes d’art ‘authentiquement’ indiennes : l’art ‘classique’ représenté par les sculptures de temple ou les miniatures mogholes, et l’art dit ‘populaire’ aux supports variés. Or, les frontières entre art populaire et tribal demeurant floues, la plupart des commissaires d’exposition indiens ont tendance à associer les deux types d’artistes (folk and adivasi). Plus récemment encore, commissaires et galeristes ont privilégié un terme générique : l’art vernaculaire.
Comme le titre l’indique, il ne s’agira pas ici de présenter les artistes regroupés sous ce label (voir Perdriolle 2012), ni de discuter la valeur esthétique des œuvres concernées, ni encore d’en résumer l’ethnographie, mais de revenir sur la genèse des catégories utilisées pour en parler[1]. Pour introduire cette généalogie, disons que l’art tribal indien est né en 1951, est devenu contemporain vers la fin des années 1980, pour dépasser les relents de primitivisme attachés au ‘tribal’, et que les mêmes raisons l’ont récemment transformé en vernaculaire, d’orientation postcoloniale. Des échos de primitivisme persistent pourtant, particulièrement dans les discussions regardant le statut de cet art face à l’histoire. Précisons donc quelques points historiographiques avant d’aborder notre sujet central.
De l’artisanat à l’art tribal indien : genèse d’une catégorie
Le type d’art qui nous concerne trouve sa première formulation et son premier catalogue d’objets en 1951, dans l’ouvrage The Tribal Art of Middle India, d’un missionnaire britannique devenu ethnologue et citoyen indien : Verrier Elwin. Intervenant sur la scène publique indienne à partir des années trente, il joua un rôle important dans la revalorisation et la défense de ces groupes marginalisés, dont les formes artistiques représentaient une expression culturelle particulièrement tangible (Rousseleau 2009).
Mais qui étaient ces groupes, qui étaient alors sur le point d’être reconnues dans la Constitution indienne ? Dans l’imaginaire évolutionniste coloniale, les tribaux étaient les héritiers des premiers habitants de l’Inde, antérieurs à l’arrivée des locuteurs Indo-Européens (Aryens pour reprendre la terminologie du XIXe siècle), ces derniers apportant la langue sanskrite, le système des castes et la mythologie védique, puis brahmanique. Aujourd’hui, la question de la diffusion linguistique et culturelle se pose de façon multifactorielle et socio-politique. Au XIXe siècle, les orientalistes et anthropologues élaborèrent une théorie du peuplement et de l’histoire de l’art en termes de conquête raciale (Aryens vs Dravidiens), qui perdure souvent encore aujourd’hui, on le verra. Héritière de ces théories, en Inde, la notion de tribu se pose donc par un ensemble de traits négatifs par rapport à la société dominante : -langues austriques, tibéto-birmanes ou dravidiennes minoritaires vs langues indo-aryennes au nord de l’Inde (sanskrit, hindi, bengali, etc.) ou dravidiennes majoritaires (tamoul, télougou, etc.) ; -division sociale par clans et lignages vs statuts socio-professionnels hiérarchisés (castes) ; -mode de vie itinérant ou périphérique (hauts-plateaux, régions désertiques, forêts) vs agriculture de plaine ; -cosmologie et pratiques rituelles particulières vs normes brahmaniques (en bref).
L’Inde indépendante développe des politiques de discrimination positive à l’égard des tribus comme des ex-intouchables (« castes répertoriées », ou Dalit : « opprimés »). Proche de Nehru, Elwin promeut également l’installation d’Instituts de recherche et de formation de ces groupes, notamment au développement de leur artisanat (design, coopératives gouvernementales). Dans son ouvrage, Elwin se concentre essentiellement sur les peintures murales rituelles (Saora et Gond), les tissus (et costumes, notamment Naga) et les sculptures sur bois (Santal). Après sa disparition en 1962, la collection d’Elwin prend place au National Museum de New Delhi, à titre de documentation anthropologique plus que pour sa valeur esthétique.
Il faut avouer qu’Elwin reste longtemps une exception, et que les expressions artistiques adivasi sont peu valorisées pour elles-mêmes avant les années 1980. Elles restent le plus souvent incluses dans un vaste ensemble de formes d’artisanat locales et ‘populaires’ indifférenciées. En 1949, Nehru créait le Central Cottage Industries Emporium (AIHB 1955). Cette sorte de foire-exposition représente encore aujourd’hui une importante vitrine de l’artisanat indien, sur l’avenue Janpath à New Delhi. En 1952 voit le jour le Comité panindien de l’Artisanat (All India Handicrafts Board ou AIHB), qui mène des enquêtes de terrain, enrichit les collections et promeut des savoir-faire en voie d’extinction (fonte à la cire perdue, dessins de sol, peintures murales, etc.). Ce Comité pose les bases du National Handicrafts & Handlooms Museum, dit plus simplement le Musée de l’Artisanat (Craft Museum), officiellement ouvert en 1956, à New Delhi. Conçu comme un conservatoire des arts et métiers, en même temps qu’un centre de patronage national des artisans, il évolue vers une vitrine de politique culturelle. C’est particulièrement le cas dans les années 1970-80, qui connaissent une nouvelle vague de voyages spirituels d’occidentaux vers l’Inde puis la multiplication des festivals de l’Inde en Europe et aux États-Unis. En écho à ce genre de quête, la directrice d’alors du Craft Museum, Pupul Jayakar, présente l’art populaire et tribal comme la survivance de rites millénaires à la « Terre Mère » de l’Inde[2].
En 1988, dans le cadre d’un festival de l’Inde au Japon, une exposition est intitulée pour la première fois exclusivement : The Art of the Adivasi (Indian Tribal Art). P. Jayakar en est encore la « Chairman », mais les commissaires en sont les trois nouveaux directeurs de musées indiens impliqués dans le prêt d’œuvres : Jagdish Swaminathan du Bharat Bhavan de Bhopal, Jyotindra Jain successeur de Jayakar au Craft Museum de New Delhi, et Haku Shah du Crafts Museum d’Ahmedabad. Cette exposition est emblématique à plus d’un titre ; elle voit la formulation de perspectives encore inédites et est portées par de nouveaux acteurs : historiens d’art formés à l’ethnologie et artistes férus de cette discipline.
Jyotindra Jain : de l’histoire de l’art tribal et rural à la production de maîtres artistes
Né en 1943 au Madhya Pradesh, Jyotindra Jain a poursuivi des études universitaires à Bombay, où il obtient un Master en « culture indienne, anthropologie culturelle et art » en 1965[3]. Il travaille ensuite deux ans comme assistant à la Gujarat Research Society de la même ville et enseigne l’art et la culture indienne (Greenough 1995, p. 230). En 1969, il part se former à la muséologie ethnographique à l’université de Vienne et y soutient une thèse de doctorat en ethnologie et Indologie (1972), sous la direction de Josef Haekel. De retour en Inde, il est nommé directeur du nouveau Musée du Folklore du Gujarat de la Fondation Shreyas, de 1976 à 1978. Ce poste lui permet de mener des enquêtes de terrain, sous l’égide de la Corporation de l’Artisanat du Gujarat (Ahmedabad). En 1979-80, il est maître de conférence à l’Institut d’Indologie du Gujarat, puis obtient une bourse d’étude (1981-83) pour rédiger un ouvrage sur les peintures murales rituelles des tribus Rathwas et Bhilalas du Gujarat – Madhya Pradesh. Ce livre le fait reconnaître comme véritable spécialiste du domaine, et il est nommé directeur du Crafts Museum en 1984. Il occupe ce poste jusqu’en 2001, date à laquelle il est nommé professeur au département d’art et esthétique de l’université Jawaharlal Nehru à New Delhi, puis dirige une section du Indira Gandhi National Centre for the Arts de la même ville avant de prendre sa retraite.
Pour comprendre sa méthodologie et ce qu’elle a apporté à l’Inde, il est utile de revenir sur ses années viennoises. La capitale autrichienne est en effet célèbre dans l’histoire de l’ethnologie pour l’école historico-culturelle, fondée par Wilhelm Schmidt. Au-delà des théories datées de ce missionnaire linguiste, ses successeurs ont conservé une orientation diffusionniste : identification d’aires culturelles, collecte d’objets et de mythes, chants, etc. En l’occurrence, l’école de Vienne possède surtout une longue tradition d’études chez les tribus Bhils et Barela Bhilala d’Inde occidentale : Wilhelm Koppers y dirigea une expédition dès 1938, Matthias Hermanns collecta des mythes en 1955[4] ; puis, en 1961 avec Josef Haekel, Hermann Janssen étudia le même groupe pour sa thèse en 1966[5]. J. Jain fut ainsi formé à une ethnographie historique et orientée vers l’étude de la culture matérielle, en même temps qu’à la collecte des mythes des groupes tribaux d’Inde de l’Ouest. Ses premiers travaux insistent sur le contexte culturel de production des œuvres, et sa muséologie relaie cette préoccupation en replaçant les objets dans des mises en scène qui rappellent les « écomusées ».
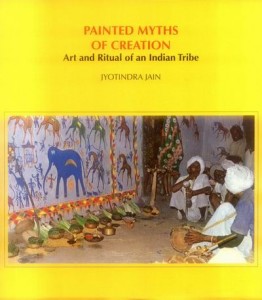 La première monographie de l’auteur, Painted Myths of Creation, porte précisément sur les peintures murales des Rathwa et Bhilala du Gujarat et du Madhya Pradesh, peintures dont l’exécution est accompagnée de chants racontant la cosmogonie. Ce livre est le premier d’une collection consacrée aux arts « populaires et tribaux » (Loka Kala Series), fondée par l’académie des arts indiens (Lalit Kala). L’ouvrage se montre pionnier davantage encore par ses prises de positions critiques. Dès la première page de l’introduction, l’auteur expose sa méthodologie, issue des sciences sociales, qui tranche avec les écrits antérieurs sur la question (surtout ceux de Jayakar ; Jain 1984, p. 1) : « l’usage indiscriminé des mots ‘fertilité’, ‘mère’, ‘symbolique’, ‘tantrique’, ‘magique’, etc. pour définir à peu près tout ce qui est inintelligible dans les cultes locaux est dû à la rareté des matériaux contextuels adéquats et bien étudiés d’une part, et à l’absence d’explication de ces concepts locaux dans les textes sanskrits d’autre part. »
La première monographie de l’auteur, Painted Myths of Creation, porte précisément sur les peintures murales des Rathwa et Bhilala du Gujarat et du Madhya Pradesh, peintures dont l’exécution est accompagnée de chants racontant la cosmogonie. Ce livre est le premier d’une collection consacrée aux arts « populaires et tribaux » (Loka Kala Series), fondée par l’académie des arts indiens (Lalit Kala). L’ouvrage se montre pionnier davantage encore par ses prises de positions critiques. Dès la première page de l’introduction, l’auteur expose sa méthodologie, issue des sciences sociales, qui tranche avec les écrits antérieurs sur la question (surtout ceux de Jayakar ; Jain 1984, p. 1) : « l’usage indiscriminé des mots ‘fertilité’, ‘mère’, ‘symbolique’, ‘tantrique’, ‘magique’, etc. pour définir à peu près tout ce qui est inintelligible dans les cultes locaux est dû à la rareté des matériaux contextuels adéquats et bien étudiés d’une part, et à l’absence d’explication de ces concepts locaux dans les textes sanskrits d’autre part. »
Autrement dit, évitons d’employer de grands mots qui n’expliquent rien et revenons à des enquêtes contextualisées sur le terrain, pour disposer « d’un ensemble d’études des formes d’art tribales régionales situées dans leur propre contexte religieux et culturel » (Jain 1984, p. 1). Partant de ce principe, Jain décompose la tradition régionale en un certain nombre de peintres dont les villageois reconnaissent tacitement la maîtrise artistique, si bien que des sous-styles peuvent être différenciés. Cette précision remet en cause le lieu commun de l’artiste ‘traditionnel’ nécessairement anonyme et répétant un schéma immuable depuis des millénaires. Jain ne cessera de rappeler ce point dans ses travaux et fournira même une raison de l’anonymat apparent des artistes ruraux : dans le système de patronage villageois, c’est d’abord le commanditaire d’une œuvre qui retient l’attention locale (Jain 1998, p. 10-11). L’artiste principal s’inscrit ensuite au sein d’une équipe. Ces deux éléments n’empêchent pas que la société évalue des talents respectifs. Dans un tel contexte, l’artiste n’a tout simplement pas besoin de signer des œuvres, qui plus est originellement destinées à disparaître.
Dans ses divers travaux, Jain innove en se focalisant sur la ‘culture régionale’, là où la plupart de ses prédécesseurs comblaient simplement les silences de la « petite tradition » villageoise par les textes de la « Grande tradition » sanskrite. Il remet ainsi en cause le préjugé selon lequel les traditions orales et locales n’étaient que de simples copies déformées d’originaux antiques. Par exemple, les chants comme les peintures Rathwa mêlent des mythes et des dieux panindiens (dont l’antique Indra) à des épisodes et personnages tout à fait spécifiques. À l’inverse, l’étude des légendes ou des pratiques locales peut livrer des clés d’interprétation pour des détails iconographiques plus largement hindous restés inexpliqués. S’ouvre ainsi tout un monde intermédiaire de sens, dont seules l’histoire et l’ethnographie livrent les clés.
Du point de vue de l’administration du musée de l’artisanat, J. Jain a poursuivi la politique d’aide aux artisans (résidence et expositions-ventes, etc.), tout en amplifiant la reconnaissance de « maîtres » atteignant à une « expression personnelle » au sein des traditions régionales. Le Comité de l’Artisanat avait en effet instauré le National Award for Master Craftsman, qui permettait de subventionner certains artisans sur la base de leur excellence mais aussi de leurs capacités innovatrices. Ce prix joue un rôle majeur dans la reconnaissance de ‘personnalités artistiques’ et dans le patronage quasi-systématique de ces artistes par le Craft Museum et d’autres musées étrangers. Jain a dirigé deux expositions sur ces « Autres maîtres » de l’art indien, « tribaux et populaires » et leurs négociations avec la modernité, à New Delhi en 1998 et à Paris en 2010 (voir Jain 1998, 2010). Sur la fin de sa vie, la peintre du Mithila (Bihar), Ganga Devi (1928-1991), a ainsi composé des séries commanditées par diverses institutions (Jain 1997, pp.92-93), de même que le célèbre warli Jivya Soma Mashe a peint la toile My Life pour le Craft Museum en 1997 (Y. Dalmia in Jain 1998). Arrêtons-nous un instant sur son cas.
Les peintures murales de la tribu des Warlis (Maharashtra), initialement réalisées lors des rituels de mariages, furent portées à la connaissance du public sous l’impulsion du Comité de l’Artisanat, puis de l’Académie des beaux-arts (Lalit Kala). Bhaskar Kulkarni, notamment, a rapporté les premières « peintures Warlis » pour l’Académie en 1976 (Dalmia 1988). Mais, dès 1975, la galerie Chemould de Bombay exposait des toiles réalisées par de vieilles femmes Warlis[6], toiles représentant notamment des arbres, l’un des seuls motifs dessinés hors du cadre rituel qui contenait les figures divines. L’exposition comptait également un homme : Jivyâ Somâ Mâshe (né en 1934), qui eut rapidement du succès pour ses toiles dépeignant davantage des activités masculines agricoles, villageoises, etc. Il reçoit le Prix National du Maître Artisan des mains d’Indira Gandhi dès 1976 et expose la même année au Palais de Menton (Perdriolle 2012). Y. Dalmia rapporte qu’un groupe de designers de l’Institut National de Design d’Ahmedabad vient lui rendre visite en 1979 pour lui passer commande de quinze toiles en couleurs. Le comité de l’artisanat organise également un atelier pendant six mois, où Mâshe forme de jeunes garçons et filles de sa communauté (Dalmia 1988, p. 234). En 1980, sa maison est déjà visitée par de nombreux touristes et collectionneurs étrangers, et il participe à de nombreux festivals internationaux. Ses visiteurs lui demandent de moins couvrir la toile (Ibidem, p. 223), et cette maîtrise de l’espace va devenir sa marque.
Il convient de souligner ici le rôle qu’a joué l’auteur-éditeur autrichien Ulli Beier (1922-2011) dans la reconnaissance de Mâshe et d’autres artistes indiens contemporains[7]. Influencé par l’existentialisme et le mouvement de la négritude, Beier a promu les littératures et les peintures du Nigéria (Osogbo) et de Papouasie-Nouvelle Guinée, avant de s’intéresser aux personnalités de quelques artistes indiens. Au sujet de Mâshe, il met par exemple en relief le fait qu’il ait été orphelin de mère, délaissé par sa belle-mère, et qu’il serait resté muet jusqu’à quatre ans, s’exprimant en dessinant dans le sable. Bien qu’il ait grandi et se soit marié de façon tout à fait commune, cet épisode enfantin est présenté comme ayant fait naître en lui un besoin impérieux d’expression de soi (urge of self expression). Dans ce cas comme dans d’autres, Beier insiste sur la « vulnérabilité » psychologique de la personne, sur les difficultés qui ont changé son parcours en destin ou vocation d’artiste. Or, ce scénario n’a cessé d’être évoqué pour expliquer la créativité de Mâshe par rapport à d’autres Warlis. Nous reviendrons sur ce point, après avoir abordé la question de la contemporanéité de ces artistes.
Jagdish Swaminathan et la contemporanéité des artistes adivasi
En 1982, le Gouvernement du Madhya Pradesh inaugure, à Bhopal, le Bharat Bhavan, un complexe dédié à l’art moderne, comprenant le Dr Rupankar Museum of Fine Art, lui-même divisé en deux ailes : l’une consacrée à l’art citadin, l’autre à l’art populaire et adivasi. Le complexe compte également des ateliers pour permettre aux étudiants en arts et aux artisans héréditaires de travailler toute l’année. Cette organisation concrétise les vœux du principal fondateur du projet : le peintre et poète Jagdish Swaminathan (1928-1994). Lecteur d’Elwin, les années précédant l’ouverture du musée, Swaminathan avait envoyé des étudiants s’inspirer et collecter des œuvres dignes d’intérêt, dans les campagnes du Madhya Pradesh. Cette collecte lui permit de découvrir notamment, à Patangarh – ville où Elwin vécut et encouragea l’art local –, une maison décorée d’un jeune Pardhan d’une quinzaine d’années : Jangarh Singh Shyam. Avant de nous intéresser à lui, exposons d’abord les positions théoriques de Swaminathan.
Swaminathan introduit au catalogue de la collection Rupankar par un véritable manifeste de « l’art populaire et adivasi du Madhya Pradesh ». Il commence par rejeter le regard impérialiste ou évolutionniste infériorisant les formes tribales. Contre un tel regard, il invoque le relativisme et l’approche esthétique universaliste de Boas et Lévi-Strauss, mais avoue préférer une perspective moins théorique, telle une ouverture « symbiotique » envers ces formes d’expression (Swaminathan 1987, p. 9). Cela ne l’empêche pas de s’appuyer sur une ethnologie actualisée, qui lui fait d’emblée reconnaître la complexité de la catégorie de tribu en Inde. Il lui préfère le terme adivasi, comme offrant une définition plus positive de ces groupes en aborigènes résistants à l’oppression (suivant les auteurs des Subaltern studies).
Swaminathan rompt lui aussi avec les scénarios raciaux et insiste sur les interactions culturelles. Mais, par contraste, il tend cependant à idéaliser les adivasi et leur art. À ses yeux, celui-ci possède une « fonction numineuse », sacrée, parce qu’il contribuerait à dépasser mythiquement les bouleversements historiques, comme l’arrivée des aryens en Inde… Revalorisant alors d’anciens thèmes, il lance quelques parallèles hasardeux : par exemple, entre un célèbre sceau de Mohenjo-Daro dit du ‘proto-Shiva’, montrant un homme portant des cornes de buffle, et les turbans à cornes de bison de la tribu des Maria Gonds[8]. S’appuyant sur cette équation, Swaminathan interprète le mythe de Lingo – héros culturel des Gonds, qui libère ses frères d’une caverne où le dieu Shiva les avait emprisonnés – comme le symbole de la résistance aborigène face aux tentatives de subjugation des hautes castes hindoues.
Plus encore, suivant les écrits de Mircea Éliade relayés par Jayakar, il oppose la perception mythique du monde et du temps, dans laquelle vivraient les aborigènes, à la perspective historique moderne. Mais, là où ses inspirateurs louaient le caractère figé et répétitif d’une ‘tradition’ opposée à la ‘modernité’, Swaminathan voit, au contraire, une capacité créative à intégrer les nouveautés. Il célèbre ainsi, non le caractère de survivance du passé, mais bien la contemporanéité des expressions tribales. C’est un changement radical de perspective, que l’on doit au fait qu’il écrit lui-même du point de vue de l’artiste créateur. À l’appui de son propos, il cite d’ailleurs des auteurs ayant revalorisé l’art primitif par ses liens avec l’art moderne : Sir Herbert Read (1961)[9] et W. Rubin (1987 [1984]).
William Rubin est célèbre pour sa direction de l’exposition « Le Primitivisme dans l’Art du XXème siècle, et l’Affinité du Tribal et du Moderne », au Musée d’Art Moderne (MOMA) de New York, en 1984. À la suite de Robert Goldwater, Rubin souligne le rôle que l’art ‘primitif’ a joué pour les peintres européens vers 1906, dans leur quête d’un dépassement du naturalisme au conceptuel[10]. Rubin ne cache pas l’ethnocentrisme de son ‘héros’ Picasso, qui se souciait peu du sens original des objets africains, mais uniquement de l’usage qu’il pouvait en faire dans sa propre quête picturale[11]. Une vive polémique suivit l’exposition, car Rubin s’intéresse lui aussi plus aux usages des modernes qu’à la nature exacte des ‘affinités’ qu’il relève. James Clifford (1988, p. 195) a bien montré que l’exposition du MOMA célébrait surtout le modernisme occidental, mais occultait les métissages et « modernismes du Tiers-Monde ». Seule la période de la ‘découverte’ coloniale des zones tribales concernées était évoquée, comme si leur histoire s’y limitait. De même, sous les dehors d’une reconnaissance généreuse de la créativité des ‘autres’, de telles définitions peuvent cacher une « anthropologie datée[12] ». Ressentir une affinité avec l’esthétique des aborigènes n’implique aucunement que l’on comprenne leurs intentions originales.
Or, ces critiques sont partiellement transposables dans le cas de Swaminathan. S’il est critique vis-à-vis des théories raciales, il continue en effet à présenter les adivasi comme des peuples ‘sans histoire’, d’avant la colonisation ‘aryenne’. De même, son discours passe facilement du vécu adivasi à celui du peintre bohème qu’il incarne lui-même. Le « temps mythique » des premiers, en particulier, serait comparable à celui de l’activité créatrice des seconds : l’un comme l’autre permettrait de s’évader du « dédale de l’histoire », pour rejoindre le « royaume de l’atemporel » (Swaminathan 1987, p. 26). Sans souci de l’histoire, les formes artistiques comme les mythologies aborigènes n’en seraient que plus libres et intégratrices des nouveautés. L’art adivasi apparaît ainsi pré-historique en même temps que post-moderne par son affranchissement vis-à-vis de l’idéologie moderne de l’histoire. Cette vision dialectique lui permet de conclure à la « contemporanéité » de l’art adivasi :
Nous définirions, par conséquent, la contemporanéité comme la validité simultanée de cultures co-existantes, de la même façon que la validité de la simultanéité d’événements dans la matrice de l’éternité. Nous traitons, donc, l’art Adivasi comme un art contemporain, quelles qu’en soient ses motivations de fonds. [13]
Malgré l’avancée originale de la démarche de Swaminathan, elle n’est pas sans paradoxe. Le plus éclatant est sans doute de rejeter tout primitivisme, tout en continuant à célébrer l’atemporalité des adivasi, et à leur prêter un ‘génie’ artistique quasi-inné, bien que non-racial. Swaminathan revalorise certes les tribaux, mais les peintres de ces groupes, aux créations censément universelles, sont condamnés à se présenter comme aborigènes pour être visibles. Le même genre d’ambivalence est présent dans les « arts primordiaux » selon Malraux (Le Musée imaginaire, 1965 ; voir L’Estoile 2007, pp. 269-271).
Pour revenir à l’artiste adivasi qu’il a promu, Jangarh Singh Shyam (1960-2001), son parcours est malheureusement révélateur des tensions générées par ce primitivisme paradoxal que Denis Vidal (2010) nomme « post-primitivisme ». Découvert par un assistant de Swaminathan (Vivek Tembey) en 1981, il rejoint Bhopal pour se former à de nouvelles techniques[14]. Les Pardhans, groupe auquel il appartient, jouaient le rôle de bardes de la tribu des Gonds, et les deux groupes réalisaient des modelages en terre et des peintures murales en noir et blanc, à l’occasion de la fête de Krishna. Présenté comme un « Pardhan-Gond », Shyam se met à utiliser la couleur sur la suggestion des peintres du Bharat Bhavan. Il y est employé et y peint, puis ses œuvres comptent parmi les pièces majeures du musée. Son style évolue beaucoup au fil du temps, sous l’influence des autres types d’art auxquels il est soumis dans un contexte artistique urbain indien, puis international[15]. Il participe en effet à de nombreuses expositions en Inde (Craft Museum) et à l’étranger. L’histoire est pourtant tragique, car le jeune peintre se suicide lors d’un séjour au musée du Mithila au Japon en 2001. Quoi qu’il en soit des raisons, toujours obscures, de sa mort, Denis Vidal (2010) a souligné la difficulté, pour un tel individu, d’incarner des logiques aussi contradictoires.
L’un des événements qui a précipité la reconnaissance de Jangarh Singh Shyam est sa participation à l’exposition Les Magiciens de la terre, en 1989. Cette exposition, dirigée par Jean-Hubert Martin, au Centre Georges Pompidou, projeta d’éviter tout primitivisme en revendiquant précisément une perspective « postmoderne » métisse (MacEvilley in Martin 1989, p. 22 ; MacEvilley 1986). Pour ce qui est des exposants indiens, Singh Shyam partage l’affiche avec Jivya Soma Mâshe et Bowa Devi du Mithila[16]. Ajoutons que le Tibet est représenté, quant à lui, par deux peintres héréditaires de rouleaux à scènes tantriques (thangka) et trois moines réalisateurs de mandalas. Un tel choix, ainsi que le titre de l’exposition suggère que la volonté métisse initiale a laissé la place à des références plus ambigües, du moins pour l’Asie : un art ‘magique’ ou ‘rituel’ lié à la terre, à la fois primordial et contemporain. Le logo même de l’exposition, une spirale dessinée par Lamu Baiga (autre peintre adivasi du Bharat Bhavan, décédé en 1987) suggère l’atemporalité de l’art indigène.
À l’opposé, la dernière génération d’expositions d’art contemporain indien tend à réintégrer les artistes adivasi dans un ensemble plus englobant, mais défini par sa localité.
Du localisé au vernaculaire
L’exposition Edge of desire. Recent Arts in India, organisée par la Asia Society (New York) et la Art Gallery of Western Australia (Perth) entre septembre 2004 et janvier 2006, sous la direction de Chaitanya Sambrani, mêle trente-huit artistes nés et travaillant en Inde. Certains sont des représentants urbains et cosmopolites de l’art conceptuel (tel Subodh Gupta), tandis que d’autres sont des artistes ‘traditionnels’ ou héréditaires par caste (chitrakar du Bengale, sculpteurs ou fondeurs, par exemple), et d’autres encore des peintres reconnus comme adivasi. Le but de l’exposition est précisément de juxtaposer toutes ces formes sur un pied d’égalité, en insistant davantage sur leurs réponses variées à des questions relatives aux arts visuels : tels la relation aux lieux, les frontières et leur franchissement, le désir d’individualité et son expression, etc.
Plus radicale que l’entreprise de Swaminathan et les Magiciens de la terre, dont le milieu de l’art indien reprocha la perspective encore trop eurocentrée, cette exposition offre sans doute une perspective vraiment post-coloniale, ‘indienne’ sur l’art contemporain indien. En même temps, se pose alors inévitablement la question des rapports entre la contemporanéité des œuvres et la nationalité des artistes (origines indiennes /africaines, etc.).
La même question se pose au sujet de la récente exposition Vernacular, in the Contemporary, organisée en deux parties de novembre 2010 à février 2011, puis de mars à juin 2011 à la Devi Art Foundation (New Delhi). Selon le manifeste de l’exposition, l’ensemble vernaculaire regroupe des arts « populaires, tribaux et traditionnels » (peintures, sculptures sur bois, bronzes de divinités, masques en papier mâchés, marionnettes de cuir)[17]. Plus précisément cependant, selon sa commissaire, Annapurna Garimella (2012), le vernaculaire inclut ici les produits et les gestes de l’artisanat, mais aussi ceux de la vie quotidienne indienne, en particulier manuels, repensés comme matière première pour la création contemporaine conceptuelle. Le « vernaculaire dans le contemporain » serait donc l’utilisation d’un matériau et de savoir-faire locaux dans le langage de l’art plastique globalisé.
Au sujet de la notion de contemporain, Garimella cite Agamben pour le définir comme ce qui est « hors du flot du présent », c’est-à-dire indépendant des modes, et capable de « réintégrer le passé dans le présent ». Comme chez Swaminathan, on peut dire que cette définition du contemporain sert surtout à intégrer des formes supposées dépassées par le public coutumier des cercles de l’art contemporain urbain et cosmopolite. De façon révélatrice, Garimella oppose cet élément vernaculaire aux « artistes anglophones » aux références essentiellement urbaines.
La notion même de vernaculaire s’enracine dans un débat linguistique. En Inde, les « littératures vernaculaires » s’opposent à celle d’expression anglaise. Récemment, les écrivains en langue vernaculaire (Bhasha dans plusieurs langues du nord de l’Inde) ont en effet répondu à des affirmations d’auteurs anglophones d’origine d’Asie du sud, comme Salman Rushdie ou V.S. Naipaul, qui affirmaient la supériorité littéraire de l’anglais[18]. Cette réponse prend souvent des accents anti-coloniaux, retranscrits en termes postcoloniaux dans la quête d’un imaginaire authentiquement national, qui serait affranchi de l’influence coloniale. Dans cette perspective, les expressions littéraires ou artistiques adivasi se trouvent souvent revalorisées comme encore plus ‘pures’ des scories de l’imagination occidentale et moderne, du fait de leur supposé isolement hors de l’Histoire[19].
Conclusion : en quoi les peintres adivasi font-ils de l’art contemporain ?
Depuis Rubin, en insistant sur la symétrie des positions, on tend au raisonnement suivant : puisque les peintres modernes s’inspiraient des arts tribaux, alors les créateurs tribaux peuvent être des artistes modernes. Plus précis, Swaminathan comme Garimella affirment la « contemporanéité » de l’art adivasi, comme expression valide dans le monde actuel tout en étant atemporelle pour l’un et ‘inactuelle’ (hors des modes) pour l’autre. Seule la seconde s’attarde un peu, toutefois, sur les apports de l’artisanat et des arts populaires et adivasi aux visées de « l’art contemporain ». C’est, à nos yeux, la question centrale du débat, et qui reste largement occultée jusqu’à maintenant.
Pour revenir à quelques définitions rapides, l’art moderne s’est posé dans la polémique contre les normes classiques de beauté, par des recherches plus profondes sur la perception esthétique elle-même (vision, couleurs, etc.). N. Heinich (1996) parle à ce sujet d’entrée dans un régime de singularité et vocationnel, où l’innovation est nécessaire, par rapport aux corps de métiers artisanaux et au académies artistiques antérieures visant davantage la reproduction d’un savoir-faire. Par contraste avec l’anonymat des ateliers, ce régime se caractérise surtout par la personnalisation de l’artiste, à travers l’autoportrait, la signature, la biographie (insistant, de préférence, sur le talent inné ou l’autodidaxie du génie vs l’apprentissage du métier). Au niveau du groupe se revendiquant d’avant-garde, la singularité impose encore la publication d’un manifeste, résumant les positions communes du groupe des originaux.
L’art contemporain, à son tour, se caractérise globalement, par des réflexions plus radicales encore, concernant l’acte artistique (support, geste, etc.), le statut d’artiste ou même de l’œuvre elle-même. Toujours plus singulier, l’artiste contemporain ‘donne à voir’ ou ‘met en acte’ (performance) ses interrogations et les concepts qu’il mobilise, plus qu’il ne vise à produire une œuvre achevée. Plus encore, depuis Marcel Duchamp, l’artiste contemporain cherche constamment à anticiper, ou parie sur ce qui va être bientôt accepté comme œuvre (Heinich 1996 ; Chalumeau 2005, p.22). Le discours explicite ou l’intention supposée de l’artiste, et la réception des critiques, sont désormais essentiels à cette « reconnaissance » et intégration. Celle-ci repose sur un jeu entre artistes provocateurs, public plus ou moins réactif et surtout commissaires, galeristes, collectionneurs et conservateurs de musées constituant les différents cercles du « monde de l’art ».
En quoi cette définition recoupe-t-elle le champ de l’art adivasi ? Dans leur contexte originalement rituel, d’abord, il est clair que les œuvres adivasi ne visaient même pas le statut d’art. Il s’agissait d’ailleurs de signes de présences divines plus que de représentations proprement dites. Placer directement ce genre d’œuvres dans le champ de l’art contemporain occulte complètement leur intention culturelle, pour les mesurer à l’aune d’une esthétique occidentale censément universelle (L’Estoile 2007, pp.375-77). Il n’est pas moins indéniable que, sitôt reconnues pour leurs qualités esthétiques, couchées sur papier et collectées comme telles, ces mêmes œuvres (adivasi comme populaires d’ailleurs) sont entrées dans le monde – et le marché – de l’art globalisé. Cette reconnaissance a eu lieu et se poursuit, on l’a vu, grâce à quelques manifestes, signés par des commissaires et spécialistes du domaine. Les premiers concernés (les artistes) tendent d’ailleurs souvent à s’autocensurer, en arguant qu’ils sont peu lettrés.
Pour que cette reconnaissance ait lieu, les faits ont cependant montré que les œuvres adivasi sont passées par un processus de narrativisation (Jain 1998 ; Hacker 2000, p. 162). Hormis les femmes peintres du Mithila (Ganga Devi), c’est particulièrement évident pour Jivya Somâ Mâshe. Un catalogue de la Galerie Chemould (The Warlis. Tribal Paintings and Legends, vers 1987) témoigne de l’évolution des thèmes de ses toiles : il commence à dépeindre des légendes Warlis, vers 1986 et, dans le catalogue, son fils Sadashiv résume les histoires et contes correspondant à chaque toile. Cette tendance, permettant aussi de constituer des séries différentes, a été reprise par les nombreux peintres Warlis actuels, qui divisent encore les récits en courtes scènes successives. De même, plus récemment, Bhajju Shyam, neveu de Jangarh Singh Shyam conclut un ouvrage illustré racontant son séjour d’artiste à Londres en 2002, par ce titre : « Je deviens un conteur (storyteller) » (Shyam 2004). En effet, le « passage à l’art » (G. Tarabout) implique une attention particulière aux attentes d’un public spécifique, différant notablement du cercle local initial, attentif aux aspects jugés important d’un point de vue rituel. La narrativisation consiste essentiellement en une représentation de divinités ou de récits mythiques, ou encore de scènes de la « vie tribale » villageoise (Hacker 2000, pp. 164-5 ; scènes inintéressantes pour le public local). Les nouveaux ‘patrons’ des œuvres appartiennent à la classe moyenne internationale ou indienne, avec leurs propres critères de pertinence, notamment de références à une ‘primitivité’ indienne. Comme partout sous la pression du marché, la dérive possible de cette logique est la réduction des qualités esthétiques à quelques traits « ethniques » à l’usage consumériste du touriste urbain.
Quant au statut d’artiste, il s’agit évidemment d’une spécialisation récente par rapport aux activités généralement agricoles des adivasi, et qui reste le plus souvent subordonnée à celles-là. Nous avons vu que Jain a remis notamment en cause l’anonymat supposé des créateurs populaires et tribaux, et que Swaminathan milita pour une reconnaissance des « artistes adivasi » pour leur travail esthétique. Les promoteurs des peintres tribaux en font des ‘artistes nés’, en soulignant des éléments biographiques démontrant leur vocation, en insistant sur les reflets, dans l’œuvre, d’événements socio-politiques ou personnels (réactions face aux ‘premiers contacts’ avec les villes, dans le cas de Ganga Devi ou Bhajju Shyam), ou en rappelant leur reconnaissance par des récompenses officielles. Si Van Gogh a incarné la figure de l’artiste moderne, singulier et maudit (Heinich 1996, p. 56), on peut dire que Jangarh Singh Shyam est la figure fondatrice de la condition d’artiste adivasi contemporain. On le disait en effet doué d’une grande sensibilité esthétique, mais attaché à sa vie rurale et communautaire au point de n’avoir pas supporté d’en être éloigné longtemps. H. Perdriolle (2012) le compare, quant à lui, à Basquiat comme deux météores de la création artistique, « métier à haut risque ».
Définis dans ces termes, plusieurs peintres adivasi sont indéniablement entrés dans le monde de l’art moderne, par le régime de singularité ainsi que l’importance du discours accompagnant l’œuvre et précisant les intentions de l’artiste comme celles du commissionnaire d’exposition. Ce dernier a acquis un statut crucial aujourd’hui dans le ‘montage’ des œuvres. L’expérimentation de nouvelles techniques et l’utilisation des supports placent également Mâshe, Singh Shyam du côté de l’art contemporain. Et leurs successeurs élaborent aujourd’hui des réflexions sur le parcours de l’artiste ou de l’œuvre, notamment par le moyen du livre illustré, à la fois récit de vie et œuvre graphique (Venkat Raman Singh Shyam/S. Anand 2016).
Références :
AIHB : All India Handicraft Board, Report on the Marketing of Handicrafts, conducted by the Indian Cooperative Union, New Delhi, and adressed to K. Chattopadhyaya, Ministry of Production, Government of India, 1955.
Amselle, Jean-Loup, L’Art de la friche. Essai sur l’art africain contemporain, Paris, Flammarion, 2005.
Beier, Ulli, Somâ Mâse and Other Warli Painters, Port Moresby, Institute of Papua New Guinea Studies (Art in the Third World Series, n° 5), 1977.
Contemporary Indian Art : Soma Mase, Deolalikar, Sultan Ali, Port Moresby, Institute of Papua New Guinea Studies (Arts in the Third World Series), 1977.
Bowles, John H., Painted Songs & Stories. The Hybrid Flowerings of Contemporary Pardhan Gond Art, Bhopal, INTACH, Bhopal Chapter, 2009.
Chalumeau, Jean-Luc, Histoire de l’art contemporain, Paris, Klincksieck (coll. 50 Questions), 2005.
Clifford, James, « Histories of the Tribal and the Modern », The Predicament of culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art, Cambridge, Harvard University Press, 1988, pp. 189-214.
Dagen, Philippe, Le Peintre, le poète, le sauvage. Les voies du primitivisme dans l’art français, Paris, Flammarion, 1998.
Dalmia, Yashodhara, The Painted world of the Warlis. Art and Ritual of the Warli Tribes of Maharashtra, Lalit Kala Akademi, New Delhi, 1988.
Devy, Ganesh N. (ed.), Painted Words. An Anthology of Tribal Literature, Penguin Books, 2002.
Greenough, Paul, « Nation, Economy and Tradition Displayed : The Indian Crafts Museum, New Delhi », in Carol A. Breckenridge (ed.), Consuming Modernity : Public Culture in a South Asian World, Minneapolis-London, University of Minnesota Press, 1995, pp. 216-248.
Hacker, Katherine, « Traveling objects. Brass images, artisans and audiences », RES, n° 37, Spring 2000, pp. 147-165.
Heinich, Nathalie, Être artiste. Les transformations du statut des peintres et des sculpteurs, Paris, Klincksieck, 1996.
Jain, Jyotindra, Painted Myths of Creation : Art and Ritual of an Indian Tribe, New Delhi, Lalit Kala Akademi, Loka Kala Series, 1984.
Ganga Devi. Tradition and expression in Mithila Painting, Mapin (Ahmedabad) & the Mithila Museum (Niigata, Japan), 1997.
(ed.), Other Masters. Five Contemporary Folk & Tribal Artists of India, Crafts Museum & the Handicrafts & Handlooms Exports Corporation of India, 1998 (catalogue d’une exposition de janvier-avril 1998).
Autres Maîtres de l’Inde, (catalogue de l’exposition, 30 mars-18 juillet 2010) Paris, Somogy, 2010.
L’Estoile, Benoît de, Le Goût des Autres. De l’Exposition coloniale aux Arts premiers, Paris, Flammarion, 2007.
Mac Evilley, Thomas, « The Common Air : Contemporary Indian Art », Artforum, n° 24, Summer 1986, pp. 106-115.
Martin, Jean-Hubert, Les Magiciens de la terre, Centre Georges Pompidou, Paris, 1989.
Perdriolle, Hervé, Art contemporain indien. Contemporain, un mot, plusieurs cultures, Milan, 5 continents, 2012.
Read, Sir Herbert, « Art in an Aboriginal Society : a Comment », in Y. Marian W. Smith (ed.), The Artist in Tribal Society, Proceedings of a symposium held at the Royal Anthropological Institute, London, Routledge & Kegan Paul, 1961, pp. 14-32.
Rousseleau, Raphaël, « L’invention de ‘l’art tribal’ de l’Inde : Verrier Elwin 1951 », in Thierry Dufrêne et Anne-Christine Taylor (dir.), Cannibalismes disciplinaires : Quand l’histoire de l’art et l’anthropologie se rencontrent, INHA – Musée du quai Branly, 2009, pp. 123-132.
“L’art âdivâsî ou art tribal de l’Inde : un art en quête d’histoire”, Tribal Art, XIV-2, n°55, Printemps, 2010, pp. 88-95.
« ’Tribal Artisans’ and Artists in Odisha : between Craft Promotion, ‘Ethnic Tourism’ and Indian Primitivism », The Politics of Ethnicity on the Margins of the State : janjati/adivasis in India and Nepal, M. Carrin & G. Toffin (eds.), CNRS-MSH, Paris, Centre de Sciences Humaines-Indian Council of Social Research, Ratna Sagar, New Delhi, 2013, pp. 121-134.
(à paraître) « Pupul Jayakar et l’artisanat indien comme instrument de politique culturelle », in Catherine Servan-Schreiber et Philippe Bouquillion (dir.), Les industries culturelles en Inde.
Rubin, William, Le Primitivisme dans l’art du XXe siècle. Affinité du Tribal et du Moderne, Flammarion, Paris 1987 [New York, Museum of Modern Art 1984], 2 volumes.
Shyam, Bhajju, The London Jungle Book, Tara Publ. (in association with the Museum of London), Mumbai, 2004.
Singh Shyam, Venkat Raman / S. Anand, Finding my Way, New Delhi, Navayana, 2016.
Swaminathan, Jagdish (ed.), The Perceiving Fingers. Catalogue of Roopankar Collection of Folk & Adivasi Art from Madhya Pradesh, India, Bharat Bhavan – Bhopal, All India Handicrafts Board – New Delhi, 1987.
THE ART OF THE ADIVASI (Indian Tribal Art), Festival of India, Hyyogo Prefectural Museum of Modern Art & the Museum of Modern Art, Saitama & others museums of Japan, 1988.
THE WARLIS. Tribal Paintings and Legends (toiles de Jivya Somâ et Balu Mâshe, légendes de Sadashiv Mâshe réécrites par Lakshmi Lal, introduction par Y. Dalmia), Chemould publications and arts, Bombay (entre 1983 et 87).
Vidal, Denis, « A Tribal Tradition is born : the emergence of post-primitivism in popular indian painting », 2010 [version actualisée d’une communication à Pondichery en 1993] (20p.).
Sources Internet :
Chatterjee, Kumkum, « Indian » Literatures Today: English and Bhasha Literatures in an Uneasy Relationship, Review of Iyer, Nalini ; Bonnie Zare (eds.), Other Tongues: Rethinking the Language Debates in India, H-Asia, H-Net Reviews. July, 2011.
URL: https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=29757
Annapurna Garimella « The Vernacular Contemporary » : Melbourne Art Fair 2012 Lecture and Forums
[1] Comme le suggère (entre autres) le philosophe Nelson Goodman, il s’agit de passer d’une question d’essence (« qu’est-ce-que l’art adivasi ? ») à une question nominaliste de notion contextualisée par ses usages (« quand parle-t-on d’art adivasi ? »).
[2] Voir Rousseleau (à paraître) « Pupul Jayakar et l’artisanat indien comme instrument de politique culturelle », in Catherine Servan-Schreiber et Philippe Bouquillion (dir.), Les Industries culturelles en Inde.
[3] Jyotindra Jain, Painted Myths of Creation : Art and Ritual of an Indian Tribe, New Delhi, Lalit Kala Akademi, Loka Kala Series, 1984, p. 1, et entretiens. Sauf indication, les informations exposées ci-dessous proviennent d’entretiens avec l’auteur en 2007, lors d’une mission financée par le CNRS (CEIAS) et dans le cadre d’une bourse post-doctorale du Musée du quai Branly.
[4] Matthias Hermanns, Die religiös-magische Weltanschauung der Primitivstämme Indiens, Wiesbaden 1966.
[5] Voir : Engelbert Stiglmayr, The Barela – Bhilala and their songs of creation, Franz Födermayr, Musical analysis of the songs, Acta Ethnologica et Linguistica, 20, Wien 1970.
[6] Yashodhara Dalmia, The Painted world of the Warlis. Art and Ritual of the Warli Tribes of Maharashtra, Lalit Kala Akademi, New Delhi, 1988, p. 221, p.²98, fig. 77.
[7] Voir Ulli Beier, Somâ Mâse and Other Warli Painters, Port Moresby, Institute of Papua New Guinea Studies (Art in the Third World Series, n° 5), 1977, et « Contemporary Art in India », Aspect, 23, Sydney, January 1982, pp. 416. U. Beier contribua ainsi également à la reconnaissance de Tyeb Mehta, Sultan Ali ou Bhupen Khakhar.
[8] Ce rapprochement réapparaît brièvement d’ailleurs dans le récent film d’Ashutosh Gowariker, Mohenjo-Daro (2016).
[9] Poète proche des surréalistes puis des existentialistes, Sir Herbert Read (1893-1968) occupa un poste de conservateur au Victoria & Albert Museum. C’est à ce titre qu’il présida l’exposition intitulée 40.000 years of modern art : a comparison of primitive and modern, dirigée par Archer et Melville à Londres, en 1948. Cette exposition préfigure celle du MOMA en 1984.
[10] Sachant que la catégorie de « primitif/sauvage » (pour Gauguin par exemple) regroupait alors l’art japonais, aztèque, indien, égyptien antique, cambodgien ou javanais, avant de désigner « l’art nègre » (qui englobait, lui-même, l’art océanien pour des considérations raciales, William Rubin, Le Primitivisme dans l’art du XXe siècle. Affinité du Tribal et du Moderne, Flammarion, Paris, 1987 [New York 1984], 1987, vol. I, pp. 1-79). Voir Philippe Dagen, Le Peintre, le poète, le sauvage. Les voies du primitivisme dans l’art français, Paris, Flammarion, 1998.
[11] Plus encore, Picasso ne reconnaissait à l’art africain qu’une valeur d’exorcisme vis-à-vis des formes classiques, dans la genèse du cubisme (Benoît de L’Estoile, Le Goût des Autres. De l’Exposition coloniale aux Arts premiers, Paris, Flammarion, 2007, p.233 ; Dagen op. cit.).
[12] James Clifford, « Histories of the Tribal and the Modern », The Predicament of culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art, Cambridge, Harvard University Press, 1988, pp. 201-2. B. de L’Estoile (op. cit., p. 233) montre également que les surréalistes et autres amateurs des années 1920 appréciaient d’autant plus les qualités formelles des objets d’art primitif qu’ils restaient fascinés par l’imaginaire de peurs et d’affects qui caractérisaient censément la « mentalité primitive », selon Lévy-Bruhl.
[13] Jagdish Swaminathan (ed.), The Perceiving Fingers. Catalogue of Roopankar Collection of Folk & Adivasi Art from Madhya Pradesh, India, Bharat Bhavan – Bhopal, All India Handicrafts Board – New Delhi, 1987, p. 30. Il cite à ce sujet André Malraux, ainsi que Carl G. Jung.
[14] John H. Bowles, Painted Songs & Stories. The Hybrid Flowerings of Contemporary Pardhan Gond Art, Bhopal, INTACH, Bhopal Chapter, 2009, p. 22 et note 27.
[15] En 1999, il est invité par exemple à collaborer avec un artiste aborigène australien lors d’un atelier co-organisé par le Craft Museum et l’ambassade d’Australie : Denis Vidal, « A Tribal Tradition is born : the emergence of post-primitivism in popular indian painting », 2010 [version actualisée d’une communication à Pondichery en 1993], 20p.
[16] Selon Hervé Perdiolle, Yves Véquaud, poète promoteur des peintures féminines du Mithila, était l’un des deux chargés de mission pour l’Inde. Hélène Fleury clarifie la biographie de cet auteur dans deux publications à venir.
[17] Notons qu’elle fait suite à une exposition intitulée « Traditional to contemporary », sur les peintures du Mithila, en mars 2010.
[18] Salman Rushdie, « Damme This Is the Oriental Scene For You ! », New Yorker, June 23, 1997, pp. 50-56. Les remarques de Naipaul ont été formulées lors de discussions à la Conférence « At Home in the World » (New Delhi – Neemranah, Rajasthan), en 2002, publiées in K. Satchidanandan et al. (eds.), At Home in the World, New Delhi : Indian Council for Cultural Relations, 2005, pp. 8-14, 123-124, 131-134. Voir Kumkum Chatterjee, « Indian » Literatures Today : English and Bhasha Literatures in an Uneasy Relationship, Review of Iyer, Nalini ; Bonnie Zare (eds.), Other Tongues: Rethinking the Language Debates in India, H-Asia, H-Net Reviews. July, 2011.
[19] Ainsi, par exemple, un mouvement littéraire adivasi est né au Gujarat, sous l’impulsion du militant (et professeur de littérature anglaise) Ganesh N. Devy (ed.), Painted Words. An Anthology of Tribal Literature, Penguin Books (2002), défenseur indéniable de la cause tribale, mais dont les premiers écrits tendent à une vision atemporelle des adivasi.