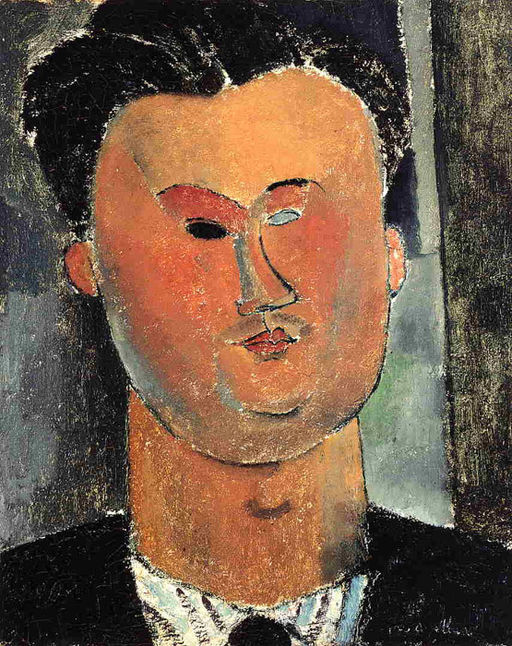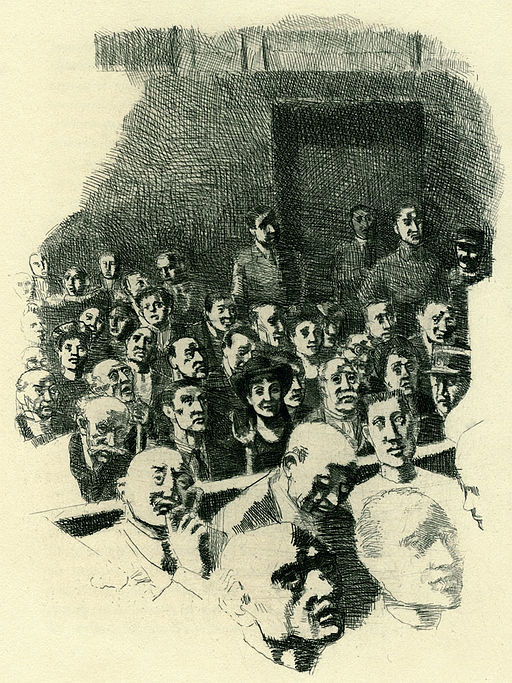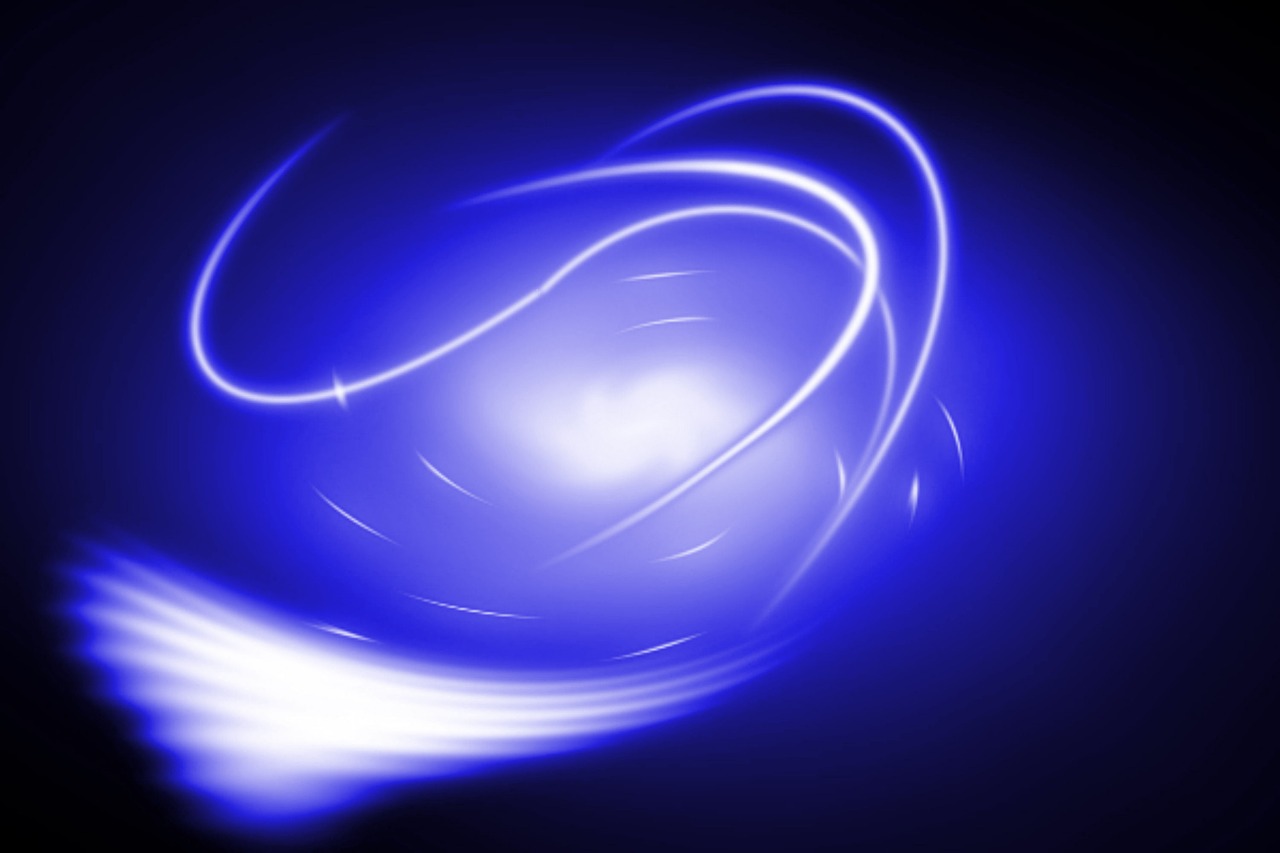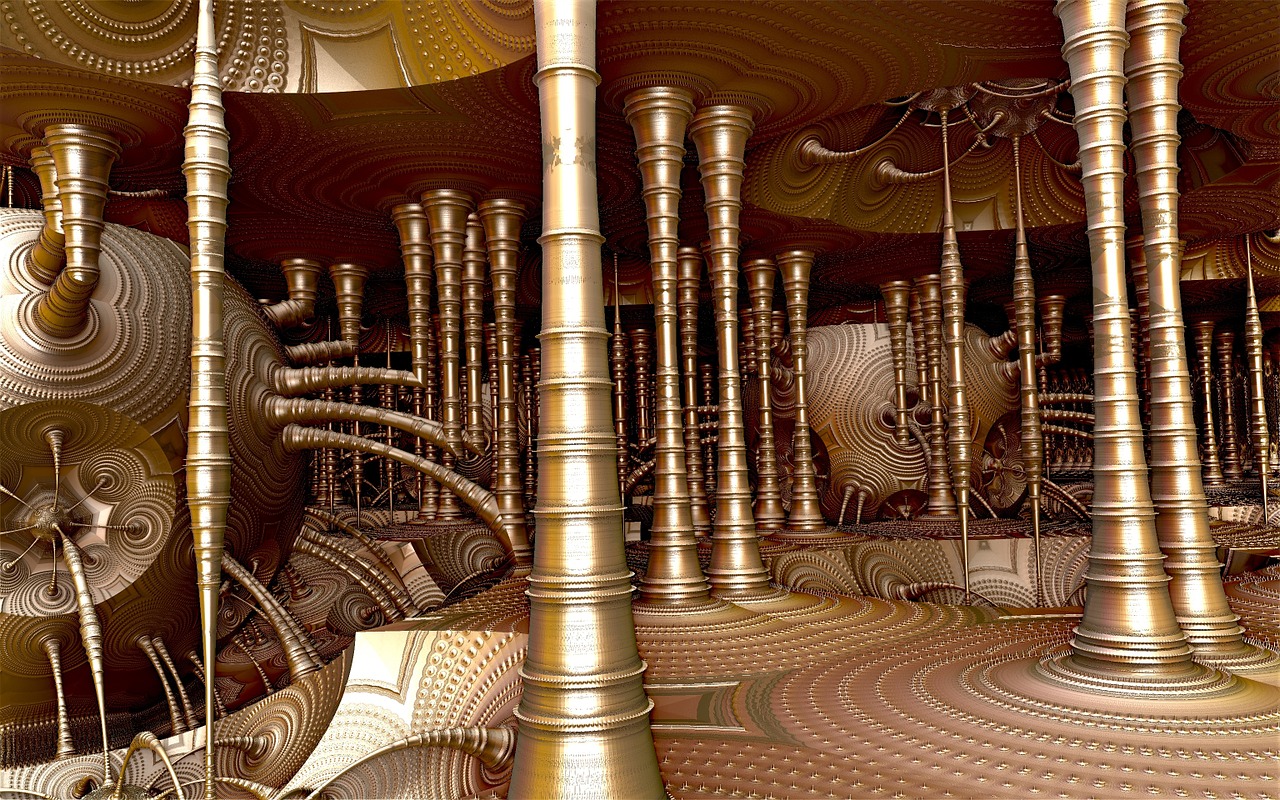Un roi sans divertissement de Jean Giono
Senda Souabni Jlidi, Université de Tunis I
Varia du dossier L’absurde au prisme de la littérature, les vignettes présentent, sous forme de brèves, quelques unes des œuvres emblématiques du mouvement littéraire de l’absurde.
Dans Un roi sans divertissement, publié en 1947 et écrit en un peu plus d’un mois, du 1er septembre au 10 octobre 1946, Jean Giono situe l’histoire un hiver de 184… dans un village de montagne. Une série de disparitions se produit dont le coupable reste introuvable jusqu’à ce qu’arrive un capitaine de gendarmerie qui se charge de l’enquête : Langlois. L’intrigue pourrait être simplement policière si les motivations du meurtrier et celles du policier n’étaient pas d’un autre ordre que celles qui d’ordinaire régissent ce genre. Le titre et la phrase de clausule[1] qui renvoient à Pascal donnent au texte une résonnance qui situe l’enquête sur un plan différent de celui commun aux romans policiers.
De fait, s’il s’agit bien de meurtres et de disparitions, il s’agit aussi d’occuper « le vide d’un monde insubstantiel » tel que l’affirme Robert Ricatte[2]. Dans ce village que la neige ensevelit pour de longs mois d’inactivité et d’ennui, le blanc devient synonyme de vide à remplir et d’angoisse à dissiper. Car cette nature rendue soudain hostile n’est pas tant une menace physique qu’une atteinte à l’être même, mettant l’homme face à soi, l’obligeant à une confrontation qui, pour le dire comme Pascal, fait réfléchir au :
Malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable, que rien ne peut nous consoler, lorsque nous y pensons de près[3].
C’est en cela qu’Un roi sans divertissement module de façon fort originale la thématique de l’absurde et doit se lire comme une protestation contre la condition humaine.
Giono ne démontre pas. Il raconte – d’ailleurs de façon fort lacunaire pour garder aux personnages tout leur mystère – le tâtonnement au bout duquel le gendarme finit par comprendre les motivations du meurtrier : s’il tue c’est par fascination pour le rouge du sang contrastant avec le blanc de la neige, y trouvant un remède à l’ennui distillé par un hiver qui semble ne jamais vouloir finir. Introduisant ainsi le motif esthétique, Giono fait le pari que seul le recours au Beau est salutaire dans une condition désespérée.
Plus innocemment, les villageois – prisonniers dans un village que la neige rend inaccessible de l’extérieur mais également paralysés de peur à l’idée d’être surpris par le meurtrier – rêvent, cloîtrés et oisifs, d’un « monde aux couleurs du paon[4] ». La couleur, négation du blanc assimilé au linceul de neige qui recouvre le village et y fige toute vie, est la possibilité d’introduire dans « l’hostilité primitive du monde[5] », un divertissement, c’est-à-dire une possibilité de détourner l’esprit de la pensée tragique de la mort. La couleur se charge d’apporter une consolation à l’absurdité de l’existence.
C’est pourquoi le narrateur d’Un roi sans divertissement qui a vite compris que l’interprétation la plus probante des crimes commis échappe aux raisons admises et conventionnelles dans ce genre d’affaire, situe son enquête sur le plan de la Beauté non sur celui de la Vérité. Il rejette par exemple le point de vue – prosaïque – de son ami historien pour faire de l’acte meurtrier une réponse au néant[6]. Si l’assassin tue c’est donc pour apposer son empreinte sur un monde qui le nie. Le meurtre pourrait être compris comme la réponse à ce « silence déraisonnable du monde[7] » dont parle Camus dans Le Mythe de Sisyphe.
Ainsi donc, dans ce roman qui illustre le tragique de la conscience quand elle prend acte de l’absurde, le but de Giono n’est pas, malgré le titre, de se rallier à Pascal et de trouver le salut dans la pensée de Dieu, mais de montrer que la tentative la plus aboutie, la seule digne d’être retenue pour contrer l’absurde est le geste esthétique. En faisant couler le sang de ses victimes sur la neige, le meurtrier se crée par ce spectacle hypnotique les conditions du bonheur. Que ce bonheur soit temporaire, illusoire, factice, là n’est pas la question et d’ailleurs les victimes potentielles sont légion. Le temps de l’extase, tiré hors de lui-même, diverti, le meurtrier dépasse les limites de la condition humaine et échappe à la finitude. Dans l’espace illimité de la neige sans contours ni repères, il inscrit son désir d’absolu. Il existe alors hyperboliquement.
Giono ne se soucie pas de morale. Peu importe que la victime soit innocente. La question n’affleure jamais dans le texte. La réflexion esthétique exclut la réflexion éthique. Le narrateur affirme, entrant dans les raisons du criminel :
[…] je veux dire qu’il est facile d’imaginer, compte tenu des cheveux très noirs, de la peau très blanche, du poivre de Marie Chazottes, d’imaginer que son sang est très beau. Je dis beau. Parlons en peintre[8].
Par ailleurs, le désir de cruauté est inscrit dans tous les hommes. Il ne s’agit pas d’en discuter. Giono le note comme une évidence. L’affirmation que M.V., l’auteur des crimes est un « homme comme les autres[9] » n’est pas une condamnation de tous les hommes mais le constat qu’ils répondent aux insuffisances de la condition humaine par les moyens qui leur sont donnés, en particulier par cette part de monstruosité naturelle à tout un chacun. Par cette illustration de la « banalité du mal », Un roi sans divertissement fait allégeance au contexte qui l’a vu naître.
Cependant, n’est pas roi qui veut. Le meurtre conjurateur de l’ennui dans Un roi sans divertissement est le fait de ces âmes d’exception – que Giono appelle les « âmes fortes[10] » – qui font fi des normes aussi bien humaines que divines et bousculent les limites qui leur sont imparties. En tuant, M.V. est un roi qui se divertit. En acceptant d’être tué par Langlois qui reconnaît en lui un homme au-dessus de la loi puisqu’il ne le livre pas à la justice, il paye le tribut de cette transgression et montre que le défi lancé à la condition humaine vaut bien qu’on en meure. C’est sans doute cela que Langlois comprend dans l’ultime et silencieux face à face avec M.V. Devenant son frère, son semblable, contaminé par le vertige existentiel, confronté à l’absurdité d’une existence devenue étriquée et dont le sens en dehors de l’acte de tuer est absent, se sentant incapable de résister plus longtemps à l’attrait du meurtre, ayant essayé en vain des divertissements moins royaux, Langlois se suicide en fumant un bâton de dynamite.
Mais quel hommage plus grand à l’art que celui que lui rend Giono en en faisant le divertissement par excellence, celui qui sublime la peine de vivre et de mourir ? Car l’auteur sait bien que « la conscience c’est l’ennui[11] » et qu’il est un besoin vital pour l’homme de trouver à s’en détourner. Dans une boutade qui n’en est peut-être pas une Giono affirme :
Le cinéma (j’entends par cinéma toute industrie d’illusion) nous permet d’accomplir nos crimes sans fatigue, sans danger, dans un fauteuil. Ajoutons que ce fauteuil aide à l’usage de la métaphysique dans la vie courante […][12].
M.V., homme d’avant le cinéma, devait, lui, parcourir de grandes étendues, quittant son village pour le village voisin, traversant la montagne à la lisière des nuages, pour obtenir cette divine satisfaction. Affronter l’absurde ne va pas sans risque ni fatigue.
[1] « Qui a dit : Un roi sans divertissement est un homme plein de misères ? », Œuvres romanesques complètes, III, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de La Pléiade », p. 606. Dorénavant ORC.
[2] « Le genre de la chronique » in ORC, p. 1288.
[3] Fragment 139 des Pensées dans l’édition Brunschvicg.
[4] ORC, p. 459.
[5] Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, in Essais, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de La Pléiade », 1965, p. 108. Edition établie et annotée par Roger Quilliot et Louis Faucon.
[6] « Evidemment, c’est un historien ; il ne cache rien : il interprète. Ce qui est arrivé est plus beau, je crois. » ORC, p.458.
[7] « L’absurde naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde. » Albert Camus, Essais, op.cit., p. 117-118.
[8] ORC, p. 480.
[9] Affirmation plusieurs fois réitérée dans le récit.
[10] Titre d’une Chronique de Giono mais appellation qui peut s’appliquer aussi bien à M.V. qu’à Langlois.
[11] Le Désastre de Pavie, in Journal, Poèmes, Essais, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de La Pléiade », 1995, p. 931. Édition publiée sous la direction de Pierre Citron.
[12] Ibidem, p. 932.