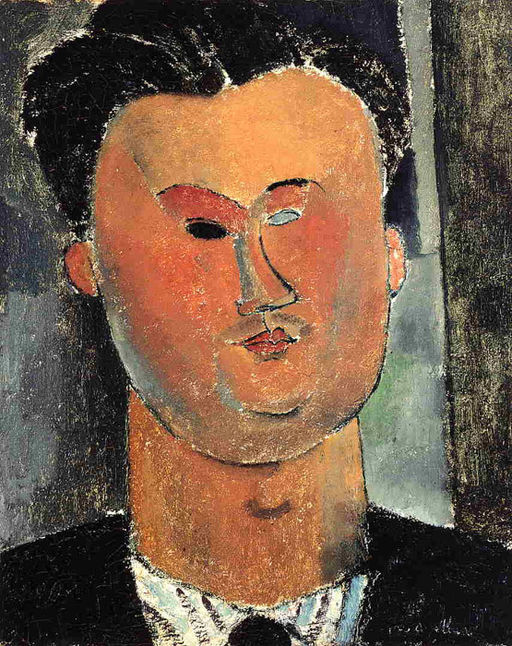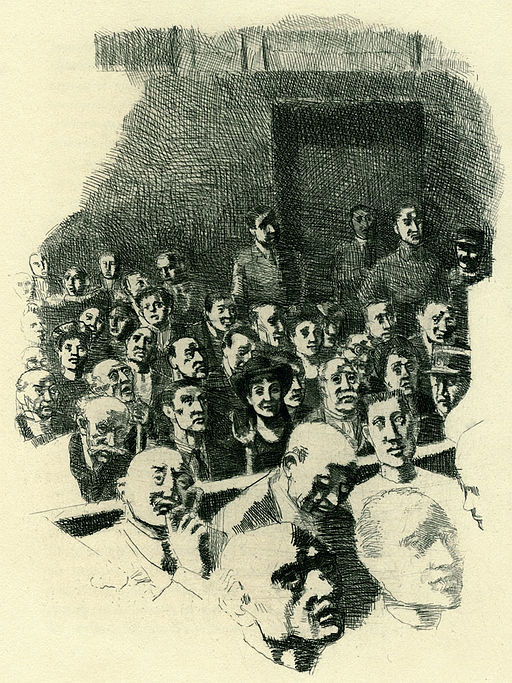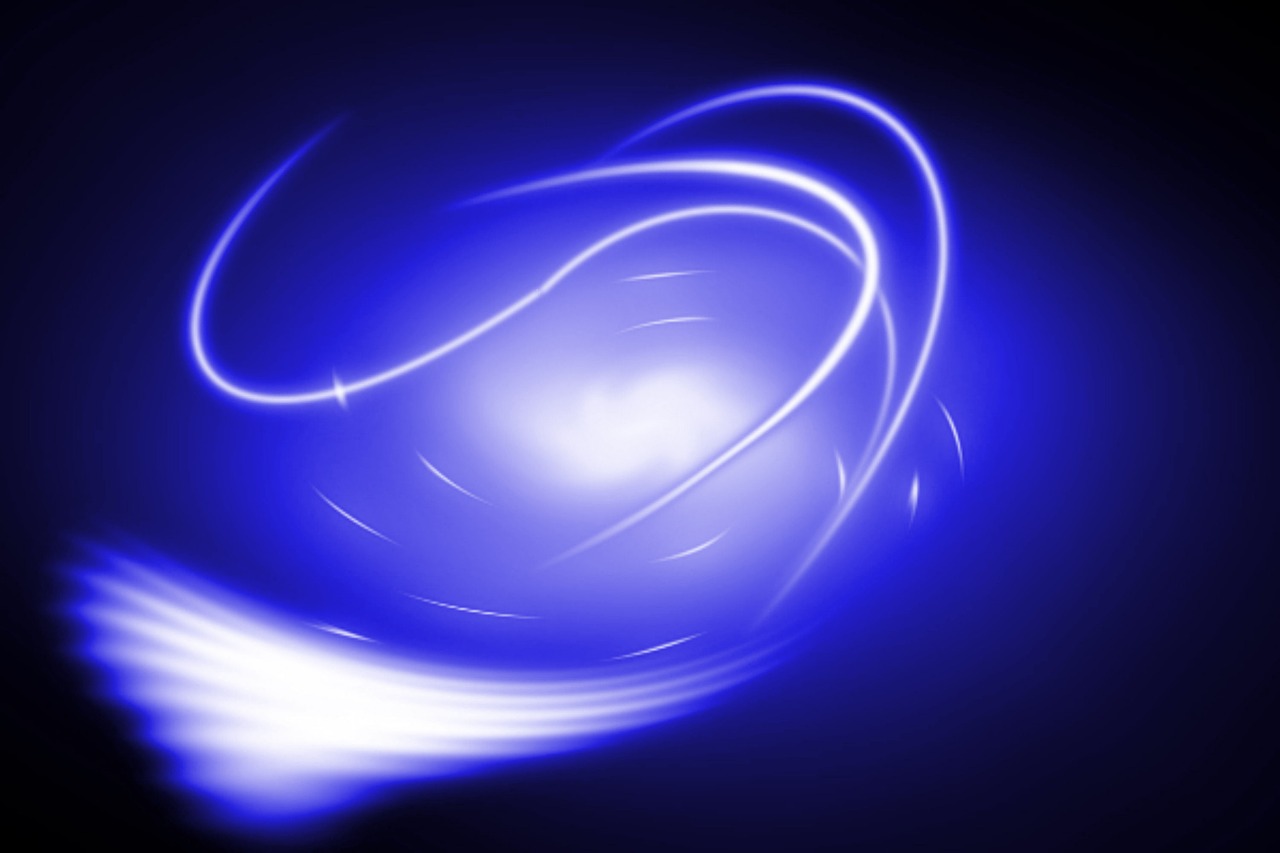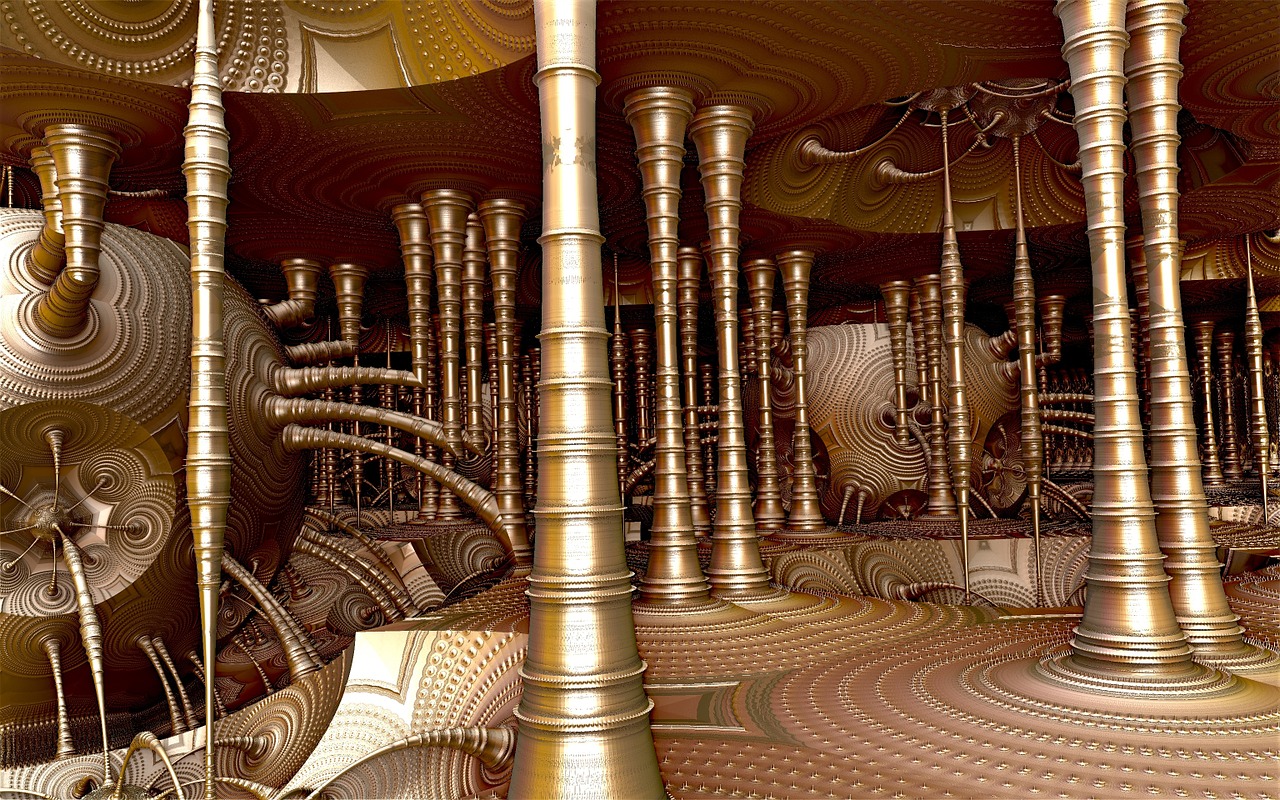Bataille absurde : de l’angoisse au rire
Guillaume Rousseau, professeur agrégé de Lettres Modernes, doctorant en littérature française du XXe siècle, Université de Pau et des Pays de l’Adour/ Université Paris IV-Sorbonne
Résumé : Dans cet article, nous nous proposons de mettre en lumière le caractère spécifiquement littéraire du sentiment de l’absurde dans les romans et récits de Georges Bataille (spécialement Madame Edwarda et Le Bleu du ciel). Par cet exemple, la fiction littéraire, en marge de la philosophie, se donne pour rôle de représenter une expérience impensable. Dans les œuvres romanesques de Bataille, l’absurde se place d’abord sous le signe de l’angoisse. En effet, Bataille s’inspire de Nietzsche en prenant acte de la mort de Dieu qu’il représente par l’image récurrente d’un ciel désormais vide. Désorientés, les personnages batailliens en proie à l’angoisse se retrouvent dans une situation d’impasse où ils ne peuvent que crier leur désespoir. Cependant, cette angoisse est finalement dépassée par un rire souverain qui non seulement admet le non-sens mais l’approuve.
Abstract: In this article, we intend to emphasize the literary specificity of the Absurd in Georges Bataille’s novels (Madame Edwarda and Le Bleu du ciel). On the fringes of philosophy, literature aims at representing an unfathomable experience. In Bataille’s fictional works, the Absurd is similar to the anguish. Indeed, Bataille rewrites Nietzsche’s « God is dead » creed with the metaphor of an empty sky. Disorientated, Bataille’s characters are now faced with a dead-end where they can only scream out in despair. However, this anguish is finally overcome by outright laughter which admits and condones nonsense.
Ma vie n’a de sens qu’à la condition que j’en manque ; que je sois fou : comprenne qui peut, comprenne qui meurt…[1]
Dans Le Livre à venir, Maurice Blanchot définit le récit de Georges Bataille à partir du scandale. Une scène capitale de Madame Edwarda (1941) permet d’en comprendre la portée : le personnage éponyme, une prostituée, exhibe devant le narrateur son sexe béant tout en déclarant être Dieu. La contradiction entre le très haut et le très bas, entre le vulgaire et le sacré confine bien évidemment au non-sens[2] et le narrateur, en retour, croit devenir fou face à cette double révélation. Mais, au-delà de cette scène, c’est le récit tout entier qui est frappé par ce sentiment d’absurde. Dans ce récit qui ne conte rien d’autre que la poursuite d’Edwarda par le narrateur dans la nuit obscure, ce dernier finit par déclarer : « M. Non-Sens écrit, il comprend qu’il est fou : c’est affreux[3]. » Auteur véritable du texte de Bataille, cette allégorie littéraire de l’absurde résiste à la récupération philosophique : « Mais sa folie, ce non-sens – comme il est, tout à coup, devenu « sérieux » : – serait-ce là justement « le sens » ? (non, Hegel n’a rien à voir avec l’ »apothéose » d’une folle…)[4]. » Au fond, l’absurde qui s’écrit dans les récits de Bataille relève d’une démarche spécifiquement littéraire. Aux côtés de Madame Edwarda, M. Non-Sens impose son expérience du monde, vérité que ne saurait réfuter Hegel et son système[5].
Notre propos sera donc d’essayer de comprendre le (non-)sens de cette expérience de l’absurde qui s’écrit en marge de la philosophie.
Nous voudrions d’abord proposer une origine à ce sens dérobé en montrant comment l’épisode nihiliste de la mort de Dieu chez Nietzsche se retrouve dans le texte bataillien avec la vision sidérante d’un ciel vide. Nous montrerons ensuite qu’au-delà de la désorientation, l’angoisse se traduit par un sentiment d’impasse où le personnage bataillien ne peut que crier sa détresse. Cependant, nous expliquerons qu’il reste toujours la possibilité de triompher de l’absurdité de la condition humaine par un rire souverain.
Le retour de Nietzsche : de la mort de Dieu au ciel vide
On a vu dans l’introduction comment le philosophe par excellence, Hegel[6], était repoussé à la marge du récit – comme s’il était dépassé par la vérité absurde. C’est finalement dans la philosophie de Nietzsche que Bataille va découvrir l’origine du sentiment d’absurde.
À n’en pas douter, celui qui apparaîtra pour Bataille comme un frère ou comme un double s’inscrit en faux contre la tradition philosophique[7]. À ce sujet, il est essentiel de souligner que Bataille a pu découvrir Nietzsche par l’entremise de Léon Chestov[8]. Dans l’un de ses ouvrages importants, La Philosophie de la tragédie, le philosophe russe place Nietzsche aux côtés de Dostoïevski et révèle chez ces deux auteurs, par-delà la philosophie et la littérature, une même vérité anti-idéaliste : l’existence tragique de l’homme qu’il s’agit de regarder bien en face, sans lui opposer quelque idéal que ce soit. Indéniablement, la scène de la mort de Dieu du Gai savoir, où le fou adresse un cri angoissé à l’ensemble de l’humanité, représente bien cette philosophie tragique de l’existence :
N’avez-vous pas entendu parler de ce fou qui allumait une lanterne en plein midi, puis se mettait à courir sur la grand’place en criant sans arrêt : « Je cherche Dieu ! je cherche Dieu ! » Comme beaucoup de ceux qui s’étaient assemblés là étaient de ceux qui ne croient pas en Dieu, il provoqua un grand éclat de rire. L’aurait-on égaré ? disait l’un. S’est-il perdu comme un enfant ? disait l’autre. Ainsi s’écriaient-ils, ainsi riaient-ils entre eux. Le fou sauta au milieu d’eux et les perça de ses regards : « Où est allé Dieu ? cria-t-il, je vais vous le dire : nous l’avons tué – vous et moi ! Nous tous, nous sommes ses meurtriers !
Mais comment avons-nous fait cela ? Comment avons-nous pu épuiser la mer ? Qui nous a donné l’éponge pour effacer l’horizon entier ? Qu’avons-nous fait quand nous avons détaché cette terre de son soleil ? Où donc se dirige-t-elle à présent ? Où nous dirigeons-nous ? Loin de tous les soleils ? Est-ce que nous ne tombons pas sans cesse ? En arrière, de côté, en avant, de tous les côtés ? Y a-t-il encore le haut et le bas ? Ne sommes-nous pas portés au hasard dans un néant sans fin ? »[9]
Par sa dramatisation, par la force de son imaginaire comme par exemple cette lanterne qui éclaire en plein jour, notons d’emblée que cette scène paraît davantage littéraire que philosophique. Mais elle l’est surtout par le fait que la mort de Dieu – qui traduit l’effondrement du système idéaliste, la garantie de la valeur – n’est pas un concept. Elle se donne précisément dans son caractère insaisissable de telle sorte qu’on en fait l’expérience : une expérience de la désorientation, de la perte de repères. Bataille évoque encore ce passage dans un entretien à la fin de sa carrière littéraire :
Pour Nietzsche, ce qu’il a appelé la mort de Dieu laissait un vide terrible, quelque chose de vertigineux, presque, et de difficilement supportable. Au fond, c’est à peu près ce qui arrive la première fois qu’on prend conscience de ce que signifie, de ce qu’implique la mort : tout ce qu’on est se révèle fragile et périssable, ce sur quoi nous basons tous les calculs de notre existence est destiné à se dissoudre dans une espèce de brume inconsistante[10]…
Autrement dit, la mort de Dieu n’est pas le signe d’un athéisme serein, au contraire, elle révèle, dans le ciel, un vide impossible à combler, plongeant l’homme dans l’angoisse, le déchirant. Une telle révélation marque Bataille et l’on ne s’étonnera pas d’en trouver la trace dans ses fictions avec l’image du ciel vide.
Dans Madame Edwarda, il est ainsi question d’un « ciel étoilé, vide et fou[11] ». Dans cette formule condensée, chaque qualificatif est déterminant et leur juxtaposition forme un paradoxe des plus surprenants : comment un ciel étoilé peut-il être vide ? Bataille précise le sens de son image frappante quelques pages plus loin alors que Madame Edwarda semble totalement absente : « Comme si je l’éveillais, elle prononça d’une voix sans vie : « Où suis-je ? » / Désespéré, je lui montrai sur nous le ciel vide. Elle regarda : un instant, elle resta, sous le masque, les yeux vagues, perdus dans des champs d’étoiles[12]. » Par le jeu des oracles, les hommes de l’Antiquité cherchaient dans le ciel des réponses… mais la question que pose Edwarda montre que nous ne sommes plus désormais dans le même monde. Après la mort de Dieu, il n’est plus possible de répondre à la question la plus simple : « Où suis-je ? » L’expérience de la désorientation trouve sa réponse sans espoir dans le geste du narrateur qui illustre au sens propre le paradoxe d’un ciel sans Dieu. Le nombre incalculable d’étoiles (le ciel étoilé) est signe de perdition (le ciel fou) et conduit au vide de l’absence. L’infini du ciel étoilé signe la fin d’un monde de valeurs : désormais tout se vaut – à l’image de Dieu, l’ancienne valeur suprême, et d’une prostituée. Les étoiles ont remplacé le soleil, image de Dieu, image du Souverain Bien. Bataille, en somme, prolonge Nietzsche : le fou cherchait encore Dieu dans le ciel de midi, mais la lanterne annonçait déjà la nuit de Bataille.
Cette inversion du ciel diurne en ciel nocturne a justement lieu de façon exemplaire dans Le Bleu du ciel, roman de Bataille au titre évocateur publié en 1957 mais dont la première version date de 1935. À l’heure où l’Europe est en proie à la montée irrépressible du fascisme, l’histoire retrace le parcours erratique du narrateur, Troppmann, qui ne parvient à se défaire d’un état dépressif, témoignant de son angoisse existentielle. La scène suivante, où s’explicite l’ironie du titre, développe l’image du ciel étoilé de Madame Edwarda pour nous renvoyer au ciel de midi :
Je descendis de la voiture et ainsi je vis le ciel étoilé par-dessus ma tête. Après vingt années, l’enfant qui se frappait à coups de porte-plume attendait, debout sous le ciel, dans une rue étrangère, où jamais il n’était venu, il ne savait quoi d’impossible. Il y avait des étoiles, un nombre infini d’étoiles. C’était absurde, absurde à crier, mais d’une absurdité hostile. […] Je me rappelai avoir vu passer, vers 2 heures de l’après-midi, sous un beau soleil, à Paris – j’étais sur le pont du Carroussel – une camionnette de boucherie : les cous sans tête de moutons écorchés dépassaient des toiles et les blouses rayées bleu et blanc des bouchers éclataient de propreté. Quand j’étais enfant, j’aimais le soleil : je fermais les yeux et, à travers les paupières, il était rouge. Le soleil était terrible, il faisait songer à une explosion : était-il rien de plus solaire que le sang rouge coulant sur le pavé, comme si la lumière éclatait et tuait ? Dans cette nuit opaque, je m’étais rendu ivre de lumière […] Mes yeux ne se perdaient plus dans les étoiles qui luisaient au-dessus de moi réellement, mais dans le bleu du ciel de midi[13].
Il nous faut donc passer par la réminiscence du temps de l’enfance pour expliquer le vide du ciel. À la suite du Gai savoir, ce texte a valeur de révélation. Là où la « nuit opaque » n’ouvre que sur l’absurde – terme répété et dérivé en « absurdité hostile » –, le ciel diurne et son soleil vont révéler la vérité sur la mort de Dieu qu’on présupposait jusqu’alors dans le ciel vide. Le texte ouvre ainsi sur la vision sidérante du soleil explosif qui laisse sans voix (infans). Commentant la parabole de Nietzsche, Bataille montre en quoi le personnage de l’insensé ne saurait se confondre avec les athées :
Ce sacrifice que nous consommons se distingue des autres en ceci : le sacrificateur est lui-même touché par le coup qu’il frappe, il succombe et se perd avec la victime. Encore une fois : l’athée est satisfait d’un monde achevé sans Dieu, ce sacrificateur est, au contraire, dans l’angoisse devant un monde inachevé, inachevable, à jamais inintelligible, qui le détruit, le déchire (et ce monde se détruit, se déchire lui-même)[14].
De la même manière, dans la scène du Bleu du ciel, l’enfant n’a rien à voir avec les bouchers : regardant le soleil, l’enfant s’ouvre à la vérité sanglante du sacrifice ce que ne peuvent faire les bouchers avec leurs « blouses rayées bleu et blanc » – le bleu du ciel et ses nuages – qui tuent comme si de rien n’était. Suivant le fou de Nietzsche, l’enfant, plongé dans l’angoisse, reconnaît sa faute. Mieux encore, avec la mention de la main blessée par le porte-plume[15], Bataille, par-delà Troppmann, parle au nom d’une littérature qui plaide coupable – ce qui sera le thème majeur de La Littérature et le Mal. Reprenant en son nom le gouffre absurde qui résulte de la mort de Dieu, l’écrivain se voue à l’« impossible »[16] :
À la place de Dieu…
il n’y a
que
l’impossible
et non Dieu…[17]
L’impasse absurde de l’angoisse : non-sens criant
Perdu d’angoisse, le personnage bataillien en proie à l’absurde se trouve placé dans une situation impossible qui est celle de l’impasse. Nous avons vu qu’il fait l’épreuve d’une désorientation mais il est surtout pris au piège, comme bloqué – ce que soulignent au mieux les premières lignes des œuvres de Bataille. Présenter le début d’une œuvre comme impasse n’a rien d’anodin : l’incipit qui devrait ouvrir l’horizon du récit se referme aussitôt sur l’angoisse du personnage. Le modèle de ce point de vue est donné par les premiers mots de Madame Edwarda : « Au coin d’une rue, l’angoisse, une angoisse sale et grisante, me décomposa (peut-être d’avoir vu deux filles furtives dans l’escalier d’un lavabo)[18]. » L’angoisse a son lieu initial, l’impasse : l’espace ouvert de la rue est réduit à son coin – fermé. Si l’on perd la percée de la rue, c’est précisément parce que l’angoisse fait face au narrateur. On ne peut être que sensible à la finesse de l’écriture de Bataille qui, pour désigner l’angoisse, inverse l’ordre habituel des articles définis et indéfinis. Le choix de l’article défini à l’initiale permet d’imposer cette angoisse, impression accentuée par le fait que celle-ci occupe la place de/du sujet. Le deuxième liminaire qui précède immédiatement l’incipit peut alors s’éclairer : « MON ANGOISSE EST ENFIN L’ABSOLUE SOUVERAINE[19]. » Le héros bataillien est déjà défait par l’angoisse, étant acculé dans l’impasse. Le Bleu du ciel, qui s’ouvre sur trois compléments circonstanciels de lieu, reprend également cet imaginaire : « Dans un bouge du quartier de Londres, dans un lieu hétéroclite des plus sales, au sous-sol, Dirty était ivre[20]. » Le lecteur s’enfonce petit à petit dans ce lieu sordide du sous-sol[21] qui n’est qu’une variante verticale de l’impasse. Le caractère laconique de la proposition principale renvoie au fin fond de la déchéance. Le narrateur s’empresse d’ailleurs d’ajouter : « Elle l’était au dernier degré[22]. » Engagée dans la voie de l’ivresse, Dirty en arrive à un point de non-retour. Pour l’héroïne ainsi que pour le narrateur qui l’accompagne, l’ivresse n’est autre que l’approfondissement du non-sens révélé de l’existence : « L’ivresse nous avait engagés à la dérive, à la recherche d’une sinistre réponse à l’obsession la plus sinistre[23]. »
Partant de cette définition de l’impasse comme allégorie spatialisée de l’existence absurde, Bataille généralise dans ses fictions les expressions « sans issue »[24] et « absence d’issue ». À chaque mention, le lecteur est amené à associer ces formules à l’image frappante de l’impasse. Ainsi, juste après la scène où le narrateur montre à Edwarda le ciel vide, la prostituée entre dans une violente crise épileptique où elle finit par arracher ses propres vêtements :
Sa nudité, maintenant, avait l’absence de sens, en même temps l’excès de sens d’un vêtement de morte. Le plus étrange – et le plus angoissant – était le silence où Madame Edwarda demeurait fermée : de sa souffrance, il n’était plus de communication possible et je m’absorbai dans cette absence d’issue – dans cette nuit du cœur qui n’était ni moins déserte, ni moins hostile que le ciel vide[25].
Avec cette vérité érotique de la mort qui se dévoile, avec Edwarda qui se mure dans son silence, le narrateur est donc de nouveau dans l’impasse, cette fois-ci au sens métaphorique. Cependant, il est essentiel de noter que cette « absence d’issue » se conjugue avec l’angoisse du « ciel vide ». La désorientation nietzschéenne propre à ce thème est d’ailleurs traduite par cette proposition pour le moins paradoxale : l’absence de sens de la nudité d’Edwarda est simultanément excès de sens[26]. C’est donc la même expérience – celle de l’angoisse – qui est en jeu.
Reste à comprendre pourquoi une telle expérience ne peut être que littéraire ou, pour le dire autrement, pourquoi la philosophie ne peut y accéder.
Dans cette perspective, il nous faut compléter notre définition de l’allégorie de l’impasse. Au sens spatial à nouveau, l’absence d’issue qu’est l’impasse se caractérise par le resserrement – la rue qui se referme – ce qui est, étymologiquement, la définition de l’angoisse (angustia[27]). Passant du lieu au personnage, le resserrement en vient à s’appliquer au corps : l’angoisse le noue de telle sorte que les héros batailliens en viennent souvent à manquer d’air. L’exemple majeur est bien sûr la crise d’épilepsie de Madame Edwarda dont nous avons déjà commencé à parler : « Elle commença de se tordre convulsivement. Elle souffrait, je crus qu’elle pleurait, mais ce fut comme si le monde et l’angoisse en elle étouffaient, sans pouvoir fondre en sanglots[28]. » L’étouffement que pressent le narrateur, Edwarda finit par le crier : « Elle vociféra d’une voix éraillée, impossible, elle criait au ciel et ses bras battaient l’air d’horreur : « J’étouffe, hurla-t-elle […] »[29]. » De même, Dirty ivre au dernier degré, sous les regards des hommes qui l’observent dans le bouge, ne peut elle aussi que crier : « « Qu’y a-t-il ? » cria-t-elle […] « Troppmann ! » cria-t-elle à nouveau[30]. » Dans ces deux premières occurrences de discours rapporté du roman, Bataille substitue à la neutralité du verbe « dire » l’intensité désespérée du verbe « crier ». En outre, les paroles elles-mêmes répondent au mieux au cri : un minimum de mots arrachés au silence pour dire le malaise intolérable de l’angoisse, de l’absurdité de la situation.
Bataille cependant ne s’arrête pas là : le cri ne se limite pas aux seuls discours rapportés. Avec les analyses de Roland Barthes sur L’Étranger de Camus, on sait que l’absurde a pu trouver dans l’écriture son expression (littéraire). Ce sera le cas également avec Bataille mais le choix stylistique qui caractérise notre auteur est à l’opposé de celui de Camus : face à la voix blanche de Meursault se tient une voix étranglée qui caractérise les différents narrateurs des récits de Bataille[31]. La maigreur de l’écriture est alors à même de retranscrire ce « cri d’une existence étouffée[32] ». Ainsi du narrateur de Madame Edwarda qui livre son angoisse aussi précisément que possible :
Je me trouvai absurde : Edwarda et moi n’avions pas échangé deux mots. J’éprouvai un instant de grand malaise. Je n’aurais rien pu dire de mon état : dans le tumulte et les lumières, la nuit tombait sur moi ! Je voulus bousculer la table, renverser tout : la table était scellée, fixée au sol. Un homme ne peut rien supporter de plus comique. Tout avait disparu, la salle et Madame Edwarda. La nuit seule[33]…
Un sujet et son attribut (l’absurdité) : tout est dit en quatre mots au début de ce paragraphe. L’explication qui suit n’empêche pas le cri de se reproduire. La révolte impossible – tout renverser – s’abolit finalement dans une phrase en suspens qui témoigne encore de l’angoisse du narrateur, phrase inachevée à l’image d’un cri qui s’étouffe à la limite du langage. L’aboutissement de ce cri de l’é-cri-ture est finalement le fragment qui triomphera notamment dans une œuvre comme L’Impossible.
Si finalement l’absurde est un cri, il s’oppose point par point à l’activité philosophique. Il faut d’abord reconnaître que cette expérience angoissante ne saurait s’appréhender comme concept : le cri s’y refuse, s’oppose au maintien du concept. Derrida d’ailleurs le notait bien : « Le philosophe s’aveugle au texte de Bataille parce qu’il n’est philosophe que par ce désir indestructible de tenir, de maintenir contre le glissement la certitude de soi et la sécurité du concept[34]. » On en vient alors à l’idée plus essentielle que le philosophe ne peut s’ouvrir à l’absurde de peur de perdre pied[35]. La philosophie devait être garante de la vérité, au regard de la fiction littéraire trompeuse – mais elle triche, nous dit Bataille. L’auteur peut reprocher à cette philosophie, reposant sur un socle de connaissances présupposées[36], d’interroger de façon « apaisée[37] ». Comme l’explique Robert Sasso, « Bataille suspecte l’interrogation philosophique d’être une clause de style ou, du moins, une ellipse de ce qu’implique toute mise en question radicale[38]. » Finalement, seul le cri de la fiction, que ce soit celui de l’insensé nietzschéen ou encore celui des personnages de Bataille, permet de tout mettre en cause : il renonce, à la limite, à la logique discursive pour s’ouvrir au non-sens du monde et de l’homme.
Rire souverain
Cependant, si l’absurde suscite le cri, il en appelle en définitive chez Bataille au rire, notion cardinale de son œuvre. Dans Méthode de méditation, Bataille marque sa différence avec Heidegger en affirmant le primat du rire sur l’angoisse[39]. Il faut reconnaître que le rire, à la suite du cri dont il semble être l’aboutissement, inquiète la philosophie : pur son inarticulé qui bien souvent échappe, le rire indique les dernières limites du langage et de la raison. Le rire a beau avoir été étudié par la philosophie depuis l’Antiquité jusqu’à Bergson, il reste toujours maintenu à bonne distance, relégué au titre de sujet mineur (quand il n’est pas tout bonnement occulté) par une philosophie nécessairement sérieuse[40]. Mais, plus fondamentalement, la philosophie est impuissante à saisir le rire : « Il n’y a pas de théorie du rire, il n’y en a qu’une expérience – déchirante, intimement explosive[41]. » En ce sens, la réflexion de Bataille à ce sujet ne pourra être qu’éclatée, à l’image du rire lui-même : le rire ne se laisse pas enchaîner dans une logique discursive suivie. Ce faisant, on comprend que la fiction littéraire a un rôle essentiel à jouer : par l’intermédiaire de ses personnages, elle est à même de représenter cette expérience impensable. Reste finalement à tenter de cerner ce rire – à défaut de le définir – et à comprendre son rapport à l’absurde.
Notons d’abord à la suite de Bataille[42] que son expérience du rire, le rire souverain, n’a rien à voir avec l’expérience commune qu’on peut en avoir. En particulier, son rire ne se limite pas aux enjeux d’une mécanique comique telle que l’a définie Bergson. Pour le comprendre, nous repartirons de l’« Introduction » du Bleu du ciel, d’où le rire de Dirty illumine l’ensemble du roman. Après l’entrée in medias res dans le bouge, le narrateur nous renvoie au début de soirée dans l’hôtel Savoy, où les deux héros sont déjà passablement alcoolisés. Dirty raconte alors tant bien que mal un souvenir à Troppmann : elle se souvient d’être déjà venue dans cet hôtel alors qu’elle avait douze ans. Sa mère était « archi-saoule[43] » ou, pour mieux dire, ivre-morte comme en témoigne la chute de la mère dans l’ascenseur : « « Il [le liftier] n’a pas ajusté la cage… la cage est allée trop haut… elle s’est allongée tout du long… elle a fait plouf… ma mère… » / Dirty éclata de rire et, comme une folle, elle ne pouvait plus s’arrêter[44]. » La chute cesse d’être un motif comique dans le cadre de cette situation absurde et intolérable. Le rire est bien évidemment discordant : c’est d’abord la sainte figure maternelle qui s’effondre mais aussi, plus profondément, l’être lui-même comme nous allons le voir.
Pour tenter de comprendre le sens de ce rire bataillien, il nous faut revenir à Nietzsche et à cette citation-clé que Bataille n’a de cesse de rappeler dans ses écrits théoriques : « Voir sombrer les natures tragiques et pouvoir en rire, malgré la profonde compréhension, l’émotion et la sympathie que l’on ressent, cela est divin[45]. » Nietzsche ne tombe pas dans le piège des autres philosophes, il livre une expérience du rire qu’a pu également connaître Bataille. Reprenons notre exemple : riant de sa mère jusque dans le décalage irrévérencieux (« elle a fait plouf »), Dirty sombre avec elle[46] en ce point où l’ivresse nous approche de la mort : « ma mère, elle, ne bougeait pas… elle avait les jupes en l’air… ses grandes jupes…, comme une morte[47]. » Plus loin, le rire de Dirty revient, toujours au sujet de sa mère : « Et Dirty éclata de rire d’une façon discordante, dans un vide, sans trouver d’écho[48]. » On aura noté ici l’effet de répétition qui met l’accent sur la nature explosive du rire : le rire est ce qui éclate, ce qui fêle la raison pour ouvrir à la limite de la folie. Mais il y a plus, comme le montre le dernier extrait, le rire s’épanouit dans l’espace du vide, dans l’espace d’un vide : il fait éclater le sens pour le faire se perdre dans le non-sens, « sans trouver d’écho ». Face à l’angoisse qui étreint le corps, le rire libère…
Dans Madame Edwarda, c’est le narrateur lui-même qui répond à l’angoisse par le rire :
J’acceptais, je désirais de souffrir, d’aller plus loin, d’aller, dussé-je être abattu, jusqu’au « vide » même. Je connaissais, je voulais connaître, avide de son secret, sans douter un instant que la mort régnât en elle.
Gémissant sous la voûte, j’étais terrifié, je riais :
« Seul des hommes à passer le néant de cette arche ! »[49]
Dans une prose aux accents volontiers mystiques, le narrateur s’engage dans la voie de la perdition en riant d’un rire absolu : « je riais ». Comme dans Le Bleu du ciel, Pierre Angélique s’élève au rire dans l’angoisse même (« j’étais terrifié ») pour sombrer jusqu’au « vide ». Poursuivant Edwarda, le narrateur poursuit son désir irrémédiablement et prend conscience de la nature tragique de l’érotisme. C’est Bataille lui-même qui, dans la « Préface », nous livre le secret de ce texte :
L’identité de l’être et de la mort, du savoir s’achevant sur cette perspective éclatante et de l’obscurité définitive. De cette vérité, sans doute, nous pourrons finalement rire, mais cette fois d’un rire absolu, qui ne s’arrête pas au mépris de ce qui peut être répugnant, mais dont le dégoût nous enfonce[50].
Au-delà de la porte saint Denis, le néant de l’arche se loge au fond du sexe d’Edwarda, lieu de « l’identité de l’être et de la mort ». Encore faut-il « pouvoir en rire » pour reprendre l’expression de Nietzsche et surtout pouvoir en rire d’un rire absolu, et non d’un rire de mépris face à un récit scandaleusement répugnant.
Rire pour finalement ouvrir les yeux, regarder en face la vérité absurde du monde – et en jouir[51]. Comme l’écrit François Warin, « le rire est la levée de l’angoisse, l’affirmation du nihil, l’accomplissement d’un nihilisme qui cette fois-ci apparaît comme la grâce suprême ou comme la « chance »[52]. » Le narrateur ne se contente pas d’accepter de souffrir, il le désire : le rire n’est plus simplement accord avec le non-sens mais « approbation du non-sens[53]. »
Conclusion
L’absurde est une expérience paradoxalement fondatrice dans l’œuvre de Bataille, particulièrement dans son œuvre littéraire. Il aura fallu le timbre si particulier de la voix des héros batailliens pour que s’exprime ce cri vibrant. Sans nul doute, c’est aussi l’expérience même de Bataille qui se joue dans ces voix étranglées. Par-delà leur caractère fictif, les récits fondent leur vérité sur un non-sens criant qui se communique au lecteur[54].
Au-delà du scandale évoqué en introduction, c’est aussi le malaise qui guette le lecteur partageant l’angoisse des personnages des récits de Bataille. Pourtant, cette expérience de l’absurde est aussi une « chance », point sur lequel nous voudrions insister dans cette conclusion. Comme son association avec le rire a pu le montrer, l’angoisse offre à l’homme la possibilité d’accéder in fine à la souveraineté, entendons par là qu’elle doit permettre de se libérer d’une existence nécessairement servile.
Voici le moment de revenir une dernière fois à la mort de Dieu. Bataille nous engage très clairement à vivre dans l’angoisse la béance de l’absence de Dieu dans la mesure où « ce vide […] est révélation du possible de l’homme, qui ne peut désormais qu’être totalité, non plus activité au service d’autrui[55]. » À la suite de l’insensé nietzschéen qui se demandait comment nous pouvions nous rendre dignes de ce meurtre, Bataille écrit « Dieu mort, je dois le remplacer[56]. » Ce que fait à merveille Edwarda qui n’est pas simplement Dieu mais « cette grandeur illimitée que l’idée de Dieu suggérait[57]. » C’est finalement ouvrir tous les possibles de l’homme jusqu’à le plonger, souverainement, dans l’impossible : « Dieu n’est rien s’il n’est pas dépassement de Dieu dans tous les sens ; dans le sens de l’être vulgaire, dans celui de l’horreur et de l’impureté ; à la fin, dans le sens de rien[58]… »
[1] Georges Bataille, Madame Edwarda, in Romans et récits, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2005, p.339. Désormais Madame Edwarda sera abrégé ME.
[2] Voir Maurice Blanchot, « Le récit et le scandale », in Le Livre à venir, Paris, Gallimard, « Folio essais », 1996, p.261.
[3] ME, p.338.
[4] Ibid., p.338-339.
[5] Bataille avait suivi à partir de 1934 les cours de Kojève sur La Phénoménologie de l’Esprit de Hegel à l’École des Hautes Études. Dès lors, l’œuvre monumentale de Hegel ne cessera de le fasciner…
[6] Pour Bataille, « personne autant que lui n’a étendu en profondeur les possibilités d’intelligence (aucune doctrine n’est comparable à la sienne, c’est le sommet de l’intelligence positive) » : Georges Bataille, L’Expérience intérieure, in Œuvres complètes, t.V, Paris, Gallimard, 1973, p.128.
[7] Voir Robert Sasso, Le Système du non-savoir. Une ontologie du jeu, Paris, Minuit, « Arguments », 1978 (spécialement le chapitre I : « Bataille et la philosophie ») ainsi que François Warin, Nietzsche et Bataille. La parodie à l’infini, Paris, Puf, « Philosophie d’aujourd’hui », 1994.
[8] Sur ce point, nous renvoyons plus spécifiquement au chapitre « TRISTI EST ANIMA MEA USQUE AD MORTEM » dans l’ouvrage de : Michel Surya, Georges Bataille, la mort à l’œuvre, Paris, Gallimard, « Tel », 2012.
[9] Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir, cité par Georges Bataille dans : L’Expérience intérieure, op.cit., p.175-176. Ce passage est également cité avec une autre traduction dans : Mémorandum, in Œuvres complètes, t.VI, Paris, Gallimard, 1973, p.219-220.
[10] Madeleine Chapsal, Envoyez la petite musique, Paris, Grasset, « Figures », 1984, p.238.
[11] ME, p.333.
[12] Ibid., p.334.
[13] Georges Bataille, Le Bleu du ciel, in Romans et récits, op. cit., p.175. Désormais Le Bleu du ciel sera abrégé BC.
[14] Georges Bataille, L’Expérience intérieure, op. cit., p.176.
[15] Pour cette interprétation, nous renvoyons également au passage qui précède immédiatement : « Je m’étais fait un certain nombre de blessures sales, moins rouges que noirâtres (à cause de l’encre). Ces petites blessures avaient la forme d’un croissant, qui avait en coupe la forme de la plume » (BC, p.175).
[16] Le terme est quasiment une signature de Bataille lui-même. Il en a fait notamment le titre d’un de ses récits. Sur cette problématique, voir par exemple Catherine Cusset, « Technique de l’impossible », in Denis Hollier (dir.), Georges Bataille après tout, Paris, Belin, « L’Extrême contemporain », 1995.
[17] Georges Bataille, Le Petit, in Romans et récits, op. cit., p.358.
[18] ME, p.329.
[19] Ibid., p.327.
[20] Le Bleu du ciel, p.113.
[21] Le sous-sol est également une référence intertextuelle à Dostoïevski comme Bataille le note juste après (Id.). Les Carnets du sous-sol étaient commentés dans l’ouvrage de Chestov déjà évoqué, La Philosophie de la tragédie.
[22] BC, p.113, nous soulignons. Voir encore à la page suivante l’introduction de l’analepse : « Avant d’être touchés par la boisson jusqu’au bout, […] » (Ibid., p.114).
[23] Idem.
[24] Soit par exemple cette citation prise dans L’Impossible qui montre bien comment l’impasse angoissante s’impose à l’existence : « Ma vie est sans issue : ce monde m’entoure de malaise » (Georges Bataille, L’Impossible, in Romans et récits, op. cit., p.536).
[25] ME, p.335.
[26] De la même manière, pour Bataille, une notion-clé comme le non-savoir n’est pas la négation du savoir mais la nuit du savoir qui intervient au terme du savoir, une fois le savoir épuisé. L’impasse du savoir ouvre sur une nuit infinie.
[27] Le premier sens du terme mentionné par le dictionnaire Gaffiot est spatial : « espace étroit (resserré), passage étroit, défilé… ».
[28] ME, p.334.
[29] Id.
[30] BC, p.113.
[31] Catherine Cusset souligne la réduction des personnages-narrateurs au statut de « voix » dans son article : « Technique de l’impossible », art. cit., p.180-181.
[32] Georges Bataille, « De l’existentialisme au primat de l’économie », in Œuvres complètes, t.XI, Paris, Gallimard, 1988, p.282. L’expression est employée à propos de Kierkegaard qui, par sa « protestation », est en mesure de s’opposer à une « philosophie inhumaine ».
[33] ME, p.330.
[34] Jacques Derrida, « De l’économie restreinte à l’économie générale. Un hégélianisme sans réserve », in L’Écriture et la Différence, Paris, Seuil, « Tel Quel », 1967, p.393.
[35] De façon symptomatique, dans une des dernières scènes du Bleu du ciel, Troppmann, faisant l’amour avec Dirty au-dessus d’un cimetière étoilé (image du ciel renversé), finit par chuter comme dans un vide. Voir BC, p.199-200.
[36] Voir par exemple ce que dit Bataille de Descartes dans L’Expérience intérieure.
[37] « Qu’importe la philosophie puisqu’elle est cette contestation naïve : l’interrogation que nous pouvons faire apaisés ! » (Georges Bataille, L’Impossible, op. cit., p.509).
[38] Voir Robert Sasso, op. cit., p.30.
[39] « je suis parti du rire et non, comme le fait Heidegger dans Was ist Metaphysik ? Heidegger, de l’angoisse » (Georges Bataille, Œuvres complètes, t.V, op. cit., p.217).
[40] Voir le chapitre 3 de l’ouvrage Nietzsche et Bataille, op. cit., de François Warin : « De Dieu. Baubô et le rire de Déméter. Du gai savoir au non-savoir ».
[41] Mikkel Borch-Jacobsen, « Bataille et le rire de l’être », Critique, n°488-489 (« Quatre essais sur le rire »), janvier-février 1988, p.21.
[42] Georges Bataille, « Non-savoir, rire et larmes », in Œuvres complètes, t.VIII, Paris, Gallimard, 1976, p.224.
[43] BC, p.114.
[44] Id.
[45] Ce passage est maintes fois cité par Bataille, même s’il est parfois tronqué. Nous le citons ici d’après l’« Avant-propos » de L’Expérience intérieure, op.cit., p.9.
[46] « Le rire n’est pas divin et souverain parce qu’il surplombe la misérable finitude humaine, mais bien parce qu’il s’y laisse entraîner et tombe avec elle dans l’impossible, dans la nuit » : Mikkel Borch-Jacobsen, « Bataille et le rire de l’être », art. cit., p.32.
[47] BC, p.114.
[48] Ibid., p.117.
[49] ME, p.334.
[50] ME, p.319.
[51] Voir encore la « Préface » à Madame Edwarda : « Si l’homme a besoin du mensonge, après tout, libre à lui ! […] Mais enfin : je n’oublierai jamais ce qui se lie de violent et de merveilleux à la volonté d’ouvrir les yeux, de voir en face ce qui arrive, ce qui est » : Ibid., p.318.
[52] François Warin, Nietzsche et Bataille, op. cit., p.330.
[53] Ibid., p.97.
[54] Voir la « Préface à la deuxième édition » de L’Impossible.
[55] Bataille Georges, « André Masson », in Œuvres complètes, t.XI, op. cit., p.37.
[56] Ibid.
[57] Ibid.
[58] « Préface » à Madame Edwarda, p.320.