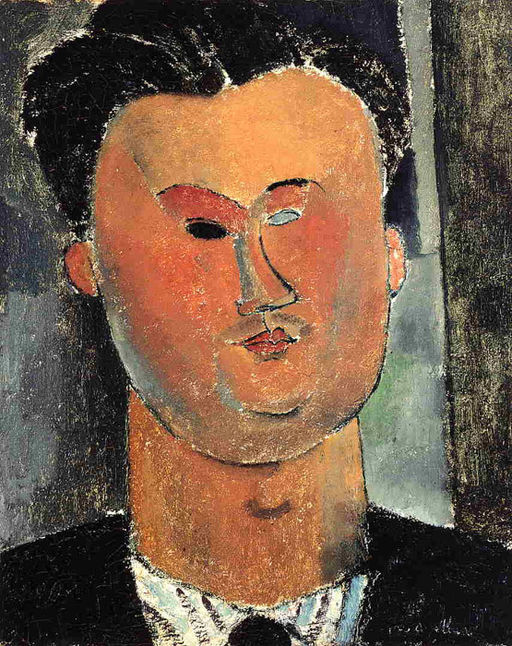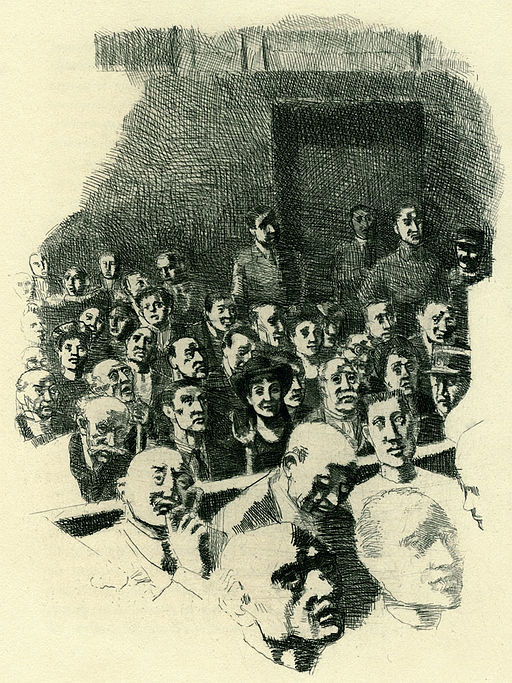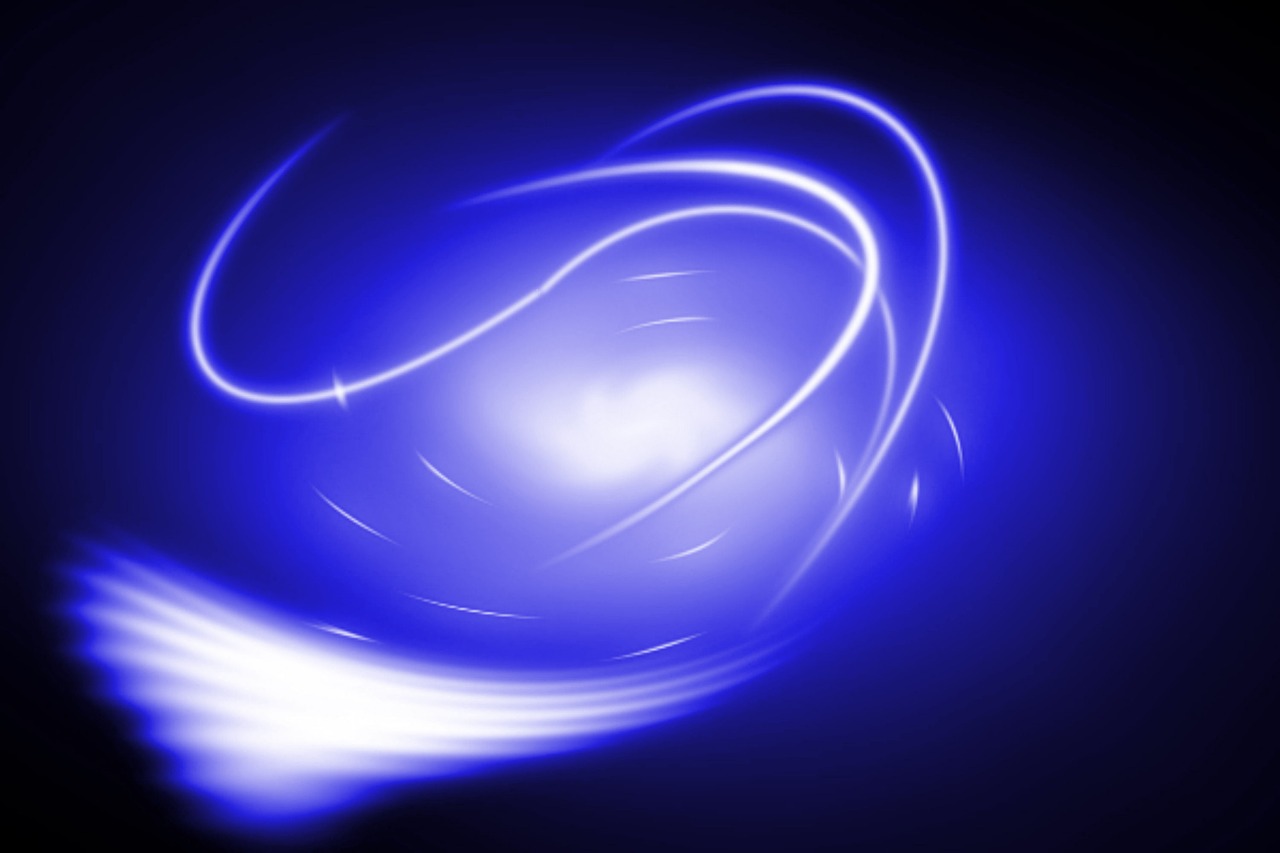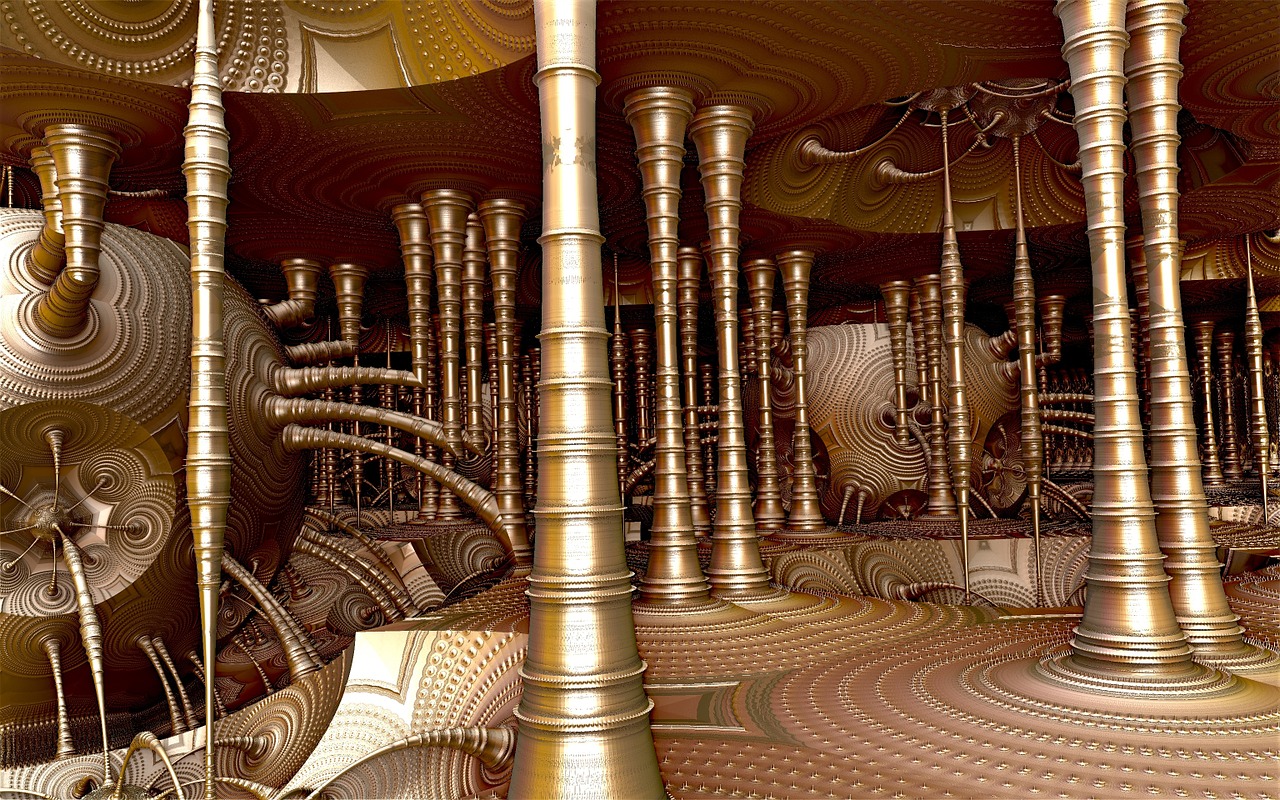Le « Chaosmos » gombrowiczien : une absurdité logique
John Raby, docteur en esthétique de l’Université Rennes 2
Résumé : Le terme d’ « absurdité » a une origine musicale et désignait tout phénomène de dissonance. Est absurde ce qui n’est pas en accord, mais aussi, à la limite, ce qui ne peut être entendu. D’où la dérivation sémantique du domaine de l’audition vers celui de la pensée. Ainsi parle-t-on parle couramment de ce qui « dépasse l’entendement ». Partant de cette origine étymologique, le problème autour duquel graviterait l’art absurde pourrait se résumer ainsi : contre l’harmonie, contre la fusion du divers en un tout, pervertir les lois organiques de la représentation en affirmant le dissemblable et la dissonance. Pour explorer une telle image, l’œuvre de Witold Gombrowicz fait office de paradigme. Son esthétique repose en effet sur une série de dissonances enchâssées que ce texte se propose d’explorer.
Abstract: The term “absurdity” has a musical origin, it has been applied to whatever phenomenon of dissonance. Something is absurd when it is not in harmony, but also, ultimately, when it can’t be heard. Hence the semantic derivation from the domain of hearing to the domain of thought. Thus do we naturally talk of what is “beyond comprehension”. Based on the etymology, the problem around which absurd art would be gravitating could be summarized as follows : it is against harmony, opposed to merging diversity into a whole, it aims at perverting the organic laws of representation by underlining dissimilarity and dissonance. To explore such an image, Witold Gombrowicz works serve as a paradigm. His aesthetics indeed appear as paradigmatic because it is based on a series of embedded dissonances we propose to examine.
Aborder la question de la relation entre absurde et pensée dans le cadre de la littérature peut se faire à partir d’une origine étymologique. Le sens premier du terme « absurdité » est en effet musical, puisqu’il provient du latin absurdus qui désigne ce qui est dissonant, ce « qui n’est pas dans le ton ». « Absurdus, en latin, est passé de la dissonance à l’illogisme, d’une réaction auditive désagréable quand on subit la fausse note à celle qui révolte l’esprit par l’incohérence […][1]. » La notion d’absurdité aurait donc pour origine un problème de résonance, c’est-à-dire de rapport. « Absurdus est formé comme absonus, qui a un sens analogue. La racine contenue dans surdus est restée dans le verbe sanskrit svar “résonner”[2]. » Est absurde ce qui n’est pas en accord, à la limite ce qui ne peut être entendu, ce qui demeure « sourd » (surdus), d’où la dérivation vers son sens contemporain : ce qui dépasse « l’entendement ». Le problème posé par l’art de l’absurde pourrait se résumer de la manière suivante : au lieu de se fondre dans le semblable pour former un tout, le dissemblable, ne doit-il pas être affirmé pour lui-même, et pervertir ainsi les lois organiques de la représentation ? Contre l’harmonie, l’absurdité engagerait à penser un système propre au multiple, une unification qui n’annulerait plus les divergences mais s’opérerait par elles. Pour explorer une telle hypothèse, nous nous appuierons sur l’œuvre de l’écrivain polonais Witold Gombrowicz. Son esthétique repose sur une succession de dissonances qui s’épanouit dans le rapport entre art et vie, auteur et œuvre.
Contre l’abstraction en littérature
Witold Gombrowicz se veut un « réaliste acharné » et critique la philosophie dont les concepts resteraient inaptes à saisir le mouvement et la singularité de la vie concrète. Toute schématisation théorique ferait figure de « passoire » par laquelle « la vie s’écoule » inexorablement[3]. Même si l’existentialisme, à partir de Kierkegaard, a tenté de remédier à ce problème en s’opposant au système hégélien, la pensée conceptuelle serait condamnée, d’après l’écrivain, à errer dans l’abstraction, sans jamais parvenir à nouer un contact avec le réel. De son côté, la littérature, pour échapper au même sort et atteindre au concret, se doit de faire « éclater les schémas », d’intensifier les antinomies les plus extrêmes sans chercher à les résoudre. En ce sens, la littérature pour la littérature, voie esthétique que Gombrowicz attribue à Borges, mais aussi au Nouveau Roman, demeure une aberration puisqu’elle ne construirait qu’un champ esthétique artificiel tissé d’idées aussi stériles qu’abstraites[4]. Concernant cet univers littéraire, Gombrowicz n’est pas avare en critiques acerbes. Il stigmatise en effet son autarcie, les écrivains « intellectualistes » composant des ouvrages non pour les lecteurs, mais pour les autres écrivains. Ou pire, pour satisfaire les exigences formelles de la critique, ces « commentatouilleurs[5] », fabricants de « clichés compliqués bourrés de verbialisme », dont le raffinement rime avec artificialité[6]. C’est ainsi que le sort vertigineux du Vrai, du Beau et du Bien se jouerait au sein d’« un microcosme gros comme le petit doigt, qui pourrait tenir tout entier dans une salle de café[7]. »
L’attitude de l’écrivain qui cherche à satisfaire cette pensée « rhétoriqueuse et morte[8] », éprouverait une crainte devant le mouvement imprévisible de l’existence qui échappe à toute systématisation. Gombrowicz s’applique à mettre en évidence cette crainte à l’aide d’arguments simples et percutants. Par exemple, la composition d’un livre, aussi parfaite soit-elle sur un plan esthétique, ne peut rivaliser avec une diversion réelle. Qu’une mouche bourdonne ou qu’une sonnerie de téléphone retentisse, cela suffit à couper la lecture, et réduit à néant le mouvement savant composé par le romancier[9]. Celui-ci a beau, sur le papier, lutter avec un dragon, il ne fait guère le poids devant l’aboiement réel d’un animal de compagnie. Devant une réalité si cruelle, l’écrivain, pris d’une sorte d’élan mystificateur, se réfugie dans la théorie, perdant volontairement le sens des réalités au profit de « l’art pour l’art »[10]. « Vous accédez aux cieux et vous avez perdu la terre […][11] » ne cesse d’accuser Gombrowicz. Dans cette fuite délibérée s’exprime moins un amour du Beau qu’un malaise qui ne dit jamais son nom[12]. Finalement, la pénétration du jugement gombrowczien est telle qu’elle remet en question les intentions de l’approche critique. Comment ne pas remettre en question sa propre démarche de chercheur lorsqu’on aborde l’œuvre gombrowiczienne ? Dans un article remarquable pour son humilité, Olivier Maillart demande s’il est possible d’analyser une œuvre aussi rétive à toute forme interprétative :
Pour qui entend construire sa critique à partir de l’œuvre commentée, il est en effet impossible d’écrire sérieusement sur Gombrowicz. Ce serait une trahison qui compromettrait toute glose, la frapperait irrémédiablement de nullité. Le formalisme universitaire, les clés, grilles, schémas actantiels et autres merveilles théoriques sont à exclure : le Maître ne les aimait pas, et n’a d’ailleurs cessé de s’en moquer[13].
Gombrowicz oppose à cet esthétisme qu’il juge chimérique une conception vitaliste de l’écriture : la pensée de l’artiste « n’est pas une sèche déduction dans l’abstrait, elle naît de la volonté de faire vivre, de créer quelque chose de vivant… et de réel… elle est donc enracinée dans la vie[14]. » Suivant une inspiration nietzschéenne, l’écriture se doit d’affirmer la vie au lieu de chercher à l’affaiblir par de vains diagrammes[15]. L’artiste véritable ne se satisfait pas de théories. Car il chercherait moins à raisonner qu’à « se défouler[16] ». Autrement dit, un créateur ne pense pas par concept mais à travers un contact direct avec la matière vivante[17]. Gombrowicz évoque à ce sujet le « bon vieux temps où Rabelais écrivait comme un marmot fait ses besoins contre un arbre […][18]. » En rédigeant Pantagruel, peu lui importait les fondements et les fins de l’écriture, lui qui recherchait simplement à faire rire ses contemporains[19]. Gombrowicz tente de renouer avec cet âge d’or de l’écriture vitaliste. L’anarchie joyeuse, explosive, s’avère être une arme contre les règles classiques de l’art.
[S]i, poussé par une vieille et mauvaise habitude, on venait encore m’importuner en me parlant de mission, de convenance, etc., je répondrai tout bonnement :
la carotte
et dans ce mot précieux je mets tout le bonheur de m’être libéré de la terreur, toute la joie d’avoir retrouvé mon équilibre, de ne plus éprouver ni peur ni honte, toute la douceur de la liberté et la volupté de la création[20].
Il y a chez Gombrowicz un « culte de l’absurde[21] », car lui seul permettrait de retrouver la « divine innocence[22] » – celle d’un Rabelais, d’un Cervantès, d’un Jarry… Pour autant, il ne s’agit pas simplement de « lâcher la bride » de son imagination. Renouer avec le vivant exige au contraire une lutte attentive contre ce que Gombrowicz nomme la « Forme ». Une lutte qui s’établit par un emboîtement de « paradoxes monstrueux[23] ». La « Forme » est l’idée génératrice, du moins principale, de l’œuvre gombrowiczienne. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une idée qui prend sa source dans des considérations abstraites, mais à travers une expérience vécue, des situations concrètes[24]. Afin d’appréhender l’étendue de cette idée, nous prendrons un point de départ « perfidement simpliste »: « chacun joue à plus sage et plus mûr qu’il n’est[25]. »
La Forme et l’Immaturité
La Forme désigne le comportement, la sensibilité, la pensée, l’expression, les actes de l’homme, mais aussi ses idées, ses convictions… De manière générale, elle correspond à l’expression, l’extériorisation de l’humain, tout ce qui compose son style, son genre de vie. À son opposé se trouve, en toute logique, l’informel. Ici, nous entrons dans l’univers privé, la vie intérieure de l’humain. Dans cette sphère intime, nous ne trouvons qu’incomplétudes, ignorances, médiocrités et petitesses honteuses… Ainsi, dans toute personne se voulant mûre se cacherait un « blanc-bec ». Un douloureux écart persisterait donc chez l’homme entre sa réalité intime et la manière qu’il a de s’exprimer, entre son moi intrinsèquement imparfait et sa personnalité. Pour compenser cet état de fait, chacun cherche à apparaître plus cultivé, supérieur ou intelligent qu’il ne le sera jamais.
Cette « division schizophrénique du moi[26] » n’est pas un fait volontaire, mais résulte des rapports interhumains. « L’homme dépend très étroitement de son reflet dans l’âme d’autrui, cette âme fût-elle celle d’un crétin[27]. » Autrui nous impose une Forme par le simple fait qu’il nous considère de telle ou telle manière, et nous transforme par sa manière de s’exprimer, ses attitudes à notre égard. Gombrowicz a baptisé ce phénomène du nom de « culculisation ». Et de la fabrication d’un « cucul » découle celle d’une « gueule » ou d’un « kiki »[28]. Dans Ferdydurke, Gombrowicz donne l’exemple d’une tante qui, lors de retrouvailles, ne manque pas de réduire le narrateur au souvenir qu’elle garde de l’enfant qu’il était : « Tu as les yeux bleus de ta mère, le nez de ton père, mais le menton est typique des Pifczycki. Et tu te rappelles comme tu as pleuré quand on t’a enlevé ce noyau, et toi tu te fourrais le doigt dans la bouche et tu criais “Aïe, aïe, aïe, man, mal, mal, là, ouille, ouille, ouille [29]!” »
Doit-on alors supposer, derrière les gueules que nous impose cette Forme, un visage originel qui serait à retrouver ? Nous ne pouvons compter sur un moi premier d’après Gombrowicz, l’homme étant une ombre dénuée d’identité propre. Du moins, ce qui lui appartient en propre se réduit à sa souffrance, une souffrance qui découle des diverses déformations qu’il subit au cours de son existence. Mais l’origine de cette douleur n’est qu’un centre vide qui circule, maladif, au sein de son intrinsèque artificialité, et qui témoigne d’une volonté désespérée d’être soi[30].
En passant de sa chambre à coucher à son salon et de son salon à son cabinet de travail, un homme change au point de devenir méconnaissable. Il n’est pas le même lorsqu’il écrit un poème ; lorsqu’il énonce son opinion sur la déchéance de la moralité et lorsqu’il mange une escalope aux betteraves[31].
Jamais cette cruelle réalité de notre essentielle inconstance n’était apparue aussi nettement à l’humanité jusqu’à notre époque. Si jadis persistait une confiance en l’humain, l’espoir d’un accord définitif entre le moi et la personnalité, cet optimisme a maintenant laissé place à une « méfiance lucide [32]». Selon une inspiration presque prophétique, Gombrowicz annonce un « Grand Tournant[33] » : celui où l’homme entre dans l’élaboration (en droit interminable) de sa propre Forme[34].
Face à cette Forme déformante et toute puissante, quelle doit être la position de l’artiste ? Se faire fabriquer un « cucul » et une « gueule » est le rôle des « bonnes tantes de la culture[35] », c’est-à-dire des critiques. Ceux-ci ne manqueront jamais de réduire la nouveauté d’une œuvre aux préceptes esthétiques des écrivains du passé, et d’accuser ainsi son immaturité à la lumière des génies. Si, à une échelle individuelle, la personne publique, sociale, étrangle la personne privée, à l’échelle de l’art, c’est la culture qui limite la libre expression des artistes. Mais ces deux échelles, finalement, se recoupent. Comme nous l’avons vu, ce besoin de domination que trahit l’attitude des critiques et des artistes « autorisés » s’explique en définitive par un malaise devant la vie. Pour échapper aux vérités intérieures, à la réalité humaine, on se fait porte parole de l’abstraction, le garant des idées esthétiques. Pour échapper au « pied », on donne tous les droits à l’ « âme »[36]. Dans ce contexte, l’artiste ne doit plus renier sa part immature, et plus globalement sa nature schizophrénique. Il doit au contraire la révéler, sans espoir de résolution. Bien plus, il est nécessaire d’inverser la donne, et de soumettre la Forme à l’informe, et faire ainsi de l’art l’expression de l’humain dans toute ses dimensions. Aller à rebours de l’abstraction pour réhumaniser la culture, tel est l’idée gombrowiczienne[37].
Contre les conceptions objectives de la littérature, créer doit devenir une activité éminemment individualiste. Il est question de s’affirmer soi-même, d’écrire pour son propre plaisir, et non de s’accorder aux canons abstraits de la Forme[38]. Écrire doit exprimer la singulière personnalité de l’auteur. Mais comment est-il possible d’exprimer son individualité si la Forme nous en empêche ? Encore faut-il se garder de comprendre ici « expression » en un sens trop naïf. Il est question d’une mise à nu de la part schizophrénique de l’humain, de son écartèlement entre la Forme et son absence, entre le mûr et le « blanc-bec ». Aucune éloge donc d’une forme d’expressionnisme qui ne peut que demeurer chimérique au regard de la vision pessimiste de Gombrowicz. La méfiance envers soi-même est au contraire de mise, et c’est pourquoi l’écriture se doit d’être constructiviste. « Prudence ! Distance ! Distance envers la forme ! Sois rusé, sois prudent, ne t’identifie jamais avec ce que tu fais de toi[39] ! » L’unique solution pour se rendre maître de la Forme, et la soumettre à l’immaturité, consiste à la créer tout en se démarquant d’elle[40]. Il faut construire et pervertir à la fois. Raison pour laquelle la parodie constitue le genre privilégié de Gombrowicz[41].
Mon écriture est fondée sur des modèles traditionnels. En un sens, Ferdydurke est une parodie du conte philosophique dans le style voltairien. Trans-Atlantique est la parodie d’un récit de l’ancien temps, dans le genre vieillot et stéréotypé. La Pornographie renoue avec le débonnaire « roman champêtre polonais ». Cosmos, c’est un peu un roman policier. Mon théâtre parodie Shakespeare et ma dernière pièce est composée sur le modèle de l’opérette[42].
Étymologiquement, « parodie » se constitue de « ôdé » (le chant), et « para » (qui signifie à la fois « contre » et « à côté »). Si parodier consiste à chanter « à côté », à chanter faux, on retrouve donc ici un parallèle avec l’origine du terme « absurde » qui se rattache à la dissonance.
La parodie déconstructive
De quelle sorte de parodie use Gombrowicz ? L’auteur s’empare de structures littéraires préexistantes afin d’y introduire un élément perturbateur qui fera imploser le schéma de départ. Soit la nouvelle Le Festin chez la comtesse Fritouille qui décrit un repas végétarien organisé par des aristocrates. L’événement qui fera imploser le récit est le suivant : un cuisinier a fait cuire un enfant dans un bouillon. « Avec quel plaisir je voyais cette absurdité gonfler sous ma plume commente Gombrowicz, se développer selon sa logique propre, une logique implacable conduisant à des solutions insoupçonnées[43]. » Dans Cosmos, l’enquête policière démarre par « l’irruption d’une absurdité logique[44] » : un moineau pendu à un fil de fer. Parfois, l’instigateur de telles perturbations est incarné par un personnage du roman. « Dans presque chacun de mes ouvrages, on trouve un régisseur qui organise l’action […][45]. » Avec Ferdydurke, le narrateur, logé chez une famille « moderne », perturbe l’harmonie familiale en introduisant un élément perturbateur : un mendiant tenant dans sa bouche une branche d’arbre. « La nuit tombait toujours et le mendiant, sous les fenêtres, tenait toujours sa jeune branche verte. Dissonance[46]. » Ou bien encore dans La Pornographie, Frédéric met en scène un couple d’adolescents dans des poses destinées à faire ressortir leur érotisme latent. « Sa jambe à elle bougea un peu, s’étendit. Elle posa son pied sur le pied du garçon. […] Il y avait dans tout cela quelque chose d’indubitablement factice, d’incompréhensible, de pervers[47]… » Gombrowicz décrit ainsi sa méthode : à partir d’éléments de la réalité, échafauder un monde absurde, une « caricature » du réel[48].
Pour autant, l’écriture gombrowiczienne n’est pas l’application d’un plan déjà donné, une catastrophe organisée. « [M]on programme ne précède pas mon œuvre, au contraire, il apparaît toujours post factum… Tout simplement, je me suis assis et je me suis mis à écrire[49]… » Gombrowicz insiste sur la séparation entre l’œuvre et les intentions de l’auteur, le livre s’écrivant de lui-même, suivant ses rouages, sa propre machinerie. « Nous avons l’impression de construire. Illusion : nous sommes en même temps construits par notre construction. Ce que vous avez écrit vous dicte la suite, l’œuvre ne naît pas de vous, vous vouliez écrire une chose et vous en avez écrit une autre tout à fait différente[50]. » Ainsi reproche t-il à H.G. Wells de trop bien savoir ce qu’il doit faire, de trop raisonner, de ne pas suffisamment écrire « à l’aveuglette[51] ». Mais n’y a t-il pas là, encore une fois, une contradiction avec le point de départ, à savoir le roman comme expression de la personnalité de l’auteur ? Gombrowicz met en garde de la manière suivante : « Vous qui êtes artistes, essayer d’éviter l’expression de vous-mêmes. Ne faites pas confiance à vos propres paroles […][52].» Comme nous l’avions dit précédemment, l’expressivité ne se résume pas aux intentions de l’auteur. Ce qui est nécessaire est la mise à jour de l’immaturité contre la Forme. Raison pour laquelle d’ailleurs les ouvrages de Gombrowicz demeurent ambigus et « bâtards ». Comment définir par exemple le livre Ferdydurke : est-ce un roman, une parodie, un pamphlet ou bien simplement une « pure blague [53]» ? Cosmos est-il une absurde enquête policière ou un conte philosophique ? Alternatives indécidables qui expriment l’immaturité contre la Forme, mais aussi, finalement, le rapport immature, inachevé, voire mystérieux entre l’œuvre et son auteur. Contre la tendance à l’achèvement, à la maturité, le corps du texte doit être à l’image de celui du narrateur de Ferdydurke :
[…] ma tête se moquait de ma jambe, ma jambe de ma tête, […] mon doigt s’en prenait à mon cœur, mon cœur à mon cerveau, mon nez à mon œil, mon œil à mon nez et tous ces morceaux se violentaient sauvagement dans une atmosphère de dérision totale et cruelle[54].
Si Gombrowicz se considère comme un « agglomérats de mondes divers[55] », comme une personne assimilable à aucun modèle, situé toujours « entre » les domaines, à la manière d’un « comédien », ou d’un « caméléon »[56], l’hétérogénéité de ses ouvrages en est aussi l’expression.
Pour finir, on constatera qu’il demeure une indépassable antinomie : l’écrivain ne peut écrire ce qu’il souhaite, mais seulement ce qu’il doit écrire, pris par un « démonisme » dont il ne peut avoir que partiellement conscience[57]. La littérature n’a pas pour but de résoudre les problèmes mais bien plutôt de les poser[58].
L’écrivain auquel je pense ne se mettra pas à écrire, lui, parce qu’il se considère comme mûri, mais au contraire parce qu’il connaît son immaturité, sachant bien qu’il n’a pas triomphé de la forme et qu’il est celui qui monte mais n’est pas arrivé au sommet, celui qui veut se réaliser mais n’a pas encore atteint la réalisation[59].
Si les contradictions, les antinomies, voire l’inévitable échec constituent la mort des systèmes, ils demeurent la vie de l’artiste[60]. Car l’immaturité est à prendre aussi dans le sens de « ferment vital », de puissance première. « Qu’est-ce qui fait ma force ? Eh bien, que tout, dans la vie, est comme ci, comme ça… n’importe comment… inaccompli… flou… insuffisant[61]… » Un livre réunis des matières mal préparées en fermentation : l’immaturité, c’est aussi la dimension des germes, des bourgeons, la puissance dionysiaque. Ainsi l’érotisme poursuivi par Frédéric dans La Pornographie, sujet central du livre, demeurera un mystère, y compris pour son auteur[62].
Cosmos : un roman sur la formation de la réalité
La lutte entre la Forme et l’informe, entre maturité et immaturité, ne se limite pas à la seule réalité humaine. Pour l’écrivain polonais, le réel lui-même est en (dé)formation perpétuelle et toute construction stable n’est qu’une apparence qui voile le « tourbillon anarchique[63] », le « magma aussi sombre qu’anonyme[64] » qui en est l’origine. Nous fabriquons des lois, des constantes pour échapper à cette chaotique multiplicité, notamment par ce que l’auteur appelle un « impératif de la symétrie et de l’analogie[65] ». La Forme dénote ainsi une lutte perpétuelle entre formation et déformation, achèvement et inachèvement, Apollon et Dionysos. Cette lutte est le centre du livre Cosmos, qui met en scène un « monde mille fois trop riche[66] », un « chaos maladroit[67] » dont l’irréductible multiplicité échappe au « gros bon sens ». Immergé dans cette surabondance, le narrateur tente de repérer des occurrences, des bribes de sens[68]. Finalement, il s’accroche à quelques analogies entre des éléments a priori insignifiants. « Plus ils étaient insignifiants, absurdes, et plus ils étaient imposants, puissants [69]! » Des bouches, des mains, des dessins hasardeux sur les murs, partout des indices qui appellent une résolution, une signification, pareils à une charade. Tout commence par la découverte d’un moineau pendu, puis d’un étrange rapport entre deux bouches : celle de Léna, « normale et charmante[70] », et celle, déformée et hideuse, de la servante nommée Catherette. Tout l’effort du narrateur tend vers une parenté entre la pendaison et ce couple de bouches. Après avoir découvert dans le jardin un morceau de bois pendu à un fil de laine, sa pulsion de symétrie le poussera à pendre un chat afin de compléter la série des pendaisons. « Je me réjouis aussitôt à la pensée du chat pendu – pendu comme le bout de bois – comme le moineau – je me réjouis de cette symétrie ! […] trois pendaisons, c’est autre chose que deux, c’est un fait[71]. » Puis la confirmation définitive de la série des pendaisons se fera grâce à la pendaison de Lucien. « Le moineau pendu, le bout de bois qui pendait, le chat étouffé et pendu, Lucien pendu. Quelle harmonie ! Quelle cohérence ! Ce cadavre idiot devenait un cadavre logique […][72]. » Mais la découverte du pendu fournit également l’occasion de connecter les deux séries pendaison-bouche, en introduisant un doigt dans la cavité buccale du suicidé[73].
Tentant ainsi de faire consister une réalité par une trame d’associations et de répétitions, le narrateur est au prise avec ce qu’on pourrait appeler une logique de l’absurde : « que deux bouches n’ayant rien en commun aient pourtant quelque chose en commun, cela m’étourdissait […][74]. » Toutes sortes de paradoxes émergent alors en cascade. La formation d’une « constellation de bouches » à partir de celles de Léna et de Catherette, d’une « double bouche à doubles lèvres[75] » exprime une « virginité débauchée », une « timidité brutale », une « honte cynique » etc.[76]. À plusieurs reprises, le narrateur refuse d’approfondir de tels raisonnements, les qualifiant d’absurdes, pour finalement surenchérir par un « pourtant », un « mais » qui relance la pensée. Ainsi surgit l’idée qu’un oiseau volant dans le ciel se rapporte au moineau pendu en tant justement qu’il n’est pas un moineau : « […] non-moineau, il avait un peu de moineau en lui[77]… » La pensée se trouve stupéfaite par des paradoxes enchaînés : « Il ne s’agit pas de cela. Donc il s’agit de cela[78]. » Tout devient équivalent et condamne l’esprit à demeurer dans un entre-deux indépassable. Une absence de regards échangés entre deux personnes devient ainsi un « échange de deux non-regards[79] » ; de même qu’une absence de pensée devient une pensée à part entière[80] ; ou qu’une amnésie est l’équivalent d’un souvenir[81]. On retrouve ce type de dédoublements dans La Pornographie. La voix d’un cocher est différente en tant qu’elle est restée la même[82] ; un paysage reste le même tout en étant différent, à la fois reconnu et inconnu[83]. La « mollesse rude » de l’adolescent Karol amène le narrateur à le considérer comme un « tueur sympathique » ; de la même manière que le bras de l’adolescente Hénia est vue comme étant à la fois « dévergondée » et « scolaire »[84]. La pensée se trouve renvoyée d’une alternative à une autre, sans jamais pouvoir les synthétiser. Bien que Gombrowicz refusait de se présenter comme un artiste-philosophe[85], de tels événements de pensée ont inspiré la philosophie, et plus particulièrement Gilles Deleuze. Nous aimerions évoquer certains recoupements entre les deux auteurs, afin de clore notre étude sur une possible réconciliation entre littérature et concept autour de l’absurde.
Gombrowicz et Deleuze
On se souviendra que Gombrowicz reprochait à la pensée philosophique son attirance irrépressible pour les systèmes, et par là son inaptitude à capter le mouvement perpétuel du vivant, le devenir. Même l’existentialisme, mouvement de pensée dont s’est pourtant inspiré l’auteur, est devenu un « piège », une « cage conceptuelle » du fait que la pensée philosophique ne peut s’empêcher de systématiser. Ainsi lorsqu’on tente d’échapper à la résolution hégélienne, le « pire des styles » apparaît, « vaguement précis, abstraitement concret, subjectivement objectif, un bavardage qui ne tient pas debout[86]. » Malgré tout, on peut se demander, à partir de Jean-Pierre Salgas, si l’absurde gombrowiczien et la pensée deleuzienne ne partageraient pas certaines résonances, et permettrait ainsi un rapprochement entre littérature et philosophie autour de l’absurde[87].
Deleuze n’avait-il en effet pas assimilé paradoxe et concept, rejeté la dialectique au profit du mouvement différentiel ? Suivant la voie tracée par Kierkegaard et Nietzsche, le philosophe français évoque la création de concepts qui ne médiatisent plus le mouvement, mais font le mouvement : « […] inventer des vibrations, des rotations, des tournoiements, des gravitations, des danses ou des sauts qui atteignent directement l’esprit[88]. » Or, pour créer ce type de mouvements, seul le paradoxe, l’absurde, l’ « entre » contre l’être demeurent adaptés. Mais de manière plus générale, c’est le monde deleuzien qui se montre très proche de l’univers gombrowiczien. S’inspirant de Nietzsche, Deleuze décrit un monde pulvérisé, tissé de différences intensives qui ne sont plus harmonisées par un principe supérieur (Dieu, moi). De la même manière, Gombrowicz évacue l’identité de l’humain et l’existence de Dieu au profit du seul devenir. « Le divorce d’avec Dieu – une affaire capitale, grâce à quoi l’esprit s’ouvre à la totalité de l’univers […][89]. » L’écrivain décrit un monde où ce n’est plus dieu mais le « démonisme » et ses dissonances, ses communications aberrantes, qui président : « J’ai toujours été et je suis encore fasciné par le démonisme de ce monde […][90]. » L’univers a implosé et à chaque individualité correspond un cosmos tout à fait distinct des autres. Exprimer un tel éclatement serait d’ailleurs la tâche suprême de la littérature[91]. Abandon du moi et du principe divin, rejet de toute harmonie préétablie au profit d’un univers éclaté, tels sont les éléments que l’on retrouve chez Deleuze comme chez Gombrowicz.
Bien plus, les deux auteurs se retrouvent aussi sur l’élément unificateur d’un tel monde. Gombrowicz évoque dans son Journal la conférence d’Heidegger consacrée au Zarathoustra de Nietzsche. Il s’attache à l’idée de l’éternel retour qui consiste à conférer au devenir le caractère de l’être. À cette occasion Gombrowicz est pris d’un vertige métaphysique : « Je me moque de la métaphysique… qui me dévore. […] Tout en me demandant si je dois préparer mon linge à laver, je suis comme un arc tendu de là-bas, des origines, aux toutes dernières réalisations qui sont là devant moi[92]. » On sait que la répétition joue un rôle fondamental dans son écriture. Elle créerait une unité dans le style, mais aussi véhiculerait une impression de mythologie[93]. Est-ce par hasard si nous retrouvons des boulettes de mie de pain, des mains, des grenouilles, des timons de livres en livres ? Or cette idée d’un être du devenir affirmé par la répétition est le socle de la pensée deleuzienne. « Quel est l’être inséparable de ce qui est en devenir ? Revenir est l’être de ce qui devient. Revenir est l’être du devenir lui-même, l’être qui s’affirme dans le devenir[94]. » On retrouve la même interprétation de l’éternel retour qui avant tant impressionné Gombrowicz.
Si Gombrowicz n’a jamais évoqué Deleuze, ce dernier écrira à plusieurs reprises sur Cosmos. Ce livre appartiendrait à l’esthétique du simulacre, en tant qu’elle est une œuvre constituée de séries divergentes qui communiquent grâce à des événements paradoxaux[95]. Ainsi deux séries, celle des pendaisons, et celle des bouches, entrent en résonnance par l’intermédiaire d’un « différenciant des différences » : le meurtre du chat[96]. À ce propos, on peut se demander si Cosmos n’incarnerait pas, et ce de manière peut-être plus nette que La Recherche proustienne, la réminiscence artistique pensée par Deleuze. En effet, loin d’obéir à la loi organique de la ressemblance, Deleuze tente de penser une réminiscence qui s’établit à partir du dissemblable, de ce qui n’a aucun rapport[97]. Il s’avère que les délires du narrateur gombrowiczien incarnent très clairement une telle conception :
[…] j’étais dans une nuée qui tournait sur elle-même, où il y a avait toujours autre chose au sommet, qui aurait pu se remémorer, saisir, tant et tant de choses depuis le tout début, le lit de fer, […] ensuite le bouchon, […] ensuite les bruits de coups, ou par exemple la comtesse, le poulet dont Lucien avait parlé, le cendrier à treillis, ou ne fût-ce que l’escalier, […], les vieilleries sous le timon et à côté, […] la fourchette, le couteau et la maison, […] ou le tri-li-li,, oh mon Dieu, Fuchs, Fuchs et tout le reste, par exemple le rayon de soleil passant par un trou du store, […] les fatigues, les odeurs, la tasse de thé[98]…
Pour finir, un autre point mérite d’être évoqué : la présence de la ritournelle. Dans Logique du Sens, Deleuze explique que ce qui fait communiquer les séries pendaison-bouche n’est plus le chat pendu mais les « mots ésotériques » de Léon[99]. Il nous semble que cette réflexion permet de comprendre en quoi l’œuvre gombrowiczienne, non seulement recoupe la cosmogonie deleuzienne et certaines théories esthétiques, mais correspond véritablement à la conception littéraire du philosophe. Ne doit-on pas reconnaître dans les jeux de langage de Léon la conception deleuzienne de la littérature comme bégaiement dans une langue majeure, comme la création de ritournelles qui vont créer un style, un devenir sonore, asémantique, de la langue ? Léon ne cesse d’« originaliser en néologisant [100]». Ses jeux de styles consistent majoritairement à :
– créer toutes sortes de néologismes (« perfection caillatique », « imaginouillez », « souvenirama ») ;
– « latiniser » les mots (« trésoribus », « merveillorum ») ;
– introduire d’autres langues (« un poquito », « prima », « first class », « bitte ») ;
– redoubler les mots (« papasser », « pipipi », « bou-bou-bou-bouloche »), ce qui tend vers un langage enfantin (« lolo », « papapoum ») ;
– citer des comptines (« Bijou-chou-genou », « ams stram gram ») ou des chansons (« Elle coule, coule, coule/Dès qu’elle entre dans Paris ! » ; « It’s a long way to Tipperary. ») ;
– jouer des allitérations (« le dos d’un dodu dindon ») ;
– enchaîner les synonymes (« spéciale spécialiste ») ;
– introduire toutes sortes d’onomatopées (« tralala », « tsoin-tsoin », « trilili »).
Ainsi Léon crée-t-il sa « muziquette[101] », sa « ritournelle[102] ». Au regard de cette somme de recoupements entre l’écrivain et le philosophe (recoupements que nous ne pouvons que présenter, à défaut de les approfondir), il apparaît étonnant que Deleuze n’ait pas davantage mis en avant, à l’instar de Proust ou Kafka, l’œuvre gombrowiczienne. Explorer ce dialogue entre un « devenir-conceptuel » de la littérature, et un « devenir-littéraire » de la philosophie ouvrirait un champ d’investigation qui permettrait d’explorer le rapport entre pensée et littérature autour d’un combat contre la dialectique au profit de l’absurde.
[1] Alain Rey, Dictionnaire Culturel en langue française, sous la direction d’Alain Rey, tome IV, Paris, Dictionnaire le Robert, 2005, p. 39.
[2] Michel Bréal et Anatole Bailly, Dictionnaire Etymologique Latin, Paris, Hachette, 1914, p. 381.
[3] Witold Gombrowicz, Testament. Entretiens avec Dominique de Roux, Paris, Pierre Belfond, 1968, p. 64.
[4] Pour une critique de l’œuvre borgésienne et du « nouveau roman » (qu’il assimile plus largement à « l’école française »), voir Ibid., p. 82-83, 102.
On retrouve une description humoristique de la confrontation avec Borges qui a réellement eu lieu lors de l’exil de Gombrowicz en Argentine dans son livre Trans-Atlantique. Borges y est décrit comme un surhumain parlant « comme un livre », et possédant une intelligence dont le raffinement est toujours exponentiel. (Voir Witold Gombrowicz, Trans-Atlantique, Paris, Gallimard, 1976, p. 67-71). On retrouve cette opposition gombrowiczienne face à l’intellectualisme dans un tout autre domaine : celui de la musique. Préférant Beethoven, considéré par l’auteur comme un réaliste, il rejette l’œuvre de Bach, jugée bien trop abstraite, mathématique, cosmique et désincarnée. Car le chant n’aurait jamais servi à exprimer la « musique en soi », d’après l’écrivain, mais bien plutôt à « charmer la femelle ». (Witold Gombrowicz, Journal. Tome 2, Paris, Gallimard, 1993, p. 67-68).
[5] Ibid., p. 222.
[6] Ibid., p. 34. Voir aussi Witold Gombrowicz, Varia I, Paris, Christian Bourgeois, 1978, p. 91 ; Witold Gombrowicz, Varia II, Paris, Christian Bourgeois, 1989, p. 74. Cet intellectualisme trouverait son origine dans une soumission de l’art à l’esprit scientifique. Si l’instinct de l’artiste se retrouve noyé dans l’intellect, ce serait la faute de l’université qui mise sur une explication objective des objets d’art (Witold Gombrowicz, Journal. Tome 2, op. cit., p. 51).
[7] Ibid., p. 106.
[8] Ibid., p. 309.
[9] Witold Gombrowicz, Ferdydurke, Paris, Gallimard, 1994, p. 104-105.
[10] Voir Witold Gombrowicz, Testament, op. cit., p. 160-161.
[11] Witold Gombrowicz, Journal. Tome 2, op. cit., p. 67.
[12] Ibid., p. 32.
[13] Olivier Maillart, « Witold Gombrowicz ou l’œuvre en fuite », Revue des Deux Mondes, janvier 2009, p. 101.
[14] Witold Gombrowicz, Testament, op. cit., p. 70. La littérature pour la littérature, comme nous l’avons vu, est une attitude que Gombrowicz juge comme étant « déloyale » vis-à-vis de l’existence. L’art doit au contraire renouer avec la « vie quotidienne », autrement dit le concret. (Witold Gombrowicz, Varia II, p. 79). En cela, l’auteur se définit comme « antilittéraire ». (Witold Gombrowicz, Testament, op. cit., p. 85).
[15] Witold Gombrowicz, Varia II, op. cit., p. 273.
[16] Witold Gombrowicz, Testament, op. cit., p. 86 et 89.
[17] Ibid., p. 69.
[18] Ibid., p. 161.
[19] Witold Gombrowicz, Varia II, op. cit., p. 83.
[20] Ibid., p. 259.
[21] Witold Gombrowicz, Testament, op. cit., p. 40.
[22] Witold Gombrowicz, Testament, op. cit., p. 50.
[23] Witold Gombrowicz, Varia II, op. cit., p. 256.
[24] Ibid., p. 187-188 ; Witold Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., p. 119.
[25] Witold Gombrowicz, Testament, op. cit., p. 134.
[26] Witold Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., p. 13.
[27] Ibid., p. 13.
[28] « (…) le cycle né du cucul s’achève ainsi par le kiki. » (Ibid., p. 103).
[29] Witold Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., p. 302.
[30] Witold Gombrowicz, Testament, op. cit., p. 89 ; Witold Gombrowicz, Varia II, op. cit., p. 187. On reconnaîtra aisément l’influence de la pensée nihiliste de Schopenhauer.
[31] Ibid., p. 255.
[32] Ibid., p. 195-196.
[33] Witold Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., p. 125.
[34] Witold Gombrowicz, Varia I, op. cit., p. 189.
[35] Witold Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., p. 14.
[36] « […] extraire de moi la maturité, aider les autres à mûrir, parler avec l’âme à des âmes ! – Avec l’âme ? Mais fallait-il oublier le pied ? Avec l’âme ? Et le pied, alors ? Pouvait-on oublier les pieds des bonnes tantes culturelles ? » (Witold Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., p. 22).
[37] Sur l’art comme moyen de retrouver l’humain, d’humaniser la Forme (c’est-à-dire de la soumettre à l’Immaturité qui est notre situation réelle), voir Witold Gombrowicz, Journal. Tome 2, op. cit., p. 176 ; Witold Gombrowicz, Testament, op. cit., p. 156-157 ; Witold Gombrowicz, Varia II, op. cit., p. 89.
[38] Ibid., p. 204, 259.
[39] Witold Gombrowicz, Varia 1, op. cit., p. 190.
[40] Witold Gombrowicz, Journal. Tome 2, op. cit., p. 181, 187.
[41] Witold Gombrowicz, Testament, op. cit., p. 50.
[42] Ibid., p. 158.
[43] Witold Gombrowicz, Souvenirs de Pologne, Paris, Gallimard, 2003, p. 166-167.
[44] Witold Gombrowicz, Cosmos, Paris, Denoël, 1973, p. 10.
[45] Witold Gombrowicz, Testament, op. cit., p. 212.
[46] Witold Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., p. 220. « […] chacune des parties de Ferdydurke se termine par l’irruption des éléments de l’absurde, de l’anomalie, de l’anarchie en train de s’infiltrer par les cassures de la forme et d’engloutir les malheureux héros qui s’affublent des apparences de la maturité. » (Witold Gombrowicz, Varia 1, op. cit., p. 66-67).
[47] Witold Gombrowicz, La Pornographie, Paris, Denoël, 1973, p. 121.
[48] Witold Gombrowicz, Souvenirs de Pologne, op. cit., p. 166.
[49] Witold Gombrowicz, Testament, op. cit., p. 119. L’auteur insiste sur l’absence de système (voir Ibid., p. 78).
[50] Witold Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., p. 107.
[51] Witold Gombrowicz, Varia 1, op. cit., p. 53.
[52] Witold Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., p. 124.
[53] Ibid., p. 282.
[54] Ibid., p. 8-9.
[55] Witold Gombrowicz, Testament, op. cit., p. 60.
[56] Ibid., p. 45.
[57] Witold Gombrowicz, Varia 1, op. cit., 53.
[58] Witold Gombrowicz, Testament, op. cit., p. 88.
[59] Witold Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., p. 120.
[60] Witold Gombrowicz, Testament, op. cit., p. 89.
[61] Ibid., p. 135.
[62] Ibid., p. 148.
[63] Witold Gombrowicz, Varia 1, op. cit., p. 66.
[64] Ibid., p. 93.
[65] Witold Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., p. 275.
[66] Witold Gombrowicz, Cosmos, op. cit., p. 26.
[67] Ibid., p. 128. Tout un vocabulaire lié au chaos ponctue l’ensemble de l’ouvrage : « masse de faits indifférenciés », « trames emmêlées », « fouillis », « labyrinthe », « orage de matière », « brouillard », « masse inconcevable, insaisissable » (Ibid., p. 41, 94, 112, 129, 211).
[68] L’ouvrage est présenté comme un « essai d’organiser le chaos ». (Ibid., p. 9).
[69] Witold Gombrowicz, Cosmos, op. cit., p. 147.
[70] Witold Gombrowicz, Cosmos, op. cit., p. 22.
[71] Ibid., p. 99, 115.
[72] Ibid., p. 206-207.
[73] Ibid., p. 210-212. Il ne s’agit pas seulement d’une simple fantaisie, le Journal dévoilant à plusieurs reprises des angoisses ressenties par leur auteur, et qui se montrent très proches de celle ressentie par le narrateur de Cosmos (qui se nomme d’ailleurs Witold). Gombrowicz a toujours été sensible aux mains, et le narrateur du roman y est également très attentif, les comparant, tentant d’y lire des signes. Or le Journal restitue une expérience angoissante vécue par Gombrowicz à l’égard d’une main de serveur. « La main silencieuse du garçon là-bas, au Querandi, silencieuse et recroquevillée. Que fait-elle là-bas – et moi ici ? » (Witold Gombrowicz, Journal. Tome 2, op. cit., p. 70). Un peu plus d’une heure plus tard, il compare une autre main avec celle du serveur (tout comme le narrateur de Cosmos ne cesse de comparer) : « La main diplomatique posée sur l’accoudoir du fauteuil, avec ses doigts légèrement repliés. Non, pas celle-ci, mais l’autre… abandonnée là-bas… point de repère, lueur lointaine dans la nuit, phare ! Adieu continent ! Me voilà en plein océan, jaillissement d’écume, ouragan, tempête, eaux déchiquetées, en plein océan, en plein mugissement, en pleine démence ! » (Ibid., p. 71-72). On remarquera d’ailleurs que le chaos gombrowiczien est souvent décrit à l’aide de métaphores aquatiques : « océan noir », « rivière noire » etc.
[74] Witold Gombrowicz, Cosmos, op. cit., p. 32-33.
[75] Ibid., p. 66.
[76] Ibid., p. 63.
[77] Ibid., p. 129.
[78] Witold Gombrowicz, Cosmos, op. cit., p. 198.
[79] Ibid., p. 151.
[80] « […] je pensais, je pensais, avec la plus grande force, la plus grande profondeur, mais sans la moindre pensée. » (Ibid., p. 194).
[81] « Je me souvins d’eux parce que j’étais en train de les oublier. » (Ibid., p. 201).
[82] Witold Gombrowicz, La Pornographie, op. cit., p. 20.
[83] Ibid., p. 17, 24, 66.
[84] Ibid., 37, 39.
[85] Witold Gombrowicz, Varia I, op. cit., p. 185. L’auteur affirme qu’il s’est seulement inspiré du « ton » et du « style » de certains philosophes, mais n’a en rien appliquer leurs thèses dans un cadre romanesque (voir Witold Gombrowicz, Testament, op. cit., p. 43-44).
[86] Witold Gombrowicz, Journal, Tome 2, op. cit., p. 168. Voir également Witold Gombrowicz, Pérégrinations Argentines, Paris, Christian Bourgeois, 1984, p. 123-132.
[87] Jean-Pierre Salgas, Gombrowicz, un structuraliste de la rue, Paris, Éditions de l’éclat, 2011, p. 60.
[88] Gilles Deleuze, Différence et Répétition, Paris, Puf, 1968, p. 16.
[89] Witold Gombrowicz, Testament, op. cit., p. 43.
[90] Witold Gombrowicz, Varia II, op. cit., p. 188.
[91] Witold Gombrowicz, Varia I, op. cit., p. 11-12.
[92] Witold Gombrowicz, Journal. Tome 2, op. cit., p. 70.
[93] Witold Gombrowicz, Ferdydurke, op. cit., p. 104.
[94] Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, Puf, 1962, p. 28.
[95] Gilles Deleuze, Différence et Répétition, op. cit., p. 161 ; Gilles Deleuze, Logique du Sens, Paris, Minuit, 1969, p. 53-54, 301, Gilles Deleuze, Le Pli. Leibniz et le baroque, Paris, Minuit, 1985, p. 111.
[96] Gilles Deleuze, Différence et Répétition, op. cit., p. 161.
[97] Gilles Deleuze, Proust et les Signes, Paris, Puf, 1986, p. 137-138.
[98] Witold Gombrowicz, Cosmos, op. cit., p. 191.
[99] Gilles Deleuze, Logique du Sens, op. cit., p. 54.
[100] Witold Gombrowicz, Cosmos, op. cit., p. 36.
[101] Ibid., p. 105-106.
[102] Ibid., p. 149.