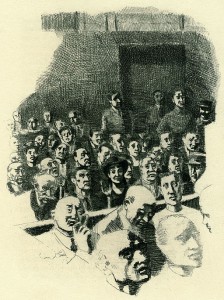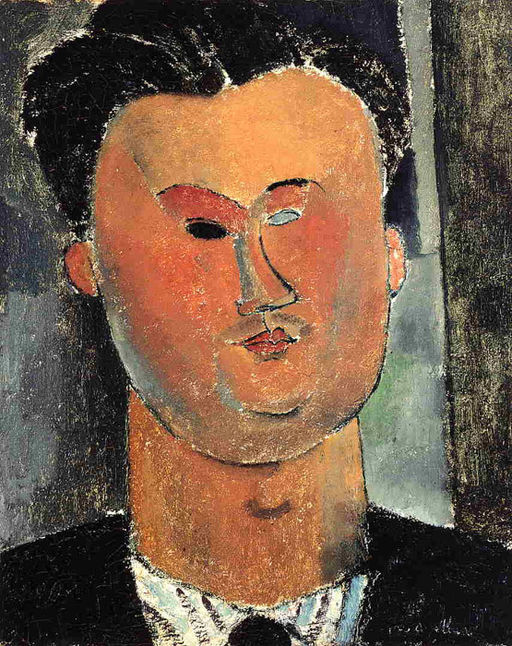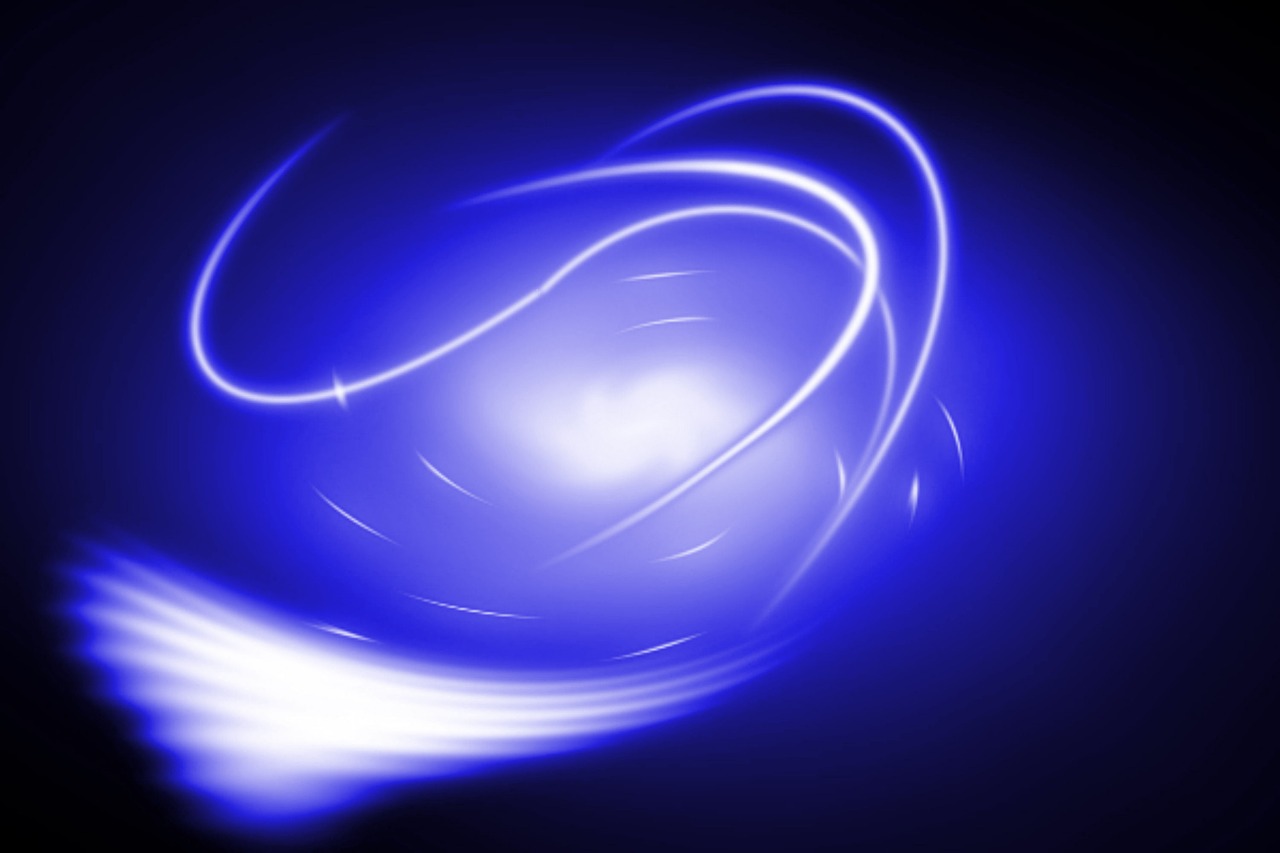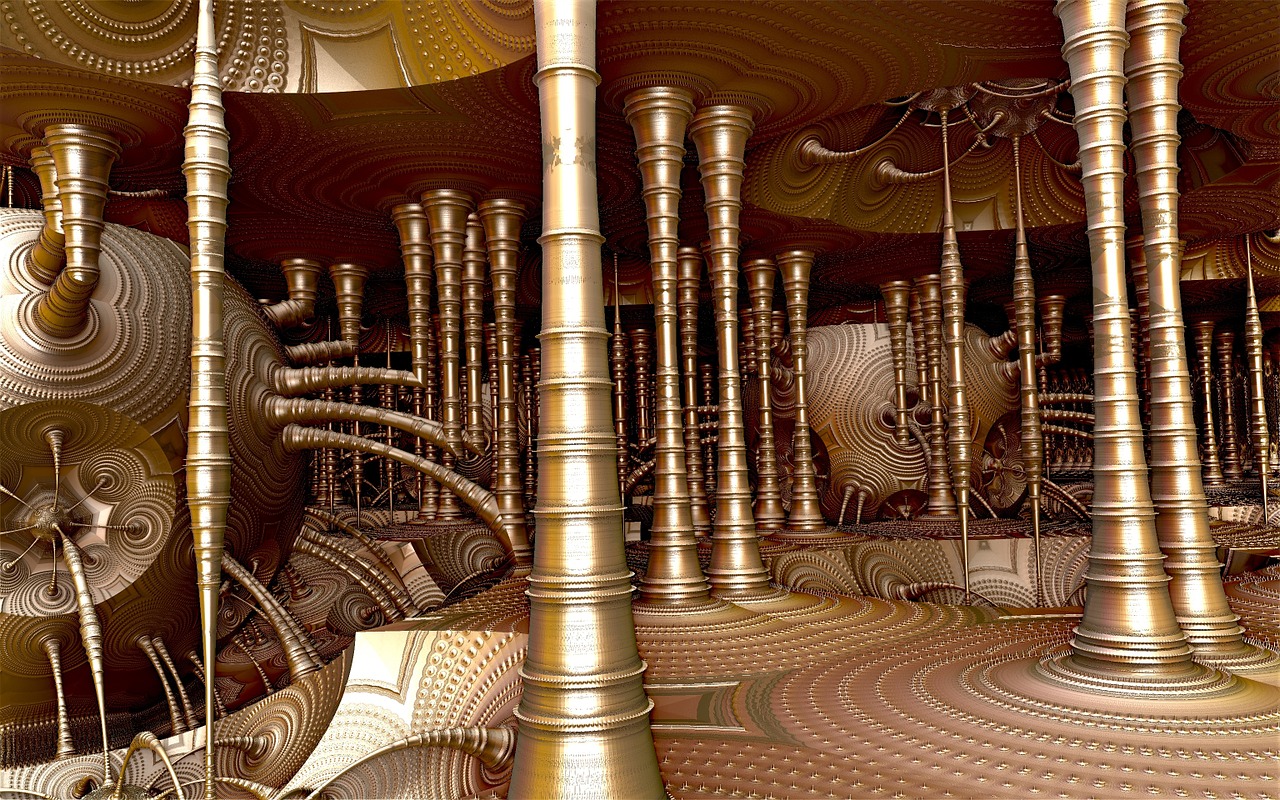L’Etranger d’Albert Camus
Samara Geske, Université de São Paulo, Brésil
Varia du dossier L’absurde au prisme de la littérature, les vignettes présentent, sous forme de brèves, quelques unes des œuvres emblématiques du mouvement littéraire de l’absurde.
L’Étranger d’Albert Camus fut publié en mai 1942, au beau milieu de la seconde guerre mondiale. Le Mythe de Sisyphe : essai sur l’absurde paraît en octobre de la même année. Cette publication concomitante fut d’abord suggérée par André Malraux qui avait lu les deux textes lorsqu’ils étaient encore à l’état de manuscrit. En octobre 1941, il lui fit remarquer que le rapprochement entre Sisyphe et L’Étranger est plus instructif qu’il ne l’imaginait : « l’essai donne au livre tout son sens et transforme ce qui dans le récit semblait monochromatique et presque pauvre[1]. » Ce rapprochement fut également rapidement remarqué par la critique : en 1943, Jean-Paul Sartre publie son Explication de L’Étranger, où il fait une lecture du récit très proche de celle de l’essai. Selon le philosophe, l’essai est en effet la clé d’interprétation du récit :
« L’Étranger, paru d’abord, nous plonge sans commentaires dans le “climat” de l’absurde ; l’essai vient ensuite qui éclaire le paysage. Or l’absurde, c’est le divorce, le décalage. L’Étranger sera donc un roman du décalage, du divorce, du dépaysement.[2] »
En 1944, Barthes s’étonne également de ce rapport presque organique entre les deux textes, pour lui, le style de L’Étranger a quelque chose de marin, il s’agit d’une « substance neutre » soumise à la « présence sous-marine de sables immobiles » : ces « cristaux durs » sont formés par Le Mythe de Sisyphe, en faisant que le style du récit soit « donc un exemple remarquable de bizarres incidences du fond sur la forme[3]. »
En effet, ce rapport profond entre essai et récit est fondamental dans l’esthétique camusienne, pour lui, une œuvre ne peut pas se passer d’une pensée profonde qui l’organise. Ce lien entre philosophie et littérature est si fort, qu’elles doivent même s’entrecroiser : « On ne pense que par image. Si tu veux être philosophe, écris des romans[4]. », écrit-il dans ses Carnets. Camus avait d’ailleurs envisagé dès le début de sa carrière de composer ses œuvres à partir de cycles organisés par des thèmes philosophiques, à savoir, l’absurde, la révolte et l’amour.
L’absurde est le point zéro de la réflexion camusienne. Avant de le rencontrer, l’homme se laisse entraîner par ses habitudes et les gestes que l’existence commande. Un jour, pourtant, le sentiment d’absurdité frappe à sa porte. Alors les décors s’écroulent. Au terme d’une vie machinale un « pourquoi » s’élève et l’homme n’a alors que deux options : le retour inconscient à cette chaîne d’actes ou l’éveil définitif, qui implique lui-même deux conséquences faire face à l’absurde ou se suicider. L’absurde est ainsi un jeu mortel qui peut conduire à la lucidité aussi bien qu’à l’évasion[5].
Face à l’absurde, l’homme se découvre mortel et comprend que toutes ses actions n’ont pas de sens sous l’horizon de sa finitude. Sa condition ontique est celle d’un condamné à mort. Mais ni l’homme ni le monde ne sont en eux-mêmes absurdes. L’absurde nait exactement d’une confrontation des deux, entre le désir éperdu de clarté qui résonne au plus profond de l’homme et le monde irrationnel, entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde. L’absurde est leur seul lien. L’homme devient alors un étranger, divorcé d’un univers privé d’illusions et de lumière[6].
La question qui se pose est alors la suivante : comment faire sentir cet état d’absurdité par la littérature sans que le récit devienne un roman à thèse ? Comme le souligne Camus, il s’agit tout d’abord de faire en sorte que la pensée profonde ne figure pas comme une étiquette sur l’œuvre. Pour ce faire il s’est interdit de créer un personnage qui, comme l’homme décrit par Le Mythe mènerait une vie machinale « lever, tramway, quatre heures de bureau » et qui prendrait un jour conscience de cette absurdité. Dans L’Étranger, il a essayé de créer d’autres moyens de faire sentir l’absurde au lecteur. Plus qu’un simple thème, l’absurde va pénétrer dans les structures du récit. Sur le plan du langage, l’absurde ne peut s’exprimer qu’au moyen de ce que Barthes avait nommé une « écriture neutre[7] » : une sorte de langue élémentaire dont l’exemple le plus frappant est celui du télégramme de l’asile, des phrases courtes, sans rapports de causalité qui ne communiquent que l’essentiel. Le langage de ce personnage étrange et taciturne qu’est Meursault suit cette même logique : il se borne à répondre oui ou non aux questions qu’on lui pose. Son style est presque télégraphique, à propos de Paris, il affirme : « C’est sale. Il y a des pigeons et des cours noires. Les gens ont la peau blanche[8]. »
L’absurde apparaît aussi sur le plan de la narration : il est d’usage qu’une histoire narrée à la première personne donne à voir l’intériorité du « je » qui parle. Mais selon l’absurde, l’homme est étranger au monde et à soi-même, bref, il est étranger absolument. Comme le disait Sartre, Meursault est comme l’homme qui téléphone dans une cabine : on peut voir ses gestes, mais on ne peut pas l’écouter. De la même façon, nous n’avons accès à ses pensées et à ses sentiments. Selon Genette, Meursault est un étrange type de narrateur intradiegétique, il narre son histoire en première personne, mais avec une sorte de focalisation externe[9]. Le personnage en tant que narrateur devient étrange et opaque pour le lecteur lui-même. Ses actions, qui pouvaient d’une certaine façon aider à le comprendre, n’expliquent rien. Il est aussi étranger aux conventions sociales ou religieuses et sa seule « justification » du meurtre fut le soleil. Il n’y a donc pas de causes, ni de buts, toutes les actions s’équivalent : se marier ou pas avec Marie, cela lui est égal. C’est justement cette chaine causale, c’est-à-dire les raisons de Meursault, que le tribunal qui le condamne essaye d’établir. Le procureur essaye de donner une cohérence à ses actes. Pour le condamner le tribunal fait de lui un personnage traditionnel (le modèle du roman réaliste, par exemple), c’est-à-dire un personnage poussé par des raisons, des désirs : l’amour, la haine, la vengeance, l’ascension sociale.
Cette volonté d’éclairer les raisons du meurtre est transmise au lecteur et rejoint ce que dans Le Mythe Camus dépeint comme l’exigence de familiarité et de clarté que l’homme désire dans son rapport au monde. Tout notre être réclame du sens, que ce soit dans le monde, dans la vie d’un homme, ou encore dans l’histoire qu’on nous raconte. Selon la formule sartrienne, la lecture de l’Étranger est la communion brusque de deux hommes, l’auteur et le lecteur, ayant entre eux l’absurde. La lecture de L’Étranger va donc se constituer comme un processus qui révèle l’absurde au lecteur, en mettant en contraposition l’appel du sens et de la clarté face à l’étrangeté et l’opacité du personnage. Laissons pour finir la parole à Camus : « Dans notre société tout homme qui ne pleure pas à l’enterrement de sa mère risque d’être condamné à mort[10]. » Comme Meursault devant le monde, le lecteur doit lui aussi faire face à l’absurde afin de s’ouvrir à la terne indifférence de L’Étranger.
[1] Olivier Todd, Albert Camus : une vie, Paris, Gallimard, 2006, p. 384
[2] Jean-Paul Sartre « Explication de L’Étranger », in Jacqueline Lévi-Valensi, Les critiques de notre temps et Camus, Paris, Garnier, 1970, p. 48.
[3] Roland Barthes, « Réflexion sur le style de L’Étranger », in Œuvres Complètes, Paris, Seuil, 1995, p. 60.
[4] Albert Camus, « Carnets I », in Œuvres Complètes II, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 2006, p. 800.
[5] Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, in Œuvres Complètes I, op. cit., p. 222.
[6] Albert Camus Le Mythe de Sisyphe, in Œuvres Complètes I, op. cit., 2006.
[7] Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, 1972.
[8] Albert Camus L’Étranger, in Œuvres Complètes I, op. cit., 2006, p. 165.
[9] Gérard Genette, Nouveau discours du récit, Paris, Seuil, 1983, p. 83.
[10] Albert Camus « Préface à l’édition universitaire américaine », in Œuvres Complètes I, op. cit., p. 214.