Entretien : Florian Forestier, Le Réel et le Transcendantal (1/2).
Étienne Besse a rencontré Florian Forestier à propos de son ouvrage, Le Réel et le Transcendantal. Voici un compte-rendu de leur entretien pour Implications Philosophiques.
Etienne Besse : Avant d’aborder ton livre, pouvons-nous revenir sur ton parcours général en philosophie ? Cet ouvrage est directement issu de ta thèse mais avant cela, y-a-t-il un fil conducteur qui a pu te conduire jusqu’à l’œuvre de Marc Richir ?
Florian Forestier : Alain Cugno a été mon premier inspirateur en philosophie. Il est lui-même assez inclassable. Sa pensée a une teneur phénoménologique, mais ce n’est pas pour autant une phénoménologie. C’est une pensée de la singularité, kierkegaardienne, mais aussi très soucieuse de l’affectivité. C’est également une pensée chrétienne, mais un christianisme très spécifique. Je vais citer la fin de son livre, L’existence du mal, qui m’a donné une impulsion vraiment déterminante :
(…) c’est l’évidence d’être soi-même et pourtant incapable de se poser dans l’être qui donne accès au fond de toute réalité. Mais cette évidence se confond avec le simple fait de l’apparaître (quelque chose m’apparaît). Il est antérieur à toute question ontologique. Il précède et fonde la question prétendument la plus radicale: “Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien?” L’énigme absolument originaire par laquelle quelque chose m’apparaît est ce qui me pose dans l’existence et précède l’être lui-même. Ni le monde que je vois, ni moi-même ne pouvons prétendre être l’absolu. Mais que je voie, que ce soit moi qui voie, engage immédiatement la puissance de l’absolu[1].
L’évidence dont parle Alain n’a pas d’attestation : ce n’est pas un sentiment. Il est évident que je suis moi : je ne peux pas être autre chose, même si j’étais quelqu’un de tout à fait autre, je serais moi. Je ne fonde pas le fait d’être celui que je suis.
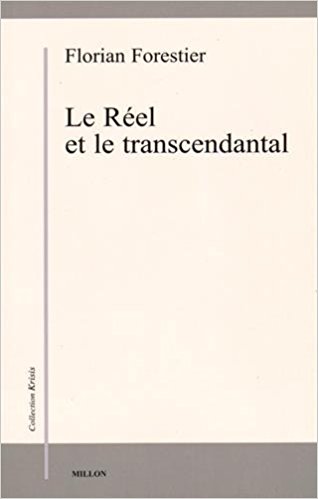 J’ai voulu poursuivre cette intuition en cherchant sans doute à tort chez Henry, Marion, ou Romano, des ressources. Avec eux, je cherchais aussi une façon de me placer hors de la pensée heideggérienne de l’être sans rejeter un certain nombre de questions qui me paraissaient essentielles à la fois quant aux conditions de possibilité de la phénoménologie et quant à ce qui sous-tend la philosophie elle-même. Je cherchais disons à comprendre le statut de « ce qui n’est pas au monde » : comme le dit Guy van Kerckhoven, nous ne sommes jamais totalement Dasein, nous ne sommes jamais totalement pris dans le monde, il y a quelque chose de constitutif de notre expérience qui ne s’explicite pas dans la forme du Dasein, ni dans la façon dont Heidegger pense l’auto-affection. Pour autant, j’ai vite éprouvé une forte réticence au glissement henryen ; il y a bien sûr quelque chose de très puisant dans la qualification positive du soi par l’auto-affection, mais cela amène aussi à une sorte de point d’arrêt de la pensée. D’une certaine façon, aller vers le soi de cette façon conduit à abandonner un pan capital de la pensée du soi : sa dimension « négative », « soustractive », « insituable ». D’une certaine façon, la voie longue amorcée par Derrida (le terme de voie longue est plutôt employé par Ricoeur) me semblait plus juste : ménager la possibilité, le lieu d’une pensée de la singularité, d’une singularité qui ne peut pas être pointée directement. Avec Nancy, les deux dimensions étaient prises en compte : l’espacement et un certain épaississement affectif et sensible. Le contact avec l’œuvre de Nancy s’est fait ainsi à la suite de la rédaction de mon mémoire de maitrise, consacré à L’énigme de la singularité, et le contact personnel avec Jean-Luc Nancy a suivi, et s’est maintenu depuis. Il est vraiment une personnalité déterminante pour moi, mais par ses choix d’écriture, il se place résolument dans les marges de la philosophie, sa pensée n’est pas en quête de ressources terminologiques et conceptuelles pour donner de la plasticité systématique, se réinventer philosophiquement. Disons qu’il est difficile de s’inscrire dans la continuité de Jean-Luc Nancy sans prendre le risque de l’imiter, d’imiter son écriture.
J’ai voulu poursuivre cette intuition en cherchant sans doute à tort chez Henry, Marion, ou Romano, des ressources. Avec eux, je cherchais aussi une façon de me placer hors de la pensée heideggérienne de l’être sans rejeter un certain nombre de questions qui me paraissaient essentielles à la fois quant aux conditions de possibilité de la phénoménologie et quant à ce qui sous-tend la philosophie elle-même. Je cherchais disons à comprendre le statut de « ce qui n’est pas au monde » : comme le dit Guy van Kerckhoven, nous ne sommes jamais totalement Dasein, nous ne sommes jamais totalement pris dans le monde, il y a quelque chose de constitutif de notre expérience qui ne s’explicite pas dans la forme du Dasein, ni dans la façon dont Heidegger pense l’auto-affection. Pour autant, j’ai vite éprouvé une forte réticence au glissement henryen ; il y a bien sûr quelque chose de très puisant dans la qualification positive du soi par l’auto-affection, mais cela amène aussi à une sorte de point d’arrêt de la pensée. D’une certaine façon, aller vers le soi de cette façon conduit à abandonner un pan capital de la pensée du soi : sa dimension « négative », « soustractive », « insituable ». D’une certaine façon, la voie longue amorcée par Derrida (le terme de voie longue est plutôt employé par Ricoeur) me semblait plus juste : ménager la possibilité, le lieu d’une pensée de la singularité, d’une singularité qui ne peut pas être pointée directement. Avec Nancy, les deux dimensions étaient prises en compte : l’espacement et un certain épaississement affectif et sensible. Le contact avec l’œuvre de Nancy s’est fait ainsi à la suite de la rédaction de mon mémoire de maitrise, consacré à L’énigme de la singularité, et le contact personnel avec Jean-Luc Nancy a suivi, et s’est maintenu depuis. Il est vraiment une personnalité déterminante pour moi, mais par ses choix d’écriture, il se place résolument dans les marges de la philosophie, sa pensée n’est pas en quête de ressources terminologiques et conceptuelles pour donner de la plasticité systématique, se réinventer philosophiquement. Disons qu’il est difficile de s’inscrire dans la continuité de Jean-Luc Nancy sans prendre le risque de l’imiter, d’imiter son écriture.
Après cela, j’ai fait un mémoire de DEA avec Catherine Malabou, commencé des recherches avec Jean-Michel Salanskis avant de faire ma thèse avec Alexander Schnell. Catherine Malabou, en introduisant le thème de la plasticité, développe une problématique dans laquelle je continue de m’inscrire : la plasticité n’est pas l’informe, le souci de la plasticité est plutôt celui des formes (d’art, de pensée) une fois la déconstruction assumée. Comment développer, inventer du nouveau, comment échapper au risque de monotonie d’une attente messianique ? Avec la plasticité, la déconstruction se déconstruit elle-même et finit par se performer à travers différents corps (conceptuels, stylistiques) successifs – elle se met plastiquement en acte en s’oubliant d’une certaine façon comme déconstruction, la métamorphose de la pensée, ses prises de forme comme leur vie et leur déconstruction. C’est une perspective que j’aime beaucoup, que je rejoins tout à fait : mais j’ai précisément eu besoin de passer par d’autres corps doctrinaux, conceptuels, stylistiques, pour la mettre en œuvre.
Hélène Politis et Jean-Michel Salanskis ont plutôt été des aiguilleurs. Hélène Politis a dirigé mon mémoire de maitrise consacré à la question de la singularité dans la philosophie française contemporaine, un domaine qui ne constitue pas directement pour elle un champ de recherches, mais recoupe ses propres préoccupations. Si un auteur est souvent associé à la question de la singularité, c’est bien Kierkegaard. Hélène Politis, en attirant mon attention sur l’importance de Hegel, la façon dont Kierkegaard se rapporte à lui, pense la singularité en débat avec l’auteur de l’Encyclopédie, m’a aidé à me déprendre d’une certaine naïveté phénoménologique, à comprendre mieux certaines lignes de partages qui se trouvaient au sein de mes propres recherches (Lacan et Badiou contre la phénoménologie, Henry, etc.) De la même façon, Jean-Michel Salanskis m’a obligé à revenir à un Kant et un Husserl moins filtrés par Heidegger, à prendre plus au sérieux ce que ces auteurs avaient dit, leurs relations avec la science de leur temps, aussi. En particulier, il m’a fait lire le Husserl des Recherches Logiques), ce qui m’a conduit à un certain nombre d’autres approfondissements (les controverses sur les fondements des mathématiques et la logique, les processus de formalisation, etc.). J’ai lu un certain nombre de textes : Vuillemin, Philosophie de l’algèbre, Lautman, Cavaillès, Poincaré, et des contemporains, comme Thom, Longo et Petitot). Tout cela donnait par ailleurs un regard plus clair, à la fois sur ce qui avait nourri Husserl, et sur son évolution.
Mais dans les deux cas, ces détours m’ont conduit à un recul qui m’a permis de revenir avec plus de clarté à mes problématiques initiales. C’est par ces détours (vers Hegel et Kierkegaard, vers Kant et le premier Husserl) que j’ai à mon tour été amené à vouloir sortir de la philosophie et la phénoménologie française dans laquelle je me situais d’abord, à sortir d’un certain heideggérianisme aussi. Les rencontres de l’œuvre de Marc Richir, d’Alexander Schnell et de son travail sur la phénoménologie constructive, répondaient bien à cela, et permettaient de reprendre des questions rencontrées par la phénoménologie française dans un cadre plus vaste, usant mieux, plus nettement de toute la richesse et l’étendue de l’œuvre husserlienne, mobilisant la philosophie classique allemande, sa posture spéculative – la façon dont elle appelle à se rapporter au concept – au philosophique.
 Ces deux détours, par la multiplicité des analyses de détail husserliennes, par la puissance de l’idéalisme allemand, répondaient également à un souci d’un autre type. Je prends très au sérieux en effet la critique de Wittgenstein, à laquelle j’ai été amené par l’enseignement et l’itinéraire de Jocelyn Benoist. Je suis depuis mon année de khâgne un lecteur de Benoist : j’ai été intéressé par ses premières recherches sur l’ego et la facticité, puis intrigué par l’inflexion progressive que celles-ci ont prises, par le détour kantien tout d’abord, le tournant frégéen ensuite, et le remplacement progressif, dans la recherche d’un empirisme impossible à formuler dans le cadre d’une phénoménologie, même (surtout) détranscendantalisée, conduisant à une reprise grammaticale de ces questions. En ce qui me concerne, j’ai fait le mouvement inverse. Si on sort du langage ordinaire : il faut le faire franchement, et au sein d’un système s’assumant comme tel, c’est pourquoi le thème de la construction phénoménologique introduit par Alexander Schnell, puis de la phénoménologie constructive et générative, est tout de suite apparu comme une clef pour moi. Le problème d’une partie de la phénoménologie française vient d’ailleurs pour moi de son ambiguïté sur cela. Il ne suffit pas d’affirmer faire une phénoménologie non transcendantale pour s’affranchir d’une structure de pensée transcendantale, d’une économie transcendantale selon laquelle s’organise la pensée. Il ne suffit pas non plus d’affirmer la singularité, l’auto-affection, la donation, même, pour donner sens philosophique à ces questions. Les conditions selon lesquelles ce sens peut être ouvert, proposé, exposé, repris, se construisent.
Ces deux détours, par la multiplicité des analyses de détail husserliennes, par la puissance de l’idéalisme allemand, répondaient également à un souci d’un autre type. Je prends très au sérieux en effet la critique de Wittgenstein, à laquelle j’ai été amené par l’enseignement et l’itinéraire de Jocelyn Benoist. Je suis depuis mon année de khâgne un lecteur de Benoist : j’ai été intéressé par ses premières recherches sur l’ego et la facticité, puis intrigué par l’inflexion progressive que celles-ci ont prises, par le détour kantien tout d’abord, le tournant frégéen ensuite, et le remplacement progressif, dans la recherche d’un empirisme impossible à formuler dans le cadre d’une phénoménologie, même (surtout) détranscendantalisée, conduisant à une reprise grammaticale de ces questions. En ce qui me concerne, j’ai fait le mouvement inverse. Si on sort du langage ordinaire : il faut le faire franchement, et au sein d’un système s’assumant comme tel, c’est pourquoi le thème de la construction phénoménologique introduit par Alexander Schnell, puis de la phénoménologie constructive et générative, est tout de suite apparu comme une clef pour moi. Le problème d’une partie de la phénoménologie française vient d’ailleurs pour moi de son ambiguïté sur cela. Il ne suffit pas d’affirmer faire une phénoménologie non transcendantale pour s’affranchir d’une structure de pensée transcendantale, d’une économie transcendantale selon laquelle s’organise la pensée. Il ne suffit pas non plus d’affirmer la singularité, l’auto-affection, la donation, même, pour donner sens philosophique à ces questions. Les conditions selon lesquelles ce sens peut être ouvert, proposé, exposé, repris, se construisent.
La pensée de Michel Bitbol a mis plus de temps à prendre place dans cette constellation. Je m’y suis intéressé assez tôt, à travers son introduction philosophique à la mécanique quantique, son essai sur le réalisme, mais l’évolution de la formulation de cette pensée, son élargissement dans De l’intérieur du monde et dans La conscience a-t-elle une origine ?, a rendu le sentiment de familiarité plus clair. La démarche de Bitbol conduit elle aussi à une position spécifique par rapport à la pensée philosophique. Elle est elle-même extrêmement plastique, encore une fois au sens où la plasticité n’est pas une fluidité, qu’elle implique une certaine solidité, une certaine robustesse des structures de pensée, qui seule permet une mise en mouvement plastique féconde. En ancrant de façon très précise sa réflexion dans l’épistémologie de la physique et des sciences cognitives, Bitbol inscrit la démarche critique au sein d’un mouvement d’appropriation des contenus ; il s’agit de suivre, de pénétrer, d’épouser des raisonnements et ce qui les sous-tend (institution symbolique, forme de vie, comme on le voudra) pour y rencontrer de l’intérieur les noeuds qui invitent à une prise de distance. Le mixte de kantisme et de wittgensteinisme de Bitbol conduit autrement dit à un réinvestissement de la phénoménologique (et comme pour Richir, c’est Merleau-Ponty qui est la principale référence). Mais c’est une phénoménologie d’un type différent. Bitbol ne part pas de la phénoménologie : son travail d’épistémologue et la façon dont il désintrique peu à peu les paramètres conceptuels le fait retrouver l’exigence d’une sorte de phénoménologie. L’itinéraire que cette pensée propose vers la phénoménologie (par l’épistémologie de la mécanique quantique et de la neurologie) beaucoup plus proche de ce qu’a fait Husserl lui-même, de la façon dont Husserl a été amené a rencontrer, déployer la phénoménologie (entre formalisme et psychologisme) que la pratique universitaire majoritaire de la phénoménologie en France. En effet, je préfère être amené à entrer dans une disposition phénoménologique avant d’avoir à gloser sur sa compatibilité avec la pureté de l’ego transcendantal, sur le sens de l’a priori matériel, etc. Enfin, cette phénoménologie répond aussi précisément aux contraintes selon lesquelles Richir déploie la sienne : le zigzag élargi comme méthode, le souci architectonique. La crise du sens et la phénoménologie est un ouvrage extrêmement proche de la pensée de Bitbol. Il faut préciser que Richir et Bitbol sont physiciens de formation : ils ont expérimenté un certain usage lié en particulier à la mécanique quantique (un certain rapport à l’objectivité) qui transparait dans leur compréhension de la raison philosophique.
Donc oui, il y a une cohérence, même si je ne l’apercevais pas d’abord moi-même.
Etienne Besse : Tu as écrit un autre ouvrage Le grain du sens qui procède aussi des thématiques de ta thèse : peux-tu nous indiquer la principale différence avec Le réel et le transcendantal ?
Florian Forestier : Je dois dire que ce sont surtout des contraintes éditoriales qui ont conduit à cette séparation. Les deux ouvrages ne devaient à l’origine n’en être qu’un. Les choses étant ce qu’elles sont, je les ai ensuite écrits dans deux orientations différentes. Le réel et le transcendantal expose un cadre au sein duquel faire de la phénoménologie et se rapporte à des auteurs classiques. C’est un ouvrage d’introduction ou de méthode. Le grain du sens propose plutôt un ensemble de variations. J’y reviens aux auteurs de la phénoménologie et de la philosophie française : Henry, Levinas, Marion, Deleuze, Badiou, Nancy, en me demandant ce qui résiste à la problématique du réel et du transcendantal. J’en cherche en quelque sorte le reste, le non-transcendantalisable, ou plutôt ce qui ne peut s’exprimer dans le langage de la philosophique transcendantale. Le plus souvent, il s’agit d’abord, me semble-t-il, d’une disposition singulière propre à chaque pensée, dans sa façon de considérer l’expérience (de nous inviter à adhérer à l’expérience). En tout cas, il s’agit par ces mises en tension, de faire sentir une altérité : il y a de l’intraduisible, parce qu’une pensée ( j’ai peur que tu ne me suives pas du tout sur ce point cependant) est toujours enveloppée dans quelque chose qui ne s’explicite pas tout à fait en elle. Que nous apprend ce qui ne se transcendantalise pas (pas au sens où je l’entends, en tout cas) chez Henry, Levinas, Marion, etc. ?
Chez Henry, je dirais le saut hors de la philosophie appelant à entrer dans un pâtir qui se fait parole (parole qui ne s’explicite plus comme philosophie). Chez Levinas : la singularité même de l’adresse, une disposition sur fond de laquelle la philosophie se déploie et qui est chez lui d’emblée éthique. La phénoménologie pour Levinas n’explicite pas l’éthique : elle se déploie dans le champ de l’éthique. Elle peut exprimer l’éthique bien sûr, la montrer, la dramatiser, mais elle n’en rend pas compte comme une structure de sens comme une forme d’intelligibilité. L’éthique est à assumer avant la légitimation phénoménologique, ce qui induit vraiment une entente très différente de la phénoménologie. Chez Marion, je dirais que ce qui ressort quand on le suit vraiment, quand on joue le jeu de ses démonstrations, c’est que l’essentiel du sens est du côté de ce qui ne s’explicite pas. Chez Richir à l’inverse, la phénoménologie entre dans un mouvement de fuite, dans vie d’un sens jamais totalisé. Marion va dire au contraire : nous devons considérer que le sens est bien donné, que cette impossibilité de se l’approprier n’empêche pas de l’appeler un sens, qu’elle est ce qui permet de le considérer comme tel. La réduction phénoménologique n’a donc pas la même signification chez l’un et chez l’autre, ce qui engendre de part et d’autres certaines simplifications rendant impossibles tout dialogue (des deux côtés, la position adoptée projette ce qui sous-tend l’autre dans un coin aveugle). Chez Richir, disons, la réduction est menée à la recherche d’un contact – l’attestation le principe de tous les principes, devient le contact avec le phénoménologique, contact non pas donc avec le sens même, mais avec ce qui permet le mouvement du sens, la concrétude en lui. Cette thématique du contact me semble très étrangère à Marion. L’esprit de la donation est à l’opposé de cela : il s’agit de penser la donation sans contact, de ne pas ramener l’attestation à autre chose qu’à l’éclosion singulière d’un sens s’ouvrant et de légitimant de lui-même. Le problème est qu’arrivée à ce point, la philosophie demeure un peu béante. Que peut-elle faire comme telle avec la donation. Là encore, on attendrait comme chez Henry que la philosophie change totalement de forme, d’expression, etc. Or, l’ambigüité chez Marion est que son écriture, sa systématique, restent classiques : sa philosophie n’invite pas au saut comme celle de Henry. Elle fait en quelque sorte comme si le saut avec été fait. Richir, lui se place bien dans une perspective de poursuite de la philosophie : c’est le côté derridien de Richir, la philosophie est toujours rejaillissante, elle ne peut qu’effleurer chaque fois la chose puis se donner d’autres corps pour l’effleurer autrement. Avec Deleuze, le différend est encore autre : Deleuze adopte une conception du transcendantal que je pourrais en grande partie reprendre, et qui sur bien des points, est vraiment très proche de Richir. La différence est dans la tonalité, dans le style. Avec Nancy aussi, comme je le disais déjà plus haut, d’autant qu’il y a chez Nancy, beaucoup plus que chez les autres, une tentation d’abandonner la philosophie. Pour Nancy l’expérience de la pensée n’est plus seulement amenée à s’expliciter ou à s’exposer par une sophistication philosophique croissante. Elle se monnaie plutôt en expériences d’écritures diverses.
En résumé, il y a toujours une dimension de posture ou de sensibilité philosophique – qui s’exprime dans le discours, dans l’attitude même. La sortie du transcendantal, si sortie il y a, se fait bien plus à ce niveau, où la question est plutôt : qu’attend on de la pensée, comment se situe-t-on par rapport à elle, comment lui répond-on ? Certains types de pensée appellent plus que d’autres une explicitation transcendantale. Dès qu’une pensée met en jeu la légitimation du sens de ce qu’elle dit, dès qu’elle demande à s’expliciter (qu’elle comprend en elle un questionnement d’elle-même, une explicitation d’elle-même), elle mobilise le transcendantal. De plus en plus, je pense cependant que toute philosophie ne le mobilise pas, que certaines ont plutôt vocation à se performer, à avoir une efficace. Il y a peut-être toujours deux dimensions au sein d’une philosophie : l’efficace et l’explicitation de soi-même (au moins suffisante pour pouvoir se reprendre). J’ajouterai que la grandeur du hégélianisme est peut-être alors, à travers la dimension de la plasticité, d’assumer les deux dimensions.
Etienne Besse : Sur le titre de ton livre, Le réel et le transcendantal : qu’est-ce que résume ton titre dans ce partage ? Il semble pourtant que – si l’on prend à la lettre celui-ci – la façon transcendantale vient, ou plutôt, selon toi, « se rencontre » beaucoup plus directement que le réel que tu présentes dans ton introduction et tes préliminaires comme « opaque » : est-ce que tu ne suggères pas plutôt une sorte de « transcendance du réel » ?
Florian Forestier : Je parle du concept philosophique du réel, de la difficulté pour la philosophie à élaborer un concept de réel. L’être et le réel n’ont pas les mêmes implications. Je ne parle donc pas du contenu concret de notre expérience, des réalités auxquelles nous avons affaire, etc., mais peut-être de ce que la philosophie a à dire sur le fait même que le terme réel existe. Le réel en ce sens n’est pas une expérience, n’est en tout cas rien dans l’expérience. Mais la problématique du réel n’est pas seulement métaphilosophique. Ce qui l’ouvre, c’est bien que notre expérience est faite de telle façon que nous nous demandons ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Toute la question bien sûr est de décider si cette distinction nous suffit, ou si elle doit être dite différemment, explicitée. En ce qui me concerne, je pense qu’il y a bien quelque chose d’expérientiel, une inquiétude, au fond de cette problématique, qu’on ne peut pas l’aplatir sur un pan purement grammatical en distinguant ce qui peut faire question (le vrai ou le faux) et ce qu’il n’y aurait pas de sens à questionner, le réel. Nous parlons de réel parce que nous ne sommes pas dans une expérience qui se tienne totalement elle-même, parce que rien n’est d’une certaine façon sûr. Enfin je précise : au sens pratique bien sûr, beaucoup de choses sont sures, le monde est là. Mais comme diraient Augustin ou Pascal « si on ne m’interroge pas je le sais, si on me questionne je l’ignore ». C’est là, mais nous n’y sommes pas tout à fait pris, dès que nous grattons, ça s’effrite. Comme le dit Alexander Schnell, il y a une précarité fondamentale de « l’être ». Je mets des guillemets ici, parce que toutes ces formulations deviennent vite égarantes, je préfère vraiment l’écriture littéraire à ce sujet. Parler de précarité de l’être est ambigu, parce qu’il n’y a pas forcément sens de demander à ce à quoi nous avons affaire d’être auto-fondé, de quelque façon qu’on le dise. Pour prendre les termes de Jocelyn Benoist, nous l’avons, nous en faisons quelque chose, il n’y a pas besoin ni sens à demander plus. Ce que je vise est plus flou, existentiel, sans doute lié aussi à des manières personnelles d’expérimenter le monde ; disons que je ne me sens pas « tenu », pas « lié » par le monde. C’est réel, mais réel comme une sorte de rêve où de labyrinthe. Une sorte d’inquiétude est là, se lie à d’autres choses, à des modalités d’expérimenter, de percevoir qui ont surement des soubassements biologiques (la taille de notre cerveau rendant la distinction des « représentations internes » et « externes » moins nettes, etc. Bref, nous y sommes, mais… C’est un peu bizarre. Le langage, et au-delà, les institutions symboliques sont habitées par ce décalage : comme l’écrit Richir, elles se sont pas totalement bouclées sur elles-mêmes, ça n’aurait pas de sens, elles doivent toujours aussi s’interpréter, se questionner… Même si ce questionnement prend des formes multiples.
Un modèle de ce pas en arrière est bien sûr Heidegger : la façon dont Heidegger déformalise l’intentionnalité en cherchant à penser la transcendance, le monde, la distance, la façon aussi dont Heidegger conduit sa pensée du jugement apophantique à ce qui le sous-tend (le vrai présuppose le faux, la négation, qui doit être première, pensée comme distance originelle, etc.) J’essaie de voir les choses dans cette ligne, mais autrement, à travers justement un glissement du terme être au terme réel. Richir est pertinent sur ce sujet : cette interrogation de l’institution symbolique, que l’institution symbolique ouvre, et qui habite notre expérience, peut prendre des modalités très diverses, ce n’est pas nécessairement une interrogation d’ensemble, et même quand elle l’est (c’est comme ça que Richir voit le mythe), elle ne prend pas une forme systématique de recherche de ce que nous appelons la vérité (Richir est très utile pour ce dégager de Heidegger sur ce point : la vérité telle que nous la comprenons est déjà une façon spécifique de mettre en œuvre cette inquiétude, elle n’a pas nécessairement sa place dans toutes les institutions, et elle n’a même pas nécessairement à servir de guide pour un pas en arrière à la façon dont Heidegger le fait (il y aurait des choses à ajouter ici sur le livre d’Etienne Bimbenet, L’invention du réalisme, pour être plus complet, mais ça nous prendrait trop de temps).
Voilà en tout cas pourquoi je parle du réel lacanien, qui pour Lacan est inséparable de la dimension du langage. Il n’est pas directement une affaire de vérité ou de perception, mais en quelque sorte entre les deux ; la dimension du réel habite notre expérience, même si nous ne pouvons jamais directement la trouver, l’assigner. Richir pour sa part parle d’écart et lie cette thématique à la réflexibilité fichtéenne.
Ici, les deux versants, réel et réflexibilité, sont liés, ils représentent deux regards sur un même problème. Si je devais formuler ce problème en termes hégéliens, je dirais : le mouvement qui conduit de l’être au néant puis au devenir – à la fois de l’écart et de la résistance à l’écart. Richir trouve un modèle très fort dans la version fichtéenne de cette problématique, dans la pensée fichtéenne de la Bildung, qui permet de penser une sorte de dynamis. C’est au sein de cette Bildung en tout cas que se situe Richir. Je précise tout de suite qu’il ne s’agit surtout pas de la recherche d’une justification phénoménologique de ces paramètres. En quelque sorte, la phénoménologie en devient inséparable (l’assimilation devient totale dans la phénoménologie de l’image d’Alexander Schnell, qui unifie phénoménologie au sens husserlien et au sens fichtéen dans un même processus). Chez Richir, les choses sont moins claires : Fichte est-il déjà phénoménologue, la mise à jour de la Bildung est-elle déjà phénoménologie, permet-elle seulement (comme j’ai tendance à le dire en distinguant différentes époques de la pensée de Richir) de déterminer des paramètres qu’il s’agit ensuite d’habiter phénoménologiquement (le passage du premier Richir, des schématismes, au second, celui des Wesen sauvages, puis au troisième, celui des phantasiai-affections). En ce qui me concerne, je distingue clairement deux dimensions (même si elles s’intriquent souvent dans les faits). D’un côté les paramètres que j’appelle transcendantaux purs (qui configurent l’espace conceptuel de la phénoménologie, jouant aussi un rôle régulateur dans sa mise en œuvre) et les concepts transcendantaux phénoménologiques.
Etienne Besse : Il y a un glissement que tu effectues entre la fameuse formule de la phénoménologie, « revenir aux choses-mêmes » d’une part, et d’autre part, la nécessité de penser « la rencontre », soit « comment rencontrons-nous les choses ? Quels modes multiples sont nécessaires (ou le nécessaire) pour la rencontre ? » (p. 9). Pourquoi ce déplacement ? Est-ce seulement pour court-circuiter la question ontologique du fondement ?
Florian Forestier : La rencontre est un terme ambigu. Je ne sais pas si je l’utiliserai encore de la même façon. Cela présuppose un choc déterminé. Je dirais – la mise en mouvement, l’activation. Ensuite, toute la question est le sens de ce revenir aux choses. On ne peut pas revenir « aux choses » : on peut avoir des expériences qui ont une teneur phénoménologique exemplaire, qui peuvent donner l’impression d’exposer à la choséité. Mais cet aspect (disons heideggérien) n’est pas celui de Husserl. Pour Richir, à proprement parler, il n’y a pas de choses, il y a des concrétudes. Les concrétudes permettent de comprendre la choséité, de lui redonner sens. Il ne s’agit pas cependant d’une fondation parce que les concrétudes ne sont pas un sol ; ou alors, elles fournissent vraiment un sol au sens géologique. Richir utilise souvent d’ailleurs cette métaphore géologique : dès lors, il s’agit d’un sol qui n’est solide qu’en apparence, qui fait de plusieurs couches, qui est agité de tout une tectonique.
Mais au-delà de cela, cela renvoie à un point qui est problématique chez Husserl : il n’y a pas nécessairement de modalité canonique de l’expérience, d’objet plus insigne que d’autres. Or chez Husserl, on ne sait jamais très bien si le modèle de la perception est directeur (il y aurait une priorité de ce modèle du fait de son caractère premier dans la genèse), si la genèse conduit à le modifier, ni si la terminologie perceptive ne vient pas malgré tout et malgré toute la prudence de Husserl habiter l’ensemble de ses descriptions : de fait, notre langage, notre conceptualité, est marquée par le modèle perceptif qui rend très vite à se répandre dans toute la phénoménologie. La perception chez Richir est par contre clairement un phénomène particulier, qui ne structure pas l’expérience en général. La perception, ce n’est pas la sensibilité. Donc déjà, il s’agit avec Richir d’éviter de partir de la forme de l’objet perceptif, bâtie sur la prédication, fût-ce pour le déconstruire après, et choisir d’emblée un autre terrain.
Pour autant, il ne faudrait pas non plus oublier quelque chose de très intéressant chez Husserl. Chez Husserl, l’objet n’a pas de fondement : l’objectivité est un format pour penser une certaine effectivité – une réalité propre aux champs dans lesquels nous nous situons. On ne sait pas a priori ce qu’est l’objet, même l’objet en général. L’objet en général ce n’est pas tous les objets, mais les lois de la généralité de l’objet – les lois de la forme objet en général. Ce glissement est vraiment important, parce qu’il permet de s’affranchir d’une certaine emprise ontologique (de l’emprise d’une certaine forme d’ontologie plutôt). La déconstruction de la forme objet en faveur de la chose, du sensible, etc., a souvent eu tendance à oublier cette avancée et à retomber sous le joug ontologique. Ce qui ne veut pas dire bien sûr que l’objet est le seul où le meilleur format pour ce déplacement (je ne dirais pas cette sortie hors) par rapport l’ontologie.
Etienne Besse : Quelle est la différence que tu veux marquer entre la rencontre et le retour ?
Nous n’avons pas perdu les choses mêmes. Nous les avons toujours d’une certaine façon, tangentielle, sous-jacente, nous les oublions et les redécouvrons de façons beaucoup plus intermittentes, occasionnelles, etc., qu’une compréhension trop linéaire du schéma husserlien peut nous le laisser penser. Nous pouvons nous mettre en condition de mieux toucher leur choséité. Le terme rencontre ici vise aussi à éviter les ambiguïtés du champ lexical du toucher, de la vue, etc., à insister sur le fait que nous ne pouvons-nous tenir dans le contact à la choséité, qu’il s’agit toujours d’entr’aperceptions, qui s’attestent en quelques sortes par leurs effets.
D’un autre côté, il ne faut pas non plus trop forcer ces oppositions, qui sont liées à des sensibilités quant aux connotations de certains choix terminologiques. De même d’ailleurs, la compréhension que Richir peut avoir de Husserl est parfois unilatérale : Husserl est bien moins mécanique et naïf que Richir le dit souvent, et on pourrait tout à fait remettre certaines affirmations de Richir en cause, en particulier sur l’articulation du prédicatif et de l’antéprédicatif. Par exemple, Richir comprend la genèse husserlienne en faisant abstraction du souci d’élucidation de l’activité logique comme telle. Chez Husserl, il s’agit ainsi de trouver de la commensurabilité entre le prédicatif et l’antéprédicatif, il n’est pas sûr du tout que le but soit de fonder le prédicatif sur l’antéprédicatif, d’en dériver son sens, etc. Husserl s’aventure très précautionneusement dans la sphère de l’antéprédicatif, guidé par la logique du prédicatif, quand Richir y saute à pieds joints pour s’installer dans le plus instable et mouvant. Tout aussi bien ainsi, on pourrait objecter à Richir selon un prisme husserlien de donner un peu vite la primeur à la phénoménologie génétique sur la phénoménologie statique. Ce qui n’est plus le même projet phénoménologique. Comme me le disait Sacha Carlson, mon livre sur Richir, qui compare systématiquement Husserl et Richir aurait pu ajouter à chaque chapitre une partie supplémentaire : après la thèse de Husserl et l’antithèse de Richir, la réponse critique d’un point de vue husserlien au déplacement richirien.
Etienne Besse : Là-dessus, la rencontre du réel passe à la question des modalités d’ouverture à la rencontre ; puis vers les pages 15-16, cette question concerne le transcendantal que tu poses ainsi : « en quoi la pensée rencontre-t-elle concrètement une nécessité ? » ; « le transcendantal est rencontré et non déduit par l’idéalisme transcendantal » : peux-tu reprendre et expliciter ce déplacement ? Quelle est la différence ? Comment expliquer une nécessité transcendantale dont les normes ne sont pas « déduites » mais « rencontrées » ?
Florian Forestier : Là encore, le terme « nécessité » est ambigu, l’idée de rencontrer une nécessité plus encore. De même, d’ailleurs, la distinction entre rencontre et déduction. La déduction spéculative n’étant pas une déduction formelle, la logique spéculative pas une logique formelle, pas une logique « dans notre tête », mais dans les choses, toutes ces distinctions deviennent vite trompeuses. Je vais essayer de dire les choses autrement. Qu’est-ce qui conduit finalement à saisir la dimension légitimante de la réflexivité chez Fichte, ou motrice de la négativité chez Hegel, et le mouvement qui conduit la genèse ? La façon dont Heidegger met en avant l’idée de finitude comme condition originelle de la manifestation et de la pensée est déterminante à ce sujet ; d’après Heidegger, c’est la condition de finitude qui, disons, délivre, configure l’acte de pensée. Ensuite, cette condition peut se penser selon d’autres paramètres que ceux de Heidegger. La « phénoménologisation » que je poursuis après Richir, Schnell ou Stanislas Jullien, est une autre façon de reprendre cette question.
Etienne Besse : Peux-tu clarifier la différence entre « réel » et « concrétude » notamment à la lueur de ce que tu écrits à la page 19 : « la phénoménalité ne peut-être pensée sans que la dimension du réel, à la fois comme sens de la concrétude qu’on ne cesse d’y rencontrer, et comme forme de la transcendance impliquée dans le mouvement de la phénoménalisation, y soit inscrite ».
Il semble que ce que tu nommes « réel » soit le donné à expliciter et la concrétude comme la constitution d’objet (p. 16-17) avec l’explicitation comme phénomène : le concret est-il donc le fait problématique du réel en cela qu’il pose le mode de saisie et la question de son explicitation ? Il n’y aurait donc pas de concret sans saisie mais en même temps celle-ci se dérobe en permanence, « s’effrite » entre l’opacité et le vide réflexif qui n’a pas de « pré-existence ». Est-ce que tu vois le réel comme Husserl, comme « réseau d’actes entremêlés » (p. 94-95), donc une plurivocité ?
Florian Forestier : Il s’agit de deux niveaux descriptifs différents. Encore une fois, je parle du réel comme d’une dimension. Ce n’est pas quelque chose qui se donne dans l’expérience, ni même qui lui donne du poids, c’est une dimension dont une pensée de l’expérience et des structures de l’expérience doit rendre compte. Par rendre compte je veux dire alors – placer la phénoménologie sous condition de cette structure qui est un transcendantal pur pour la phénoménologie. C’est pourquoi, à nouveau, je me réfère à la tripartition lacanienne de l’imaginaire, du symbolique et du réel.
La concrétude est au contraire la compréhension phénoménologique, sous réduction, du poids, de l’épaisseur de l’expérience. En effet, en un sens, on peut dire que réel et concrétude sont inséparables. L’expérience n’est pas expérience de rien – elle n’est pas volatile, elle ne s’invente et ne se réinvente pas librement, c’est bien à la fois ce à quoi répond la problématique de la concrétude et ce que désigne la problématique du réel. Mais la problématique du réel le désigne sous un angle très différent : encore une fois, comme dimension appartenant à l’ensemble de l’expérience.
[1] Alain Cugno, L’existence du mal, Seuil, 202, p. 265.











