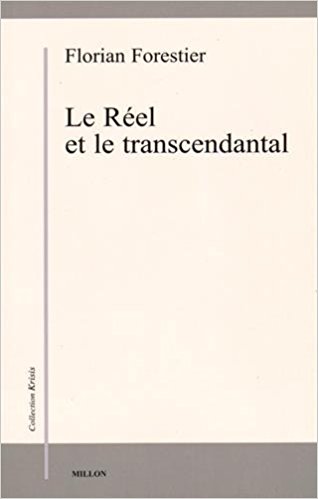Entretien : Jean-Hugues Barthélémy (2/2)
Ludovic Duhem s’est entretenu avec Jean-Hugues Barthélémy à propos de son ouvrage La Société de l’invention. Pour une architectonique philosophique de l’âge écologique (Paris, Éditions Matériologiques, 2018). Voici un compte-rendu de cet entretien pour Implications philosophiques. Vous pourrez trouver l’ouvrage ici.
Ceci est la deuxième partie d’un entretien dont vous pourrez trouver le début ici.
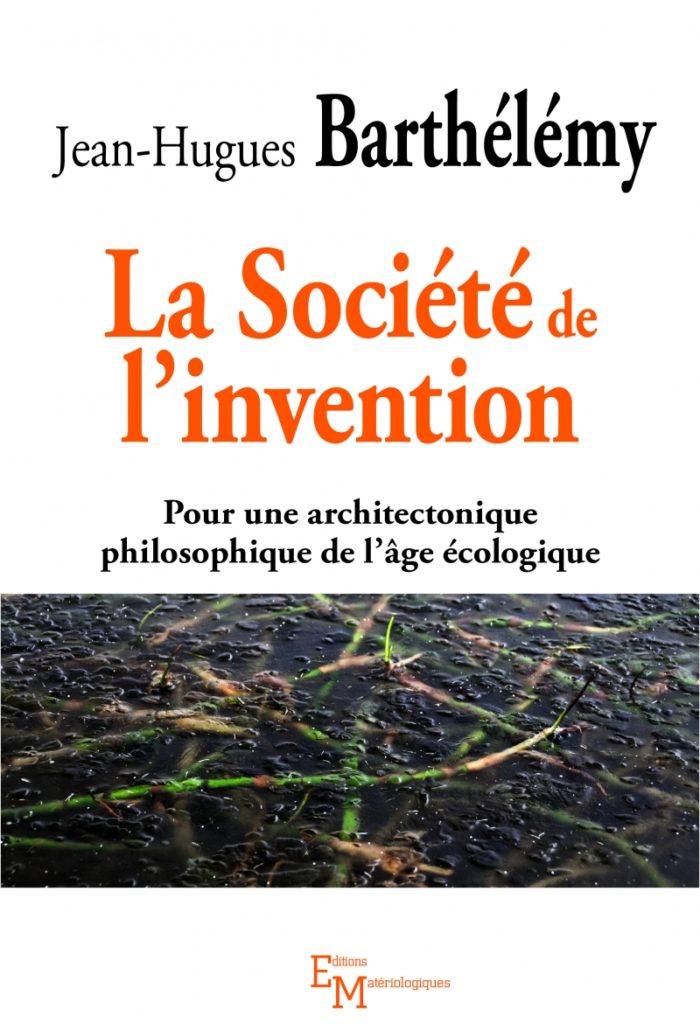 Ludovic Duhem : Alors que les quatre chapitres de la deuxième partie de ton ouvrage exposent ce que tu y nommes les « schèmes » nécessaires à ton projet de reconstruction philosophique globale, les quatre chapitres de sa première partie ne font, eux, qu’y préparer en revenant sur ce que tu présentes comme quatre « problèmes » philosophiques très contemporains dont le traitement conduit selon toi à « repenser » ou même « redéfinir » certaines notions très actuelles, mais qui sont restées floues au lieu de devenir des concepts proprement dits : le problème de l’humanité et de l’animalité après Darwin – pour « repenser l’être sujet » (chap. I) ; le problème des conditions de possibilité et limites de la connaissance après la relativité einsteinienne et la physique quantique – pour « redéfinir la technoscience » (chap. II) ; le problème de la gouvernementalité en contexte technologique après le numérique – pour « repenser la technocratie » (chap. III) ; le problème du sens de l’éducation et des valeurs – pour « redéfinir la crise du sens » (chap. IV). J’ai ici deux questions réciproques l’une de l’autre : premièrement, en quoi ces problèmes ont-ils besoin d’être revisités via un dialogue critique avec certains penseurs actuels, en particulier avec Stiegler et Latour, auxquels tu accordes une attention plus soutenue et plus transversale ? Deuxièmement, pourquoi la discussion engagée au sujet de ces quatre problèmes n’est-elle pas aussi engagée de manière plus serrée avec les théories contemporaines du sens, en particulier celles élaborées par la philosophie analytique que tu évoques pourtant ?
Ludovic Duhem : Alors que les quatre chapitres de la deuxième partie de ton ouvrage exposent ce que tu y nommes les « schèmes » nécessaires à ton projet de reconstruction philosophique globale, les quatre chapitres de sa première partie ne font, eux, qu’y préparer en revenant sur ce que tu présentes comme quatre « problèmes » philosophiques très contemporains dont le traitement conduit selon toi à « repenser » ou même « redéfinir » certaines notions très actuelles, mais qui sont restées floues au lieu de devenir des concepts proprement dits : le problème de l’humanité et de l’animalité après Darwin – pour « repenser l’être sujet » (chap. I) ; le problème des conditions de possibilité et limites de la connaissance après la relativité einsteinienne et la physique quantique – pour « redéfinir la technoscience » (chap. II) ; le problème de la gouvernementalité en contexte technologique après le numérique – pour « repenser la technocratie » (chap. III) ; le problème du sens de l’éducation et des valeurs – pour « redéfinir la crise du sens » (chap. IV). J’ai ici deux questions réciproques l’une de l’autre : premièrement, en quoi ces problèmes ont-ils besoin d’être revisités via un dialogue critique avec certains penseurs actuels, en particulier avec Stiegler et Latour, auxquels tu accordes une attention plus soutenue et plus transversale ? Deuxièmement, pourquoi la discussion engagée au sujet de ces quatre problèmes n’est-elle pas aussi engagée de manière plus serrée avec les théories contemporaines du sens, en particulier celles élaborées par la philosophie analytique que tu évoques pourtant ?
Jean-Hugues Barthélémy : Pour ce qui est de ta première sous-question, il est vrai que ma confrontation à Stiegler est un peu plus transversale, dans l’ouvrage, que mes confrontations pourtant répétées à Kant, Husserl, Heidegger ou Rawls. Cependant, elle n’est pas plus transversale que mon double rapport – de filiation écologiste et de critique architectonique – à Hans Jonas, et elle l’est moins que mon double rapport – de filiation anti-substantialiste et de critique architectonique – à Simondon. Latour, lui, est présent uniquement aux chapitres II et IV de la première partie de l’ouvrage, tandis que Stiegler, qui est présent aux chapitres III et IV, intervient également dans la seconde partie puisqu’il fait l’objet de ma critique dans le chapitre VII, consacré à la refondation hors l’éthique du droit.
La présence de Latour dans le chapitre II, qui vise à redéfinir la notion de technoscience, était incontournable. Contrairement à ce que disent certains sociologues des sciences, c’est le philosophe Gilbert Hottois et non pas Latour qui est le créateur de l’acception proprement philosophique de cette notion. Or, je montre que le potentiel épistémologique de cette dernière, tel qu’il était présent chez Hottois, ne s’est jamais réalisé, et que Latour est pour beaucoup dans le fait que la notion ne soit même jamais devenue un concept. J’avais d’ailleurs publié ici même, dans notre dossier « Technique et technoscience », un article intitulé « Technoscience : propositions épistémologiques pour un devenir-concept d’une idée devenue embarrassante », qui livrait la version à la fois pédagogique et synthétique de ce qui deviendra quelques mois plus tard le chapitre II de La Société de l’invention. À chaque fois, donc, je soutiens qu’un véritable concept de technoscience ne peut pas désigner un âge de la science, mais un âge post-bachelardien de la compréhension des conditions techniques qui ont toujours été, depuis Galilée, celles de la physique. En lien avec ceci, je montre que le relativisme résiduel et dénié de Latour ne peut réconcilier découverte et invention sans soumettre la première à la seconde, ce que ne fera pas une véritable Relativité philosophique.
Quant à Stiegler, il était incontournable dans le chapitre III, qui vise à repenser la technocratie. Depuis l’époque où Foucault thématisait les techniques de pouvoir logées au cœur même des savoirs, la technocratie a changé de visage au profit des pouvoirs de « La Technique ». La différence, telle que la pense la philosophie de « La Technique » à la suite de Heidegger comme aussi bien de La Technique ou l’enjeu du siècle de Jacques Ellul, n’est pas que nous serions seulement passés des méthodes de contrainte des corps à celles, plus subtiles, de contrainte des esprits, ni seulement des « experts » dotés de savoir-faire aux « systèmes-experts » technologiques. La philosophie récente de « La Technique » voit dans cette dernière davantage qu’un ensemble de savoir-faire sophistiqués – « les techniques » -, et davantage aussi qu’un puissant ensemble de moyens artefactuels – « la technique ». Elle y voit bien plutôt ce qui seul permet de rendre compte de cette puissance elle-même : l’appartenance de « La Technique » au devenir de l’humain comme « destin » ou, mieux encore, la fondation de l’humain lui-même sur ces « béquilles de l’esprit » que seraient, aux yeux de Stiegler, les artefacts. Je pose alors en termes de mutation de la technocratie la question, également soulevée par Stiegler, de l’unification du système technique par la phase numérique de l’âge de l’information.
J’en viens maintenant à ta deuxième sous-question. Parmi les quatre chapitres de la première partie de l’ouvrage, le seul où j’aurais pu faire intervenir les théories analytiques du sens est le chapitre IV, qui vise à redéfinir la notion de « crise du sens ». Mais cette notion même n’est pas une notion analytique, et c’est pourquoi il faut attendre le chapitre V, qui ouvre la seconde partie de l’ouvrage et veut repenser le sens comme faire-sens tridimensionnel de toute chose, pour voir apparaître le nom de Wittgenstein – qui, depuis 1989, a toujours été le philosophe dont je me sentais le plus proche dans mon questionnement le plus fondamental et le moins fondationnel à la fois, celui qui me conduit aujourd’hui à envisager la sémantique archiréflexive. Même dans ce chapitre V, cependant, mon double rapport de filiation réflexive et de critique architectonique – ou archiréflexive – à Wittgenstein n’est qu’allusivement évoqué, parce que La Société de l’invention a pour strict complément La Philosophie du paradoxe, où je consacre un chapitre entier au philosophe autrichien.
Dans La Société de l’invention, donc, je me contente de signaler que le second Wittgenstein, s’il a bien distingué contre le premier Wittgenstein entre l’objet d’un nom et sa signification, a cependant ramené celle-ci à l’usage du nom sans penser le fait que le faire-sens de l’objet lui-même est pluridimensionnel et irréductible à l’ob-jet noématique. À cet oubli se rattache le fait que Wittgenstein nous enferme dans le langage – dont la « grammaire » est certes élargie aux « formes de vie », mais qui n’aurait pas de genèse – au lieu de penser un sens prélangagier, et lui aussi pluridimensionnel. Dans La philosophie du paradoxe, je développe cette critique, en lien avec la question archiréflexive de la non-originarité de l’individu philosophant comme sens-sujet individuant le sens, milieu de tous les milieux. Je tâche par la même occasion de déceler dans De la certitude, ultime texte de Wittgenstein, quelques éléments qui rendent possible une transition entre le « tournant grammatical » wittgensteinien et ma sémantique archiréflexive. En font partie les aphorismes « Peut-on dire : où manque le doute, manque aussi le savoir ? » et « Ce qu’il faut à nouveau ici, c’est un pas, analogue à celui que fait la théorie de la relativité », mais aussi « De toute façon, il est important de se représenter un langage dans lequel n’existe pas notre concept de savoir », où le tournant grammatical pointe désormais vers autre chose que la réduction anti-théorétique des prétendus pseudo-problèmes à des questions de définition…
Ta question m’a donc donné l’occasion d’annoncer quelque peu le propos de La Philosophie du paradoxe, un an avant sa parution! Pour ce qui est des auteurs avec lesquels je dialogue dans La Société de l’invention puis dans La Philosophie du paradoxe, je crois qu’il y a là encore une réelle complémentarité entre ces deux ouvrages : tandis que le premier dialoguait surtout avec Kant, Mill, Husserl, Heidegger, Jonas, Simondon, Rawls, Latour, Stiegler et Pelluchon, le second dialogue surtout avec Wittgenstein, Popper, Kuhn, Deleuze, Habermas, Descombes, Badiou, Benoist et Meillassoux. Ces deux derniers sont les deux philosophes de ma génération avec qui j’ai réellement envie de dialoguer, Benoist étant plus spécifiquement celui dont j’ai suivi l’évolution depuis 25 ans en m’étant toujours dit que nos questionnements les plus fondamentaux – et les moins fondationnels, j’y insiste – étaient extrêmement proches, même si nos réponses ne sont proches que depuis que Benoist est devenu post-wittgensteinien – pour ma part, et depuis un très long exposé oral et passionné de 3 heures que j’avais consacré à De la certitude en 1989 à l’Université de Rennes 1, j’ai toujours été post-wittgensteinien dans mon questionnement le plus fondamental, et quoi qu’en pensent ceux qui ne connaissent que mes travaux sur Simondon et la problématique épistémo-ontologique !
Dans La Philosophie du paradoxe, je discute le contextualisme de Benoist, dans la mesure où d’une part il reconduit volontiers les prétendus pseudo-problèmes à des questions de définitions sans interroger la différence, qu’il présuppose, entre définition nominale et définition réelle, et d’autre part il ne pense pas le décentrement scientifique par lequel, justement, les définitions nominales elles-mêmes peuvent parfois se révéler réelles et, comme telles, modifiables si le progrès de la connaissance scientifique l’exige. En fait, le problème du décentrement est, depuis La Société de l’invention, le problème fondamental de la philosophie et celui que je reproche à la philosophie occidentale, y compris post-wittgensteinienne, de ne pas avoir posé dans sa radicalité – certes extrêmement dérangeante pour les ambitions des philosophes. Car contrairement au sujet scientifique, l’individu philosophant, au moment où il ob-jective les significations manipulées comme égalées à leur dénotation noématique, n’a rien pour se décentrer et réduit donc lui-même le faire-sens de ces significations à cette seule dimension noématique. Par là il se rend à son insu originaire parce que non constitué par le sens ainsi ob-jectivé, même lorsque ses propres thèses soutiennent la non-originarité du sujet en général. C’est ce problème abyssal, et aporétique en apparence, qui est exposé puis résolu par la sémantique archiréflexive au chapitre V de La Société de l’invention, et que reprend de façon détaillée La Philosophie du paradoxe dans ses chapitres III (« Introduction au Problème du décentrement ») et VI (« Vers la Relativité philosophique »).
Quant à Meillassoux, La Philosophie du paradoxe discute justement la réflexivité de son « matérialisme spéculatif » à l’aune de mon propre questionnement post-wittgensteinien et archiréflexif sur les conséquences, restées impensées, de l’ob-jectivation, par l’individu philosophant, des significations qu’il manipule. Je montre aussi, en lien avec cette question, que Meillassoux se facilite la tâche en faisant contraster le réalisme spéculatif avec le simplisme du réalisme spontané ou naïf, et sans penser aucunement le très complexe réalisme gnoséologique décentré conquis de haute lutte par la science contre le réalisme spontané. De même, donc, que le réalisme spéculatif ne se rend pas capable d’un réalisme non gnoséologique du sens, de même, sur le terrain proprement gnoséologique cette fois, il ne pense pas le décentrement scientifique et ses deux vertus – dont la seconde n’a jamais été pensée jusqu’ici : a/ la transformation de l’ob-jectivation spontanée des significations par l’intention[n]alité humaine en objectivité, et b/ la capacité à ob-jectiver les significations sans se rendre pour autant et à son insu originaire parce que non constitué par le sens ainsi ob-jectivé.
Ludovic Duhem : À plusieurs reprises depuis le début de cet entretien, y compris à l’instant même, tu as évoqué ce qui est l’idée philosophique la plus centrale et fondamentale du livre – une idée qui me paraît tout à fait nouvelle et d’une grande portée –, à savoir que la résolution de la « crise du sens » comprise comme crise de la réflexivité implique l’abandon de la connaissance à la science – la « connaissance » philosophique de soi étant d’une autre nature, archiréflexive et diffractante pour le sens, dont il s’agit de révéler la pluridimensionnalité restée selon toi impensée –, parce que le sujet connaissant de la science, lui, parvient à se décentrer et ne subit donc pas les effets de la loi illusionnante de l’intentionnalité humaine comme structure d’oubli de sa propre non-originarité de sens-sujet individuant le sens – « milieu de tous les milieux ». Pourrais-tu expliciter davantage cette idée qui semble faire du sens lui-même le réel comme tel, et dire en quoi ta pensée « archiréflexive » de la « non-originarité » restée impensée de l’individu philosophant parviendrait à aller au-delà de ce que la phénoménologie (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty) puis l’herméneutique (Heidegger, Gadamer, Ricoeur) ont pu penser au siècle dernier ?
Jean-Hugues Barthélémy : Tu viens de formuler le fond de l’affaire, en effet, dans toute sa complexité et en connectant les trois idées qui le définissent dans sa nouveauté archiréflexive – source de tant de malentendus, que j’espère dissiper dans La Philosophie du paradoxe – : les trois idées a/ du décentrement du sujet connaissant de la science, b/ de la pluri-dimensionnalité du sens comme faire-sens de toute chose et c/ de l’intentionnalité humaine comme intentionnalité ob-jectivante pour le sens et donc comme structure d’oubli de sa propre non-originarité de sens-sujet individuant le sens.
Cette structure d’oubli, d’abord, n’est pas ce que Husserl nommait l’oubli de soi de l’intentionnalité dans son objet. Si l’archiréflexivité sémantique se situe au-delà de la réflexivité phénoménologique, c’est parce que la structure d’oubli dont elle parle et qu’elle tente de déjouer est une loi de fonctionnement qui conduit tout sujet humain à se rendre originaire, et à le faire à son insu. Husserl voulait reconduire l’intentionnalité humaine à elle-même en tant que source du sens, tandis que je veux pour ma part sauver l’intentionnalité humaine de son auto-absolutisation insue. Cette auto-absolutisation insue est précisément ce que Husserl, par la réduction phénoménologique, a prétendu transformer en thèse consciente et assumée : chez lui, l’individu philosophant qui pratique la réduction se découvre sujet transcendantal qui constitue le sens depuis l’originarité de l’ego cogito qu’il est. Mais il y a chez une Husserl une contradiction : le sujet constitue le sens tout en prétendant accéder aux idéalités ob-jectives. Ma solution ne consiste pas à dire que si le sens n’est précisément pas ob-jet, c’est parce qu’il est constitué par le sujet. Elle consiste à dire que si le sens n’est pas ob-jet, c’est parce qu’il n’est pas noématique mais pluridimensionnel et qu’il constitue le sujet, qui est non-originaire et qui individue le sens comme une transcendance constitutive. Le chapitre V de La Société de l’invention rappelle d’abord en quoi Heidegger, au §13 de Sein und Zeit, pense déjà ce qu’il nomme la « plurimodalité » de l’« être-au-monde », dont la connaissance ne serait qu’un mode, puis en quoi, malheureusement, cette thèse, chez Heidegger, ne s’applique pas à l’individu philosophant lui-même dans sa non-originarité de sens-sujet pour l’obliger à diffracter pluridimensionnellement les significations mêmes qu’il manipule – afin de révéler en quoi leur faire-sens ne se réduit pas à l’ob-jet noématique de connaissance et peut donc s’individuer dans l’individu philosophant non-originaire. Au lieu d’instaurer l’archiréflexivité qui diffracte pluridimensionnellement toute signification, Heidegger se contente de penser aux §§ 15-18 une « significativité » (Bedeutsamkeit) comme structure de renvois entre étants.
Mais encore une fois, ceci n’est compréhensible que si l’on accepte de questionner ce qui ne l’a jamais été : l’intentionnalité humaine elle-même en tant que structure d’oubli de sa propre non-originarité nous rendant incapables d’admettre qu’en tant que faire-sens, l’arbre ou la table ou l’humain « là-devant » ou le concept, etc., à l’infini, nous font, nous qui ne sommes pas originaires… Il s’agit donc, pour l’individu philosophant, de penser sa propre non-originarité en cessant d’ob-jectiver les significations manipulées comme égalées à leur dénotation noématique, car cette ob-jectivation réduisant le faire-sens à la seule dimension de l’ob-jet rendait l’individu philosophant originaire, et cela à son insu. Les sciences, elles, ont inventé au contraire des types de décentrement qui permettent au sujet connaissant non seulement de transformer l’ob-jectivation des significations en objectivité, mais également de ne pas se rendre originaire à son insu lorsqu’il réduit ainsi le faire-sens des significations à la seule dimension de l’ob-jet. Mais réciproquement, les sciences, dans leur ob-jectivation spontanée – jusqu’ici partagée à tort par la philosophie – des significations manipulées, ne peuvent diffracter pluridimensionnellement ces significations, la « connaissance » de soi-même comme sens-sujet non-originaire parce que fait par le sens tridimensionnel étant l’affaire, bien modeste, de la philosophie telle qu’elle comprend aujourd’hui sa véritable vocation.
Lorsque je parlais plus haut d’un réalisme non gnoséologique du sens, cela signifiait justement que le sens est pluridimensionnel et donc irréductible à la seule dimension de l’ob-jet de connaissance. Il est une transcendance qui, parce qu’elle ne me fait pas face mais déborde bien plutôt la seule dimension de l’ob-jet, me constitue : une transcendance que j’individue dans ma non-originarité de sens-sujet qui pense des sens-objets. En cela le sens est bien « le réel », comme tu disais, mais surtout pas le réel tel que je pourrais prétendre le réduire à l’ob-jet connu. C’est la raison pour laquelle, lorsque l’ontologie – désormais seconde parce que traduction unidimensionnelle parmi d’autres de la sémantique archiréflexive – propose que le sens comme transcendance constitutive soit l’interface langue technicisée/système d’objets symbolisés s’individuant en moi pour me faire sens-sujet, cette explication doit rester philosophiquement seconde et proposée/soumise aux savoirs proprement dits, qui sont les savoirs scientifiques. De même, on ne doit surtout pas conclure de cela que les animaux non techno-langagièrement reconstruits en sens-sujets ne vivraient pas du sens, car leur constitution psycho-physiologique tridimensionnelle – elle est affectivo-perceptivo-active – est ce qui donne un sens à ce qu’ils vivent. Simplement, n’étant pas techno-langagièrement reconstruits – leur langage et leur technique ne se sont pas interpénétrés pour devenir une double transcendance constitutive -, leur intentionnalité n’ob-jective pas encore le sens sous la forme de significations égalées à leur dénotation noématique. Le paradoxe est donc que si l’intentionnalité humaine est une intentionnalité ob-jectivante pour le sens – et créatrice de significations nouvelles comme d’objets nouveaux -, c’est parce qu’elle s’est reconstruite à partir d’une double transcendance constitutive qui est la nouvelle forme du sens pluridimensionnel et in-ob-jectivable…
Ludovic Duhem : Pour conclure cet entretien, il reste un dernier point à aborder qui n’est pas la moindre originalité de La Société de l’invention. En l’occurrence, de la méthode archi-réflexive adoptée pour résoudre la crise du sens, il ne résulte pas seulement une redéfinition des domaines de la philosophie (le domaine épistémo-ontologique, le domaine politico-économique et le domaine pédagogico-axiologique), mais aussi un humanisme décentré – évoqué plus haut – qui va jusqu’à reconnaître le statut de « sujet » aux êtres vivants « sensitivo-émotifs » et à leur accorder des droits. Or – et c’est là que tu proposes une idée audacieuse aux conséquences multiples -, tu considères que le droit n’est justement plus à penser comme un « système de compatibilité des libres-arbitres » axiologiquement fondé et anthropocentrique, mais comme le « système de la compatibilité des besoins en souffrance » partagés par bien plus d’êtres vivants. Il s’ensuit à mon sens plusieurs questions décisives : comment peut-on ainsi « refonder le droit hors l’éthique » contre toute la tradition juridique et morale ? Comment peut-on faire de la justice un « régime de normativité » qui ne soit plus ni ontologique ni surtout axiologique ? Pourquoi les notions biologico-économiques de « besoin » et de « dette » sont-elle alors nécessaires pour assurer des droits aux vivants humains et non humains ? Quelles sont finalement les conséquences politiques d’une telle voie pour former société avec les non-humains sans exclure ce qui fonde traditionnellement la polis et plus précisément la démocratie (liberté, rationalité, égalité, représentation, souveraineté) ?
Jean-Hugues Barthélémy : Je commencerai par ta dernière sous-question, car elle me permettra d’évoquer un dialogue, que je crois ici utile à la pédagogie de mon projet, avec la philosophe politique écologiste Corine Pelluchon. Celle-ci a le mérite de vouloir donner des droits aux animaux non-humains, mais elle prétend le faire à partir d’un contrat social post-rawlsien. Il me semble qu’il n’est pas possible, dans une théorie du contrat, de donner des droits à des non-contractants. Par ailleurs, l’optique de Pelluchon semble travaillée par une ambition de séparation du droit – et de la problématique politique – vis-à-vis de l’éthique qui pourtant ne se réalise pas chez elle. De fait, ma refondation du droit est quant à elle clairement « hors l’éthique » d’une part, et d’autre part elle ne relève pas d’une théorie du contrat. Mais comme tu le dis, le risque est de ne plus conserver le fondement démocratique du droit. Sur ce point, la reconstruction globale du philosopher comme simple connaissance de soi – dans sa non-originarité – qui se traduit secondairement en trois problématiques respectivement épistémo-ontologique, politico-économique et pédagogico-axiologique permet de prévenir aisément ce risque. En effet, de même que l’ontologie est soumise à cette transcendance qu’est pour elle le savoir scientifique, de même l’économie politique comme éco-logie politique refondant le droit est soumise à cette transcendance qu’est pour elle la volonté du collectif humain – et l’axiologie, elle, est soumise à la transcendance qu’est pour elle la conduite de l’individu philosophant. Il ne s’agit pas pour autant d’un retour de la théorie du contrat au sein de ce qui se présente comme autre : il s’agit bien plutôt d’échapper au débat contemporain entre théories du contrat et théories postmarxistes du soupçon. D’où mon propos final dans ce chapitre VII sur la philosophie de la production économique. J’ajoute à cet égard, et pour faire le lien avec ta première sous-question, que prendre ainsi à contre-pied toute la tradition philosophique occidentale – qui privilégie en effet la fondation éthique du droit – me paraît d’autant moins problématique que c’est aujourd’hui parfaitement nécessaire à la résolution de la crise du sens dans sa tridimensionnalité restée impensée. Par ailleurs, je ne dirais pas que la tradition « juridique » s’associe à la tradition philosophique, s’il est vrai que le positivisme juridique se situe hors l’éthique. Mais ce que je lui reproche, c’est de ne pas fonder le droit sur la normativité du besoin en souffrance – cette normativité que je dis « économique » et non pas axiologique. Le positivisme juridique est en réalité au service d’une société du désir qui a oublié la normativité du besoin au nom de l’ « intérêt », et l’économie politique qu’il favorise n’est absolument pas celle qui satisfait les besoins de tous dans un souci écologique.
La réponse à ta deuxième sous-question devient ici possible. Car si la justice n’appartient plus à l’ordre axiologique du Bien, du Beau et du Vrai – qui est chez moi l’authentique axiologique et non pas l’ob-jectif épistémo-ontologique -, c’est parce que dans de nombreuses espèces la justice et la liberté sont ressenties, selon une complexité fort variable, comme des besoins, dont la satisfaction est ainsi au service du besoin central et auto-normatif de santé : le gorille enfermé devient dépressif, le chimpanzé rétribué de façon inéquitable refuse de continuer de travailler comme le fait son congénère mieux rétribué. Le besoin, qui n’est ni le désir ni simplement le « besoin vital », est tout ce dont la non-satisfaction engendre la souffrance et l’altération de la santé. À ce titre, justice et liberté ne sont pas des valeurs relevant de l’axiologie mais des besoins relevant de l’économie politique refondant le droit hors l’éthique. C’est le même chapitre VII qui développe ce point, et le chapitre VIII, lui, précise ce qui relève de l’axiologie, et que je qualifie de « pédagogico-axiologique » parce que les valeurs sont ce qui s’incarne dans l’exemplarité et l’ouverture à l’autre pour être transmis non seulement aux enfants mais aussi aux adultes : nous nous éduquons tous les uns les autres, si l’on nomme « éducation » la transmission des valeurs – et « formation », ce qui prépare le jeune aux trois dimensions du sens de toute chose, qui sont aussi les trois dimensions de l’existence.
Il est temps, je crois, de conclure avec la réponse à ta troisième sous-question. Tu qualifies le besoin de notion « biologico-économique ». Chez moi elle est économique mais transcende le biologique proprement dit, puisque la liberté et la justice sont des besoins humains – et souvent non-humains dans leurs formes moins complexes, tel le besoin de liberté de mouvement – dont la non-satisfaction empêche la satisfaction du besoin de santé, celle-ci pouvant elle-même être biologique mais aussi psychique et psycho-sociale. Quant à la notion de dette, elle est la traduction politico-économique de ma non-originarité sémantique d’individu philosophant individuant le sens. Ici comme à chaque fois, tout se comprend en partant de la sémantique archiréflexive première, qui seule me protège de retomber dans une attitude de savoir – épistémo-ontologique, politico-économique ou pédagogico-axiologique – qui ferait qu’à mon insu je me rendrais originaire car non constitué par le sens que je manipule. C’est pourquoi le chapitre V et le début de chacun des chapitres VI, VII et VIII sont décisifs pour comprendre la méthode nouvelle et ses exigences radicalement anti-dogmatiques. La Philosophie du paradoxe, je l’ai dit, reviendra sur la méthode.