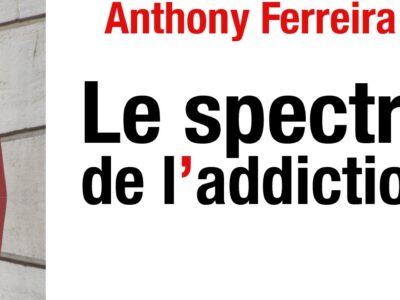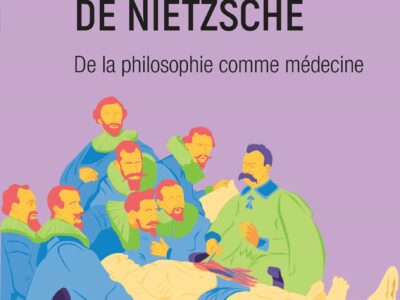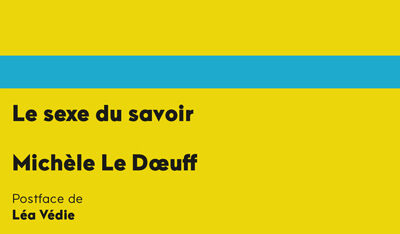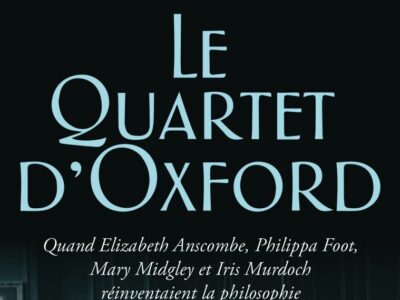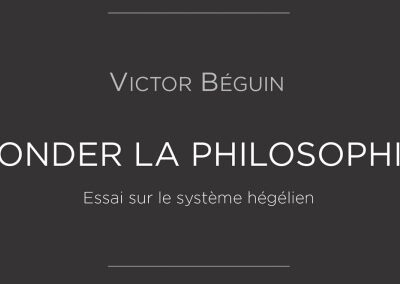Les Essais de Montaigne : un ars bene vivendi
Spécialiste de l’histoire littéraire et intellectuelle de la première modernité, Jean-Claude Vuillemin est Liberal Art Research Professor Emeritus de littérature française à la Pennsylvania State University (États-Unis). Outre « Foucault archéologue : généalogie d’un concept », déjà publié dans Implications philosophiques en 2017, il est l’auteur de nombreuses autres études consacrées à la problématique baroque, aux théories de la littérature et à la dramaturgie du XVIIe siècle, dont en particulier celle de Jean de Rotrou (1609-1650). Après Épistémè baroque : le mot et la chose (Hermann, 2013) et Foucault l’intempestif (Hermann, 2019), son prochain livre portera sur la notion de « vivre à propos » chez Montaigne.
Résumé
Après avoir proclamé que « l’objet nécessaire de notre visée » c’est la mort (I, 20, 84), Montaigne affirme que celle-ci est « le bout, non […] le but de la vie » (III, 12, 1051). Examinant en particulier l’épisode de son accident de cheval que l’essayiste relate dans « De l’exercitation » (II, 6) et la Lettre adressée à son père sur la mort exemplaire de La Boétie (1563), cet article discute cette apparente palinodie en prenant en compte l’ensemble des Essais. La présence de plus en plus concrète de la mort s’avère pour Montaigne le vecteur d’une philosophie bien moins préoccupée par l’apprentissage du trépas que par l’exhortation à « vivre à propos » (III, 13, 1108) ; un ars bene vivendi plutôt qu’un ars moriendi.
Mots-clés : mort, agonie, La Boétie, philosophie, « vivre à propos »
Abstract
After contending that death is paramount and that philosophy teaches how to properly come to terms with it (Essays, I, 20), Montaigne then claims that death is not life’s goal but only its end (ibid., III, 12). Focusing mainly on “On Exercise” (ibid., II, 6) and on Montaigne’s letter to his father about La Boétie’s commendable agony (1563), this article revisits this apparent palinode in the framework of the whole Essays. It is not so much philosophizing that instructs Montaigne on how to die correctly, but rather the unavoidability of dying which guides him on how to ‘live appropriately’ (ibid., III, 13). Rather than an ars moriendi, Montaigne’s Essays are indeed an ars bene vivendi.
Keywords: death, agony, La Boétie, philosophy, “to live appropriately”
« Je ne m’étrange pas tant de l’être mort comme j’entre en confidence avec le mourir. »
Montaigne, Essais, III, 9, 971[1].
« Notre grand et glorieux chef-d’œuvre c’est vivre à propos. »
Montaigne, Essais, III, 13, 1108.
I. Introduction
On a souvent relevé la contradiction entre les déclarations de l’essai « Que philosopher c’est apprendre à mourir », qui invitent à considérer la mort comme « Le but de notre carrière […] l’objet nécessaire de notre visée » (I, 20, 84), et l’affirmation subséquente du chapitre « De la physionomie » selon laquelle la mort devient au contraire « le bout, non pourtant le but de la vie » (III, 12, 1051). Davantage qu’un reniement à mettre au compte d’un éventuel tournant philosophique de l’essayiste qui serait prétendument passé du stoïcisme à l’épicurisme[2], je propose de lire cette apparente volte-face comme résultant d’une seule et même stratégie : échapper à l’obsession de la mort qui n’a cessé de hanter Montaigne, et cela depuis « la saison la plus licencieuse de [s]on âge » (I, 20, 87). Pour l’essayiste, il appert en définitive que philosopher est beaucoup moins apprendre à mourir qu’un formidable encouragement à profiter de la vie.
II. La mort : le bout, non le but de la vie
Émaillé de sentencieuses maximes stoïciennes et épicuriennes que Montaigne égraine en une suite d’apophtegmes pour mieux peut-être s’en persuader[3], le chapitre de 1572 « Que philosopher c’est apprendre à mourir » est moins une adhésion à la philosophie austère du Portique ou à la morale apparemment plus accommodante du Jardin qu’une tentative pour esquiver une pensée mortifère qui rend la vie invivable. S’il était possible d’échapper « fût-ce sous la peau d’un veau » (I, 20, 85) à la perspective de la mort ou d’avoir recours aux « armes de la couardise » (ibid., 86), Montaigne n’aurait pas hésité à choisir cette solution peu glorieuse et à couler une existence paisible dépourvue d’exemplarité : « le meilleur jeu que je me puisse donner », avoue-t-il, « je le prends, si peu glorieux au reste et exemplaire que vous voudrez » (ibid.). Prêt à tout pour éviter la mort, il s’étonne par conséquent de la décision de Socrate qui, estimant « une sentence d’exil pire qu’une sentence de mort » (III, 9, 973), refusa de quitter Athènes et de contrevenir à des lois qui, pourtant, étaient alors « si fort corrompues » (ibid.). Décision d’autant plus inconcevable pour notre essayiste que Socrate « jugeait le monde sa ville » (ibid.).
À défaut de pouvoir acclimater la mort en y pensant le moins possible, comme le fait souvent le commun des mortels, Montaigne s’efforce initialement de la circonvenir en s’appuyant sur des poncifs philosophiques. C’est du moins ce que permet d’augurer la formule que Cicéron dans ses Tusculanes emprunte au Socrate du Phédon de Platon[4] et que reprend Montaigne dans l’incipit d’un chapitre à l’intitulé programmatique : « Cicéron dit que Philosopher n’est autre chose que s’apprêter à la mort » (I, 20, 81). Stratagème pourtant aussi infructueux que cette « nonchalance bestiale » (ibid., 86) de tous ceux et celles qui se défont allègrement du « pensement de la mort » (ibid., 85) :
Ils vont, ils viennent, ils trottent, ils dansent, de mort nulles nouvelles. Tout cela est beau. Mais aussi quand elle arrive, ou à eux, ou à leurs femmes, enfants et amis, les surprenant en dessoude [i. e. à l’improviste] et à découvert [i. e. sans défense], quels tourments, quels cris, quelle rage, et quel désespoir les accable ! Vîtes-vous jamais rien si rabaissé, si changé, si confus ? (ibid., 86)
Cette désinvolture que moque ici Montaigne et que fustigera Pascal dans sa critique du divertissement nous menant « insensiblement à la mort » (Pensées, fr. 33, 841) et qu’il assimilera à « un enchantement incompréhensible » (ibid., fr. 681, 1222) sera au contraire hautement louée par Nietzsche qui voyait en cela une occasion de se réjouir. Ce qui rendra heureux l’auteur du Gai Savoir en constatant « que les hommes ne veulent absolument pas penser la pensée de la mort » (IV, § 278, 209) ne procède pas de leur possible cécité mais viendrait plutôt de leur capacité à gérer l’inéluctable. Ayant affranchi la mort de toute vaine angoisse, les hommes – du moins certains d’entre eux – sont dès lors en mesure de jouir pleinement de la vie. Ce ne serait donc pas leur supposé aveuglement qui met Nietzsche en joie, c’est au contraire la sagesse de ces surhommes audacieux et souverains qui corroborent la proposition de Spinoza selon laquelle « L’homme libre ne pense à rien moins qu’à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie » (L’Éthique, IV, prop. 67, 331). Mais, ne pas se soucier de la mort n’implique malheureusement pas pour autant mieux s’occuper de la vie.
Si les stoïciens exigeaient que l’on supporte avec courage et équanimité les vicissitudes de la vie, Nietzsche emboîte le pas des sectateurs de Marc Aurèle[5] et, franchissant une étape supplémentaire, demande que nous les aimions : « Ne pas seulement supporter la nécessité, encore moins se la dissimuler […] mais l’aimer » (Ecce Homo, « Pourquoi je suis si avisé », § 10, 1237). Aimer la vie avec toutes ses joies et ses plaisirs – ce qui ne devrait pas faire difficulté – mais aussi – ce qui est beaucoup plus ardu – l’apprécier avec ses épreuves et ses malheurs.
Sans pour autant souscrire à cet amor fati que prônera Nietzsche et qui génère la joie, Montaigne aurait souhaité, je pense, pouvoir se conduire comme ceux ou celles qu’il critique. Mais, incapable d’adopter une telle posture insoucieuse, il la dévalorise. « Ils sont trop verts », prétendra de même le Renard de La Fontaine à propos des raisins qu’il ne peut atteindre, « et bons pour des goujats ». Cette stratégie consistant à dénigrer ce qui nous échappe sera épinglée par notre essayiste dans la boutade qui ouvre le chapitre consacré à la grandeur : « Puisque nous ne la pouvons atteindre », ironise-t-il, « vengeons-nous à en médire » (III, 7, 916).
Les ajouts ultérieurs à la version initiale de « Que philosopher c’est apprendre à mourir » (I, 20) peuvent être perçus comme les prodromes de la conduite tout à fait contraire que Montaigne adoptera une quinzaine d’années plus tard dans « De la physionomie » (III, 12). La mort a beau être pour l’instant encore le « but de notre carrière », elle se trouve néanmoins fortement concurrencée par les félicités de la vie qu’apportent les additions de 1588 : « le plaisir est notre but », insère Montaigne dans son texte de 1572 (I, 20, 81). Le « dernier but de notre visée » n’est plus la mort, « c’est la volupté » (ibid., 82).
Pourquoi faudrait-il en effet se préoccuper autant d’une mort qui, n’étant qu’« [u]n quart d’heure de passion sans conséquence, sans nuisance, ne mérite pas des préceptes particuliers » (III, 12, 1051)[6] ? Même si la pertinence du florilège des truismes stoïciens et épicuriens accumulés dans le fameux chapitre « Que philosopher c’est apprendre à mourir » ne saurait être prise en défaut d’un point de vue purement conceptuel, ces prescriptions dogmatiques[7] sont loin de constituer un viatique irréfutable dans le quotidien de l’existence où, enjoint Montaigne, « il faut donner jusqu’aux dernières limites du plaisir » (I, 39, 246).
Faisant preuve d’une sorte de fatalisme gai et s’écartant subrepticement de Sénèque et consorts, Montaigne enjoint d’« allonge[r] les offices de la vie tant qu’on peut » et en arrive même à souhaiter que « la mort [l]e trouve plantant [s]es choux, mais nonchalant d’elle » (I, 20, 89). C’est, par exemple, ce que fit le sultan de Fès, Abd al-Malik qui, gravement malade, continua à combattre les portugais jusqu’à son dernier souffle en 1579. Montaigne conclut son chapitre « Contre la fainéantise », où il est question dudit sultan, en jugeant que « L’extrême degré de traiter courageusement la mort, et le plus naturel, c’est la voir non seulement sans étonnement, mais sans soin, continuant libre le train de la vie jusque dans elle » (II, 21, 679). Rien de très étonnant par conséquent qu’il en vienne à affirmer dans le troisième livre des Essais, écrit quelque vingt ans après avoir récité l’antienne stoïcienne, que la mort c’est le bout et non le but de la vie. La paronomase est explicite dans la quasi-tautologie : le but de la vie, c’est la vie. Dominant sinon éclipsant la mort, la vie « doit être elle-même à soi sa visée » et son légitime effort consiste à « se régler, se conduire, se souffrir » (III, 12, 1052). L’intérêt porte désormais sur le voyage et non plus sur un terminus obsédant auquel Montaigne souhaiterait d’ailleurs pouvoir « coniller et [s]e dérober » (III, 9, 978). La mort est la finitude de la vie, non sa finalité.
La palinodie que semble accréditer l’ingénieuse addition d’une simple voyelle pour qu’un terme perde son sens initial et en acquière un tout contraire ne marquerait-elle pas un ultime stratagème pour se débarrasser de la pensée lancinante de la mort ? Après s’être focalisé sur l’attente de la mort, c’est maintenant le souci de la vie qui prime. Vivre est « non seulement la fondamentale mais la plus illustre [des] occupations » (III, 13, 1108). Comme le décrétait déjà Montaigne dans le chapitre « De l’institution des enfants », écrit peu de temps après « Que philosopher c’est apprendre à mourir », la philosophie est une science qui n’enseigne pas à mourir mais « qui nous instruit à vivre » (I, 26, 163). Elle aide à mener une existence dont la mort n’est plus désormais que « sa fin, son extrémité, non pourtant son objet » (III, 12, 1052). Il est vrai qu’entre les positions apparemment irréconciliables du chapitre vingt du premier livre et l’avant-dernier du troisième, le rapport à la mort de l’essayiste s’est considérablement modifié.
À l’exception des disparitions notables de La Boétie en 1563, bien sûr, et de son père en 1568, c’est surtout à des morts plus ou moins abstraites que Montaigne fut initialement confronté. Certes, il perdit « deux ou trois » [sic] enfants en bas âge mais, il supporta ces décès, écrit-il, « sinon sans regret, au moins sans fâcherie » (I, 14, 61). Très fréquente à l’époque, la mort d’un nourrisson n’avait rien à voir avec le chagrin que cette disparition occasionne aujourd’hui. En outre, on sait que Montaigne préférait à sa descendance biologique une descendance spirituelle. Les « enfantements de notre esprit », estimait-il, « sont produits par une plus noble partie que la corporelle, et sont plus nôtres » (II, 8, 400). Quid de la lettre de consolation de Plutarque à son épouse Timoxena lors du décès de leur fille, traduite par La Boétie, que Montaigne offrit à sa femme en 1570 à la suite de la mort de Thoinette, leur premier enfant, âgée de seulement deux mois[8] et dont la disparition coïncidait avec son travail éditorial de plusieurs autres textes de l’ami sarladais ? Ce texte ressortit sans doute davantage à l’exercice littéraire traditionnel de l’epistola consolatoria qu’il ne permet d’inférer un sentiment personnel chez la destinataire et moins encore chez le destinateur[9].
Il ne va bientôt plus s’agir d’une fatalité plus ou moins acceptée, d’une espèce de théorie de l’inéluctable, mais d’une pratique de la mort beaucoup plus tangible qui le « pince continuellement la gorge ou les reins » (III, 9, 978). Non seulement Montaigne va-t-il avoir l’occasion de côtoyer maintenant celle qui l’obnubilait depuis toujours, mais il s’est aussi rendu compte de l’inefficacité d’une philosophie pellucide dont se passe allègrement la plupart des mortels. Notamment ses voisins, ces paysans périgourdins que les guerres incessantes et les disettes à répétitions ruinent sans relâche et qui, victimes en particulier de l’épidémie de « peste véhémente » de 1585 (III, 12, 1047), meurent de « meilleure grâce qu’Aristote » :
Je ne vis jamais paysan de mes voisins entrer en cogitation de quelle contenance et assurance il passerait cette heure dernière. Nature lui apprend à ne songer à la mort que quand il se meurt. Et lors, il y a meilleure grâce qu’Aristote, lequel la mort presse doublement, et par elle, et par une si longue prévoyance. (ibid., 1052)
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Montaigne trouve « [l]es mœurs et les propos des paysans […] communément plus ordonnés selon la prescription de la vraie philosophie, que ne sont ceux de nos philosophes » (II, 17, 660). Quant à la nature, qui a soumis l’individu à une mort irrémédiable, elle lui donne aussi les moyens de l’accepter et se montre ainsi meilleure conseillère que la philosophie, voire que la religion[10]. « Nous ne saurions faillir à suivre nature » (III, 12, 1059), prévient Montaigne ; c’est « un doux guide », estime-t-il, « mais non pas plus doux que prudent [i. e. sage] » (III, 13, 1113), ses lois « nous apprennent ce que justement il nous faut » (III, 10, 1009). Natura optima dux sequenta. À son école, où s’inscriront d’ailleurs les stoïciens comme les épicuriens, on apprend qu’il ne faut pas troubler « la vie par le soin de la mort, et la mort par le soin de la vie. L’une nous ennuie, l’autre nous effraye » (III, 12, 1051). À quoi bon, en effet, s’affliger à l’avance d’une chose à laquelle on ne saurait se dérober ? Mais, alors que les stoïciens s’endurcissent contre le réel afin de supporter l’insupportable et s’affermissent contre les maux de la vie en prévoyant notamment la mort par une intense préméditation à son égard, et que les épicuriens tâchent de remédier aux angoisses inhérentes à ce même réel en les déclarant nulles et non advenues[11], Montaigne se nourrit de ces deux doctrines ainsi que du scepticisme, cette philosophie « enquêteuse, non résolutive » (III, 11, 1030), pour façonner une sagesse éclectique à sa convenance[12]. Libre de toute orthodoxie et nullement dogmatique, celle-ci accorde sa primauté à ce “simple” plaisir d’exister que l’on découvre un jour éphémère et unique.
Et c’est peut-être surtout à la suite d’un accident de cheval que le vivre prévaudra dès lors sur toute autre considération. Un vivre que Montaigne, « philosophe imprémédité et fortuit » (II, 12, 546), élèvera au rang de « grand et glorieux chef-d’œuvre » (III, 13, 1108). Même si l’écriture, à laquelle il ne s’adonne d’ailleurs qu’« à diverses pauses et intervalles » (II, 37, 758) et, plus généralement, la littérature confèrent de la profondeur aux épreuves de l’existence, Montaigne placera la vie sinon au-dessus de la pensée, comme le fera Nietzsche, du moins loin au-dessus des dogmes immarcescibles de la philosophie[13].
III. Essai d’une mort approchée
C’est fort à propos que Pascal Quignard consacre un chapitre de ses Désarçonnés à la fameuse chute de cheval que relate Montaigne dans « De l’exercitation » (II, 6). Mais il présume trop vite que « l’écriture des Essais commence dans l’extase mortelle » relative à cet accident (Les Désarçonnés, XVII, 56). Tel n’est pas le cas. L’auteur du magnifique Tous les matins du monde (Gallimard, 1991) aurait-il cueilli cette contre-vérité dans une lecture trop rapide d’un essai que Jean Lacouture consacre à Montaigne ? De toutes les causes qui ont pu déterminer Montaigne à prendre « sa relative et provisoire retraite », Lacouture retient « la plus extravagante », c’est-à-dire cette chute équestre :
C’est gisant à terre et plus qu’à demi-mort que Michel, nouveau seigneur de Montaigne, devint sinon l’auteur des Essais, en tout cas l’explorateur foudroyant de notre conscience et le Plutarque de lui-même. (Montaigne à cheval, 142)
L’on remarquera toutefois que si tel avait été le cas, ce « fou d’équitation » (ibid., 37) qui s’aimerait mieux « bon écuyer que bon logicien » (III, 9, 952), qui souhaiterait passer sa vie « le cul sur une selle » (ibid., 987), qui « ne démonte pas volontiers » (I, 48, 289) et dont les « profondes rêveries » lui arrivent partout « mais plus à cheval, où sont [ses] plus larges entretiens » (III, 5, 876), n’aurait certainement pas manqué d’accorder à cette chute un rôle fondateur de son entreprise littéraire. Il n’en fit rien. Si c’est bien un cheval qui est à l’origine des Essais, il ne s’agit pas de celui monté par Montaigne lors de son accident. Plutôt qu’à ce « petit cheval » victime d’un « puissant roussin » (II, 6, 373), c’est à un équidé métaphorique dissipé que sont redevables les Essais. Celui auquel l’essayiste assimile son esprit dans le bref chapitre « De l’oisiveté » (I, 8) où il transforme un otium indiscipliné en un otium studiosum tout en décrétant très bientôt que c’est « une lâche ambition de vouloir tirer gloire de son oisiveté et de sa cachette » (I, 39, 247).
En 1571, après avoir vendu le 24 juillet 1970 à Florimond de Raemond sa charge de Conseiller au Parlement de Bordeaux[14] et ayant laissé son esprit « en pleine oisiveté », Montaigne s’étonne que celui-ci, « faisant le cheval échappé » engendre quantité « de chimères et monstres fantasques » (I, 8, 33). Afin de se donner tout loisir de les examiner et éventuellement de « faire honte » à son esprit (ibid.), il décide alors de tenir le registre de toutes ses élucubrations. Ces délires intempestifs étaient de surcroît accompagnés d’épisodes dépressifs auxquels le jeune retraité de 38 ans remédie par la « sotte entreprise » consistant dans la « rêverie [i. e. folie] de [s]e mêler d’écrire » (II, 8, 385). Les Essais, cette « marqueterie mal jointe » (III, 9, 964), cette « fricassée » (III, 13, 1079) d’« excréments d’un vieil esprit » (III, 9, 946), résulteraient donc d’une thérapie que Montaigne mit en œuvre afin de dompter une imagination débridée combinée à une « humeur mélancolique […] très ennemie » (II, 8, 385) de sa « gaité naturelle » (III, 8, 938)[15]. « Sans ses poussées de profonde “mélancolie”, et sans sa peur de la folie », écrit Géralde Nakam, « peut-être les Essais n’existeraient-ils pas » (« Montaigne, la mélancolie et la folie », 204). L’accident équestre ne fit donc pas l’auteur, même s’il a certainement eu, comme le suggère Nakam, « un profond retentissement psychologique […], une valeur créatrice déterminante »[16].
Bien que Montaigne soit incapable de se souvenir de la date précise de cet accident de cheval qu’il situe « [p]endant nos troisièmes troubles ou deuxièmes » (II, 6, 373), c’est-à-dire entre 1567 et 1570[17], celui-ci revêt néanmoins un formidable intérêt. Même s’il ne fut pas l’élément déclencheur de l’écriture des Essais, il permit en tout cas à l’essayiste de s’« avoisiner » suffisamment de la mort pour pouvoir l’« apprivoiser » (ibid., 377) et la connaître mieux. Inversement proportionnel à ses effets, il arrive qu’un « événement si léger » (ibid.), comme peut l’être une chute de cheval, offre la possibilité de faire la quasi-expérience de la mort, cette « plus grande besogne que nous ayons à faire » (ibid., 371). Plus éclairant sur le sujet que les témoignages d’autrui rapportés tout au long des Essais, cet accident a l’insigne privilège de permettre à Montaigne de raconter sa propre expérience du passage de la vie à la presque mort ; de faire, comme diraient aujourd’hui les psychologues et autres psychiatres, “une expérience de mort approchée” (EMA) – imminent death experience (IDE).
Il est indubitable que cette dramatique chute de cheval que Montaigne qualifie bizarrement d’« événement si léger » et « assez vain » (II, 6, 377) a eu d’importantes conséquences sur sa vie. De même que l’on ne sort pas indemne d’assister à l’éprouvante agonie d’un proche, on ne revient pas du seuil de l’au-delà sans en rapporter quelques séquelles. Mais il s’agit en l’occurrence de séquelles positives qui se traduisirent par une inextinguible soif de vivre dans l’accomplissement de soi. Ayant constaté que la mort n’est pas aussi terrible qu’il avait pu l’imaginer et qu’elle ne nécessite aucune propédeutique particulière, Montaigne allait profiter de cette révélation pour apprendre à vivre. « Mon métier et mon art : c’est vivre », pourra ainsi déclarer dans l’allongeail qui fait suite à la narration de cet accident celui qui crut un instant avoir trépassé (II, 6, 379). S’il est avéré, comme dit Lucrèce, que personne ne revient de l’au-delà pour en parler (ibid., 371)[18], il est tout aussi vrai que la vie n’apparaît jamais aussi belle qu’à celui ou à celle qui vient de frôler la mort. La vie n’est jamais aussi précieuse que lorsqu’elle se dévoile dans sa précarité. Et lorsqu’elle est traitée comme telle sa valeur s’en trouve accrue. Si cette mésaventure contribua très vraisemblablement à ce que la thématique de la mort soit abondamment présente dans les Essais, elle stimula surtout chez leur auteur une appétence indéfectible pour la vie. La force des Essais ne doit pas masquer le fait que pour Montaigne, qui « aime la vie et la cultive » (III, 13, 1113), l’appétit de vivre l’a toujours emporté sur la nécessité du livre[19]. Lui qui savait pertinemment qu’« à mesure que la possession du vivre est plus courte, il […] la faut rendre plus profonde et plus pleine » (ibid., 1112) et pour qui « [l]a plus expresse marque de la sagesse, c’est une réjouissance constante » (I, 26, 161). Même si cette détermination à jouir de la vie n’annule évidemment pas la mort, elle possède au moins la vertu de la tenir à distance.
Après la perte de La Boétie et celle de son père, ainsi que tous les cadavres qu’il a dû voir en ces temps de guerres civiles ou autres épidémies, cette « défaillance de cœur » (II, 6, 372) occasionnée par sa violente chute lui inspira vraisemblablement le désir d’une vie encore plus vivante. Et cela afin de conjurer l’inéluctable, afin de s’affirmer contre ce qui, tôt ou tard, aura nécessairement raison de lui. Outre cette attitude de défi à l’encontre de la mort, c’est peut-être aussi en souvenir de cet accident que, s’il pouvait choisir le lieu de sa mort, il préférerait que ce fût « plutôt à cheval que dans un lit » (III, 9, 978). Quoi qu’il en soit, Montaigne est maintenant parvenu à la conclusion que « si nous avons su vivre constamment et tranquillement, nous saurons mourir de même » (III, 12, 1051).
IV. L’expérience de la mort
À l’inverse d’autres fâcheux aléas de l’existence auxquels il est malgré tout possible de s’accoutumer, la mort n’offre aucune véritable « exercitation », c’est-à-dire aucun exercice préalable d’entrainement incontestable. Comme le relève à juste titre Montaigne, « nous ne la pouvons essayer qu’une fois ; nous y sommes tous apprentis quand nous y venons » (II, 6, 371). En effet, on ne peut au mieux qu’approcher la mort, on ne saurait la vivre. « Montaigne ne peut rien saisir ni de sa chute, ni de sa mort », remarque pertinemment Laurent Jenny, « revenu à lui, il ne saurait faire que des expériences de vivant » (« “Il ne faut point d’art à la chute” », 34). Toujours à propos de « De l’exercitation », Ullrich Langer écrit que Montaigne « pose la mort comme une expérience impossible, mais fait tout ce qu’il peut pour transmettre l’expérience de ses approches » (« Mourir et agir », 80). Sa syncope lui permet « une saisie de soi, un contact avec la vie au niveau le plus primitif et le plus délicat, sans effroi […] » (ibid.). Rien, ni les réflexions conceptuelles ou les évocations littéraires sur la mort, les pratiques mystiques qui s’en réclament et auxquelles était par ailleurs réfractaire Montaigne[20], ni encore les observations directes de cadavres, ou son caractère apodictique ne renseignent vraiment sur son authentique nature. Bien que la mort soit pour Montaigne « une partie de notre être non moins essentielle que le vivre » (III, 12, 1055), elle échappe néanmoins à toute expérimentation personnelle. Quant aux discours que l’on tient à son endroit, ils sont sujets à caution.
 Si Montaigne considère encore que la manière de se comporter devant la mort constitue « la plus remarquable action de la vie humaine » (II, 13, 605), il met cependant en garde contre ce que donne à voir les agonisants au prétexte que ceux-ci n’ont que très rarement conscience de leur état. Il « n’est endroit », note malicieusement notre essayiste, « où la piperie de l’espérance nous amuse plus » (ibid.). Les témoignages livresques, pour ne pas dire romanesques, de ceux qui ont approché la mort au plus près ne sont donc guère fiables du fait que, n’estimant pas être arrivés à leur dernière heure, leurs auteurs comptent sur ces écrits pour s’assurer une excellente réputation lorsque la mort se sera éloignée. Quant au suicide, Montaigne écarte ceux qui, « tout sain[s] et tout rassis » (ibid., 607), l’envisagent de façon toute théorique dans un avenir indéterminé et il s’intéresse surtout à ceux qui y ont eu véritablement recours. Chez ces derniers, il distingue ceux qui sont morts subitement, sans avoir eu l’occasion « d’en sentir l’effet », c’est-à-dire sans avoir conscience de leur entrée dans le néant, et ceux qui ont eu le temps de « voir écouler la vie peu à peu » (ibid.). Dans cette seconde catégorie, il y a ceux qui ont finalement renoncé à l’exécution de leur projet ; ceux qui, tels Lucius Domitius ou Albucilla, se sont avérés incapables de le mener à terme ; et, enfin, seuls dignes d’intérêt, les rares individus qui, tels le philosophe Cléanthe, le lettré Pomponius Atticus et Tullius Marcellinus, un ami de Lucilius et de Sénèque, sont allés jusqu’au bout de leur dessein alors que plus rien ne les y obligeait. Comme Socrate qui eut tout loisir de méditer sa mort, ou encore Caton d’Utique qui renouvela son geste après une première tentative infructueuse, ces personnages de moindre notoriété ont cela en commun qu’ils s’approchèrent assez près de la mort pour, au lieu de la craindre, « la vouloir tâter et savourer » (ibid., 609). Montaigne évoque ici ceux qui, tel en particulier Marcellinus dont parle Sénèque[21], ont eu l’occasion « non d’échapper à la mort, mais de l’essayer » (ibid., 610). Comme il en fit lui-même l’expérience, tous ceux-là affirment n’avoir senti dans son approche « aucune douleur, voire plutôt quelque plaisir, comme d’un passage au sommeil et au repos » (ibid.). Quant à Caton, parangon de l’excellence humaine[22], Montaigne ne pense pas qu’il se soit contenté de l’impassibilité prescrite par « la secte stoïque » et préfère croire qu’« il sentit du plaisir et de la volupté en une si noble action, et qu’il s’y agréa plus qu’en autre de celles de sa vie » (II, 11, 424).
Si Montaigne considère encore que la manière de se comporter devant la mort constitue « la plus remarquable action de la vie humaine » (II, 13, 605), il met cependant en garde contre ce que donne à voir les agonisants au prétexte que ceux-ci n’ont que très rarement conscience de leur état. Il « n’est endroit », note malicieusement notre essayiste, « où la piperie de l’espérance nous amuse plus » (ibid.). Les témoignages livresques, pour ne pas dire romanesques, de ceux qui ont approché la mort au plus près ne sont donc guère fiables du fait que, n’estimant pas être arrivés à leur dernière heure, leurs auteurs comptent sur ces écrits pour s’assurer une excellente réputation lorsque la mort se sera éloignée. Quant au suicide, Montaigne écarte ceux qui, « tout sain[s] et tout rassis » (ibid., 607), l’envisagent de façon toute théorique dans un avenir indéterminé et il s’intéresse surtout à ceux qui y ont eu véritablement recours. Chez ces derniers, il distingue ceux qui sont morts subitement, sans avoir eu l’occasion « d’en sentir l’effet », c’est-à-dire sans avoir conscience de leur entrée dans le néant, et ceux qui ont eu le temps de « voir écouler la vie peu à peu » (ibid.). Dans cette seconde catégorie, il y a ceux qui ont finalement renoncé à l’exécution de leur projet ; ceux qui, tels Lucius Domitius ou Albucilla, se sont avérés incapables de le mener à terme ; et, enfin, seuls dignes d’intérêt, les rares individus qui, tels le philosophe Cléanthe, le lettré Pomponius Atticus et Tullius Marcellinus, un ami de Lucilius et de Sénèque, sont allés jusqu’au bout de leur dessein alors que plus rien ne les y obligeait. Comme Socrate qui eut tout loisir de méditer sa mort, ou encore Caton d’Utique qui renouvela son geste après une première tentative infructueuse, ces personnages de moindre notoriété ont cela en commun qu’ils s’approchèrent assez près de la mort pour, au lieu de la craindre, « la vouloir tâter et savourer » (ibid., 609). Montaigne évoque ici ceux qui, tel en particulier Marcellinus dont parle Sénèque[21], ont eu l’occasion « non d’échapper à la mort, mais de l’essayer » (ibid., 610). Comme il en fit lui-même l’expérience, tous ceux-là affirment n’avoir senti dans son approche « aucune douleur, voire plutôt quelque plaisir, comme d’un passage au sommeil et au repos » (ibid.). Quant à Caton, parangon de l’excellence humaine[22], Montaigne ne pense pas qu’il se soit contenté de l’impassibilité prescrite par « la secte stoïque » et préfère croire qu’« il sentit du plaisir et de la volupté en une si noble action, et qu’il s’y agréa plus qu’en autre de celles de sa vie » (II, 11, 424).
Quoi qu’il en soit, afin de posséder une connaissance idoine d’une mort autant inévitable qu’imprévisible[23] il faudrait pouvoir directement l’expérimenter. Mais n’est pas Hercule, Orphée, Ulysse, Énée, ou Lazare qui veut. Toutefois, si nous ne possédons aucun témoignage fiable de l’au-delà, il est peut-être possible d’en avoir un avant-goût par le truchement de son image et de sa préfiguration : le sommeil. On se souvient que dans la mythologie grecque Hypnos, le Sommeil, père de Morphée, et Thanatos, la Mort, étaient frères jumeaux[24]. Le premier était par conséquent susceptible de donner soit une idée apaisante de la seconde[25], soit au contraire de la faire craindre : « À mon âge », remarque à cet égard Louis, le narrateur du Nœud de vipères de François Mauriac, « le sommeil attire l’attention de la mort, il ne faut pas faire semblant d’être mort » (75). C’est aussi la raison pour laquelle, avance-t-on parfois, nos ancêtres du Moyen-Âge et de la première modernité auraient pour dormir privilégié une position assise plutôt qu’allongée rappelant trop celle des gisants. D’où peut-être les dimensions relativement petites des lits de l’époque.
Montaigne fait état de cette parenté convenue entre la mort et le sommeil (II, 6, 372) mais considère que celui-ci, au lieu de tisser des liens avec le non-être et d’amputer l’existence d’une partie d’elle-même, lui procure au contraire un surcroît de félicité. Afin de pouvoir jouir le plus possible du sommeil, dont à plusieurs reprises il souligne les vertus[26], et pour que ce plaisir du « dormir » ne lui échappe pas, on sait qu’il avait « autrefois trouvé bon qu’on [le lui] troublât pour qu’[il] l’entrevisse » (III, 13, 1112). Ainsi, en se faisant réveiller à plusieurs reprises pendant la nuit, ce gros dormeur que fut Montaigne pouvait répéter les douceurs de l’endormissement et multiplier les délices du « bégaiement du sommeil » (II, 6, 375). Un sommeil qui, par l’intermédiaire du rêve, conserve malgré tout une affinité indiscutable avec la vie. Pourquoi, se demande d’ailleurs Montaigne, qui dit « songe[r] peu souvent » mais bizarrement (III, 13, 1098), « ne mettons-nous en doute si notre penser, notre agir, n’est pas un autre songer, et notre veiller quelque espèce de dormir ? » (II, 12, 596). Une possibilité que ne manquera pas d’exploiter la thématique baroque pour laquelle « [n]otre veillée est plus endormie que le dormir » (ibid., 568).
De plus, rêver de personnes disparues, ainsi que leur présence dans nos propos ou dans nos souvenirs involontaires ou provoqués, est une sorte de revanche sur la mort ; un piètre palliatif auquel peuvent recourir les malheureux mortels contre l’implacable Camarde. Montaigne préserve de la sorte la mémoire de La Boétie et permet au natif de Sarlat de continuer d’exister longtemps après sa précoce disparition. Outre ces ersatz pour tâcher de tuer la mort, la survivance en surplomb des disparus peut se perpétuer non seulement dans cette « idolâtrie » vouée, comme dit Proust, « à ce qu’ils ont aimé »[27], mais aussi dans le désir manifesté par les vivants de parachever leurs œuvres interrompues. Ainsi, bien que Montaigne ne prise guère la gestion du domaine familial, « occupation » qu’il juge « plus empêchante que difficile » (III, 9, 949), il s’évertue néanmoins de restaurer « quelque vieux pan de mur et de ranger quelque pièce de bâtiment mal dolé » (ibid., 951). Il précise que ces travaux ont été entrepris plus en hommage à son père « qu’à [s]on contentement » (ibid.). C’est peut-être aussi dans ce même ordre d’idées que Montaigne poursuit dans son Beuther, mais avec désinvolture et sans grande assiduité, la tâche initiée par son père de noter dans un registre « jour par jour les mémoires de l’histoire de sa maison » (I, 35, 224). Louant l’œuvre paternelle, il s’estime « sot d’y avoir failli » (ibid.). Enfin, c’est par une “gravelle” présumée héréditaire que la présence de Pierre Eyquem se perpétue dans l’existence même de Michel, affligé lui aussi de « cette qualité pierreuse » (II, 37, 763). Absents dans leur présence, les défunts peuvent de la sorte défier la mort, la tenir en mépris en s’avérant éminemment présents dans leur éternelle absence.
À la différence d’Alexandre le Grand qui tenait le « dormir » et « la besogne », autrement dit l’amour physique, comme deux phénomènes renvoyant à notre mortalité[28], Montaigne considère la seconde comme « la plus noble, utile et plaisante » de toutes les opérations naturelles (III, 5, 878) et voit dans le sommeil non une image de la mort, imago mortis, mais une occasion supplémentaire de satisfaction. Est-ce parce que dans sa jeunesse son père le réveillait au son de la musique ? Ou parce que l’essayiste devenu vieux continue à jouir de « huit ou neuf heures d’une haleine » d’un sommeil ayant « occupé une grande partie de [s]a vie » (III, 13, 1096) ? En tous cas, plutôt qu’au « dormir » ou de s’adresser à des auteurs trépassés ayant traité le sujet capital de la mort, mais « qui ne sont pas revenus nous en dire des nouvelles » (II, 6, 371), c’est à son accident de cheval qu’il s’en remet pour rendre compte d’un phénomène par nature inaccessible. S’il ne fait évidemment pas l’expérience effective de la mort, Montaigne se rapproche suffisamment d’elle pour en faire l’exercitation, c’est-à-dire l’exercice ou, pour mieux dire, l’essai.
Cet accident confirme que ce n’est pas le dormir que l’on doit assimiler à la mort mais bien plutôt celle-ci qui est à rapprocher « d’un puissant sommeil plein d’insipidité [i. e. insensibilité] et d’indolence » (III, 9, 971). Mais, si l’on fait abstraction de l’hypothèse douteuse de la résurrection, il s’agit d’un sommeil dont jamais on ne se réveillera.
La mort que Montaigne a eu l’occasion d’avoisiner lui est apparue comme « bien heureuse » (II, 6, 377) et, le plongeant dans une disposition « très douce et paisible » (ibid., 376), n’a donc pas à être redoutée. Contrairement à ceux ou celles ayant fait une “expérience de mort approchée” et qui rapportent des indices susceptibles de laisser envisager l’existence d’une vie après la vie, Montaigne se contente de relever le caractère paisible et plaisant de la chose. Le passage de vie à trépas, lui causa « une langueur et une extrême faiblesse sans aucune douleur » (ibid.). Fort de l’expérience de cet épisode, lorsqu’il passera en revue quelques modalités de la mort, « celle qui vient d’affaiblissement et appesantissement » lui semblera elle aussi « molle et douce » (III, 9, 983), assimilable à un agréable endormissement. Si mourir c’est s’endormir, pourquoi craindre la mort ? Elle n’a rien d’épouvantable, sauf bien sûr la mort des autres, de ceux ou de celles que l’on aime.
Cette vision d’une mort sereine et somme toute enviable préfigure le diagnostic sensuel qu’en établira La Mettrie vers 1750. Selon ce médecin matérialiste convaincu, « l’opium de la mort » fait que « tout le sang en est enivré, les sens s’émoussent, on se sent mourir comme on se sent dormir, ou tomber en faiblesse, non sans quelque volupté » (Système d’Épicure, lxvii, 180). Le rapport que fait Montaigne de son accident de cheval corrobore ce pronostic.
Connivents « d’une si jointe et fraternelle correspondance » (III, 13, 1114), le corps et l’esprit ne s’étiolent pas toujours au même rythme. « Tantôt c’est le corps qui se rend le premier à la vieillesse ; parfois aussi c’est l’âme » (I, 57, 328). Toutefois, si elles ne périclitent pas à l’unisson, ces deux entités meurent néanmoins en même temps[29]. Montaigne est convaincu, « contre l’opinion de plusieurs, et même d’Étienne de La Boétie » (II, 6, 374) que la mort entraîne l’ensevelissement concomitant de l’âme et du corps. Mourir se résumerait donc à l’abrogation de l’être dans sa totalité. « Dieu seul […], et la foi » (II, 12, 554), estime-t-il prudemment, peuvent nous éclairer sur le « dilemme » (ibid., 551) de l’immortalité de l’âme qui ne saurait être résolu par les diverses doctrines philosophiques contradictoires qu’il passe rapidement en revue dans ce même chapitre. La foi postule, elle ne peut savoir. Et, plus encore que la foi, il n’est pas exclu que ce sont peut-être « les vaines espérance de la gloire » (ibid., 552) ou la croyance en la justice divine qui conduisent à parier sur l’éternité de l’âme.
La mort, ce « sommeil entier et pur » qu’idéalisera René Char (« Rougeurs des Matinaux », VIII, 81), n’est rien d’autre pour Montaigne que le « passage à l’exemption de toute peine » (I, 20, 92). C’est un « saut » moins douloureux dans le néant que celui, redoutable bien qu’insensible, de la jeunesse à « ce misérable état » (I, 20, 91) qu’est la vieillesse :
Nous ne sentons aucune secousse, quand la jeunesse meurt en nous, qui est en essence et en vérité une mort plus dure que n’est la mort entière d’une vie languissante, et que n’est la mort de la vieillesse. (ibid.)
Pourquoi donc craindre la mort si l’on considère que « le saut n’est pas si lourd du mal être au non-être, comme il est d’un être doux et fleurissant à un être pénible et douloureux » (ibid.) ? Cette conception d’une mort bienfaisante, ou du moins que l’on ne devrait pas redouter, est étayée par l’idée qu’elle palliera définitivement les outrages de la vieillesse et qu’elle mettra un terme aux atteintes insupportables de la maladie. Grâce aux maux qui sont le lot de la condition humaine et plus encore de la vieillesse, on devrait pouvoir envisager le non-être avec sérénité. C’est en tout cas ce que donnent à penser à Montaigne ses fréquentes crises de colique néphrétique qui, tout en le faisant souffrir, lui offrent aussi la possibilité de considérer la mort qu’elles préfigurent « non sans quelque naturelle douceur » (III, 13, 1095) et de s’habituer à elle : « Si tu n’accoles la mort, au moins tu lui touches en paume une fois le mois » (ibid., 1092). Voués à une mort moins douloureuse en définitive que peuvent l’être certaines vies, l’âme et le corps s’éteindront de conserve, à tout jamais, dans le néant de la nuit éternelle.
V. Moribonds et agonisants : une distinction précaire
Ratifiant une conviction préalable, l’épreuve d’une mort paisible peut s’expliquer du fait que, selon Montaigne, la sensibilité de l’esprit est vraisemblablement corrélative à l’état du corps. Lorsque celui-ci entre en déliquescence, il se pourrait que l’esprit ne soit plus à même de s’en rendre compte. Grâce à l’exercitation de sa quasi-mort, Montaigne estime que l’âme, confrontée « à un si grand étonnement de membres et si grande défaillance des sens » ne saurait « maintenir aucune force au-dedans pour se reconnaître » (II, 6, 375). C’est, à plusieurs siècles de distance, ce que paraît confirmer l’expérience que fit le journaliste Philippe Lançon à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à la suite de l’attentat terroriste contre Charlie Hebdo du 7 janvier 2015. Après l’une de ses multiples anesthésies, il dit n’avoir « jamais eu autant de mal à revenir parmi les vivants » – comme Montaigne – et que ses plongées dans le néant artificiel lui firent entrevoir que « [l]e bien-être était de l’autre côté » (Le Lambeau, 440). Bien que l’attentat terroriste dont fut victime Lançon et les nombreuses interventions chirurgicales subséquentes n’aient évidemment rien de comparable avec la syncope de Montaigne, les deux hommes eurent néanmoins la révélation que la mort est empreinte de douceur et que, de ce fait, elle ne doit pas être envisagée avec appréhension.
Affranchi de toute douleur physique, Montaigne – comme Philippe Lançon – n’a pas souffert la moindre angoisse existentielle[30]. Il ne fait nullement état d’éventuelles craintes inhérentes à la perspective d’accéder à un arrière-monde et de se retrouver bientôt devant son présumé Créateur, ni, ce qui peut davantage étonner, de devoir quitter non seulement sa famille et ses amis, mais aussi les plaisirs de la vie. Il n’avait, avoue-t-il, « affliction ni pour autrui ni pour [lui] » (II, 6, 376). Oubliés, semble-t-il, ses « parents ou amis » au bénéfice de qui, du moins si l’on s’en tient au propos de l’adresse liminaire « Au lecteur », il aurait pourtant rédigé ses Essais afin que ses proches puissent conserver « plus entière et plus vive la connaissance qu’ils ont eue de [lui] » (3). Une fois ce désir d’éclaircissement assouvi, le souci d’autrui n’a plus lieu d’être. Quant au souci de soi, il est en partie comblé par cette entreprise mémorielle déjà entamée et par le fait que la mort, loin d’être une épreuve épouvantable à traverser, s’apparente au contraire à un glissement voluptueux vers une absolue félicité. Cela corrobore son opinion selon laquelle « ceux que nous voyons […] renversés et assoupis aux approches de leur fin » ne sont pas « fort à plaindre » (II, 6, 374 et 375). En effet, sa chute de cheval lui permet de penser que le passage de la vie à trépas n’a rien à voir avec ce que le moribond peut laisser croire à ceux et à celles qui assistent à son agonie.
À cet égard, il peut être intéressant de reprendre la distinction opérée par Paul Ricœur entre le moribond, qui « n’est tel que pour celui qui assiste à l’agonie », et l’agonisant qui, jouissant de sa conscience, fait l’expérience de son propre trépas (« Jusqu’à la mort », 41 sqq.). Alors que Montaigne-moribond s’acharne sur son « pourpoint à belles ongles » (II, 6, 375), en proie à un réflexe indépendant de sa volonté et occasionné par un « estomac pressé [de] sang caillé », Montaigne-agonisant prend « plaisir à [s]’alanguir et à [s]e laisser aller » (ibid., 376 et 374). Contrairement à ce que perçoivent les témoins de l’accident, Montaigne éprouve une mort « non seulement exempte de déplaisir, ains mêlée à cette douceur que sentent ceux qui se laissent glisser au sommeil » (ibid.). À la suite d’un accident ou d’une longue maladie, les mourants auraient « l’âme et le corps ensevelis et endormis » et, par conséquent, conclut Montaigne, « [n]ous les plaignons sans cause » (ibid., 374). Celui ou celle qui assiste à une agonie investirait le moribond d’une sensibilité qui n’est plus celle du mourant, mais la sienne propre.
Cependant, cette dichotomie entre un agonisant faisant la douce expérience de la mort et un moribond donnant éventuellement l’impression d’une intense douleur est loin d’être toujours pertinente. Moribonds et agonisants partagent souvent les mêmes souffrances et en dévoilent les signes patents.
Estimant peut-être que l’expérience consécutive à son accident de 1568 relevait de l’exception, Montaigne ne fera plus état de la discrimination qu’il avait alors établie en 1574 entre ce que ressent le mourant et ce que perçoit son entourage. Dans son chapitre « De la cruauté », écrit vers 1580, le clivage chez un même individu entre son état de moribond, manifestant des signes de souffrance, et celui d’agonisant, présumé insensible à la douleur, cède maintenant la place à la distinction banale entre le mort et le mourant. À la condition somme toute enviable du premier, il oppose celle que connaît le second confronté à ses afflictions. « Les morts je ne les plains guère, et les envierai plutôt », remarque-t-il, « mais je plains bien fort les mourants » (II, 11, 430). Comme l’atteste cette sentence sur une solive de sa librairie, reprise dans II, 13, 608 : Emori nolo, sed me esse mortuum, nihili æstimo[31], ce n’est pas la mort qui est à redouter, mais bien plutôt le mourir. Celle-là, avait-il déjà affirmé, « touche bien plus rudement le mourant que le mort, et plus vivement et essentiellement » (I, 20, 93). Même pour un essayiste déterminé à peindre non l’être mais le flux irrépressible du temps auquel celui-ci est soumis, le passage drastique de l’être au non-être est impossible à saisir. Laissant de côté sa propre expérience, Montaigne se place maintenant sur un plan plus général où ledit passage s’avère souvent plus douloureux que ne le laissait croire son accident de cheval. Il se remémore vraisemblablement l’agonie de son ami La Boétie, mort en 1563, mais dont il a retracé les péripéties dans une lettre adressée à son père et publiée à Paris chez l’imprimeur-libraire réputé Fédéric Morel le 24 novembre 1570[32].
VI. L’agonie de La Boétie : un acte conforme aux discours
Dans cette Lettre à son père sur la mort d’Étienne de La Boétie, Montaigne enregistre soigneusement l’agonie de son irremplaçable ami, à Germignan, dans la maison sise au nord-est de Bordeaux appartenant à Richard de Lestonnac, beau-frère de l’épistolier et son collègue au Parlement de Bordeaux. Alors que La Boétie est malade depuis le lundi 9 août 1563, la narration proprement dite ne commence que le samedi 14, lorsque la gravité du mal ne fait plus aucun doute, pour aller jusqu’à l’aube du mercredi 18, quand s’éteint celui qui avait vécu « trente-deux ans, neuf mois, et dix-sept jours » (Lettre à son père, 89).
Dans ce compte rendu digne des meilleurs Artes bene moriendi[33], Montaigne dresse le tableau d’un mourant lucide jusqu’à sa dernière heure, en proie aux affres de la maladie – probablement la peste – et soucieux de son comportement dans une chambre « pleine de gens » et remplie de « cris et de larmes » (Lettre à son père, 59 et 67). Fidèle à la tradition, le mourant tient parfaitement son rôle devant les diverses personnes qui se succèdent à son chevet : d’abord sa femme – sa « semblance », comme il appelle Marguerite de Carle, veuve du chevalier Jean d’Arsac épousé en 1554 – ; son oncle et tuteur, Monsieur de Bouilhonnac ; puis sa nièce Mademoiselle de Saint-Quentin ; sa belle-fille Jacquette d’Arsac et le futur époux de celle-ci, Thomas de Beauregard, le frère cadet de Montaigne ; Jean de Belot, un ami poète et confrère au Parlement de Bordeaux. Outre les familiers du mourant qui recueillent ses ultimes recommandations, assistent aussi à l’agonie un notaire, un médecin, un apothicaire, un prêtre, un valet, et sa « garnison » ainsi que La Boétie nommait « les filles qui le servaient » (Lettre à son père, 67). Grâce à cette Lettre, nous assistons à notre tour à la “bonne mort” d’un individu entouré des siens et pourvus des sacrements idoines de l’Église.
Ce qui impressionne Montaigne, et ce qu’il met parfaitement en évidence dans sa Lettre, c’est, d’une part, de voir à quel point La Boétie parvient à dominer sa douleur afin de mettre ses affaires en ordre et à ne pas affliger ses proches et, d’autre part, de constater que les derniers moments d’un ami rencontré quelques années auparavant sont en parfaite conformité avec les discours que celui-ci tenait de son vivant. Même si Montaigne juge son écriture incapable de rendre parfaitement compte de la « brave démarche » et du « courage invincible » de La Boétie dont le corps est maintenant « atterré et assommé par les furieux efforts de la mort et de la douleur » (Lettre à son père, 21), il dépeint un mourant dont les effets de l’agonie « surpassent les préceptes mêmes de la philosophie » (I, 28, 192). À l’instar de Pyrrhon[34] et de « tous les autres vraiment philosophes », La Boétie est capable « de faire répondre sa vie à sa doctrine » (II, 29, 705), de faire correspondre ses actes à ses discours, son ergon à son logos. Comme Denys, Montaigne réprouve ces « musiciens qui accordent leurs flûtes et n’accordent pas leurs mœurs » ou ces « orateurs qui étudient à dire justice, non à la faire » (I, 25, 138). Et Montaigne conclut le chapitre « De l’institution des enfants » en ces termes : « Voici mes leçons. Celui-là y a mieux profité, qui les fait, que qui les sait » (I, 26, 167). Comme le précisaient les éditions antérieures, à quoi peut-il servir en effet « qu’on prêche l’esprit, si les effets n’en vont quant et quant ? ». Notre essayiste ne pouvait par conséquent que souscrire à la caractérisation toujours d’actualité d’Épictète : « La première et la plus importante partie de la philosophie est de mettre les maximes en pratique » (Manuel, 208). En dernier recours, ce sont nos actes (erga) qui nous définissent, pas nos paroles (logos). Sans les actes, la philosophie n’est que jeu avec les mots ; ou, pour le dire autrement, un simple caquetage.
Alors qu’en ces temps guerriers la vaillance militaire est chose passablement commune et parfois redevable au hasard[35], ce dont fait preuve La Boétie au cours de sa longue et pénible agonie est un courage beaucoup plus rare qui confirme ce que fut sa vie : « vraie, parfaite et philosophique » (II, 7, 382).
Conforté dans la très haute estime qu’il nourrit à l’égard de La Boétie par la manière dont se comporte celui-ci au cours de ses dernières heures, Montaigne l’informe « que cela [lui] servirait d’exemple pour jouer ce même rôle à [son] tour » (Lettre à son père, 53). En dépit de son calvaire, c’est aussi ce que son ami trouve encore la force de lui recommander :
Il m’interrompit pour me prier d’en user ainsi, et de montrer par effet que les discours que nous avions tenus ensemble pendant notre santé, nous ne les portions pas seulement en la bouche, mais engravés bien avant au cœur et en l’âme, pour les mettre en exécution aux premières occasions qui s’offriraient. (ibid.)
La Boétie ajoute, et Montaigne retiendra la leçon, que cette incarnation en actes des discours est « la vraie pratique de nos études et de la philosophie » (ibid.)[36]. Agir est autre chose que parler ou écrire, même avec les armes de l’éloquence ou les ressources de la perspicacité.
En plus d’appliquer ce précepte parrèsiastique[37] à une existence où les vérités professées devraient se refléter dans un mode de vie congruent, Montaigne en fera le sujet d’un chapitre des Essais intitulé « Qu’il ne faut juger de notre heur qu’après la mort » (I, 19). Dans ce bref chapitre écrit peu de temps après la publication de la Lettre à son père, Montaigne se souvient à l’évidence des propos de son ami et, empruntant à l’adage attribué à Solon[38], décrète que le « dernier acte de [la] comédie, et sans doute le plus difficile » (I, 19, 79), doit se montrer à la hauteur des leçons méditées de la philosophie. « En tout le reste », prévient-il, « il y peut avoir du masque » (ibid.).
En ce sens, philosopher c’est bien apprendre à mourir. Non pas vivre en ayant sans cesse la pensée de la mort à l’esprit, mais mourir en parfaite conformité avec les discours préalables tenus à ce sujet. Dans cet « acte à un seul personnage » (III, 9, 879) – mais auquel assistent encore à l’époque de nombreux témoins –, l’attitude du mourant servirait ainsi de critère auquel s’évaluerait l’ensemble de sa vie passée : « C’est le maître jour », estime pour l’instant Montaigne, « c’est le jour juge de tous les autres » (I, 19, 80). La fin de la vie colorerait et validerait ainsi la totalité de l’existence. Au cours de « ce dernier rôle de la mort et de nous, il n’y a plus que feindre », poursuit Montaigne, « il faut parler Français, il faut montrer ce qu’il y a de bon et de net dans le fond du pot » (ibid.).
Du fait de l’importance accordée à ce moment très particulier de l’agonie qui, comme celle de La Boétie, se déroulait généralement en présence d’un certain public[39] et servait de cadre à l’ultime communion et à l’administration de l’extrême-onction, on risquait fort de ne pas se montrer à la hauteur de la prestation attendue. De la même façon qu’un excès de souffrances risquerait d’empêcher le mourant de se comporter de manière correcte, un courage excessif pourrait être perçu comme une manifestation d’orgueil seyant mal à tout bon chrétien et une trop grande peur comme le signe rédhibitoire d’un manque de foi et d’espérance. Afin de jouer correctement son rôle, il fallait s’y entraîner et, pour ceux ou celles qui n’avaient pas eu l’occasion d’assister à l’exemplaire agonie de l’ami de Montaigne, il convenait non seulement d’étudier mais aussi de pratiquer les leçons de ces Artes bene moriendi qui, à l’instar de la Lettre de Montaigne, enseignaient l’art de bien mourir. L’on ne pouvait qu’espérer que le personnage que l’on s’entraînait à interpréter serait celui que l’on représentera en public le jour fatidique[40]. Mais, ainsi qu’on l’a précédemment vu, la mort est une pièce qui n’admet aucune répétition. Tout comme la vie, elle ne peut se jouer qu’une seule fois.
Ironie du sort confirmant l’imprévisibilité de la mort, Montaigne ne pourra émuler La Boétie. Lui qui n’imaginait « aucun état […] si insupportable et horrible, que d’avoir l’âme vive et affligée, sans moyen de se déclarer » (II, 6, 375) et avait émis le souhait que dans l’éventualité où il perdrait un sens il préfèrerait « perdre la vue que l’ouïe ou le parler » (III, 3, 824), au cours de sa propre agonie, un phlegmon aux amygdales le priva malencontreusement de l’usage de la parole.
VII. De l’art de bien mourir ?
S’il estimait alors devoir juger la vie en regardant « toujours comment s’en est porté le bout » (I, 19, 80), l’essayiste sera bientôt d’avis que nous avons tort d’accorder une telle importance à la mort. « À mon avis », sera-t-il amené à déclarer, « c’est le vivre heureusement, non […] le mourir heureusement qui fait l’humaine félicité » (III, 2, 816). Montaigne reflète en cela la sensibilité générale des élites humanistes de son siècle qui, du moins selon les dires de Michel Vovelle, offrirait « une nouvelle lecture de la mort et de l’au-delà en revalorisant la valeur de la vie, dont la brièveté même fait le prix »[41].
Précurseur d’un temps ou la mort solitaire se substituera à la mort solidaire, Montaigne aimerait trépasser « hors de [s]a maison et éloigné des [s]iens » car, explique-t-il, « Il y a plus de crève-cœur que de consolation à prendre congé de ses amis » (III, 9, 978). Afin de ne pas accroître sa douleur en se voyant mourir dans le regard des assistants lorsque le jour sera venu, il se détache le plus possible d’autrui : « Je me dénoue partout », confesse-t-il dans un ajout postérieur à 1588, « mes adieux sont à demi pris de chacun, sauf de moi » (I, 20, 88). Il se dit prêt à mourir seul, « sans regret de chose quelconque, si ce n’est de la vie » (ibid.). Préférant mourir loin des siens, à Paris ou à Venise (III, 9, 973 et 982), il se satisferait « d’une mort recueillie en soi, quiète et solitaire, toute [s]ienne » (ibid., 979). Mais, pour l’instant du moins, Montaigne trouve dans l’expérience qu’il a faite du décès de La Boétie la parfaite illustration de ce que devrait être une mort réussie. Cela pourrait expliquer que, lors de la longue agonie de son ami – on sait qu’une mort subite était alors la marque d’une malédiction[42] –, il ait fait passer l’admiration pour l’attitude du mourant, déclarant par trois fois attendre la mort « gaillard et de pied coi » (Lettre à son père, 79), avant la compassion à son égard.
Après l’énumération de quelques exemples de personnages antiques dont la mort a, soit démenti l’éclat de leur vie, soit l’a au contraire rachetée, Montaigne complète le bref chapitre « Qu’il ne faut juger de notre heur qu’après la mort » par un allongeail rédigé en 1588, mais paru seulement en 1595, et dans lequel il évoque le cas de « morts braves et fortunées [i. e. heureuses] » (I, 19, 80) et qu’il illustre par l’exemple de « quelqu’un » dont il tait le nom. Montaigne se souvient vraisemblablement ici de l’agonie courageuse de La Boétie mort quelque vingt-cinq ans auparavant mais il ne nomme pas explicitement son “frère d’alliance”. Cela est d’autant plus curieux que ce chapitre contient la réminiscence d’un passage de la Lettre à son père inspiré de Sénèque exigeant que la mort fasse « l’essai du fruit de [nos] études » (ibid.)[43].
Outre le mal qu’il endure courageusement au cours d’une agonie exemplaire digne des plus belles morts de l’Antiquité, La Boétie souffre tout autant de la tristesse que sa femme et ses proches éprouvent à son endroit que de ses propres douleurs. Il s’efforce de dissimuler « l’opinion certaine qu’il avait de sa mort » et « [q]uand il les voyait auprès de lui, il contrefaisait la chère [i. e. la figure] plus gaie et les paissait de belles espérances » (Lettre à son père, 39). Ce chagrin, qu’il souhaite leur éviter en cachant autant que faire se peut la gravité de son mal, serait même plus difficile à supporter que les souffrances occasionnées par la maladie : « Les maux que nous sentons en nous », remarque-t-il,
ce n’est pas nous proprement qui les sentons, mais certains sens que Dieu a mis en nous : mais ce que nous sentons pour les autres, c’est par certain jugement et par discours de raison que nous le sentons. (ibid., 85)
Selon La Boétie, il y aurait donc une affliction que l’individu ressentirait à l’égard de lui-même mais qui serait tempérée par « certains sens » d’origine divine permettant d’envisager la transition vers l’au-delà avec sérénité, et une souffrance beaucoup plus rationnelle résultant du malheur dont on voit ses proches s’affliger.
Non seulement les affres de l’agonie souffertes par La Boétie diffèrent de celles ressenties par Montaigne lors son accident de cheval, mais les sentiments respectifs des deux amis vis-à-vis de la mort sont également discordants. Recouvrant ses esprits après « une grande faiblesse », La Boétie rapporte que son état lui avait « semblé être en une confusion de toutes choses » et qu’il n’avait « rien vu qu’une épaisse nuée et brouillard obscur » (Lettre à son père, 31). Il ajoute qu’« il n’avait eu nul déplaisir à tout cet accident », mais refuse toutefois de valider l’encourageante prophétie de Montaigne : « “La mort n’a rien de pire que cela, lui dis-je lors, mon frère. – Mais n’a rien de si mauvais”, me répondit-il » (ibid.). Et ce ne sont pas ses mystérieuses visions « admirables, infinies, et indicibles » (ibid., 83) qui le feront changer d’avis.
Un élément toutefois sur lequel les deux amis s’accordent c’est la souffrance de ceux ou de celles qui restent. Alors qu’il ne se préoccupera nullement de la perte de ceux ou celles qu’il est sur le point d’abandonner après sa chute de cheval, et s’il augure que la mort n’est pas un mal pour celui qui part, Montaigne admet que le « dommage » demeure à la charge des survivants : « À vous ne serait-ce que heur », pronostique-t-il en considérant la disparition de son « frère », « mais le dommage serait à moi qui perdrais la compagnie d’un si grand, si sage et si certain ami, et tel que je serais assuré de n’en trouver jamais de semblable » (Lettre à son père, 35). Curieusement, La Boétie ne minimise pas l’impact délétère de son décès. Il ne se contente pas d’acquiescer, il amplifie le préjudice à venir. Il « assure » que s’il souhaite guérir, ce n’est pas pour surseoir au seuil vers la mort qu’il a « déjà franchi à demi » (ibid.), mais pour éviter que « beaucoup de gens » (ibid., 37), au nombre desquels figure bien évidemment Montaigne, ne se désespèrent d’une « bien grande » perte [sic] que va causer son trépas. « Mais quoi qu’il en soit », ajoute-t-il en s’en remettant maintenant au présage favorable de son ami, « je suis prêt à partir quand il plaira à Dieu » (ibid.)[44]. S’il est vrai qu’à l’heure de disparaître nous mourons pour les autres, il est tout aussi vrai que ceux-ci meurent pour nous. La Boétie, comme Montaigne, ne semble guère sensible à ce fait.
VIII. Conclusion : vivre à propos
En ce qui concerne Montaigne, il « plaira à Dieu » de le rappeler à Lui le 13 septembre 1592, vingt-neuf ans après la disparition de son ami. De l’être-pour-la mort que préconisait le chapitre « Que philosopher c’est apprendre à mourir » Montaigne a glissé à l’être-pour-la-vie que corroborera l’ensemble du troisième livre des Essais et qu’entérinera le chapitre de 1580 « De la physionomie ».
Qu’il s’agisse de ses crises de “gravelle”, de la perte d’une dent[45] ou, tout simplement, des maux et autres inconvénients dus à l’âge, il est passé d’une mort spéculative et impersonnelle, à une mort concrète, subjective, s’attaquant directement à son être ou à l’être de ses proches. La mort cesse d’être ce maître jour arbitre de tous les autres et se trouve maintenant reléguée à n’être plus que le bout de la vie. Elle devient « le mouvement d’un instant » (I, 14, 56) coupé de ce qui précède comme de ce qui suit. La façon de mourir est désormais beaucoup moins importante que tout ce qui l’a précédée : la façon de vivre. Le but c’est bien le voyage de la vie, non son inéluctable bout.
Depuis déjà pas mal de temps « engagé dans les avenues de la vieillesse » (II, 17, 641), Montaigne enregistre les atteintes personnelles de l’ultime effondrement. À la suite de signes prémonitoires qui ne sauraient tromper quant à l’issue funeste qu’ils anticipent, le “vieux” Montaigne au « poil gris » (III, 2, 817), refusant de se borner à n’être que ce qu’il a été, imperméable au ressentiment et à l’amertume, opte pour l’alacrité consécutive à la résolution la plus judicieuse qui soit :
Principalement à cette heure que j’aperçois [ma vie] si brève en temps, je la veux étendre en poids ; je veux arrêter la promptitude de sa fuite par la promptitude de ma saisie, et par la vigueur de l’usage compenser la hâtiveté de son écoulement : à mesure que la possession du vivre est plus courte, il me la faut rendre plus profonde et plus pleine. (III, 13, 1111-1112)
Détermination ô combien pertinente pour quiconque affectionne la vie jusque dans la désertion progressive de celle-ci et qui, aimant « mieux être moins longtemps vieil que d’être vieil avant que de l’être » (III, 5, 842), ne s’est jamais contenté d’exister mais voulait vivre le plus intensément possible. Ne pas mourir avant d’être réellement mort.
Longtemps avant Victor Hugo pour qui « le plus lourd fardeau, c’est d’exister sans vivre » (Les Châtiments, IV, 9), Montaigne savait pertinemment que vivre ne saurait se résumer à seulement être. « C’est être, mais ce n’est pas vivre », déclare-t-il, « que se tenir attaché et obligé par nécessité à un seul train » (III, 3, 818). Au lieu d’une existence longue, mais désespérément vide, il serait vraisemblablement partisan du choix supposé d’Achille optant pour une vie brève mais riche[46].
Confronté à sa propre mortalité, le châtelain de Montaigne ne souhaitait rien de moins que vivre à propos. C’est-à-dire ne pas faire de sa vie une œuvre d’art, comme nous y invitera à le faire Michel Foucault[47], mais s’efforcer de porter l’existence à son plus haut degré d’épanouissement. Réussir sa vie est indiscutablement plus important que réussir sa mort. Tel devrait être notre grand et glorieux chef-d’œuvre : « faire bien l’homme et dûment » (III, 13, 1110). Davantage que l’ars bene moriendi que Montaigne semble présenter dans son fameux chapitre « Que philosopher c’est apprendre à mourir » ainsi que dans la lettre à son père sur la mort de La Boétie, l’ensemble des Essais est un fervent plaidoyer pour un ars bene vivendi[48]. Plus qu’une méditation sur la mort, les Essais sont une célébration de la vie.
Bibliographie
Philippe Ariès, L’Homme devant la mort, 2 vol., Paris, Seuil, 1985.
Aristote, Éthique à Nicomaque, éd. R.-A. Gauthier et J.-Y. Jolif., 4 vol., Louvain, Publications universitaires et Paris, Béatrice-Nauwelaerts, 1970.
Antoine Arnauld et Pierre Nicole, La Logique ou l’Art de penser, éd. Ch. Jourdain, Paris, Gallimard, 1992.
Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, dans Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même, suivies du Manuel d’Épictète, éd. M. Meunier, Paris, Flammarion, 1992, p. 31-176.
Frédéric Brahami, Le scepticisme de Montaigne, Paris, PUF, 1997.
Frédéric Brahami, « Scepticisme », dans Ph. Desan (dir.), Dictionnaire de Michel de Montaigne, Paris, Classiques Garnier, 2016, p. 1042-1044.
Vincent Carraud et Jean-Luc Marion (dir.), Montaigne : Scepticisme, Métaphysique, Théologie, Paris, PUF, 2004.
René Char, « Rougeurs des Matinaux », dans Les Matinaux, Paris, Gallimard, 1950, p. 77-86.
Cicéron, Tusculanes, éd. G. Fohlen, trad. J. Humbert, 2 vol., Paris, Les Belles Lettres, 1960.
Antoine Compagnon, « Le but et le bout », dans Un été avec Montaigne, Paris, Éditions des Équateurs/France Inter, 2013, p. 125-128.
Jean-Michel Delacomptée, Et qu’un seul soit l’ami. La Boetie, Paris, Gallimard, 1995.
Philippe Desan, Montaigne. Les formes du monde et de l’esprit, Paris, PUPS, 2008.
Denis Diderot, Essai sur les règnes de Claude et de Néron et sur les mœurs et les écrits de Sénèque, pour servir d’introduction à la lecture de ce philosophe, 2 vol., Londres, [Bouillon], 1782.
Épictète, Manuel, dans Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même, suivies du Manuel d’Épictète, éd. M. Meunier, Paris, Flammarion, 1992, p. 177-209.
Épicure, Lettres, Maximes, Sentences, éd. J.-Fr. Balaudé, Paris, Livre de Poche, 2020.
Véronique Ferrer, « La gaieté de Montaigne », dans J. Balsamo et A. Graves (dir.), Global Montaigne. Mélanges en l’honneur de Philippe Desan, Paris, Classiques Garnier, 2021, p. 233-242.
Gustave Flaubert, Correspondance, sélection B. Masson, éd. J. Bruneau, Paris, Gallimard, 1998.
Michel Foucault, « À propos de la généalogie de l’éthique : un aperçu du travail en cours », dans Dits et Écrits, 1954-1988, 4 vol., éd. D. Defert et F. Ewald, Paris, Gallimard, 1994, vol. IV, p. 609-631.
Olivier Guerrier, « Le Socrate de Foucault et le “socratisme” de Montaigne », dans T. Gontier et S. Mayer (dir.), Le Socratisme de Montaigne, Paris, Classiques Garnier, 2010, p. 57-69.
Homère, L’Iliade, trad. E. Lasserre, Paris, Flammarion, 1965.
Homère, L’Odyssée, trad. M. Dufour et J. Raison, Paris, Flammarion, 1965.
Victor Hugo, Les Châtiments, éd. R. Journet, avec un dossier pédagogique de F. Naugrette, Paris, Gallimard, 1998.
Jean Lacouture, Montaigne à cheval, Paris, Seuil, 1996.
Laurent Jenny, « “Il ne faut point d’art à la chute” », dans L’expérience de la chute. De Montaigne à Michaux, Paris, PUF, 1997, p. 17-51.
Julien Offray de La Mettrie, Système d’Épicure, dans De la volupté. Anti-Sénèque ou Le souverain bien, L’École de la volupté, Système d’Épicure, éd A. Thomson, Paris, Desjonquières, 1993, p. 155-191.
Philippe Lançon, Le Lambeau, Paris, Gallimard, 2018.
Ullrich Langer, « Mourir et agir dans “De l’exercitation” », Bulletin de la Société internationale des Amis de Montaigne, vol. 8, n° 17-18, 2000, p. 79-87.
Alain Legros, « Éphéméride du Seigneur de Montaigne », dans Montaigne manuscrit, Paris, Classiques Garnier, 2010, p. 67-102.
Alain Legros, « Sentences peintes et autres inscriptions de la bibliothèque de Montaigne », dans Montaigne, Les Essais, éd. J. Balsamo et al., Paris, Gallimard, 2007, p. 1892-1903.
Lucrèce, De la nature, éd. A. Ernout, introduction et notes É. de Fontenay, Paris, Les Belles Lettres, 2009.
François Mauriac, Le nœud de vipères, Paris, Grasset, 1964.
Michel de Montaigne, Les Essais, éd. P. Villey revue par V.-L. Saulnier, Paris, PUF, 2004.
Michel de Montaigne, Lettre à son père sur la mort d’Étienne de La Boétie, éd. J.-M. Delacomptée, Paris, Gallimard, 2012.
Michel de Montaigne, À Mademoiselle de Montaigne, dans Œuvres complètes, éd. A. Thibaudet et M. Rat, Paris, Gallimard, 1962, p. 1371.
Carlo Montaleone, « “… entrer en une longue et paisible nuit …” La mort au miroir de Montaigne », Bulletin de la Société internationale des Amis de Montaigne, vol. 2, n° 75, 2022, p. 15-35.
Géralde Nakam, Montaigne et son temps. Les événements et les Essais, Paris, Gallimard, 1993.
Géralde Nakam, Les Essais de Montaigne. Miroir et procès de leur temps. Témoignage historique et création littéraire, Paris, Nizet, 1984.
Géralde Nakam, « Parcours et visages de la mort de Montaigne dans les Essais », Bulletin de la Société des Amis de Montaigne, n° 43-44, 2006, p. 17-30.
Géralde Nakam, « Montaigne, la mélancolie et la folie », dans C. Blum et F. Moureau (dir.), Études montaignistes en hommage à Pierre Michel, Paris, Champion, 1984, p. 195-213.
Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir. « La gaya scienza », trad. P. Wotling, dans Œuvres, éd. P. Wotling, Paris, Flammarion, 2017, p. 31-321.
Friedrich Nietzsche, Ecce homo. Comment on devient ce qu’on est, trad. É. Blondel, dans Œuvres, éd. P. Wotling, Paris, Flammarion, 2017, p. 1201-1287.
Gianni Paganini, « Pyrrhonism vs Internalism. Montaigne and Sanches », dans J. Balsamo et A. Graves (dir.), Global Montaigne. Mélanges en l’honneur de Philippe Desan, Paris, Classiques Garnier, 2021, p. 293-301.
Blaise Pascal, Pensées, dans Les Provinciales, Pensées et opuscules divers, éd. G. Ferreyrolles et Ph. Sellier, Paris, Librairie Générale Française, 2004, p. 755-1383.
Gabriel Pérouse, « La Lettre sur la mort de La Boétie et la première conception des Essais », Folia Litteraria, n° 8, 1982, p. 101-123.
Platon, Phédon, trad. P. Vicaire, dans Œuvres complètes, éd. M. Croiset et al., Paris, Les Belles Lettres, 2005, tome IV, 1repartie.
Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, éd. A. Compagnon, Paris, Gallimard, 2021.
Marcel Proust, Le Temps retrouvé, éd. P.-E. Robert et al., préface de P.-L. Rey et B. G. Rogers, Paris, Gallimard, 1990.
Pascal Quignard, Les désarçonnés. Dernier royaume VII, Paris, Grasset, 2012.
Paul Ricœur, « Jusqu’à la mort : du deuil et de la gaieté », dans Vivant jusqu’à la mort. Suivi de Fragments, préface O. Abel, postface C. Goldenstein, Paris, Seuil, 2007, p. 29-91.
M.A. Screech, Montaigne & Melancholy. The Wisdom of the Essays, préface Marc Fumaroli, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 2000.
Sénèque, Lettres à Lucilius, dans Entretiens. Lettres à Lucilius, éd P. Veyne, Paris, Robert Laffont, 1993, p. 585-1094.
Baruch Spinoza, L’Éthique, éd. R. Caillois, Paris, Gallimard, 1993.
Fortunat Strowski, Montaigne. Paris, Félix Alcan, 1906.
Roger Trinquet, « La Boétie ou le duc de Guise ? Une identification controversée », Bulletin de la Société des Amis de Montaigne, n° 18-19, 1976, p. 7-12.
Jean Vignes, « La lettre de consolation de Plutarque à sa femme traduite par La Boétie et ses prolongements chez Montaigne, Céline et Michaël Fœssel », Exercices de rhétorique, n° 9, 2017, doi : 10.4000/rhetorique.545.
Pierre Villey, Les sources et l’évolution des Essais de Montaigne, 2 vol., Paris, Hachette, 1933.
Michel Vovelle, La mort et l’Occident. De 1300 à nos jours, Paris, Gallimard, 1983.
Jean-Claude Vuillemin, « Montaigne, à corps et âme », Europe, 2024, p. 248-270.
Jean-Claude Vuillemin, Foucault l’intempestif, Paris, Hermann, 2019.
[1] Les références aux Essais renvoient à l’édition de P. Villey revue par V.-L. Saulnier citée dans la bibliographie et dont je modernise l’orthographe. Afin d’éviter un nombre excessif de notes, l’indication du livre accompagnée du numéro du chapitre et celui de la page est directement donnée dans le corps de l’article.
[2] Aujourd’hui contestée, l’idée d’un Montaigne passant du stoïcisme au scepticisme et à l’épicurisme est largement redevable à l’analyse génétique de Fortunat Strowski de 1906, Montaigne et, surtout, à la thèse du doctorat d’État de Pierre Villey de 1908, Les sources et l’évolution des Essais de Montaigne. L’on préfère maintenant faire de Montaigne un partisan de la docte ignorance s’abreuvant à maintes sources du scepticisme qu’il accommode à son gré pour en faire « less a body of doctrines than a practice of thinking » (Gianni Paganini, « Pyrrhonism vsInternalism », 293). Outre ce texte, voir plusieurs autres articles sur le sujet contenus dans J. Balsamo et A. Graves, dir., Global Montaigne.
[3] Je partage l’impression d’Antoine Compagnon selon laquelle il semblerait que dans ce chapitre l’esprit de Montaigne « raisonnait son imagination, mais sans parvenir à y croire, comme s’il répétait une leçon » (Un été avec Montaigne, 127). Cet essai s’apparente en effet davantage à une anthologie des meilleurs apophtegmes stoïciens qu’à une démonstration débouchant sur une thèse.
[4] « Toutes les fois qu’on s’adonne à la philosophie […] on s’applique uniquement à mourir, à être mort » (Phédon, 64a, 12). Si le vulgum pecus ne comprend pas cela, Cicéron, entre autres, agrée avec Platon et fera référence à ce passage du Phédon : « Tota enim philosophorum vita, ut ait idem, commentatio mortis est » (Tusculanes, I, 30, 74). Dubitatif peut-être quant à l’efficacité de la sentence, Montaigne préfère en attribuer la paternité à Cicéron, qu’il ne prise guère, plutôt qu’à « ce bon et grand Socrate » (I, 23, 118) qu’il tient pour « [l]e plus sage homme qui fut onques » (II, 12, 501).
[5] « Resserre-toi sur toi-même », intime Marc Aurèle (Pensées, VII, § 28, 104) avant de déclarer : « N’aimer uniquement que ce qui t’arrive et ce qui constitue la trame de ta vie » (ibid., VII, § 57, 109).
[6] « Cela n’est pas trop religieux », remarquera Diderot à propos de ce constat, « mais cela est beau » (Essai sur les règnes de Claude et de Néron, II, 46). Antoine Arnauld et Pierre Nicole rapprocheront ces propos du refus de Montaigne de se repentir et les taxeront de « [p]aroles horribles, et qui marquent une extinction entière de tout sentiment de religion » (La logique, III, 252).
[7] Ces doctes sentences sont proches des « ergotismes » que critique Montaigne dans « De l’institution des enfants » (I, 26, 160). Carlo Montaleone parle à ce propos d’« un centon de citations » (« La mort au miroir de Montaigne », 18).
[8] Ainsi que l’atteste une éphéméride de son Beuther, il s’agit bien de deux mois et non de deux ans, comme l’écrit par inadvertance Montaigne dans la brève missive accompagnant la traduction et dans laquelle il « laisse à Plutarque la charge […] de consoler » sa femme et de l’« avertir de [son] devoir » (À Mademoiselle de Montaigne, 1371). Pour une transcription de l’Ephemeris historica de Beuther, voir Alain Legros, « Éphéméride du Seigneur de Montaigne », notamment p. 85. L’erreur tient vraisemblablement au fait que la fille disparue de Plutarque était, elle, âgée de deux ans.
[9] Pour une analyse de la lettre de Plutarque, voir Jean Vignes, « La lettre de consolation de Plutarque à sa femme traduite par La Boétie et ses prolongements chez Montaigne, Céline et Michaël Fœssel ».
[10] Selon Schopenhauer, « tous les systèmes religieux et philosophiques » sont « comme le contrepoison que la raison, par la force de ses seules méditations, fournit contre la certitude de la mort » (Le Monde comme volonté et comme représentation, « Suppléments au livre quatrième », XLI, 1203).
[11] Tels sont en particulier les bienfaits à attendre du tetrapharmakos, ce quadruple remède qui, notamment dans la Lettre à Ménécée et dans les quatre premières Maximes capitales d’Épicure, promet la guérison de la crainte des dieux et de la mort, l’éradication du mal de l’âme et l’accès facile au plaisir.
[12] Pour les libertés que prend Montaigne vis-à-vis du scepticisme antique voir notamment V. Carraud et J.-L. Marion, dir., Montaigne : Scepticisme, Métaphysique, Théologie, ainsi que Frédéric Brahami, Le scepticisme de Montaigne et son entrée « Scepticisme » dans Ph. Desan, dir., Dictionnaire de Michel de Montaigne.
[13] « J’ai mis tous mes efforts à former ma vie », nous dit Montaigne, « Voilà mon métier et mon ouvrage. Je suis moins faiseur de livres que de nulle autre besogne » (II, 37, 784) ; profession de foi réitérée dans un allongeail en II, 6, 379. Vivre s’apprend davantage en vivant qu’en lisant ou en écrivant.
[14] Après Géralde Nakam qui dresse l’inventaire des tares du « Quatrième état de la justice » (Les Essais de Montaigne, 131-149), Philippe Desan se demande si ce n’est pas une déception due aux dérives de la justice qui aurait poussé Montaigne à démissionner, à moins qu’il ne décidât d’abandonner une profession frisant la dérogeance afin de s’adonner à un mode d’existence plus en conformité avec son désir de noblesse (Formes du monde, 147 et 179).
[15] Exempt de tristesse (I, 2, 11), Montaigne sait qu’il peut facilement succomber à la mélancolie déclenchée par « le chagrin de la solitude » (II, 8, 385). Après M. A. Screech (Montaigne & Melancholy), Véronique Ferrer note que Montaigne ne partageait pas l’opinion de son temps qui, selon la théorie des humeurs de la médecine galénique, conférait encore à la mélancolie suscitée par la bile noire – l’atrabile – des qualités positives pour le poète, l’artiste et le philosophe. Montaigne en « voit surtout le caractère pathologique et dangereux, préférant les vertus vivifiantes et créatrices de la gaieté » (« La gaieté de Montaigne », 235).
[16] G. Nakam, Montaigne et son temps, 206. « “[C]onstitutive”, pour toutes les leçons qu’elle apporte à Montaigne », cette chute, estime Nakam, fut « créatrice de l’œuvre » (« Parcours et visages de la mort », 20). Nakam émet aussi l’hypothèse que cet accident, ayant « précédé de peu sa démission » du Parlement de Bordeaux aurait pu la déterminer (Montaigne et son temps, 206).
[17] Selon G. Nakam, qui date l’accident en 1568, cette imprécision tiendrait au fait que ces deux guerres civiles « se sont succédé sans démarcation nette » (Montaigne et son temps, 209).
[18] « nemo expergitus extat / Frigida quem semel est vitai pausa sequuta » (De natura rerum, III, v. 929-930) : « personne ne se réveille et ne se relève, une fois que le froid du trépas est venu le saisir » (Traduction d’A. Ernout, Lucrèce, De la nature, 245).
[19] « Ce sont nos passions qui esquissent nos livres », écrira Proust, « le repos d’intervalle qui les écrit » (Le Temps retrouvé, 214).
[20] Sceptique quant à toute dissociation de l’âme du corps que favoriserait l’extase mystique, Montaigne, « was not the kind of philosopher », écrit M. A. Screech, « who “practiced dying” in ecstasy » (Montaigne & Melancholy, 99).
[21] Sénèque écrit à Lucilius que l’eau chaude continuellement versée dans une baignoire où leur ami avait décidé de mourir d’inanition « lui causa peu à peu une faiblesse accompagnée, disait-il, de plaisir, de ce plaisir que l’être éprouve dans un paisible anéantissement » (Lettres à Lucilius, IX, 77, 820).
[22] « Ce personnage-là », écrit Montaigne, « fut véritablement un patron que nature choisit pour montrer jusqu’où l’humaine vertu et fermeté pouvait atteindre » (I, 37, 231). L’autre modèle est Socrate qui « a fait grande faveur à l’humaine nature de montrer combien elle peut d’elle-même » (III, 12, 1038).
[23] Même incomplet, l’inventaire des manifestations de la mort (I, 20, 85) atteste que celle-ci se décline sous les formes les plus diverses et que celle consécutive à la vieillesse s’avère la plus « rare, singulière et extraordinaire » (I, 57, 326).
[24] Chez Homère, par exemple, Zeus intime à Apollon de faire emporter le corps de Sarpédon « par des porteurs agiles, le Sommeil et la Mort, les jumeaux » dans « la vaste et grasse Lydie » (L’Iliade, 16, 281). Dans ses Tusculanes, Cicéron écrit que sans être « tout à fait analogue au sommeil […] [l]’image de la mort s’offre à vous tous les jours dans le sommeil » (I, 38, 92).
[25] Lorsque nous dormons, écrit Lucrèce, nul « ne se prend à regretter sa personne et sa vie […]. Or, il ne tient qu’à nous qu’il en soit de même du sommeil éternel » (De la nature, III, 245).
[26] Voir notamment le bref chapitre « Du dormir » (I, 44) inspiré des Vies des hommes illustres de Plutarque où Montaigne relate l’impérieux sommeil dont auraient fait preuve Alexandre, Othon, Caton et Auguste, aux moments les plus cruciaux de leur existence.
[27] M. Proust, Sodome et Gomorrhe, II, 166. Outre dans la ressemblance physique que le narrateur de la Recherche note entre sa mère et sa grand-mère disparue, le souvenir de celle-ci se perpétue dans l’attachement de la première pour le sac et les manchons de la défunte qu’elle porte, ainsi que pour l’exemplaire conservé des Lettres de Mme de Sévigné qu’elle lit, relit et cite.
[28] Montaigne rapporte qu’Alexandre « se connaissait principalement mortel » par l’orgasme « et par le dormir : le sommeil suffoque et supprime les facultés de notre âme ; la besogne les absorbe et dissipe de même » (III, 5, 878).
[29] Voir sur ce point Jean-Claude Vuillemin, « Montaigne, à corps et âme », 264-265.
[30] « C’est sans doute la première fois », note L. Jenny, « qu’on raconte une extase sur un mode aussi purement phénoménologique, hors de tout cadre interprétatif, qu’il soit médical, mythologique ou religieux » (« “Il ne faut point d’art à la chute” », 33).
[31] Traduction latine que Cicéron (Tusculanes, I, VIII, 15) donne d’une maxime d’Épicharme de Cos : Je ne souhaite pas mourir, mais peu m’importe d’être mort ; voir Alain Legros, Sentences peintes, 1901.
[32] Publiée sept ans après l’événement, mais vraisemblablement rédigée peu après celui-ci, cette lettre-récit fait office d’épilogue à la publication des œuvres de La Boétie que Montaigne vient d’éditer et dont la remarquable agonie n’est pas la moindre d’entre elles.
[33] « Le récit des dix jours de souffrance est d’une abstraction si élaborée », estime Jean-Michel Delacomptée, « qu’elle peint moins une réalité qu’une morale. C’est une leçon » (Et qu’un seul soit l’ami, 115). Plutôt qu’un compte rendu fidèle, ce texte serait pour Delacomptée une sorte d’ars moriendi empreint de sobriété : « pas plus de pathos dans la description des tourments que de fioritures dans le style » (Montaigne, Lettre à son père, 64). Pour Gabriel Pérouse également, cette lettre est un « monument construit pour faire de l’homme un personnage » (« La lettre sur la mort de La Boétie », 102).
[34] Pyrrhon aurait toutefois enfreint sa doctrine d’indifférence lors de ses disputes avec sa sœur, « femmelette » qu’il jugeait indigne de servir « de témoignage à [s]es règles » (II, 29, 706), et lors d’une attaque d’un chien où il aurait reconnu qu’il est « très difficile de dépouiller entièrement l’homme ; et [il] se faut mettre en devoir et efforcer de combattre les choses, premièrement par les effets [i. e. actions], mais, au pis-aller, par la raison et par les discours » (ibid.).
[35] « […] il n’est aucune des vertus qui s’espende [i. e. se répande] si aisément que la vaillance militaire » (II, 7, 382).
[36] Toutefois, selon Gérard Defaux, La Boétie aurait au contraire démenti au moment de mourir son existence philosophique par un souci de vaine gloire. Cela expliquerait que Montaigne ait différé de sept années la publication des écrits de l’ami, voir Montaigne et le travail de l’amitié, 165-195.
[37] Sur le concept de parrêsia (i. e. le dire-vrai éruptif), voir Jean-Claude Vuillemin, « La parrêsia ou le courage de la vérité », in Foucault l’intempestif, 302-309. Le parrèsiaste ne dit pas ce qui est, mais ce qu’il est. Selon Olivier Guerrier, « l’écriture des Essais elle-même a à voir avec la parrhêsia » (« Le Socrate de Foucault et le “socratisme” de Montaigne », 66).
[38] Ce topos avait été déjà évoqué dans un chapitre précédent où Montaigne écrivait : « Aristote, qui remue toutes choses, s’enquiert sur le mot de Solon que nul avant sa mort ne peut être dit heureux, si celui-là même qui a vécu et qui est mort selon ordre, peut être dit heureux, si sa renommée va mal, si sa postérité est misérable. […] Et serait meilleur de dire à Solon, que jamais homme n’est donc heureux, puisqu’il ne l’est qu’après qu’il n’est plus » (I, 3, 17). Devenue lieu commun, la sentence est en effet longuement discutée par Aristote dans l’Éthique à Nicomaque (I, chap. 11, 76-86).
[39] « Le mourant doit être au centre d’une assemblée », écrit Philippe Ariès. « On mourait toujours en public. D’où le sens fort du mot de Pascal, qu’on meurt seul, car on n’était jamais physiquement seul au moment de la mort » (L’Homme devant la mort, I, 26). Cette habitude cultu(r)elle se perpétuera au moins jusqu’à la fin du XIXe siècle.
[40] Bien au-delà de la Renaissance, dans l’ensemble des classes sociales et jusque dans la lointaine Amérique, « la mort restait un spectacle dont le mourant était le metteur en scène, et le spectacle pouvait être plus ou moins réussi » (Ph. Ariès, L’Homme devant la mort, II, 157).
[41] M. Vovelle, La mort et l’Occident, 201. Si l’intérêt pour cette « porte du salut » qu’est le moment de la mort perpétue l’héritage médiéval des artes moriendi, Vovelle note que la vie deviendra bientôt « la vraie mesure de l’éternité » et, comme l’écrit le cardinal Bellarmin dans son Arte di ben morire : « une bonne mort ne saurait réparer une mauvaise vie » (cité dans La mort et l’Occident, 210).
[42] Pascal sera encore persuadé qu’une « Mort soudaine [est] seule à craindre, et c’est pourquoi », ajoute-t-il, « les confesseurs demeurent chez les Grands » (Pensées, fr. 781, 1335). Cela dit, et même si tel ne fut pas le cas, Montaigne aurait souhaité se « plonge[r] la tête baissée stupidement dans la mort, sans la considérer et reconnaître » (III, 9, 971). Comme « la vie n’est pas la meilleure pour être longue », il sait que « la mort est la meilleure pour n’être pas longue » (ibid.).
[43] Roger Trinquet est convaincu « que c’est […] au duc Henri de Guise que Montaigne a voulu faire allusion » (« La Boétie ou le duc de Guise ? », 9).
[44] Dans son commentaire de la Lettre à son père qu’il a éditée, J.-M. Delacomptée remarque que La Boétie « meurt en chrétien » plus qu’en philosophe. « Quand le stoïcien jouit de sa propre mort […] lui la déplore. Docile, il l’accepte : elle ne dépend pas de lui, mais de Dieu » (24).
[45] « Voilà une dent qui me vient de choir, sans douleur, sans effort », rapporte Montaigne, « c’était le terme naturel de sa durée. Et cette partie de mon être et plusieurs autres sont déjà mortes, [ou] demi-mortes […]. C’est ainsi que je fonds et échappe à moi » (III, 13, 1101). De ce fait, lorsque la mort fera son dernier office « elle ne tuera plus qu’un demi ou un quart d’homme » (ibid.).
[46] Ce lieu commun est contredit par l’épisode retracé dans le Chant IX de L’Odyssée au cours duquel, Ulysse, descendu chez « le puissant Hadès et l’effroyable Perséphone », rencontre Achille qui, regrettant le monde des vivants, est convaincu qu’il vaut mieux vivre longtemps, même dans l’ombre et l’ennui, que mourir jeune et auréolé d’une gloire illusoire.
[47] Après avoir déclaré que « la vie, parce qu’elle est mortelle, ait à être une œuvre d’art », Foucault ajoute : « Pourquoi un tableau ou une maison sont-ils des objets d’art, mais non pas notre vie ? » (« À propos de la généalogie de l’éthique », 615 et 617).
[48] « Mais ne lisez pas, comme les enfants lisent, pour vous amuser, ni comme les ambitieux lisent, pour vous instruire », recommandera Flaubert à Marie-Sophie Leroyer de Chantepie le 6 juin 1857. « Non. Lisez pour vivre. […] Mais je vous recommande d’abord Montaigne. Lisez-le d’un bout à l’autre et quand vous aurez fini, recommencez » (Correspondance, 343 et 344).