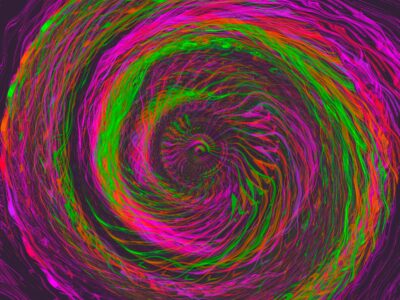Compte-rendu critique – L’Accélération de l’histoire. Des Lumières à l’Anthropocène
Marie Goupy est Maîtresse de conférences à l’Institut Catholique de Paris. Ses recherches portent sur l’état d’exception et les enjeux politiques et temporels liés aux situations de crises. Elle a publié L’état d’exception ou l’impuissance autoritaire de l’État à l’époque du libéralisme, Éditions du CNRS, 2016, et, récemment, en co-direction avec Yann Rivière, l’ouvrage collectif De la dictature à l’état d’exception. Approches historique et philosophique, Rome, Éditions de l’École Française de Rome, 2023.
Christophe Bouton, L’accélération de l’histoire. Des Lumières à l’Anthropocène, Paris, Seuil, 2022.
Le livre est disponible ici.
Résumé :
Cet article propose un compte-rendu critique de l’ouvrage de Christophe Bouton, L’accélération de l’histoire. Des Lumières à l’Anthropocène. L’ouvrage a pour intérêt d’interroger la conception de l’histoire pessimiste et homogénéisante qui tend à se dissimuler derrière le topos largement diffusé de l’accélération de l’histoire depuis les Lumières jusqu’à aujourd’hui. Il expose surtout le pluralisme des expériences du temps, qui n’a cessé d’exister sous la modernité. Une réflexion vivifiante et passionnante, mais qui prend le risque de relativiser la pesanteur des formes objectivées de l’accélération, ou plus largement, du temps social.
Mots-clefs : Christophe Bouton, accélération, conception de l’histoire, présentisme, dictature du présent
Abstract :
This article is a critical review of Christophe Bouton’s L’accélération de l’histoire. Des Lumières à l’Anthropocène. The book’s main interest is to question the pessimistic, homogenizing conception of history that tends to hide behind the widely disseminated topos of the acceleration of history from the Enlightenment to our present day. Above all, he exposes the pluralism of experiences of time that has never ceased to exist under modernity. An invigorating and fascinating reflection, that nevertheless risk to over-relativize the weight of objectified forms of acceleration, or more broadly, of social time.
Key Words: Christophe Bouton, acceleration, conception of history, presentism, dictatorship of the present
« Accélération de l’histoire ». En 1984, la formule ouvrait les Lieux de Mémoires de Pierre Nora. Depuis, elle s’est très largement diffusée, et en l’inscrivant au commencement de son ouvrage, L’accélération de l’histoire, des Lumières à l’Anthropocène, Christophe Bouton fait écho à ce qui résonne presqu’autant comme un lieu commun dans la société, que comme un véritable topos dans le champ des sciences sociales (p. 7).
Probablement forgée par Daniel Halévy en 1948[1] (p. 10), popularisée sous l’impulsion de Pierre Nora[2], le succès de l’idée d’accélération de l’histoire traduit sans doute d’abord un sentiment aussi diffus dans les sociétés contemporaines, que difficile à cerner : l’expérience d’une forme d’accélération permanente du temps, qui semble affecter autant les événements, la technique et la science, que la vie sociale. Au-delà de cette expérience partagée néanmoins, l’expression trouve place au sein d’une histoire intellectuelle plus longue, que Christophe Bouton fait remonter aux premières réflexions sur la temporalité moderne sous les Lumières, et qui a conduit à faire de l’accélération le support de réflexions critiques sur la modernité.
C’est peut-être d’abord cette situation que l’ouvrage choisit d’assumer pour point de départ d’un examen prudent du topos de l’accélération de l’histoire : l’accélération semble à la fois une sorte d’évidence, fondée sur une expérience sociale partagée ; mais en creusant à peine l’étude des discours, le topos de l’accélération de l’histoire révèle presque immédiatement les liens qu’il entretient avec une longue tradition d’analyse critique de la modernité. Cette situation pèse lourdement sur l’interprétation du sens de l’accélération de l’histoire, dont l’évidence apparente dissimule en réalité un pluralisme sémantique, sinon une réelle confusion. Mais surtout, l’articulation qui s’est nouée après les Lumières entre le thème de l’accélération et la critique de la modernité a contribué à imposer une lecture moins descriptive qu’un jugement moral et politique sur l’accélération de l’histoire, que Christophe Bouton résume sous la forme d’un « théorème de l’accélération » qui en fixe a priori le sens :
-La modernité se caractérise par l’accélération de l’histoire.
-L’accélération de l’histoire implique une rupture avec le passé et une dissolution de l’avenir.
-La modernité débouche sur la dictature du présent. (p. 27)
En d’autres termes, la notion même d’accélération de l’histoire apparait dans la littérature comme bien moins descriptive que normative, en particulier parce qu’elle véhicule une longue histoire critique de la modernité qui s’est constituée dans le sillage des Lumières en perdurant jusqu’à aujourd’hui – ou jusqu’à l’époque de l’Anthropocène, pour reprendre le titre de l’ouvrage.
Partant de là, l’ouvrage ne se propose pas d’ajouter une nouvelle pierre à l’édifice déjà volumineux des analyses de l’accélération en tant que supports plus ou moins explicites d’une critique de la modernité. Il se présente plutôt comme une théorie critique de l’histoire, c’est-à-dire « une démarche visant à analyser, à déconstruire les catégories de l’expérience historique…. » (p. 23). En d’autres termes, Christophe Bouton entreprend de secouer le topos : l’accélération de l’histoire est-elle bien la catégorie de l’expérience historique qui permet de saisir le rapport à l’histoire et au temps proprement moderne ? Et si tel est bien le cas, permet-elle bien encore d’appréhender l’expérience historique aujourd’hui ? (p. 19)
Pour tenter d’aborder ces questions, l’auteur entreprend de restituer les liens historiques qui ont été noués entre l’accélération et la modernité depuis le tournant des Lumières. Mais en prenant appui sur une littérature diversifiée (des romans, des essais connus ou plus marginaux, des traités scientifiques), adossées à des champs disciplinaires très différents (la philosophie, les sciences sociales mais aussi les sciences dures) (p. 23), il refuse d’emblée de faire de l’accélération le « signe distinctif » (p. 27) ou le socle d’un discours homogène sur la modernité – laquelle n’est pas seulement saisie comme une période, qui va de 1750 à nos jours, mais bien comme l’expression d’un nouveau rapport au temps et à l’histoire dont le sens n’a guère cessé d’être discuté.
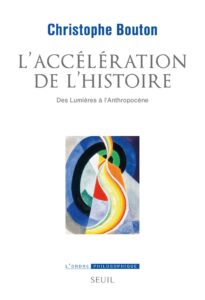 Cette démarche permet à Christophe Bouton de formuler deux thèses centrales, à la fois claires et extrêmement stimulantes : en premier lieu, à bien observer la littérature dans sa diversité, il apparait qu’il n’existe pas de perception homogène de l’accélération de l’histoire, qui permettrait de définir en quelque sorte l’expérience de la temporalité moderne, mais celle-ci s’est au contraire toujours caractérisée par une forme de polychronie (p. 111). Une polychronie, on va le voir, largement masquée par le « théorème de l’accélération », véhiculé par des auteurs et une tradition de pensée critiques à l’égard de la modernité. En second lieu, et c’est peut-être la thèse et la partie les plus captivantes de l’ouvrage, la restitution de cette polychronie permet à l’auteur d’aborder le sens polymorphe de l’expérience de l’accélération aujourd’hui, en particulier, après l’annonce de l’Anthropocène.
Cette démarche permet à Christophe Bouton de formuler deux thèses centrales, à la fois claires et extrêmement stimulantes : en premier lieu, à bien observer la littérature dans sa diversité, il apparait qu’il n’existe pas de perception homogène de l’accélération de l’histoire, qui permettrait de définir en quelque sorte l’expérience de la temporalité moderne, mais celle-ci s’est au contraire toujours caractérisée par une forme de polychronie (p. 111). Une polychronie, on va le voir, largement masquée par le « théorème de l’accélération », véhiculé par des auteurs et une tradition de pensée critiques à l’égard de la modernité. En second lieu, et c’est peut-être la thèse et la partie les plus captivantes de l’ouvrage, la restitution de cette polychronie permet à l’auteur d’aborder le sens polymorphe de l’expérience de l’accélération aujourd’hui, en particulier, après l’annonce de l’Anthropocène.
L’ouvrage se développe en trois moments principaux. Dans un premier moment (chap. I et II), l’auteur restitue le lien historique et théorique entre les pensées de l’accélération et celles de la modernité, tel qu’il s’est construit depuis les Lumières en se maintenant jusqu’à aujourd’hui. Il établit surtout comment « la thèse de l’accélération de l’histoire sert parfois [à la lecture de l’ouvrage, souvent] d’axiome à ce que l’on peut appeler le théorème de l’accélération, qui semble être dans l’air du temps » (p. 27). Dans un second moment (chap. III-chap. V), l’ouvrage entreprend de montrer comment ce « théorème de l’accélération » masque une réelle polychronie. Loin d’une simple « dictature du présent », signifiant aussi la fin de l’historia magistra vitae ou d’un rapport authentique à la tradition, ainsi qu’un rapport appauvri à l’avenir sous la forme d’un « épuisement des énergies utopiques » (p. 205), la littérature témoigne au contraire, pour l’auteur, d’une pluralité de rapports à l’histoire, et des formes de résistance à l’égard du discours dominant de la modernité. Dans un dernier moment (chap. VI et VII), Christophe Bouton se penche sur la forme d’expérience de l’histoire qui se donne à lire dans l’annonce très récente de l’ère de l’Anthropocène, dont la nature est, là encore, polychronique. Elle témoigne bien néanmoins, pour l’auteur, de l’émergence d’un nouveau rapport au temps bien plus riche et positif que le « théorème de l’accélération » ne laisse le saisir.
L’accélération de l’histoire, des Lumières à l’Anthropocène est un livre érudit, complexe, foisonnant – à tel point qu’il est parfois un peu difficile d’en restituer le fil conducteur. La structure de l’ouvrage, ainsi que la thèse centrale, permettent néanmoins de dégager une stratégie argumentative consistante et très cohérente.
Les deux premiers chapitres sont consacrés à la clarification sémantique du concept d’accélération de l’histoire, mais surtout à celle du lien que la catégorie entretient, dans un large pan de la littérature, avec les critiques de la modernité. Christophe Bouton propose pour ce faire une « Courte histoire de l’accélération de l’histoire » d’abord (chap. 1), puis une restitution des « Critiques de la modernité au prisme de l’accélération » (chap. 2). Ces chapitres sont précieux pour se situer dans une littérature touffue, qui prend elle-même rarement le temps de revenir sur sa généalogie. Ils permettent surtout de montrer que s’il existe une pensée de l’accélération bien avant la modernité, en particulier dans toute une tradition eschatologique cherchant à penser le « “raccourcissement des temps” par Dieu pour faire advenir plus rapidement le Jugement dernier » (p. 47), il existe néanmoins un sens proprement moderne de l’accélération (p. 50), que Koselleck a été l’un des premiers à théoriser[3]. Depuis la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, le thème de l’accélération de l’histoire est effectivement convoqué et traité avec des significations un peu différentes – en particulier, comme accélération politique des événements (par exemple chez Hegel, Marx ou Burkhardt) (chap. I, 1), et comme accélération technologique liée au développement du capitalisme (chez Marx encore, ou Blanqui) (chap. I, 2). Néanmoins, en dépit de cette différence de domaines dans laquelle l’accélération se voit saisie à partir des Lumières, elle traduit assez largement une nouvelle expérience du temps, qui s’exprime d’abord dans les termes désormais fixés par les travaux de Koselleck comme expérience de la nouveauté ou des « temps nouveaux » (p. 51), en lien avec un processus matériel, qui contribue à affranchir la notion de l’idéologie (p. 54). Ce qui permet de comprendre aussi pourquoi la notion d’accélération, pourtant souvent floue, est devenue le support de critiques assez vives de la modernité (Chap. II).
Critique du progrès ou de la suractivité stérile des modernes pris par l’accélération de la vie (en particulier chez Nietzsche[4]), réflexions sur un processus objectivé qui finit par s’imposer aux hommes à la manière d’une loi scientifique (particulièrement développée par l’inventeur de la « loi de l’accélération », Henry Adams[5]), ou encore analyses de la déstabilisation de l’histoire (chez Daniel Halévy[6]), le thème de l’accélération est effectivement au cœur d’un longue tradition critique de la modernité, qui semble d’abord plutôt exposer des arguments assez différents. L’érudite exposition des critiques restituées par Christophe Bouton s’achève néanmoins sur deux réflexions centrales, qui ont contribué, pour l’auteur, à articuler la critique de l’accélération moderne autour de trois axes temporels – passé, présent, futur –, en fournissant une nouvelle cohérence à un ensemble d’analyse disparates, et en fixant les grands traits de ce que l’auteur qualifie donc de « théorème de l’accélération ». Un théorème relativement tacite, sinon jamais formulé, mais qui s’est désormais imposé dès qu’on aborde la question.
Dans la présentation du célèbre ouvrage sur les Lieux de mémoire[7], Pierre Nora fait de l’expérience de l’accélération de l’histoire, dans la modernité, un « arrachement au passé » (p. 81), qui conduit à la destruction de la mémoire traditionnelle, et qui se traduit dans un paradoxe, et en réalité un rapport « dialectique : l’excès de mémoire (“fausse”) signifie son exact contraire, il est précisément l’expression d’un manque de mémoire (“vraie”) » (p. 86). L’approche sociologique de Hartmut Rosa[8] décrit quant à elle l’accélération de la société et non de l’histoire, en distinguant « trois formes d’accélération : l’accélération technique, l’accélération du tempo de la vie, et l’accélération du changement social » (p. 88). Mais elle se fait bien l’expression d’une nouvelle expérience du temps et de l’histoire, en particulier en introduisant l’idée que l’hyper accélération sociale conduit paradoxalement à une forme d’« immobilité fulgurante » – ou à un présent accéléré et permanent –, qui confisque l’avenir en échappant à l’emprise du projet politique.
Pour Christophe Bouton, ces réflexions – auxquelles vont s’adjoindre un peu plus loin celle, également centrale, de François Hartog[9] – ont participé à la construction d’une représentation globale de la structure temporelle moderne, en articulant peu à peu expérience du passé, du présent et du futur autour de la catégorie centrale de l’accélération. Sauf qu’en formulant une sorte de discours cohérent autour de la temporalité moderne, instituée en régime d’historicité unique et univoque, ce discours a fini par glisser vers une pensée de l’histoire plus ou moins déterministe, structurée autour d’un enchainement d’arguments central : la modernité se caractérise par l’accélération ; l’accélération a conduit à un présentisme sans futur ni passé ; ce qui a abouti à une forme d’ « immobilité fulgurante », qui présente tous les traits d’une « “fin de l’histoire” : derrière l’hyperaccélération de surface, les structures profondes de la société non seulement ne se modifient pas, mais se renforcent et deviennent encore plus difficile à changer » (p. 93). Autrement dit, la catégorie d’accélération, qui constitue un indéniable outil heuristique pour décrire des changements technologiques, sociologiques, politiques majeures (p. 110) – ce que Christophe Bouton reconnait en particulier aux travaux sociologiques de Rosa lui-même (p. 15) – a fini par se charger d’une puissante dimension normative, qui se décline autour de trois axes critiques : l’accélération mène à une perte de la tradition, à une perte de contrôle et enfin, à une perte de sens, toutes constitutives de la modernité (p. 107). Trois critiques qui mènent invariablement, pour l’auteur, vers un jugement pessimiste sur l’histoire, lequel pèse désormais sur l’interprétation du présent à la manière d’une philosophie de l’histoire.
Dans ce cadre, Christophe Bouton est assez sévère avec la théorie de Rosa, instituée en point de passage « de l’accélération à la fin de l’histoire » (p. 87). L’approche critique de Rosa aurait, en particulier, fait basculer toute une tradition interprétative de la modernité au prisme de l’accélération dans la voie périlleuse d’une « philosophie de l’histoire teintée de pessimisme et de fatalisme : l’Histoire est pensée selon une loi globale, un principe nécessaire, avec un cours unique qui se déroule dans un temps linéaire et homogène » (p. 110). À tel point, selon Christophe Bouton, que l’accélération finit par fonctionner chez Rosa comme « la fin de l’histoire » selon Bourdieu[10] : elle agit tel un « performatif déguisé en constat », lequel « fait d’ailleurs le jeu de l’idéologie néolibérale, qui pense précisément que la politique doit être au service, à la remorque de l’économie » (p. 100).
Les trois chapitres suivants sont alors consacrés à déconstruire patiemment cette conception homogène de l’histoire qui, derrière une approche critique de l’accélération dans ses multiples formes objectivées, a entériné le « désenchantement de la politique » (p. 99). Pour Christophe Bouton, ces réflexions ont négligé systématiquement la capacité de résistance des individus. Et elles ont, ce faisant, recouvert la réalité polychronique des sociétés, c’est-à-dire l’existence d’une « multiplicité hétérogène de temps incommensurables » (le terme est explicitement repris à Bernadette Bensaude-Vincent[11], p. 111). De façon cohérente, l’auteur reprend ainsi une à une chacune des dimensions de cette conception homogène de l’accélération de l’histoire : la dictature du présent, qu’il analyse en particulier à partir des travaux incontournables d’Hartog (chap. III), la perte du passé, qui demeure habitée par la pensée de Koselleck (chap. IV), et la dissolution de l’avenir, abordée à partir de l’idée largement véhiculée (p. 205) qu’il existerait un épuisement des utopies. Dans l’ensemble des chapitres, l’auteur s’efforce de relativiser des topos bien installés : sans doute, les idées de dictature du présent, de perte du passé ou de dissolution de l’avenir ont-elles un intérêt heuristique. Plus spécifiquement, la notion même d’accélération permet de saisir « certaines évolutions technologiques et politiques majeures au sein de la modernité, mais elle est vidée de sens si on l’applique à l’histoire en général » (p. 110). Plus encore, en s’articulant dans une pensée globalisante du temps et de l’histoire moderne, elle finit par assimiler presque par avance toute modalité un peu dissonante de rapport au passé ou à l’avenir.
Ainsi, l’ouvrage examine l’idée de « dictature du présent » (chap. III) en revenant d’abord au « maître ouvrage » d’Hartog, Régimes d’historicité[12]. Le premier apport de l’ouvrage réside dans la proposition même du terme de « régime d’historicité » pour « décrire les différentes relations que les sociétés entretiennent avec leur historicité, leur diverses “expériences du temps” » (p. 115). Mais, dans la restitution de cette longue « histoire de l’accélération », Hartog trouve surtout place avec sa réflexion sur le présentisme comme véritable « diagnostic sur notre époque actuelle » (p. 115), c’est-à-dire précisément comme nouveau régime d’historicité. Le présentisme contribue à fixer, dans la lecture de Christophe Bouton, les principaux traits du rapport que les sociétés contemporaines entretiennent au temps et à l’histoire dans une certaine lecture de la modernité : en tant que présent dévorant et sans avenir (p. 137), dans lequel le rapport au passé est un rapport essentiellement artificiel (p. 144). La lecture d’Hartog est néanmoins, pour l’auteur, totalisante : « tout ce qui semble ne pas entrer dans le schéma du présentisme s’y trouve d’emblée réintégré, comme une faille ou un symptôme ou une récupération » (p. 145). Ainsi, pour Hartog, les analyses de Hans Jonas sur le « principe de responsabilité » sont-elles interprétées comme ne sortant pas du cercle du présentisme, « puisque le souci de l’avenir se présente même comme la raison d’être de ce phénomène »[13]. Pourtant, selon Christophe Bouton, « l’éthique de la responsabilité, qui porte sur un futur lointain déconnecté du présent immédiat, échappe au présentisme » (p. 146). De façon plus précise, et particulièrement intéressante, l’auteur entreprend de discuter notamment la manière dont le rapport « endetté » du présent au passé et à l’avenir dans les sociétés contemporaines, permet à Hartog de confirmer l’idée de présentisme, alors même qu’elle pourrait être lue a contrario comme l’expression d’un « décentrement » du présent (p. 148), en particulier dans des formes d’irruption du passé, qui « revient perturber le présent comme un spectre inquiétant » (p. 149).
De façon similaire, l’ouvrage revient ensuite (chap. IV) sur l’idée, d’abord principalement développée par Koselleck lui-même, que le processus d’accélération historique entraine la fin d’un rapport authentique à la tradition, ou, dans des termes moins normatifs, la fin de la « fonction traditionnelle de l’histoire, qui fait d’elle, depuis l’Antiquité, une source d’enseignement et de leçons » (p. 155). Le thème se développe d’abord dans l’article séminal de Koselleck, « “Historia magistra vitae”. De la dissolution du “topos” dans l’histoire moderne en mouvement », paru en 1967[14]. Là encore, Christophe Bouton relativise l’idée de dissolution de l’histoire comme « école de la vie » non seulement au XIXe, mais tout au long du XXe et jusqu’à aujourd’hui. Pour ce faire, il prend en particulier appui sur trois auteurs centraux, qui développent chacun une réflexion complexe sur le rapport à l’histoire : Marx, qui dans Le 18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte introduit l’idée célèbre que la répétition hante les révolutions du XIXe siècle, en réveillant les spectres du passé[15] (p. 170). Nietzsche, qui, dans la « Seconde considération inactuelle » pèse « l’utilité » et les « inconvénients » de l’histoire pour la vie, en accordant une utilité possible à l’historia magistra vitae dans la modernité (p. 177-178)[16]. Benjamin enfin, qui, dans « Sur le concept d’histoire »[17], « reprend l’idée de ce dernier [Nietzsche] d’une histoire utile pour la vie, mais (…) en un sens résolument non « monumental » (p. 187), c’est-à-dire où ce sont les vaincus, les sans-noms qui doivent être convoqués, pour affronter les luttes du présent. En somme, on trouve dès le XIXe, pour Christophe Bouton, des stratégies de « résistance » à l’égard d’une conception de l’histoire et du temps qui traduit déjà un certain discours univoque sur le sens de l’histoire et la forme – vide et homogène – du temps.
Enfin, dans un geste analogue, l’auteur déconstruit l’idée que la temporalité moderne accélérée ait conduit à une pure et simple « dissolution de l’avenir », engendrant « l’épuisement des énergies utopiques » (p. 205). La question est essentielle, car l’utopie a été centrale dans la construction de la modernité, en devenant dès le dernier tiers du XVIIIe un « concept directeur » ou « concept de combat » (p. 207). Or, là encore pour Christophe Bouton, les formes persistantes d’utopies tout au long du XXe siècle, jusqu’à l’irruption de la notion d’éthique de la responsabilité ou aux formes discrètes d’utopies réalistes[18] qui ont émergées ces dernières décennies, sont presque systématiquement réduites au seul statut de symptôme d’une expérience du temps déchue dans la modernité (p. 138). Mais a contrario, pour Christophe Bouton, l’utopie du temps libre, que l’on trouve dans une certaine mesure déjà chez Marx, a traversé tout le XXe siècle (en particulier via Ernst Bloch[19], Paul Lafargue[20], ou Bertrand Russell[21]), et on la retrouve encore dans l’utopie réaliste de Rutger Bregman[22] ou dans le programme politique de Benoît Hamont. En d’autres termes, à l’instar du rapport au passé, comme au présent, Christophe Bouton veut là encore « brosser le tableau d’une modernité plurielle, qui abrite différentes tendances de pensée, en harmonie ou en conflit les unes avec les autres, dans laquelle les utopies disparaissent tandis que d’autres apparaissent » (p. 241).
Dans le cadre fixé par ce tableau à la fois historique et surtout très théorique du rapport entre accélération et modernité, les deux derniers chapitres (chap. VI et VII) abordent frontalement le problème qui constitue en quelque sorte le point focal de l’ensemble de l’ouvrage : l’expérience du temps aujourd’hui, en particulier après la proclamation de l’Anthropocène, peut-elle être lue à partir de l’idée d’accélération ? et si oui, l’accélération assigne-t-elle le sens de l’histoire qui s’annonce ?
En effet, la catégorie d’anthropocène, qui s’est imposée très récemment dans les débats publics (p. 238) pour viser l’avènement d’une nouvelle ère géologique/historique provoquée par l’activité humaine sur terre, s’est vue largement saisie par la catégorie d’accélération. En premier lieu, parce qu’au « sein de la nouvelle ère géologique, la notion de « Grande accélération » a été introduite pour la période allant de 1945 à nos jours, afin de souligner la croissance exponentielle des nombreuses variables qui mesurent l’influence néfaste de l’homme sur la nature, comme la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, la baisse de la biodiversité, la déforestation, etc. » (p. 258-259). Mais en second lieu, et plus profondément encore, parce que l’anthropocène s’est vu alors interprété, dans bien des travaux, à partir de cette longue pensée critique de la modernité que l’ouvrage s’est attelé à restituer. Et dans ce cadre, « le théorème de l’accélération (…) devient : Modernité = Accélération = Anthropocène » (p. 258).
Or, là encore, Christophe Bouton refuse de lire l’anthropocène comme une expérience du temps homogène, soluble dans une expérience uniforme du temps comme accélération, dans une lecture pessimiste – et en réalité déterministe – de l’histoire. La proclamation de l’anthropocène signale au contraire d’abord, une fois encore, la même polychronie moderne. Ainsi, bien qu’elle soit issue des « sciences du système Terre », qui, à partir des années 80 ont associé des climatologues, des biogéochimistes, des océanographes et des écologues, le concept s’est vu d’emblée très largement débattu (p. 270-286)[23]. On admet sans doute assez largement, désormais, que l’anthropocène ou « la nouvelle époque de l’homme » constitue celle au cours de laquelle l’humanité est devenue une force géologique, au point de devenir capable de menacer sa propre survie (p. 258). Mais les conflits autour de la datation de cette période sont nombreux (p. 277 et ss.), et ils signifient bien les enjeux politiques – en termes de responsabilité (p. 284) – de la question. L’auteur résiste en particulier à l’idée que l’anthropocène annonce de façon univoque une simple « renaturalisation » de l’histoire. Sans doute, comme l’a bien établi l’historien Dipesh Chakrabarty[24], l’anthropocène abolit le « clivage entre histoire et nature, plus exactement entre l’histoire humaine et l’histoire de la nature » (p. 286). Mais cette renaturalisation ne signifie pas, pour Christophe Bouton, la fin du clivage entre histoire naturelle de la Terre et histoire humaine, mais plutôt une convergence et un entrelacement (p. 298). Et ce, en particulier, parce que la catégorie d’anthropocène n’est pas seulement le fruit d’une abolition du clivage entre histoire naturelle et histoire humaine, mais en même temps d’une « extension de la catégorie de faisabilité à l’histoire de la nature, la conviction que celle-ci serait devenue faisable, contrôlable par les hommes » (p. 313). Ce qui a précisément conduit à multiplier les figures paradoxales de cette faisabilité, dans de nouvelles représentations concurrentes du temps et de l’histoire. Ainsi, d’un côté, on a vu les travaux autour de l’anthropocène s’accompagner de réflexions porteuses des fantasmes de surpuissance, dans la géo-ingénierie et les techno-utopies (p. 320 et ss). De l’autre, un discours collapsologiste s’est saisi de l’anthropocène pour annoncer la fin de l’histoire, avec des échos apocalyptiques. Les conceptions de l’histoire demeurent donc, pour l’auteur, plurielles.
Plus précisément, un conflit s’esquisse aujourd’hui entre trois conceptions centrales, déclenchées par « l’événement anthropocène » : une conception futuriste, notamment représentée par l’éco-modernisme ; une conception pessimiste, porteuse d’un discours de fin de l’histoire, comme dans la collaspologie (p. 346), et une nouvelle conscience du temps que Christophe Bouton associe enfin pleinement au terme d’anthropocène. Car l’anthropocène a bien introduit un nouveau régime d’historicité, qui se donne d’abord à lire dans la forme d’expérience du temps qui lui est associée, et qui n’a été envisagée ni par Koselleck, ni par Rosa. Hartog qualifie justement cette expérience de « temps messianique, mais négatif » (p. 301). La conscience qui la porte est inédite, car elle est celle d’une menace planétaire – c’est-à-dire à la fois à l’échelle de la planète et comme menace pour la planète – en modifiant la perception de l’histoire, qui n’est plus limitée à l’espère humaine (p. 349). Mais elle n’est pas celle d’un grand sujet homogène ; elle est plutôt – aujourd’hui au moins – une conscience plurielle, qui résiste au retour des grands récits (p. 340).
L’ouvrage esquisse rapidement les trois volets de cette nouvelle expérience du temps – comme forme de responsabilité tournée vers l’avenir, mais aussi vers le présent lui-même, et comme reprise des réflexions sur l’histoire des hommes à partir du rapport qu’elle entretient avec la nature. Avec, dans tous les cas, une rupture claire avec le présentisme, au sens où Hartog l’entend (p. 364). Ces aspects ne sont pas développés. On peut penser que l’auteur esquisse surtout des pistes pour des travaux futurs, à partir d’une thèse centrale : l’anthropocène est bien porteur d’un nouveau régime d’historicité qui rompt avec le présentisme, trop souvent associé aux travaux portant sur l’accélération. Et, à l’instar de toutes les expériences de la temporalité sous la modernité, ce nouveau régime donne déjà lieu à d’inévitables conflits d’interprétation. C’est donc en prenant la mesure de ce polymorphisme, c’est-à-dire, en saisissant la portée et la signification des luttes et des stratégies qui vont se jouer autour du sens de ce régime d’historicité, que l’on pourra véritablement penser les régimes temporels aujourd’hui – et non en continuant à lire notre rapport à l’histoire et au temps à partir d’une critique de la modernité homogène et, en réalité, pessimiste.
L’ouvrage, foisonnant, captivant par moment, est très stimulant intellectuellement et politiquement. Et par la portée même de ses thèses, il soulève naturellement un certain nombre de questions, que l’on pourrait presque toutes aborder en interrogeant la signification du caractère polychronique des sociétés modernes. S’agit-il seulement de conceptions du temps plurielles dans des sociétés pouvant par ailleurs être globalement soumises à des formes d’objectivation de l’accélération sociale, ou s’agit-il bien d’expérience du temps diverses ? Ces expériences du temps, si elles existent bien, relèvent-elles à proprement parler de régime d’historicités différents ? Ces questions auraient engagé une réflexion complexe sur la matérialité des formes temporelles, en introduisant certainement des jeux d’échelles. Ainsi, qu’il existe sous la modernité des formes de résistances à l’égard d’une conception dominante du temps n’est guère douteux, et, comme le note l’auteur lui-même, Hartog et Koselleck l’observent également. Néanmoins, elles ne disent rien encore du poids respectif des représentations, comme de la manière dont elles ont pu se traduire concrètement, ni surtout de leur rapport avec le monde social concret. Et de ce point de vue, les critiques sévères de Christophe Bouton contre Rosa évitent peut-être un peu trop la dimension matérielle de l’accélération, ou les formes de son objectivation sociale, contre laquelle les théories du temps qui résistent à la conception dominante pourraient s’avérer très faibles. En d’autres termes, il est délicat de dénoncer la façon dont l’analyse sociologique de Rosa finit par fonctionner comme un « performatif déguisé en constat », faisant « le jeu de l’idéologie néolibérale », sans prendre très au sérieux la dimension matérielle de l’accélération sociale qui pèse sur les individus et leurs représentations.
Pour les mêmes raisons, l’auteur aurait peut-être gagné à approfondir les conceptions de l’histoire qui « résistent » au thème homogène de l’accélération moderne. Car on trouve certainement chez Nietzsche, Marx ou Benjamin, des critiques puissantes de la conception dominante du temps et de l’histoire, qui se déploie au XIXe dans une histoire du progrès et un temps homogène et vide, selon les termes de Benjamin[25] ; mais les stratégies de cette « résistance » au temps du progrès sont profondément divergentes, et elles engagent là encore une réflexion, en particulier chez Marx ou Benjamin, sur les forces matérielles de l’histoire – et non pas seulement sur les possibles « usages » de l’histoire qui résistent à la temporalité dominante.
Inversement, on s’interroge, à l’issue de l’ouvrage, sur l’absence ou presque de toute réflexion sur les usages politiques du temps et de l’histoire par les pouvoirs en place, par des acteurs qui peuvent être tout à fait conscients de « l’utilité de l’histoire », comme de l’utilité du temps – on pense en particulier au gouvernement par l’urgence et la crise aujourd’hui.
Quelles que soient ces questions, l’ouvrage présente une réflexion extrêmement riche, et si vivifiante que l’on se gardera bien, dans ce compte-rendu, d’effacer par quelques remarques, le grand intérêt que doit susciter la réflexion érudite et très stimulante de L’Accélération de l’histoire, qui soulève des questions majeures : même si l’accélération pèse sur les sociétés modernes à la manière d’un destin parce qu’elle constitue une forme temporelle objectivée – dans des rapports de production, des rapports sociaux, des formes de vie –, écrase-t-elle bien le pluralisme des expériences du temps, comme des conceptions du temps ? Mais surtout, un choc heurtant précisément les expériences du temps n’est-elle pas à même de provoquer un sursaut politique d’une ampleur suffisante pour affronter cette lourde matérialité ? Plus spécifiquement, l’anthropocène, qui adosse une nouvelle conception du temps ou un nouveau régime d’historicité, n’a-t-il pas d’abord été l’expérience de chocs heurtant une expérience du temps dominante, et que l’on pourrait sans doute associer à la crise du Covid, mais qui remontent sans doute un peu plus en amont, notamment à Tchernobyl ? Autrement dit, ne faut-il pas aborder les expériences du temps comme ce qui peut ébranler les conceptions dominantes, en faisant vaciller même la lourde pesanteur des formes objectivées de l’accélération permanente ?
[1] Daniel Halévy, Essai sur l’accélération de l’histoire (1948), Paris, fayard, 1961.
[2] Pierre Nora, « Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux », in P. Nora (dir.), Les lieux de mémoire, t. I, La République, Paris, Gallimard, 1984.
[3] Voir en particulier les articles publiés dans Reinhart Koselleck, Le Futur Passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, trad. Jochen Hoock et Marie-Claire Hoock, Paris, Éditions de l’EHESS, 1990.
[4] En particulier dans Friedrich Nietzsche, Humain trop humain, t. I, trad. Robert Rovini revue par Marc B. de Launay, Paris, Gallimard, 1988.
[5] Henry Adams, L’éducation de Henry James, trad. Régis Michaud et Franck L. Schoell, Paris, Imprimerie nationale, 2007.
[6] Daniel Halévy, Essai sur l’accélération de l’histoire, Paris, Fayard, 1961.
[7] Pierre Nora, Les lieux de mémoire, op. cit.
[8] Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps, Paris, La Découverte, 2010.
[9] François Hartog, Régimes d’historicité, Paris, Éditions du Seuil, 2003.
[10] Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Éditions du Seuil, 1977, p. 278.
[11] Bernadette Bensaude-Vincent, « Slow versus fast : un faux débat », Natures Sciences Sociétés, n°22, 2014, p. 260. Cité par Christophe Boudon p. 111.
[12] François Hartog, Régimes d’historicité, Paris, Éditions du Seuil, 2003.
[13] François Hartog, Régimes d’historicité, op. cit., p. 206. Cité dans Christophe Bouton, p. 146.
[14] Reinhardt Koselleck, « “Historia magistra vitae”. De la dissolution du “topos” dans l’histoire moderne en mouvement », traduit dans Le Passé Futur, op. cit., pp. 37-62.
[15] Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, in Œuvres, t. IV, Politiques I, p. 438-439.
[16] Friedrich Nietzsche, « De l’utilité et des inconvénients de l’histoire pour la vie », trad. Pierre Rusch, in Œuvres, Paris, Gallimard, 2000, t. 1.
[17] Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire », in Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000.
[18] Rutger Bregman, Utopies réalistes, Paris, Éditions du Seuil, 2017.
[19] Ernst Bloch, Du rêve à l’utopie. Entretiens philosophiques, Paris, Hermann, 2016 et Le principe espérance, trad. F. Wuilmart, Paris, Gallimard, 1982.
[20] Paul Lafargue, Le droit à la paresse, Paris, Allia, 2009.
[21] Bertrand Russell, Éloge de l’oisiveté, Paris, Allia, 2010.
[22] Rutger Bregman, Utopies réalistes, trad. J. Amrali, Paris, Éditions du Seul, 2017.
[23] Sur l’origine du terme, voir Paul J. Crutzen et Eugene F. Stoermer, « The Anthropocène », IGBP, Newsletter, n°41, 2000.
[24] Dipesh Chakrabarty, “The Climate of History: Four Theses”, Critical Inquiry, n°35/2, 2009, pp. 197-222.
[25] Walter Benjamin, « Sur ce concept d’histoire », op. cit., p. 439.