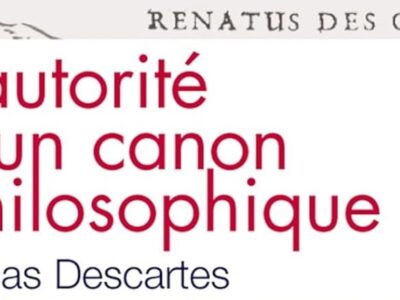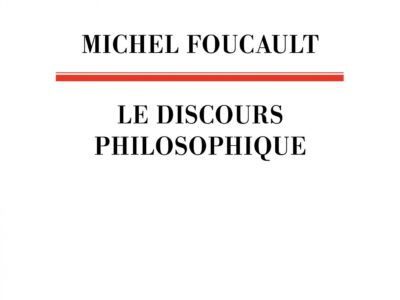Compte-rendu critique – L’histoire libérale de la modernité
Jean-François Colomban est doctorant en philosophie économique à l’EHESS (LIER-FYT) et à l’Université Côte d’Azur (CRHI). Sa thèse, intitulée « Une “philosophie des sciences sociales” du débat sur le calcul socialiste (1918-1939) » vise à examiner la façon dont s’articulent les théories et arguments inédits produits dans le cadre de ce débat aux idéaux sociaux portés par les théoriciens, afin d’une part d’éclairer la dynamique des sciences économiques et d’autre part d’en apprendre davantage sur la définition des idéaux sociaux dans nos sociétés modernes.
Florence Hulak, L’histoire libérale de la modernité, Paris, Émancipations, Presses Universitaires de France, 2023. p. 336.
L’ouvrage est disponible ici.
Résumé
L’ouvrage de Florence Hulak a pour ambition principale d’identifier les schèmes de pensée libéraux présents dans la critique contemporaine progressiste, ainsi que d’établir la généalogie de cette pensée jusqu’aux historiens français libéraux du début du XIXe siècle, sous la Restauration. Ces schèmes, que l’on peut retrouver chez Bourdieu ou une partie des postcolonial studies, sont visibles dès les travaux d’Augustin Thierry, pour connaitre ensuite une évolution complexe dans les œuvres de Guizot et Michelet, avant d’être enfin repris puis critiqués par Marx, dont s’inspire une partie significative de la critique contemporaine. Cette investigation minutieuse passe au crible l’ensemble de ces schèmes -parmi lesquels s’en dégagent trois principaux. L’État y est fréquemment conçu comme une puissance intrinsèquement oppressive et radicalement distincte de la société. Les groupes n’ont d’unité qu’en vertu de leur opposition à d’autres groupes ou au pouvoir. Quant à la perspective d’émancipation, celle-ci réside moins dans la poussée plus ou moins conflictuelle de groupes sociaux en vue de la réalisation d’un idéal collectif de justice que dans la capacité originaire des individus à défendre les droits dont ils sont intrinsèquement porteurs. L’autrice parvient à restituer cette généalogie dans le détail des travaux historiques étudiés, sans omettre les tensions ou hésitations interne à ces œuvres ancrées dans les conflits socio-politiques de leur temps.
Mots clefs : Histoire, Critique contemporaine, Philosophie des sciences sociales, Libéralisme, Réflexivité
Abstract
Florence Hulak’s book aims at identifying a liberal way of thinking within the contemporary progressive critique, and retraces these concepts up to the French liberal historians of the beginning of the 19th century, during the Restoration period in France. One could find this way of thinking in Bourdieu’s work or some postcolonial studies, but also as far as Augustin Thierry’s work, from which such a way of thinking would follow a complex trajectory through the works of Guizot and later Michelet to finally find its way in Marx’s theory. Even though Marx would become critical towards these theoretical elements, a significant part of the contemporary critique has drawn inspiration from the first Marx, thus completing the link between the 19th century’s liberals and today’s critique. This investigation examines thoroughly the various aspects of this way of thinking, from which can be drawn three major elements. The State is frequently considered as a power inherently oppressive and radically distinct from society. Groups’ principle of unity is reduced to their opposition to other groups or to the government. As far as the prospect of emancipation is concerned, it is not the result of a more or less conflictual momentum towards the enforcement of a collective ideal of justice, but rather the outcome of an inherent tendency of individuals to defend their “natural” rights. This genealogy is all the more so successful as it delves into the very details of these historical works, while pointing out the inner tensions and hesitations of these works produced in the middle of the socio-political conflict of their time.
Keywords: History, Contemporary Critique, Philosophy of Social Sciences, Liberalism, Reflexivity.
Introduction
Augustin Thierry et Ranajit Guha : l’association semble aussi saugrenue qu’anachronique. Certes, l’un et l’autre ont fondé un courant historiographique, mais le premier est un historien français libéral écrivant sous la Restauration pour « rendre à la roture sa part de gloire dans nos Annales » (p.50) tandis que le second est un historien indien du XXe siècle ayant contribué à faire émerger le courant des subaltern studies via l’étude de l’Inde coloniale[1]. C’est pourtant dans l’identification de ce qui les unit que réside le tour de force qu’opère l’ouvrage de Florence Hulak, L’histoire libérale de la modernité. Il s’agit pour l’autrice de mettre en évidence dans la science historique libérale de la société française telle qu’elle émerge au XIXe siècle sous la Restauration des schèmes de pensée que l’on retrouve dans une partie de la critique contemporaine, qu’elle s’incarne dans des travaux de chercheurs ou des discours militants. Ces schèmes se retrouvent notamment dans une critique féministe et post-coloniale, mais plus largement dans la critique inspirée du premier Marx, selon laquelle les rapports sociaux dans nos sociétés de classes sont fait non pas d’un lien de solidarité fondé sur la visée d’un idéal de justice déterminé, mais d’une lutte, d’« un conflit en perpétuel développement »[2]. Autrement dit, l’ouvrage propose une généalogie inédite de schèmes irriguant une grande partie de la critique contemporaine (pp.20-21). Cette généalogie parvient à restaurer une forme de continuité dans l’histoire de la pensée critique, sans laquelle l’émergence de cette critique serait inexplicable car réduite à une apparition ex nihilo détachée des groupes sociaux qui la produisent.
Ce propos relatif à l’histoire de la pensée s’articule à un propos politique qui ne laisse pas d’être manifeste. En effet, ce travail vise à contribuer à la réorientation de la critique progressiste vers une voie davantage socialiste[3] en la purgeant des schèmes de pensée libéraux, sinon en général, du moins lorsque ceux-ci entravent le développement de la critique. L’autrice prend au sérieux l’émergence de nouvelles critiques qui identifient des formes de domination (notamment de race et de genre) jusqu’alors négligées voire ignorées (p.9), à rebours de la tendance des intellectuels conservateurs à les disqualifier grossièrement en les flanquant de l’étiquette infamante « woke ». Cependant, Florence Hulak cherche à identifier les difficultés auxquelles ces voies critiques sont confrontées. Limitons-nous ici à la difficulté principale : elles tendent à penser les liens de solidarité exclusivement comme le produit négatif d’une lutte, et les limitent par conséquent à la solidarité interne à un camp s’opposant à un autre camp hétérogène à cette solidarité. Dès lors, il devient difficile de concevoir un projet de société juste fondée sur une solidarité intégrant l’ensemble des membres d’une société et s’efforçant de réaliser un idéal de justice défini positivement sur la base de valeurs communes (pp.59-60).
Tous les auteurs étudiés dans l’ouvrage se heurtent à ce même obstacle. Aussi le livre de Florence Hulak cherche-t-il à le à circonscrire avec précision pour mieux s’en affranchir. Dans cette perspective, la dernière partie de l’ouvrage, traitant du Marx tardif, commence à esquisser une conception de la solidarité qui s’extrait de la logique oppositionnelle. L’autrice souligne cependant qu’elle ne sera pleinement dépassée que par les sciences sociales naissantes en Allemagne et en France dans la seconde moitié du XIXe siècle.
I.1. – L’objet, « l’histoire libérale de la modernité »
Quelle est alors cette science historique libérale oubliée qui toutefois semble avoir des effets majeurs sur les schèmes de pensée de la critique contemporaine, notamment lorsqu’elle se fonde sur l’histoire comme discipline pour fonder ses énoncés critiques ? L’introduction de l’ouvrage en dresse les grandes lignes conceptuelles. Il s’agit du type d’histoire produite par des historiens libéraux français de la première moitié du XIXe siècle, sous la Restauration (principalement Augustin Thierry et François Guizot), puis de ses ramifications chez Jules Michelet et le premier Marx. Cette histoire est qualifiée de libérale pour des raisons politiques et épistémologiques. Politiquement, elle permet de soutenir le libéralisme sous la Restauration (p.37). Épistémologiquement, elle se caractérise par un travail sur les documents historiques qui vise à restituer le point de vue des vaincus. Ce point de vue est décisif, aux yeux de ces libéraux et leurs disciples, puisque ce sont les « vaincus » qui, luttant dans un élan spontané de liberté contre un pouvoir oppressif portent non seulement la liberté mais aussi la vérité, soit le véritable sens de l’histoire (p.30).
I.2. – Une méthode de philosophie des sciences sociales
Cette définition indissociablement politique et épistémologique de l’objet renvoie à la méthode générale déployée dans l’ouvrage. L’autrice, connue pour ses travaux en philosophie des sciences sociales, fait référence à la sociologie de la connaissance de Karl Mannheim ainsi que, secondairement, à sa reprise amendée par Cyril Lemieux et Bruno Karsenti (p.22 et p.28)[4]. Rendre compte de la dynamique interne des sciences humaines et sociales exige d’examiner les ancrages sociaux de leurs auteurs, et notamment les idéaux socio-politiques portés par les groupes auxquels ils appartiennent. On ne peut comprendre l’émergence et le succès de cette science historique particulière à moins d’examiner d’une part les idéaux de ces acteurs, et d’autre part les raisons en vertu desquelles ces intellectuels estiment que seule l’histoire (ou plus précisément, un certain type d’histoire) permet le gain de réflexivité nécessaire à la poursuite de leur idéal. On mesure dès lors les enjeux impliqués dans l’une des questions liminaires, « Pourquoi le premier libéralisme donne-t-il naissance à la science historique dans les années 1820 ? » (p.30)[5].
Une fois l’objet clairement défini, l’introduction esquisse les différents chemins empruntés par les continuateurs de cette première histoire libérale. Cette dernière, analysée dans le premier chapitre comme une relecture libérale du concept aristocratique de « guerre des races » (le premier Thierry, 1817-1827/28), aboutit d’une part à une histoire de la nation (le second Thierry et Guizot d’un côté, Michelet de l’autre) exposée dans le chapitre 2, et d’autre part à une histoire des classes (le premier Marx) examinée dans le chapitre 3, dont le dépassement est esquissé par une auto-critique marxienne (le second Marx). Nous suivrons la structure ternaire de l’ouvrage, mise en exergue par le sous-titre « Race, nation, classe ».
I.3. – La première histoire libérale d’Augustin Thierry
Cette science historique nait de la volonté, à l’heure de la Restauration monarchique, et donc de l’échec de la Révolution française, de sauver le récit du progrès de la liberté contre les objections réactionnaires (p.61). Celles-ci sont d’ordre politiques et épistémiques. D’une part, la victoire des réactionnaires monarchistes est un fait politique indubitable qui semble signer la fin de l’ère révolutionnaire. D’autre part, le récit libéral du progrès, fondé en grande partie sur le contractualisme de Rousseau, souffre d’une abstraction excessive face au savoir concret de l’ordre social que déploient les réactionnaires. Louis de Bonald comme Joseph de Maistre dépeignent une société qui n’est pas composée d’individus libres garantissant la sauvegarde collective des libertés par un contrat originel, mais qui est d’emblée une totalité chargée de son passé, avec ses mœurs et ses lois ; une totalité harmonieuse et hiérarchisée, conforme à l’ordre divin (p.68). Voilà le double défi qui se présente aux libéraux du début de la Restauration, cantonnés à un rôle d’opposition impuissante : produire le récit montrant que le projet libéral est plus juste que son homologue réactionnaire, d’une part en ancrant cet idéal dans la société par un savoir concret sur cette dernière et d’autre part en défendant que l’échec politique de la Révolution française n’atteint pas l’idéal libéral et le savoir qui lui correspond.
Pour mener à bien ce projet, Augustin Thierry, considéré comme l’expression de ce mouvement réflexif, mobilise deux schèmes de pensée disponibles à son époque : le « progrès de la liberté » et, plus inattendu, la « guerre des races ». La reprise du premier schème n’est guère surprenante, car il s’agit au fond de la simple inscription de l’idéal libéral dans une philosophie de l’histoire, à la manière du Tableau historique de Condorcet (p.67). C’est le recours au second schème qui est plus étonnant, non seulement parce que ce dernier est emprunté aux réactionnaires, mais surtout parce qu’il vise, dans son usage initial, à lutter contre le schème du « progrès de la liberté » (p.76). La « guerre des races » apparait d’abord chez le comte de Boulainvilliers, comme l’a remarqué Foucault[6] (p.35). L’aristocrate défend que l’histoire n’est pas une continuité harmonieuse de l’ordre monarchique, mais une série de conquêtes, une « guerre des races » à l’issue de laquelle les vaincus se retrouvent dominés par les vainqueurs (p.81)[7]. Face au déclin progressif du pouvoir féodal, Boulainvilliers veut défendre les droits de l’aristocratie au nom des victoires passées de la noblesse (p.15, pp.87-88).
Précisons que le concept de « race » ne renvoie pas au concept d’un groupe ethno-racial. Par « race », les réactionnaires désignent d’une part un groupe inscrit dans la continuité d’un lien de filiation et d’un héritage, et d’autre part un groupe avec des normes, des coutumes et un idéal propre, distincts de la normativité portée par l’État (monarchique) (p.37, p.88). C’est cette définition de la race qui permet, après la Révolution, au comte de Montlosier, de refuser au Tiers victorieux le statut de « vainqueur ». Oui, il a gagné, mais non, le Tiers n’est pas un groupe doté d’une normativité propre. Il est juste une sorte de déchet produit par la véritable histoire de l’affrontement entre monarchie et aristocratie, entièrement passif et dépourvu de toute capacité d’initiative (pp.81-82). Par conséquent, on peut écarter la roture de la scène de l’histoire où se joue la légitimation du droit des vainqueurs sur les vaincus. Parler de « guerre des races » comme le fait Thierry, et donc accorder au Tiers le statut de « race », est alors un geste politique fort en faveur du Tiers.
Florence Hulak ajoute toutefois que le concept de « race » mobilisé par Thierry est en décalage avec le concept aristocratique, dans la mesure où il est purement politique. La « race » renvoie alors au fait même de partager une position de vainqueurs ou de vaincus, sans autre principe d’unité complémentaire (p.215). Dès lors, l’unité historique des concepts de « vaincus/vainqueurs » est purement analogique : les « vaincus » n’ont aucune « ascendance naturelle » ou « tradition culturelle » commune, car leur seul élément commun est d’être dominés et de lutter pour le progrès de la liberté (p.136, p.140).
I.4. – La « guerre des races » libérale
Pourquoi Thierry recourt-il à ce schème de la « guerre des races » et comment le combine-t-il au premier schème de sa pensée, celui du « progrès de la liberté » ?
D’abord, cela lui permet de concrétiser le grand récit du progrès des libertés en l’inscrivant dans une histoire de luttes et d’en complexifier la linéarité simpliste. Thierry relit les historiens réactionnaires et les archives historiques pour identifier les étapes concrètes du progrès des libertés contre le pouvoir (qu’il soit féodal ou monarchique). Il reprend à l’historien monarchiste Dubos, contre l’histoire aristocratique, l’idée selon laquelle se serait conservée dans les villes, malgré les invasions germaniques, une tradition gallo-romaine empreinte de droit romain et de désir de liberté et d’égalité politique (p.86, p.95). Il y ajoute que les villes, du fait de leur goût pour les activités « industrieuses » (i.e. de production et de commerce), ont su préserver pour l’humanité les « arts et les mœurs de l’industrie » malgré les invasions barbares (pp.96-97). Face aux velléités dominatrices des nobles, les bourgeois se seraient armés pour défendre leurs activités, au point de se prêter mutuellement serment en vue de leur défense commune, et devenant par là-même des « citoyens » capables d’agir en vue d’un intérêt collectif potentiellement conflictuel avec leur intérêt individuel (pp.98-99). La Révolution est un énième épisode de cette lutte, face à la monarchie qui a parachevé la domination féodale en instituant une paix des vainqueurs (p.108). Et comme les libertés se gagnent par une lutte continue, un droit après l’autre pour ainsi dire, un revers local n’implique pas l’invalidation du récit général : la Révolution française battue par la Restauration ne signe pas l’échec de la lutte pour la liberté.
Puis, le geste de Thierry lui permet de faire basculer la légitimité des vainqueurs vers les vaincus. Les vaincus, i.e. la « masse » (qui recouvre l’ensemble des individus et groupes dominés, soit pour l’essentiel le Tiers État mais sans s’y réduire -p.91) constituent à la fois le camp qui porte les progrès de la liberté et le point de vue vrai sur l’histoire. La masse est intrinsèquement du côté de la liberté pour l’ensemble de la société car sa lutte est toujours défensive ; de ce fait, l’idée d’exercer une domination lui est totalement étrangère (p.20, p.92). Le modèle convoqué est celui du bourgeois médiéval armé qui défend ses droits face aux menaces féodales, et qui, une fois la sauvegarde de ses droits assurée, retourne pacifiquement à son activité économique (p.98).
Quant au point de vue de la vérité, c’est là une innovation de Thierry : le point de vue des dominés, que les dominants ne peuvent jamais pleinement aliéner, permet de révéler la nature conflictuelle de l’histoire que le récit des vainqueurs -lesquels cherchent à légitimer leur pouvoir- tend à dissimuler (p.20, p.41). Cette thèse est révolutionnaire (au double sens du terme) dans la mesure où elle se propose de rédiger l’histoire du point de vue des vaincus, ce qui est inédit depuis les premiers historiens grecs selon l’autrice (p.92).
Enfin, le concept aristocratique de la « guerre des races » fournit une base pour élaborer le concept de « sujet-objet » de l’histoire. Florence Hulak désigne ainsi un groupe qui est un acteur significatif des dynamiques historiques de la société et qui produit un discours pour légitimer son action à ses yeux comme aux yeux des autres groupes, soit un acteur réflexif travaillé par un idéal de justice (p.16). Ainsi, le progrès de la liberté ne résulte ni d’un mouvement impersonnel comme c’était le cas dans la philosophie de l’histoire du XVIIIe siècle, ni d’une série de revendications individuelles, mais de la poursuite d’un idéal libéral par la « masse ». La lutte des libéraux d’opposition face à la monarchie est alors inscrite dans une continuité historique assurée par la cohérence (partielle) du sujet porteur de la liberté, certes limitée à une unité analogique.
I.5. – Thierry, un pur libéral ?
Selon l’autrice, Thierry n’a pas réussi à faire de la « masse » un groupe cohérent porteur d’un idéal positif qui dépasse la simple lutte contre le pouvoir (pp.145-148) du fait de sa conception libérale du lien social : Thierry ne voit que des individus poussés par un élan de liberté dont ils sont intrinsèquement les porteurs, un groupe qui n’a d’unité qu’oppositionnelle puisqu’une fois les droits acquis, celui-ci se dissout. Toutefois, il est frappant de constater que d’autres conceptions du lien social se trouvent chez Thierry. On l’a vu, la race se définit chez lui avant tout politiquement (par l’opposition vainqueur / vaincu), mais ce concept dans son héritage aristocratique recouvre davantage, comme dit plus haut, à savoir un ensemble de pratiques, normes et d’idéaux inscrits dans un héritage. De même, l’autrice mentionne que chez Thierry, le serment que prononcent les jurés bourgeois pour défendre leur commune face à l’oppression féodale produit un lien social qui ne se réduit pas à l’épreuve momentanée de la défense de la cité, mais qui constitue un ferment rattachant le bourgeois à une communauté politique dotée d’un lien interne (pp.99-100). Dans les deux cas, l’unité ne se réalise pas uniquement par l’opposition au groupe au pouvoir, mais elle résulte de dynamiques internes propres (qui restent à préciser), ou émane certes d’une opposition, mais pour former un collectif qui se maintiendra une fois la lutte terminée. L’autrice tranche en faveur du libéralisme du Thierry (p.307), mais le lecteur est en droit de se demander si ces deux autres aspects sont minimisés pour purifier le portrait de Thierry de ses éléments non libéraux, ou si Thierry met réellement de côté ces éléments alors même qu’ils pourraient servir son propos (p.89), ce qu’il faudrait alors expliquer.
II.1. – L’histoire nationale : penser l’unité après la Révolution
Là encore, comprendre l’émergence de l’histoire de la nation suppose de lire ces travaux comme une réponse aux problèmes identifiés par certains groupes sociaux en vertu de leurs idéaux. Cependant, une autre variable intervient, à savoir la participation des groupes au pouvoir. Ce qui intéresse au premier chef l’autrice ici sont les modifications de la réflexivité libérale (exprimée dans leurs discours descriptifs et normatifs) induites par la participation au pouvoir. Selon Florence Hulak, l’entrée au gouvernement de libéraux en 1828 suppose de mieux définir « les contours de ce qui devient la source légitime du pouvoir et l’objet du gouvernement » (p.148). On comprend le souci de légitimer l’État une fois que ces libéraux y prennent part mais moins la nécessité de définir l’objet du pouvoir. Cela impliquerait que le gouvernement, pour intervenir sur la société, nécessiterait un savoir totalisant portant sur une société dotée d’une certaine unité (pp.166-169) – thèse forte qui mériterait d’être thématisée et discutée davantage.
II.2. – De Guizot et Michelet à Febvre
Comment s’opère cette unité nationale chez Guizot puis Michelet ? Guizot, qui assume davantage de « gouverner la nation en libéral » (p.171), fait de l’État monarchique le premier principe de cette unité. L’historien opère comme Thierry une synthèse entre le récit philosophique du progrès de la liberté et la « guerre des races », sauf que ce processus aboutit à une unité nationale garantie par la soumission à un même droit et à un même État (p.154). Le désir de liberté des barbares germains s’unit à l’ordre juridique de la civilisation romaine conservé dans les villes, synthèse parachevée par le christianisme (p.157). Quant à Michelet, le parcours est plus complexe : dans ses premiers écrits, la nation se constitue progressivement par un travail interne, aussi bien matériellement que spirituellement (p.194), mais dès 1847-48, Michelet, déçu du régime de juillet, rejoint les républicains. La bourgeoisie, alliée à la monarchie de juillet, est alors déchue de son statut de sujet de l’histoire pour être remplacée par la paysannerie, dont l’unité résulte de son ancrage dans le territoire national, sans pour autant être essentialisée, puisque la formation achevée d’un tel sujet n’est possible que par un ressaisissement politique de son unité, sur le modèle de la réunion des États généraux de 1789. Ce sera Lucien Febvre, bien plus tardivement, qui donnera un sens essentialiste à la thèse de Michelet, quitte à réactiver le mythe de la France gauloise (p.218).
III.1 – Marx, héritier de la première histoire libérale
 Le dernier chapitre est sans doute le plus surprenant, puisqu’il inscrit le premier Marx dans la continuité de cette histoire libérale – du moins sur le plan épistémique, ce qui a tout de même des implications politiques, notamment dans le rapport à l’État. Or, c’est de ces travaux de Marx que va s’inspirer une partie de la critique contemporaine progressiste, négligeant les pistes dégagées par Marx lui-même pour critiquer et s’affranchir de ces schèmes libéraux.
Le dernier chapitre est sans doute le plus surprenant, puisqu’il inscrit le premier Marx dans la continuité de cette histoire libérale – du moins sur le plan épistémique, ce qui a tout de même des implications politiques, notamment dans le rapport à l’État. Or, c’est de ces travaux de Marx que va s’inspirer une partie de la critique contemporaine progressiste, négligeant les pistes dégagées par Marx lui-même pour critiquer et s’affranchir de ces schèmes libéraux.
A la différence des historiens libéraux de la nation, Marx ne cherche pas à rendre compte de l’unité de la nation pour elle-même ou pour légitimer l’État agissant en son nom, mais à exhiber théoriquement le fondement réel des aspirations socialistes du prolétariat en vue de la dictature du prolétariat puis de l’avènement de la société sans classe. Le jeune Marx (celui de L’idéologie allemande, du Manifeste et dans une certaine mesure de Misère de la philosophie) s’inspire principalement de la première version de cette histoire libérale, celle du premier Thierry, qu’il lit attentivement et remobilise au point de le qualifier de « “père de la lutte des classes ” dans l’historiographie française » (p.224).
Que reprend le jeune Marx de cette histoire ? Parmi tous ceux identifiés par l’autrice, limitons-nous à signaler les quatre éléments pertinents faisant de Marx un point de relais entre la première histoire libérale et la critique contemporaine. Premier emprunt, l’opposition entre des dominants et une « masse »[8] de dominés dont l’unité résulte de leur situation de dominé et de la lutte pour s’en extraire (pp.261-263).
Deuxième emprunt, cette fois à l’histoire nationale, le schème général selon lequel le conflit de classe est dépassé en vue d’une union de la société -union nationale chez Michelet, société sans classe chez Marx (p.244).
Troisième emprunt, le rapport de force qui est constitutif d’une société de classe ne se joue pas seulement sur la scène socio-politique, mais aussi sur le plan du savoir (p.253). Dès lors, la critique doit, contre le discours universaliste des dominants, remettre en lumière le conflit et les intérêts matériels antagonistes qui le sous-tendent –au point de reproduire le geste de lecture qu’avait opéré Thierry sur les chartes communales. En effet, de même que le discours des libertés octroyées masque le conflit entre aristocrates et bourgeois, de même, ces chartes évoquent un peuple unique, dissimulant alors l’antagonisme entre le prolétaire et le bourgeois qui cherche à accroitre sa main d’œuvre en faisant miroiter au paysan ce foyer de liberté qu’est la commune (pp.259-260).
Quatrième emprunt, lié au précédent : il faut adopter le point de vue des dominés (en l’occurrence du prolétariat) pour saisir politiquement la visée de l’émancipation et épistémiquement la vérité du rapport historique de classe –ce qui ne signifie pas pour autant que la science marxiste se réduit à ce point de vue (p.247). Cette position est associée à une conception interne de la critique, tirée des historiens libéraux (p.250). Il serait intéressant d’approfondir ce lien, non mentionné dans les chapitres précédents, notamment car la critique interne suppose un groupe (quel que soit la conception qu’on se fait du lien qui unit ses membres) au nom duquel elle est émise, alors même que les libéraux peinent à trouver un principe d’unité social entre « races » ou même interne à la « race ».
III.2. – L’auto-critique marxienne du 18 Brumaire
Ce discours va être profondément ébranlé à la suite de l’échec de la révolution de 1848, qui s’achève avec le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte. Dans Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, publié en 1852, Marx procède à une auto-critique qui aboutit de fait à l’effacement de cet héritage libéral sur quatre points décisifs.
Première auto-critique, le sujet porteur de liberté et du point de vue de la vérité fait place à une lecture plus fine et complexe de la société française du milieu du XIXe siècle. La victoire de Bonaparte, fort du soutien de la paysannerie et de la bourgeoisie, fait voler en éclat la perspective d’une révolution imminente portée par le prolétariat, politiquement isolé, et oblige ainsi à prendre au sérieux la diversité des groupes composant la société (p.237, pp.265-266).
Deuxième auto-critique, l’expérience bonapartiste appelle à modifier le concept d’État. En effet, ce dernier n’est plus l’appareil d’une classe dominante exerçant sa violence sur des vaincus disposant toujours d’une capacité de résistance originelle, mais une machine militaro-bureaucratique qui, en même temps qu’elle s’autonomise des groupes qui la soutenait initialement, est organiquement lié à la société au point d’en altérer ses dynamiques sociales internes. S’il y a bien eu intégration de la bourgeoisie à l’État monarchique, comme l’affirmait Guizot, cette instance a poursuivi sa dynamique d’accroissement de la division du travail en interne et de centralisation, au point de s’affranchir de la bourgeoisie pour devenir une « machinerie » autonome (p.287). Cette autonomie n’est toutefois possible qu’à une double condition : l’État tire sa puissance de l’imposition fiscale des paysans (p.285), et surtout il ne peut se maintenir qu’en l’absence de forces sociales suffisamment conséquentes pour entraver son action. Pour ne pas sombrer, l’État de Bonaparte doit fragmenter les groupes en une masse, au sens d’une série d’individu sans liens forts entre eux (p.284). Un État ne pourrait en théorie se maintenir sans soutien social, si ce n’est précisément dans cette configuration particulière où l’État renforcé à l’issue d’un long processus remontant à la monarchie fait face à une société hyperfragmentée (pp.166-167)[9].
Troisième auto-critique, l’action désintégratrice de l’État oblige d’une part à repenser les conditions d’émergence et de maintien des classes sociales, et d’autre part à ne plus se limiter à un concept d’unité social fondé sur la simple opposition à un groupe. A posteriori, le seul critère de l’opposition ne parait plus suffisant pour rendre compte de l’unité d’un groupe, d’où le recours à un concept de classe au sens fort, fondé sur des pratiques et position communes dans les rapports de production (pp.270-271). Dès lors que le principe d’unité de chaque classe est ancré dans les rapports de production, il n’est guère étonnant que la critique marxienne bascule du terrain historico-politique à celui de l’économie politique. Comprendre l’économie politique permet de rendre compte de l’émergence des classes au sens fort du terme, et donc de la possibilité même d’une lutte des classes sans laquelle la réappropriation de l’État comme organe de régulation et d’intégration d’un côté et la dissolution des classes de l’autre ne peuvent avoir lieu (p.301).
Enfin, dernière auto-critique, il ne suffit plus de partir du point de vue des prolétaires pour lutter contre la domination bourgeoise, il faut épouser le point de vue bourgeois pour épurer la pensée critique de ses éléments bourgeois. C’est l’autre raison qui préside à la réorientation marxienne vers l’économie politique (pp.280-281).
IV.1. – Parachever le dépassement de l’histoire libérale par la sociologie
Si cette auto-critique de Marx dans Le 18 Brumaire complexifie considérablement le récit initial d’un Thierry et, à certains égards, fournit des éléments dont pourra se ressaisir la sociologie, elle ne débouche pas sur un savoir positif des processus sociaux qui rendrait compte à la fois des liens de solidarité unissant la société et de ses conflits internes, et qui s’articulerait à un idéal positif de justice ne se réduisant pas à la simple abolition de la domination.
L’auto-critique marxienne permet à l’autrice d’isoler le premier Marx du second d’une part, et de les distinguer de la démarche sociologique naissante d’autre part -et ainsi d’identifier deux des sources de la critique progressiste contemporaine. D’un côté, le lecteur se voit donner une idée plus précise de « l’histoire socialiste » permettant de dépasser l’histoire libérale. Rattachée à la sociologie naissante (notamment durkheimienne) et à Marc Bloch, il s’agit d’une histoire qui pense l’émergence des normes sociales et la façon dont elles s’articulent au droit. C’est là une histoire qui examine la façon dont le marché et l’État produisent les individus comme sujets, s’interrogeant sur l’institution d’individus libres et autonomes (pp.312-313).
D’un autre côté, certains des schèmes libéraux identifiés se retrouvent via le premier Marx dans la critique progressiste, et plus précisément dans les subaltern studies, avant d’être critiqués et prolongés par la sociologie bourdieusienne et les postcolonial studies. Sont mentionnés le postulat selon lequel l’accès à la vérité sur les rapports de pouvoir –et donc à la vérité sur l’ordre socio-politique- passe par le point de vue des dominés, la conception d’un sujet comme résistant à la normativité et au pouvoir (dont la cohésion se réduit alors à une simple opposition) ou encore le blocage de la critique sur le moment du soulèvement (qui ne va pas jusqu’à la discussion des différents projets de justice possibles) du fait de l’impossibilité de renverser la domination (p.314). Dans les subaltern studies, on retrouve à la fois la critique des travaux niant aux masses d’hommes leur spontanéité (de même que Thierry critiquait un Montlosier niant la capacité d’action du Tiers) et le projet d’écrire l’histoire du point de vue des dominés à partir des documents produits par les dominants –notamment en renversant le sens des énoncés pour retrouver le point de vue des dominés, comme l’a fait Ranajit Guha et Augustin Thierry avant lui (p.316). Prolongeant de manière critique ces hypothèses, Bourdieu affirme qu’il y a une affinité entre la position du dominé et la position scientifique, et s’il s’efforce de dégager un point de vue sociologique qui s’affranchirait des prénotions des acteurs (i.e. essentiellement de la violence symbolique), ce point de vue correspondrait alors à celui de dominés libérés de la violence symbolique (p.317). Du côté des postcolonial studies, certaines positions fondées sur la thèse de Spivak selon laquelle les subalternes « ne peuvent pas parler » défendent qu’il serait illégitime de reconstruire le point de vue des dominés, ce que l’autrice rapporte à un certain respect du « silence des vaincus » chez Thierry (Ibid).
IV.2. – Quelle place de l’histoire pour la réflexivité contemporaine ?
Certes, la sociologie dépasse l’histoire libérale, mais va-t’elle jusqu’à dépasser la science historique elle-même ? Là réside une ambigüité l’ouvrage : il semble que l’autrice fasse de la discipline historique (et plus précisément du concept de « sujet de l’histoire ») un passage obligé encore aujourd’hui dans le processus d’accroissement de la réflexivité des sociétés modernes (p.85). Tous les auteurs semblent devoir se plier à une exigence proprement moderne de définir un sujet de l’histoire, au double sens d’acteur significatif continu (des communes médiévales à la Révolution) et d’acteur collectif décisif qui, entre tous les groupes de la société, est celui qui porte le projet émancipateur / le plus réflexif pour l’ensemble de la société. Cependant, L’autrice remarque à juste titre que ce schéma de la guerre des races butte sur la question de ce qui fait l’unité sociale de chacun des groupes et de l’ensemble de la société, et que cette question ne sera reprise avec succès par la sociologie naissante en France et en Allemagne. Marx reprend ce schéma avant de l’enterrer, et l’histoire semble s’arrêter là, quand bien même il donne quelques outils pour le dépasser -ce qui revient à affirmer qu’il y a une coupure entre la réflexivité propre à la science historique et la sociologie naissante. Dès lors, on pourrait adresser à l’autrice la question suivante : si la définition d’un sujet de l’histoire semble nécessaire au progrès de la réflexivité des sociétés modernes, pourquoi c’est non pas l’histoire mais la sociologie qui prend le relais, alors même que cette dernière met à mal le concept de sujet de l’histoire pour mieux saisir le rôle de la complexité des sous-groupes et des idéaux correspondants dans le progrès de la réflexivité sociale, comme le fait Mannheim ? L’autrice semble faire ce pas lorsqu’elle affirme que « l’histoire socialiste » qui dépasserait l’histoire libérale est moins une histoire à proprement parler qu’une « science sociale de l’historicité » (p.313). Cela ne signifierait pas pour autant que le rapport au passé serait jugé non pertinent pour la réflexivité sociale, mais que ce dernier devrait être lu à travers les concepts produits non pas au sein de l’histoire mais de la sociologie.
IV.3. – Un libéralisme encore pertinent ?
La question se pose également pour le libéralisme : quelle est sa place dans le progrès de la réflexivité contemporaine ? Si l’autrice défend à plusieurs reprises que cette histoire libérale a été dépassée par la sociologie (notamment sur trois points, résumés dans la conclusion), la persistance de la pertinence de cet apport libéral indique en filigrane que ce dépassement n’a pas été complet. Peut-être faut-il y voir une critique de la sociologie, à la traîne dès lors qu’il s’agit de prendre aux sérieux les nouvelles critiques antiracistes et féministes évoquées dans l’introduction, que ce soit sur le plan des travaux de sciences sociales ou sur celui des institutions universitaires, rétives à l’intégration de ces préoccupations à un tel point que ces revendications n’ont pu pleinement éclore qu’au sein de nouveaux départements ad hoc. Dès lors, l’issue ne résiderait ni dans la disqualification de ces critiques du fait de leurs schèmes libéraux pourtant bien présents, ni dans le simple recueil de ces critiques à cause de leurs présupposés libéraux, mais dans l’intégration de celles-ci dans une théorie sociologique nécessairement plus réflexive que l’histoire libérale. Ceci étant dit, il reste à préciser si la pertinence contemporaine du libéralisme pour la critique ne va pas pour l’autrice au-delà du simple fait de prendre au sérieux ces préoccupations. L’ouvrage ne semble pas trancher la question de manière évidente (p.218)[10].
IV.4. – Une suite nécessaire ?
L’ouvrage, très complet et érudit, est convainquant dans la généalogie qu’il opère, et saura faire sentir au lecteur la façon dont ces schèmes de pensée résonnent encore aujourd’hui dans la critique contemporaine et la nécessité de les dépasser pour laisser place à une critique plus sociologique. C’est pourtant là que résident les deux limites principales de l’ouvrage : la démonstration, pour être pleinement convaincante, ne peut se passer de détailler plus précisément le deuxième terme de la comparaison (la critique contemporaine) et l’horizon vers lequel devrait tendre la critique (la « science sociale de l’historicité » socialiste). L’un comme l’autre n’occupent que quelques pages dans l’ensemble de l’ouvrage. Ce dernier apparait dès lors comme un premier chapitre cohérent et relativement clos, voué à s’intégrer dans une démonstration plus large. C’est parce que le lecteur est conquis qu’il peut attaquer l’ouvrage comme incomplet vis-à-vis des attentes qu’il suscite- curieux retournement du « schème de la conquête » (p.241).
[1] Ce courant historiographique s’attache à étudier les groupes étant dominés au point de ne pouvoir porter un discours public dans la société ou de ne laisser une trace de leur pensée.
[2] L’autrice renvoie à Balibar, alors considéré comme l’expression de cette critique contemporaine. Étienne Balibar et Immanuel Wallerstein, Race, nation, classe. Les identités ambiguës, Paris, La Découverte, 2018 [1988] in Hulak, 2023, pp.13-14.
[3] Incidence, Paris, Éditions du Félin, n°11, Automne 2015.
[4] Les ouvrages de références y sont respectivement cités : Karl Mannheim, « La conscience utopique », in id., Idéologie et utopie (1929), trad. J.-L. Évard, Paris, MSH, 2006, pp.180-188 et Bruno Karsenti & Cyril Lemieux, Socialisme et sociologie, Paris, EHESS, 2017.
[5] L’autrice se concentre toutefois sur les idéaux sociaux, sans les rapporter systématiquement à des groupes sociaux déterminés.
[6] Michel Foucault, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France (1976), Paris, EHESS/Gallimard/Seuil, 1997, pp. 116-118.
[7] Si l’expression « guerre des races » est d’Augustin Thierry, et non de Boulainvilliers, le concept est bien présent chez ce dernier auteur.
[8] Marx reprend le terme dans L’idéologie allemande.
[9] Il semble en cela rejoindre Guizot.
[10] Cf surtout la phrase conclusive de l’ouvrage p.318: « La pensée critique ne peut se réapproprier efficacement l’histoire libérale de la modernité sans tenir compte des altérations fondamentales que lui a apportées l’histoire socialiste. »