L’obscur en soi : la non-dualité du principe
Alexandre Couture-Mingheras, agrégé et docteur de philosophie, est rattaché au Laboratoire de métaphysique allemande et de philosophie pratique (MAPP) de l’Université de Poitiers.
Résumé
Pourquoi le méchant nous fascine-t-il autant ? Sans doute parce qu’il nous conduit au bord de l’abîme, par-delà l’image normée et policée du monde et en-deçà du sens de notre propre identité, restituée à son étrangeté. En prenant pour point de départ la perspective non-dualiste de Georges Vallin – au croisement du néo-platonisme et de la pensée indienne – nous montrons dans un premier temps que la négation du bien dont le méchant est le suppôt doit elle-même être reconduite à une négativité plus originaire, celle-là même de l’absolu. À cet égard la puissance du méchant consiste, par son œuvre de déconstruction, à l’affranchir de son unilatéralité et de sa détermination, c’est-à-dire de la dualité même entre bien et mal. La seconde partie de l’article déploie cette perspective à travers la mystique du mal chez Georges Bataille. La négation, portée cette fois-ci sur le négateur lui-même, ouvre sur ce qui défie toute catégorie et dont l’expérience du mal cherche, par excès et négation des formes, à retrouver l’intimité. C’est dans ce pressentiment de la réalité supra-duelle – de l’ordre de « l’intériorité transcendantale », désindexée de tout moi – que se révèle ce dont la figure du méchant est l’avatar : l’obscur en soi.
Mots-clés : négation, non-dualité, principe, intériorité transcendantale, Soi
Summary
Why does the villain fascinate us so much? No doubt because he leads us to the edge of the abyss, beyond the standardized and policed image of the world and below the sense of our own identity, restored to its strangeness. Taking as a starting point the non-dualist perspective of Georges Vallin – at the crossroads of Neo-Platonism and Indian thought – we first show that the negation of goodness, of which the wicked is the henchman must itself be led back to a more original negativity, that of the absolute. In this respect the power of the villain consists, through his work of deconstruction, in freeing the absolute from its unilaterality and its determination, i.e. from the very duality between good and evil. The second part of the article unfolds this perspective through Georges Bataille’s mysticism of evil. The negation, this time focused on the denier himself, opens up the space for that which defies all categories and whose intimacy the experience of evil seeks, through excess and the negation of forms, to rediscover. It is in this foreboding of the supra-dual reality – of the order of “transcendental interiority”, disconnected from any determinate self – that is revealed what the villain stands for: the obscure in oneself.
Keywords: negation, non-duality, principle, transcendental interiority, Self
« Ils m’appelaient l’obscur, et j’habitais l’éclat »[1]
Introduction : la norme et le neutre
Il est deux façons d’appréhender le méchant. On peut, d’une part, chercher à le comprendre, en le réinscrivant dans une histoire individuelle et collective dont il est autant l’acteur que l’assujetti, bourreau que victime. Il s’agit alors de saisir la série de ses actes à partir de ses causes et raisons supposées. La continuité entre acte présent et histoire passée redouble alors celle qui lui sert d’assise entre « nous » et « eux », en ce que ce n’est pas l’ombre – la « nature » abyssale – mais l’acte seul qui nous distingue. Compris, le méchant se trouve alors restitué à son humaine figure. On peut, d’autre part, chercher à comprendre la fascination qu’il exerce sur nous. Auquel cas, dans ce pourquoi sans réponse pour s’affronter à l’impossible et l’intolérable, il y va moins du méchant que de ce qu’il dit de nous, c’est-à-dire, dans l’expérience même de la fascination, entre crainte et ravissement, précisément en son caractère inexplicable, de cela qui s’éveille sourdement de n’être compréhensible. Car c’est là le savoir abyssal qu’exprime – comme un cri déchirant l’horizon du commun et qui n’a pas de sens autre que son irruption – la « bouche d’ombre »[2], plus ancienne que toute raison. La figure du méchant, comme médiation défigurante, nous ramenant alors à l’obscur sans-visage.
Dans un cas, s’ouvre la voie du sens et de la limite, qu’on appellera la voie de la norme, c’est-à-dire de ce qui est déterminé, particulier, unilatéral, conditionné, duel. Il y a de l’admiration pour ces faux méchants, qui incarnent la liberté à l’égard des normes, la puissance d’un vouloir auto-fondé et se voulant jusque dans la négation de toutes les valeurs. Bouc émissaires d’une positivité dont ils révèlent le fond infondé, ils figurent une possibilité que notre société exclut, fermée qu’elle est sur la possibilité de toute échappée. Sympathique anti-héros, plus éclatant de vérité que le héros conforme pour suivre un bien affadi – la bienséance comme mort du bien – à l’écart du héros profondément singulier des grandes épopées dont L’Iliade ou le Mahabharata nous offrent l’exemple, le méchant, en niant sa contre-valeur, sert un Bien dont sa propre libération à l’égard de la morale du « bien et du mal » est le vif pressentiment. L’appréhension morale se trouve alors confrontée à ses limites, le « bien » héroïque rappelé à sa supercherie, le « mal » antihéroïque au service d’un bien plus grand que le bien socialement établi. Le bien, révélé à sa relativité ainsi qu’à sa propre obscurité, apparaît dès lors comme le nom que porte un mal dissimulé. Car c’est bien en son nom que les pires atrocités ont été commises dans l’histoire des hommes. Le cas de l’inquisition et desdites « sorcières », ainsi qualifiées et ostracisées pour déranger le pouvoir, marginales, mettre en danger les normes existantes, n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de la façon dont une société assure sa conservation : par le partage entre l’ami et l’ennemi, c’est-à-dire par une inclusion qui ne ramène le multiple à l’unité d’un groupe que pour avoir exclu ce qui était perçu comme autre. Si bien que le méchant, par l’à-côté où il se place, est tel que de révéler à l’unité du groupe son illusion et la force de division sur laquelle sa cohérence repose – plus proche de l’idée d’humanité pour être au service d’une justice plus haute que celle avalisée. La dynamique grégaire de normalisation ne vit en effet que de ce qu’elle forclot, de ce qui vient contester sa limite. À cet égard, le méchant figure tout autant le ciment malgré lui du groupe, que celui capable de le mettre en péril, son agent de destruction, heureux « irrégulier » que de révéler par la négation l’absence de fondement des règles instaurées, l’irraison de l’ordre des raisons communes, et de rappeler les « gentils » à leur méchanceté.
Dans l’autre cas, s’ouvre la voie du neutre, en référence à son sens étymologique ne-uter, ni-ni, à la neutralisation des opposés et partant de la dualité même entre les termes. Du reste la norme et le neutre forment un couple : de même que l’infigurable ne saurait s’éprouver hors de la figure qu’il défigure, de même l’approche métaphysique du « méchant » ne saurait-elle s’affranchir de l’homme et de la société dont, exclu ou s’excluant, il ébranle les fondements. Le neutre, au sens qu’il prit avec Blanchot et Bataille, est le nom de ce qui ne se dit qu’à se suspendre, c’est-à-dire de l’hors-normes, de l’inclassable, de l’indéterminé, de l’inconditionné Il est en effet une sombre fascination pour le méchant archétypal, qui ne sert pas ce qu’il croit être un bien ni ne dénonce un faux bien, mais lequel sert volontairement et sciemment le mal dont il se constitue le suppôt. La volonté du mal est pur vouloir du Non-Être, passion du Négatif : il faut détruire, anéantir, soumettre, posséder, avoir – à défaut d’être. La peur mêlée de fascination qu’il suscite, ivresse de l’abîme : le démoniaque sourd du dedans, daïmon inversé que de rapporter les paroles non des dieux, mais des abysses de l’être.
Dans une interview de 1993[3], un an avant d’être assassiné, Jeffrey Dahmer revient ainsi sur l’obscur désir – « l’obsession », qui faisait taire tout autre « sentiment et désir » – qui l’avait assujetti, dans une expérience recherchée qui, de l’ordre de « l’exaltation », à son extrême limite conduisait à sa dépersonnalisation et lui faisait oublier parfois au réveil l’abomination qui s’était plus tôt produite. Dans son « fantasme de contrôle et de domination », l’objectivation de l’autre par la destruction et le cannibalisme en annulait l’altérité, les victimes faisant ainsi « partie » de lui (« they felt part of me »). Il y allait également, confie-t-il, de la « victoire sur la mort ». Le fil unique, si fragile, qui maintient le vivant, cette vie surabondante et pourtant en sa forme si faible, il lui semblait la pouvoir trouver dans la mort, ou plutôt, à l’instar de Gilles de Rais, dans « la mort à l’œuvre »[4], assistant au passage, au « je-ne-sais-quoi » d’un instant où se révèle, se défaisant, le nœud de la vie et de la mort. Voilà l’homme libéré de sa figure qui, dans cela qu’il y a de monstrueux en lui, ne peut plus être soumis à notre mesure et ainsi compris.
Or si cette figure diabolique nous fait frémir d’un frisson « sacré », c’est parce que dans cette négation de l’être il y va d’un rapport à l’être. Inversion du principe, image se donnant pour être ou centre particulier prenant la place du centre universel – la subordination de la volonté universelle à la volonté du particulier –, le méchant est celui par qui « l’ombre transcendantale » se cherche une place et croît en « l’ombre empirique »[5] de nos actes et plus secrètes pensées, celui qui révèle la « réalité » à sa négativité et les phénomènes à leur vacuité.
I. « La nuit est aussi un soleil »[6]
Si Shiva a pu être considéré au XIXe siècle par orientalistes et philosophes comme une figure paradoxale car divine du « mal » – lui qui, ami des marginaux et hors-la-loi, est à l’instar de Dionysos l’hors-normes[7] – c’est parce qu’il symbolise, en prenant place dans la Trimurti aux côtés de la puissance créatrice de Brahma et de celle, préservatrice, de Vishnu, la puissance pure de destruction. Puissance terrible en ce qu’elle ramène toute forme limitée d’être, qui se prétend séparée, à la nuit de l’indéterminé, et que dans le vide du non-manifesté elle résorbe ce qui se manifestait de se croire « autre ». Si bien que la négation elle-même se trouve libérée de sa négativité, de même que la position de sa positivité. La négation devient la puissance suprême du dieu en ce qu’elle défait l’illusion même de ce qui avait été établi et préservé : elle révèle la positivité à sa vacuité. S’ouvrant, l’oeil de connaissance (jnanadrishti) entraîne la dissolution du monde, c’est-à-dire du monde comme altérité, ce « comme » ayant été exhibé comme tel au lieu même – proprement apocalyptique – d’auto-révélation plénière du dieu. En son œil immobile on entre comme en un trou noir duquel nul ne ressort plus pour n’être plus personne qui en puisse réchapper. Demeure, seul, le Soleil noir de la Réalité.
Il faut risquer l’obscurité et en assumer la « part maudite » pour sortir des ténèbres. Sans la puissance du non-être, le mal comme négatif de l’être, c’est la semblance d’être qui se trouve condamnée à son illusion. Dans le feu purificateur de la négation, ordre factice et harmonie de surface s’effondrent, laissant apparaître le chaos, l’injustice, la sottise, la mauvaise foi et la lâcheté, dont ils étaient eux-mêmes l’occultation. Lorsque la lumière se croit assurée de soi, la voilà renvoyée à son ombre. Si la sagesse obéit à une loi plus haute que celle, normative, des hommes, alors on peut affirmer à bon droit que la « morale se moque de la morale »[8].
Dans son article « Réflexions sur la sagesse et la révolte »[9], Georges Vallin oppose la sagesse « superficielle » et « vulgaire », qui est celle du ritualisme et de la bienséance – ainsi du conformisme social du confucianisme, « aisément pharisien » – à la sagesse véritable, au-delà des conventions – ainsi du taoïsme –, irréductible à toute appréhension moralisante en termes de « bien » et de « mal ». La première est conservatrice voire réactionnaire : elle agit au nom d’une norme établie en Loi, d’un socle de valeurs établies en Bien, d’un sentiment de soi – suffisance d’un ego qui se complaît dans son ascèse et se trouve magnifié –, paré d’une humilité à laquelle lui-même paraît croire. La seconde, révolutionnaire, détruisant toute fixation en une forme déterminée, toute crispation identitaire, transcende l’opposition pour intégrer le négatif, le « mal » dans le principe. « Aussi bien le sage ne saurait-il se poser comme le champion de la conservation indéfinie des formes : il ne peut pas ne pas avoir conscience de la nécessité de leur transformation et de leur déclin »[10]. Car au-delà de la « puissance créatrice et conservatrice », qui est celle du Dieu du monothéisme chrétien, il fait droit à la « puissance destructrice ou transformatrice »[11] du principe. La mythologie du dieu méchant
détruit le héros tragique innocent : le « destin » apparemment aveugle, implacable et cruel, n’est ici qu’une expression de cette puissance du négatif qui ramène la détermination séparative à son essence véritable, par-delà l’oubli et l’affirmation de soi dans lesquels elle avait tendance à s’enfermer (…).[12]
Autrement dit, c’est parce que l’individu à titre d’illusion de « réalité autonome et séparée » est institué à même la « négation originelle posée au cœur de l’absolu »[13] qu’une nouvelle négativité vient à se déployer à son encontre. Le méchant en niant les formes limitées de l’être et des « valeurs auxquelles son expérience le confronte », par sa « violence rageuse et destructrice de sa négation » dévoile leur « fondamentale précarité » et leur « caractère finalement illusoire ». Le mal apparaît ici au sommet paradoxal de la sagesse par le détachement qui est le sien – certes sous forme de négation – à « l’égard des apparences et des fausses harmonies empiriques ». En desservant le bien, il en sert un plus grand, le plus haut qui soit pour s’excepter de l’opposition. Aussi le négatif affranchit-il le principe des limites dans lesquelles la « conscience pharisienne » l’enfermait : le mal, sans peras, est bien l’agent d’illimitation de la limite, la mise à « mort de Dieu » comme libération de « l’idée » de Dieu et, partant, de son contre-terme, l’égoïté. Pour peu toutefois que le « méchant » poursuive jusqu’au bout son entreprise de destruction, et qu’il se prenne désormais pour cible, dans le vide de sa subjectivité, progressivement délestée « d’elle-même » : alors sera-t-il conduit
par-delà la négation des valeurs et de toutes les formes d’ordre auxquelles sa moderne aventure le confronte, à retrouver ce sens de l’Unité qui se profile inéluctablement derrière toutes les formes et au terme de ses révoltes les plus extrêmes (…).[14]
D’où cette intensité du méchant qui, brisant limites et normes, conduit l’immanence, comme écrasée sur elle-même, à son effondrement dans le sans-fondement de l’apparence de fondement – évidence « naturelle » – de laquelle elle se soutenait. Par l’effroi qu’il incarne pour révéler l’abîme – le sans-fond, le sans-raison, l’inintelligible, l’incompréhensible –, le méchant met la caverne en crise. Dans la nuit de l’oubli, la réalité du phénoménologique se clôt sur elle-même et, jetant le voile, recouvre son néant ontologique. Mais dans la nuit du crime, c’est le néant du phénomène qui se trouve remonter à la surface.
Le mal, porté à son faîte suprême, comme agent du Vide et du Néant, inhérent au Vide supra-essentiel ou Nirguna Brahman, dont il procède, révèle, par sa négation, la vacuité inhérente au monde et au moi. Le négatif oeuvrant ainsi que de reconduire de l’obscurité du monde à l’obscurité de cela qui, n’étant rien de déterminé (no-thing), ni ceci ni cela (ne-uter ou neti-neti) transcende la dualité même du positif et du négatif, de la plénitude et de la vacuité, négation supérieure en somme pour libérer le « sujet » de toute détermination prédicative[15].
Il ne faudrait donc pas se laisser tromper par l’apparente dissolution de la figure du méchant par ce qui en constitue l’unique racine. Si sa figure sert d’antithèse rassurante à nos propres yeux, assurés de notre bonté, dans le cadre normatif de toute société, il se pourrait que ce soit pour avoir fui notre propre ombre, qu’il vient à réveiller de sa nescience, amenant au jour ce qui dort d’un sommeil dogmatique à s’éveiller à ce qu’il y a de plus obscur et profond en soi. Car c’est là où il y a ignorance de soi, crainte et rejet, que se tient le « monstre », l’hors-normes vérité de soi – l’identité numineuse de la coincidentia oppositorum -, dans l’ombre de laquelle le « moi » entrevoit sa propre fin.
La relativité du mal au bien se renverse alors : le mal comme puissance de négation délivre le bien de lui-même, c’est-à-dire de sa déterminité et de son unilatéralité. C’est cette négativité originelle de l’Absolu que le mal, ressaisi dans sa pure force de destruction, recueille, et dont l’écho ténébreux résonne en l’ombre de chacun. Le méchant fascinant que d’annoncer les cimes à même les abysses, le suprahumain à même l’inhumain.
II. Le suprême négatif et « l’imposture de la réalité »
Comment échapper en effet du dedans à la caverne s’il n’est une négation qui ne la révèle à elle-même et ne s’applique à détruire les formes assurées d’elles-mêmes en leurs rassurantes limites ? La « spiritualité » du mal tient à sa supériorité sur un « bien » relatif et satisfait de soi, bien qui, jamais totalement bon pour apparaître, comporte en soi une ombre, point aveugle à partir duquel précisément il s’établit comme tel. Le révolté n’amène pas tant à la crise qu’il ne la révèle, renvoyant la justice à son injustice et l’existence à sa profonde aliénation.
Ce que Bataille appelle « l’hypermorale » ou la « morale du sommet »[16], se caractérise en effet par son éminence ou sa « souveraineté » : tandis que la « morale du déclin », qui engendre les règles de morale et de bienséance, est conservatrice, attachée qu’elle est à la forme et à la limite, le « sommet moral », dont la logique est celle de l’excès, de l’intensité, de la dilapidation, du sacrifice qui « porte au maximum l’intensité tragique »[17], déforme toute forme et illimite la limite. Au bien affadi et fixe du « monde des adultes »[18], des règles et de la raison artificielle, s’oppose la « monstruosité de l’enfant », souverain que de n’obéir à aucune instance extérieure à soi et de soumettre toute positivité à son œuvre de destruction – qui est donc, tout autant, de dévoilement du négatif.
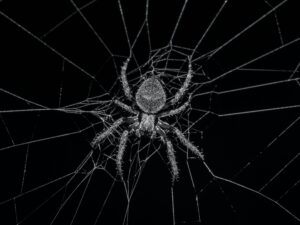 La négation en niant le positif révèle son néant, secouant la raison la reconduit à son abîme. Ayant plongé en son ombre, le mal peut révéler au bien la sienne propre, de sorte que révélant la morale à sa relativité, et le « bien » à sa duplicité, dans son œuvre de destruction il conduit à ce qui, en soi, excède toute opposition. Il s’agit du reste d’une négation « sans emploi »[19] et sans « relève » (Aufhebung), et non pas dialectique comme chez Hegel – « le » philosophe de Bataille, génie ultime de « l’intelligence positive »[20] – puisqu’elle ne produit rien, son œuvre consistant au contraire à défaire et, poussée jusqu’au bout, à défaire celui-là même qui défait, si bien que la négation se niant elle-même nie et le positif et le négatif. Il y va non d’une négation productrice, portée par la contradiction, mais d’une négation neutralisante, qui libérant l’opposé de son illusion affranchit de l’illusion même de contradiction.
La négation en niant le positif révèle son néant, secouant la raison la reconduit à son abîme. Ayant plongé en son ombre, le mal peut révéler au bien la sienne propre, de sorte que révélant la morale à sa relativité, et le « bien » à sa duplicité, dans son œuvre de destruction il conduit à ce qui, en soi, excède toute opposition. Il s’agit du reste d’une négation « sans emploi »[19] et sans « relève » (Aufhebung), et non pas dialectique comme chez Hegel – « le » philosophe de Bataille, génie ultime de « l’intelligence positive »[20] – puisqu’elle ne produit rien, son œuvre consistant au contraire à défaire et, poussée jusqu’au bout, à défaire celui-là même qui défait, si bien que la négation se niant elle-même nie et le positif et le négatif. Il y va non d’une négation productrice, portée par la contradiction, mais d’une négation neutralisante, qui libérant l’opposé de son illusion affranchit de l’illusion même de contradiction.
Car si « l’envers est aussi le coeur de la vérité »[21], de quelle sombre vérité se trouve alors porteur l’excès du mal ? La « fusion des êtres »[22], la dé-limitation des formes individuées. Mais plutôt que de suivre la voie de l’implosion, maturation progressive qui conduit l’égoïté à faire l’épreuve de sa vacuité et partant à se mettre en quête de son centre véritable, qui est la voie du « dedans » comme l’appelait Rûmî, le méchant suit celle de l’explosion, destruction externe qui, creusant « l’impossible et l’envers de la vie »[23], cherche à même la mort des formes de vie à saisir sur le vif de son trépas la vie même. Ne pouvant échapper à un ordre qui l’écrase et en résorbe la différence ou se le subordonne, le méchant, comme pour libérer la vie impuissante en lui, ne trouve en effet de solution pour échapper à ses propres limites que de nier celles des « autres » :
Il n’est qu’un moyen en son pouvoir d’échapper à ces diverses limites : la destruction d’un être semblable à nous ; dans cette destruction, la limite de notre semblance est niée ; nous ne pouvons en effet détruire un objet inerte, il change, mais ne disparaît pas, seul un être semblable à nous disparaît dans la mort. La violence subie par notre semblable se dérobe à l’ordre des choses finies, éventuellement utiles : elle le rend à l’immensité.[24]
La violence, en niant les êtres en leur détermination, ouvre à la nuit, insaisissable, de l’indéterminé, au « rien » ou « vide » qui est, dans l’intégration des opposés, « plénitude impersonnelle »[25]. Aussi la mort, trahissant « l’imposture de la réalité »[26] comme délimitation et extériorité partes extra partes des êtres, reconduit-elle à l’intériorité ou « immensité immanente, où il n’y a ni séparations, ni limites ». Alors que notre regard ordinaire est chargé du sens de la séparation et prête peu d’attention « au passage de l’être d’une forme à l’autre », le regard plongé dans les abysses de la mort cherche à retrouver ce sens de l’intériorité ou immanence transcendantale[27], de laquelle l’homme, être de réflexion et de scission, est en apparence séparé.
Notre infirmité veut que nous connaissions les autres comme s’ils n’étaient que des dehors, mais ils ne sont pas moins que nous de l’intérieur. Si nous envisageons la mort, le vide qu’elle laisse obsède en nous le souci personnel, alors que le monde est seulement composé de pleins. Mais la mort irréelle, laissant le sentiment d’un vide, en même temps qu’elle nous angoisse nous attire, car ce vide est sous le signe de la plénitude de l’être. [28]
La nuit du crime, fût-elle profonde, « aspire à l’éclat du soleil »[29]. D’où cette paradoxale recherche par le mal qui avoisine celle de l’essence de la religion que Bataille définit comme la « recherche de l’intimité perdue », de ce qui « a l’emportement d’une absence d’individualité, la sonorité insaisissable d’un fleuve, la vide limpidité du ciel »[30]. Passant de l’être déterminé à l’être neutre supra-formel par l’œuvre au noir de la destruction, le méchant trouve ainsi, à même sa négation, le Suprême Négatif par-delà l’opposition établie par la « morale du déclin » entre le sacré et le mal, ce que Bataille nomme le « sacré noir »[31]. Si le sacré se caractérise par la dissolution des déterminations particulières des êtres dans l’indéterminé et l’illimitation de la limite, alors il se révèle en toute son ambiguïté, entre ténèbres et lumières, entre terreur et plaisir, dans la fascination de l’homme pour le mal[32], le désir du Terrible.
En effet, le pécheur[33] avoisine le saint pour chercher la vérité de l’être hors des voies moyennes et subvertir l’ordre, révélé à la contingence de son ordonnancement. Entre la morale commune et le mal, il est la distance que creuse le rapport à l’infini, le second libérant ce que la première avait forclos par son rejet de « l’être au-delà de lui-même, à la limite du néant »[34]. Ennemi du « principe », du « monde » et du « moi », le méchant, en niant en effet nie la déterminité et la dualité où ils se trouvaient confinés, et partant nous conduit à l’extrême limite de l’expérience, au-delà et avant qu’elle ne devienne humaine : dans l’inhumain, le suprahumain. Le mal, métaphysiquement ressaisi, annule ainsi tout essai d’anthropologie du mal pour se donner dans l’absentement de la figure de l’homme – pour être sans-visage. Mais c’est pour autant que le principe ait lui-même été libéré de sa figure, affranchi de son repli sur l’un des termes de l’opposition, bref que, restitué à son ombre comme l’homme à sa « part maudite », il ait cessé d’être le nom d’une limite – l’Autre que Soi.
III. La neutralisation supra-duelle
« Je puis dire aussi de cette chose, impure et répugnante, qu’elle est divine, mais l’admettre suppose entendu le principe de l’ambiguïté du divin, qui ne diffère pas en principe de l’ambiguïté du sacré »[35]. Si Bataille poursuit une « mystique du mal », c’est non toutefois pour avoir comme on pourrait le croire sacralisé la chair et par simple renversement subversif, typiquement sadien, ramené le supra à l’infra, le ciel aux enfers. Car, à l’inverse d’une telle inversion, tributaire de ce qu’elle inverse et partant de la limite qu’elle transgresse, il y va ici non tant d’une dévaluation des valeurs que de la neutralisation radicale de leur opposition, de l’effacement de la frontière entre l’endroit et l’envers, inaugurant l’entrée dans l’ouvert du sans-limite, non amalgame du saint et du pécheur, confusion procédant d’une conscience encore naïve, attachée à la forme de ce qu’elle déforme, mais bien ambiguïté constitutive du sacré pour être celle du principe lui-même.
Si le sensualisme de Sacher-Masoch se mêle à l’extase spirituelle de Sainte Thérèse d’Avila, et les ténèbres du « méchant » à la « nuit noire » de saint Jean de la Croix, c’est parce que la sensualité se découvre portée par le supra-sensuel qui l’excède et que l’auto-négation, y compris en son humanité, fait résonner ce qui se dessine à effacer toute humaine figure. La relève du sujet de la limite – le « moi » comme auto-limitation – arrachant alors les valeurs, relatives et oppositives, à leur limitation. Le « moi », dans l’épreuve de son néant, éprouve le néant de toutes les valeurs : la souveraine valeur, en soi, indéterminée, advient dans l’implosion des valeurs, pour soi, déterminées. Rien n’a de valeur : le nihilisme, ici porté à son acmé, ayant outrepassé son stade inférieur, réactif, s’avère ainsi constituer l’envers de l’absolutisme. L’ici, révélé à son là-bas, s’évanouit comme cela qui jamais ne fut.
C’est cette puissance d’annihilation, qui libère le principe de son unilatéralité, dont le mal est porteur. Quoique le sacré « noir » ne soit certes pas identique au sacré « blanc », il n’en reste pas moins « sacré » du fait, en dernière instance, de l’identité supra-duelle dont il procède et dont il a fait de son œuvre de négation de l’être le lieu de désoccultation. Mais si chez Bataille le bien ne s’oppose pas tant au mal qu’il lui est subordonné, comme la limite à son au-delà illimité, et si au mal revient la souveraineté, au bien la relativité et la fixité, c’est parce que le « bien », à l’instar de « Dieu », loin de renvoyer à l’infini, est le nom même d’une limite. Pour ouvrir le principe à sa non-dualité, il faudra donc détruire le nom de ce qui est encore limité, passer à une « théologie sans Dieu » ou à un « hyperchristianisme », hyper que d’avoir intégré son « autre » et de s’accomplir en se dépassant.
En effet, quel est ce Dieu qui, « pur », exclut de soi l’impur, la corruption, la culpabilité, le vice et la colère, sinon un Dieu amputé, fait à l’image de l’image que les hommes se font d’eux-mêmes ? Car c’est dans ce ou bien ou bien exclusif, celui de la limite, où le choix entre les valeurs implique une exclusion – le reliquat du non-choisi – que se meut la conscience « ordinaire » régie par la « morale du déclin ». Le « sommet » suppose au contraire la totale intégration de « l’autre », non intégration unilatérale par repli d’un terme sur son opposé, qui est dénégation, mais intégration supra-duelle par libération des termes de leur opposition, qui, de l’ordre du ni-ni (neuter), est neutralisation.
« Dieu n’est rien, s’il n’est pas dépassement de Dieu dans tous les sens »[36]. Le coup de maître de Bataille consiste alors à « élargir la possibilité de Dieu jusqu’à son impossibilité »[37], faisant ainsi du mal le ressort de la révélation du principe en sa non-dualité. Le principe, ni noble ni vulgaire, ne constitue pas tant le « le contraire du mal ou du laid » que celui de « la chose », c’est-à-dire du règne de l’extériorité comme « forme expressive de sa servitude », c’est-à-dire le règne des « nécessaires vulgaires de la vie, qui ordonnent un monde de choses et, dans ce monde, des hommes traités comme des choses, réduits à la valeur utile, à la fonction ». Si le principe « contre l’ascèse est que l’extrême est accessible par excès, non par défaut »[38], alors est-ce au mal, dionysiaque, que revient le privilège, dans la pure dépense, gratuite et sans raison, de rompre avec le « cours habituel des choses »[39] et, de là, d’ouvrir le passage à l’au-delà de la limite, limite qui, dans l’épreuve de sa négativité, se trouve alors délivrée d’elle-même[40] : « Là toute possibilité s’épuise, le possible se dérobe et l’impossible sévit. Être face à l’impossible – exorbitant, indubitable – quand rien n’est plus possible est à mes yeux faire une expérience du divin ; c’est l’analogue d’un supplice »[41].
IV. La levée du « moi » : l’expérience pure
Aussi est-ce dans l’épreuve la plus extrême de dépossession de soi que l’idée de « moi » et de « Dieu » se trouve neutralisée et éprouvée la preuve de la non-dualité des termes. Il y va en effet d’une déconstruction hyperbolique, laquelle, loin de progresser du « moins » vers le « plus », par « amélioration » de soi ou « développement personnel », régresse vers l’auto-affirmation du « plus » dans un « moins » révélé à son illusion. Car la négation ici engagée, bilatérale, portant en retour sur le négateur même, neutralise celui qui se croyait « pur » ou « impur » en le ramenant à la vérité impersonnelle dont sa persona était l’occultation.
Cet œil qui, pour le contempler, dans sa nudité, seul à seul, s’ouvre sur le soleil dans toute sa gloire, n’est pas fait de ma raison : c’est un cri qui m’échappe. Car au moment où la fulguration m’aveugle, je suis l’’éclat d’une vie brisée, et cette vie – angoisse et vertige – s’ouvrant sur un vide infini, se déchire et s’épuise d’un seul coup dans ce vide. [42]
L’expérience pure[43], tel est le nom que Bataille donne à cette épreuve. Si l’expérience ordinaire est déterminée et intentionnelle, portée sur un « objet », qu’elle est de l’ordre du quoi, l’expérience pure, de l’ordre du cela[44], hors-normes, indéterminée et inclassable, porte au contraire « sur » l’inconnu ou le suprême indéterminé pour reconduire le sujet à l’au-delà de sa déterminité et de sa finité, c’est-à-dire pour remonter la pente de l’intentionnalité vers la vérité inobjectivable de Soi. S’il faut certes partir de l’expérience, rien que de l’expérience, c’est pour autant qu’elle est radicale en rétrocédant en amont de ses conditions vers la racine supra-duelle qui en constitue tant l’origine absolue que la fin. Ces dernières, qui rendent possible l’expérience comme expérience duale de soi et du monde, la soustraient d’un même geste au noyau indéterminé, à son excédent. L’expérience « impure », révélée à son pseudo-savoir, se trouve alors reconduite à son inexpérience.
C’est une sottise épuisante que, là où, visiblement, tous les moyens manquent, l’on prétende cependant savoir, au lieu de connaître son ignorance, de reconnaître l’inconnu, mais plus triste est l’infirmité de ceux qui, s’ils n’ont plus de moyens, avouent qu’ils ne savent pas, mais se cantonnent bêtement dans ce qu’ils savent ». Et en effet, « celui qui sait déjà ne peut aller au-delà d’un horizon connu (…).[45]
Afin de libérer le savoir de la limite, il le faut révéler à son non-savoir absolu, et dans l’absentement de toute limitation – le « connaissable » n’étant tel que d’être pourvu de déterminations –, faire le sacrifice de toute idée et de tout concept, si bien que le non-savoir se trouve établi en « axiome » pour révéler l’apparent savoir à son mensonge.
Si l’Avidyā, ignorance métaphysique dont la caverne est le symbole topique, est en effet un savoir apparent, l’Agnosia – la privation de la Gnosis, du savoir – ou non-savoir absolu, dans la Suprême Obscurité, se réfère tant au processus de non-savoir (unknowing) de désapprentissage de ce que l’on croyait jusqu’alors savoir qu’au principe en tant que, supra-essentiel, il précède tout savoir. Héritée en effet du mysticisme chrétien et de la théologie négative[46], elle engage un dépassement de toute détermination et entente duelle du principe, conduisant la négation à se nier elle-même. C’est pourquoi elle conjoint d’un côté l’épreuve de neutralisation de toute représentation du « monde » et de « soi » – qui n’est telle que depuis le point de vue de celui qui n’a pas encore été abîmé – et de l’autre la neutralisation de toute « idée » du principe. À ce titre elle figure l’antidote de l’ignorance métaphysique, le non-savoir guérissant de l’ignorance, l’expérience pure n’étant donc telle que de reconduire, après purification, du savoir apparent au non-savoir de l’absolu.
Extrême sans fin ni sens, l’expérience purifiée de son pseudo-savoir se trouve restituée à la pureté de sa vérité supra-duelle, par-delà l’illusion du sujet (connaissant) et de l’objet (connu), et partant par-delà la dualité du « moi » et du « principe », « l’un et l’autre » ayant « perdu l’existence distincte »[47]. Le langage disposant de la puissance de dire, en son dualisme, ce qui est dédit de se dire, de « traduire » le non-duel dans l’oxymorique « conjonction des opposés ». En effet, si l’expérience ordinaire est celle de « spectateurs qui toujours » regardent « les choses, et jamais Ce qui regarde »[48], comme l’écrivait Rilke, que notre conscience, orientée vers le monde des « choses » et identifiée au « moi », vit dans l’oubli d’elle-même comme l’œil qui s’oublie comme principe d’ouverture du champ visuel – mais « qui nous a donc retournés comme cela ? », interroge le poète – alors l’expérience pure, par l’opération inverse, proprement régressive, restitue le principe à sa supra-dualité. L’insaisissable ne saisissant que le moi de se laisser dessaisir, la conscience prenant conscience d’elle-même à condition de se défaire de tout contenu et du « moi » qui, s’étant cru « propriétaire » de la conscience, s’en révèle n’être qu’un « habitant ». « Le moi n’est libéré que hors de soi »[49], si bien que l’expérience pure est également qualifiée d’intérieure que d’advenir à même l’abolition radicale de l’illusion de séparation du principe, du monde et du moi : faisant « reculer un peu plus les bornes du cœur, les bornes de l’être, elle détruit en le dévoilant le fond du cœur, le fond de l’être »[50].
En effet, la double neutralisation de l’idée de « moi » et de l’idée de « Dieu » délivre l’intériorité de son appréhension égocentrique, c’est-à-dire du « moi » qui s’en croyait constituer la substance : intériorité « cosmique » – ou intériorité transcendantale – que de n’être celle de personne et de n’être l’envers d’aucun absolu dehors. Car cette expérience, sur laquelle l’intelligence analytique et classificatrice se brise, constitue un « voyage au bout de l’homme » et que loin d’indiquer une limite – « mon » intériorité – elle dit l’effacement même du propre. « Dans l’expérience, il n’est plus d’existence limitée. Un homme ne s’y distingue en rien des autres »[51]. Délivré de l’instance égotique – « délivre-moi de moi, je ne veux plus l’être »[52] – et délivré de « Dieu », demeure cela qui, refluant du vu au voyant, se tient, point dans le cercle, au centre du Soleil du Soi, non du moi, du « sujet s’isolant du monde », mais du Soi « lieu de communication »[53].
Ainsi l’expérience pure, « nue, libre d’attaches »[54], constitue une « expérience limite », non au sens du passage à la limite mais comme anéantissement de son illusion. Si bien que, loin de renvoyer à un « type » d’expérience, qui s’opposerait à l’expérience commune, elle rappelle l’expérience dite « ordinaire » à son essence métaphysique. L’empirisme métaphysique[55] ne désigne pas une expérience métaphysique mais toute expérience à son sommet métaphysique et dont « l’ordinaire » est le reflux dans l’oubli, c’est-à-dire en ce qui la fait proprement être une Erfahrung, un voyage qui emporte dans la vision nouvelle de ce qui est le voyant lui-même.
« Qui ne ‘’meurt’’ pas de n’être qu’un homme ne sera jamais qu’un homme »[56]. Le mal souverain nous détourne certes : mais c’est un détour qui est retour au Suprême Obscur en soi, c’est-à-dire, par l’épreuve du négatif de l’Absolu, plus fidèle au principe pour ne le soumettre à notre regard, la terrifiante, inhumaine, sublime vérité supra-duelle de Soi.
Conclusion : le « méchant » et Soi
« Celui qui connaît le Soi rejette loin de lui et le mal et le bien »[57]. Mais si le mal, ici appréhendé en son caractère hors normes, a le pouvoir de faire vaciller la caverne par l’explosion des déterminités, il ouvre seulement, dans l’écart et la négation, sur l’indéterminé sans l’être : méchant, et non neutre.
D’une part, il demeure prisonnier de sa dualité dans le choix qu’il fait du négatif. Non pas, comme on l’a vu, que le négatif soit « mauvais » en soi. Car de même que l’instrument ne préjuge pas par soi de l’usage qui en sera fait, de même la force de négation rapportée à son principe n’en est pas moins essentielle que celle, positive, de création. Mais son choix exclusif du mal, son rapport autrement dit à l’ombre destructrice dont la manifestation est, que de se manifester, porteuse – ce qui apparaît disparaît – porte le poids d’une liberté (la « possibilité » du mal) faite nécessité. Jeffrey Dahmer, relâché, aurait récidivé de son propre aveu.
D’autre part, le hiatus entre l’indéterminé – vacuité pleine – et la surdétermination et le sur-conditionnement du « méchant », tyran que d’être esclave de ses désirs et pensées, écart qui de l’intensité offerte par la destruction fait le moyen d’une libération, passagère, de soi, est proprement, comme scission, l’épreuve même de la souffrance, laquelle n’est pas extérieure à l’ego mais lui est structurelle. Il n’est pas de moi « heureux ». Le mal-commis s’origine dans le mal-être, c’est-à-dire nie toute vie que de nier la vie en soi.
Croire toutefois qu’il est une différence entre « nous » et le « méchant » procède d’un tel oubli en ce que le « méchant », qui porte un nom de division, n’a d’existence que dans l’opposition. En effet, la conscience duelle atteste de son ignorance quant à sa nature véritable. Ne peut la fasciner que ce à quoi elle prête une existence, et c’est pour n’avoir pas soulevé son voile, intégré sa propre ombre, que l’ombre du mal l’appelle encore. Le « méchant » est certes tel que de s’oublier, mais celui qui croit au « méchant » – au « diable » – n’en fait pas moins partie des « meurtriers du Soi »[58].
J’ai compris brusquement l’histoire ancienne que m’avait racontée Adrien, de ce Karmapa tibétain s’inclinant devant ses bourreaux, pour la raison qu’il voyait en eux – au-delà de leur déviance présente et de leur ignoble brutalité – cette qualité de Bouddha dont ils étaient, malgré eux, une manifestation – et qui, à ses yeux, rayonnait d’un insoutenable éclat au fin bout de la chaîne de leurs incarnations (…).[59]
D’où l’invitation donnée à voir nous aussi en soi et au-delà, à appréhender selon la non-dualité toute forme comme « son propre Soi »[60]. Par-delà bien et mal.
[1] Saint-John Perse, « Du Maître d’astres et de navigations », Amers (1957), Paris, Gallimard, 2004, p. 36.
[2] L’expression provient d’un poème de Victor Hugo tiré des Contemplations, « Ce que dit la bouche d’ombre ».
[3] https://www.youtube.com/watch?v=iWjYsxaBjBI.
[4] Georges Bataille, Le Procès de Gilles de Rais, plumitif latin traduit par Pierre Klossowski, introduction de Bataille, Paris, Pauvert, 1965, p. 13.
[5] La négativité inhérente aux actes faisant signe vers une négativité plus originaire, ce que cherche à traduire la distinction entre ombre empirique et ombre transcendantale.
[6] Friedrich Nietzsche, « Le chant d’ivresse », Ainsi parlait Zarathoustra. La citation ouvre L’expérience intérieure de Bataille.
[7] Alain Daniélou, Shiva et Dionysos. La religion de la Nature et de l’Eros, de la préhistoire à l’avenir (1979), Paris, Arthème Fayard, 1991. Évidemment l’association au « mal » est un contre-sens complet, ce que Schelling avait bien vu. Mais elle révèle dans sa mécompréhension quelque chose d’essentiel. Voir leçons 20 à 22 dans Schelling, Philosophie de la mythologie, tr. fr. A. Pernet, suivi de François Chenet, Schelling et l’Orient, Grenoble, Jérôme Millon, 2018.
[8] Blaise Pascal, Pensées, opuscules et lettres, Paris, Garnier, 2011, fragment 220 (éd. Sellier), p. 671. Il s’agit évidemment d’un détournement de la formule initiale, portée sur la différence entre morale du jugement et morale de l’esprit.
[9] Georges Vallin, Lumière du non-dualisme, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1987.
[10] Ibid., p. 134.
[11] Ibid., p. 136.
[12] Ibid.
[13] Ibid., p. 137.
[14] Ibid., p. 138.
[15] Ibid., p. 158 : « Le Vide du Non-Être exige en effet, en vertu de son Infinité intégrale, que la négation de l’Infini qui semble posée et cristallisée en dehors de lui dans la multiplicité des formes séparées, existe en quelque sorte au niveau de l’Absolu lui-même. Le Vide du Sur-Être exige, en vertu de son illimitation interne, sa propre négation ou sa manifestation ».
[16] Georges Bataille, La littérature et le mal, Paris, Gallimard, 1957, avant-propos.
[17] Georges Bataille, Discussion sur le péché (conférence et discussion du 5 mars 1944), présentation de Michel Surya, Paris, Lignes, 2010, p. 54.
[18] Georges Bataille, Les Larmes d’Éros, Jean-Jacques Pauvert, Paris, 10/18, 1961/1971, p. 16.
[19] Georges Bataille, Discussion sur le péché, (conférence et discussion du 5 mars 1944), présentation de Michel Surya, Paris, Lignes, 2010, p. 35.
[20] Georges Bataille, L’expérience intérieure, Paris, Gallimard, 1943, p. 128, note.
[21] Georges Bataille, Les Larmes d’Éros, op.cit., p. 92.
[22] Ibid., p. 53.
[23] Ibid., p. 91.
[24] Ibid., p. 93.
[25] Ibid., note p. 120.
[26] Georges Bataille, Théorie de la religion, Paris, Gallimard, 1973, p. 63.
[27] La question de l’immanence transcendantale ou « intériorité cosmique » est ici introduite, pour ainsi dire, par son « pli » ou son « négatif ». Elle résulte de la déconstruction de la précompréhension de la réalité comme réalité chosale et de la conscience comme simple ouverture sur une réalité qui la précèderait. Autrement dit, il s’agit de repenser l’en-soi comme Soi. Le développement de cette idée, qui renvoie dos à dos le « mythe de l’intériorité » et ce qu’on pourrait appeler le « mythe de l’extériorité », nous conduirait ici trop loin.
[28] Ibid.
[29] Georges Bataille, Le Procès de Gilles de Rais, op.cit., p. 13.
[30] Georges Bataille, Théorie de la religion, op.cit., p. 68.
[31] Ibid., p. 97.
[32] Bataille était fasciné par le supplice chinois dit des « cents morceaux ».
[33] Voir Michel Surya, Sainteté de Bataille, Éclat, 2012.
[34] Ibid., p. 57.
[35] Georges Bataille, Œuvres complètes, T. 8, Paris, Gallimard, 1976, p. 250.
[36] Georges Bataille, L’Érotisme, Œuvres complètes, T. 10, Paris, Gallimard, 1976, p. 262-263.
[37] Takuji Iwano, « La divinité chez Georges Bataille », The journal of Humanities, Meiji Univ., vol. 15, 2009, p. 33.
[38] Georges Bataille, L’expérience intérieure, op.cit., p. 34.
[39] Georges Bataille, Les Larmes d’Éros, op.cit., p. 55.
[40] Bataille prend le contre-pied du Yoga qui, comme ensemble de « grossières recettes, agrémentées de pédantisme et d’énoncés bizarres », n’est « qu’une esthétique ou une hygiène ». Mais l’attaque elle-même est en un sens ludique. « Mais je sais peu de chose, au fond, de l’Inde… ». Voir L’expérience intérieure, op.cit., p. 28-30.
[41] Ibid., p. 45.
[42] Ibid., p. 92.
[43] « Concept » central du monisme neutre, qui est moins une « doctrine » que la perspective non-duelle déployée en Occident au tournant du XXe siècle autour d’une constellation d’auteurs, de Mach et Avenarius à Deleuze. Comme l’indique le terme, le monisme, neutre que de se neutraliser lui-même comme « monisme bilatéral » – l’un à l’exclusion du multiple –, fait signe vers la réalité en tant qu’elle est non-duelle, par-delà la dualité du sujet et de l’objet.
[44] L’opposition chez William James – qui court des Principles of Psychology jusqu’aux Essais d’empirisme radical – entre what et that recoupe celle entre ce qui est déterminé et objectivé (le quoi) et ce qui est indéterminé et inobjectivable (le cela).
[45] Georges Bataille, L’expérience intérieure, op.cit., p. 119.
[46] Lexique de provenance néo-platonicienne et qu’on retrouve notamment chez Denys l’Aréopagite. Voir sa Théologie mystique, in Œuvres complètes, Paris, Aubier, 1943, p. 177 : « C’est dans le Silence en effet qu’on apprend les secrets de cette Ténèbre dont c’est trop peu dire que d’affirmer qu’elle brille de la plus éclatante lumière au sein de la plus noire obscurité ». Il est toutefois une différence fondamentale entre la mystique chrétienne et le non-savoir bataillien. Aux yeux de Bataille la première consacre un « arrêt dans le mouvement » alors que le second est marqué par l’inachèvement. Mais c’est pour y avoir vu un arrêt, fantasmatique, que Bataille succombe lui-même à une forme de fixation dans le zigzag un peu vide de son projet. De là l’insuffisance de la mystique du mal.
[47] Georges Bataille, L’expérience intérieure, op.cit., p. 74.
[48] Rilke, Élégies de Duino (huitième).
[49] Ibid., p. 88.
[50] Ibid., p.122.
[51] Ibid., p. 40.
[52] Ibid., p. 72.
[53] Ibid., p. 21.
[54] Ibid., p.15.
[55] Voir Stéphane Madelrieux, Philosophie des expériences radicales, Paris, Seuil, 2022, qui critique l’empirisme métaphysique comme « mauvais programme philosophique » en ce qu’il « attribue systématiquement plus de réalité et de valeur aux expériences exceptionnelles » (p. 16). Critique qui en manque à nos yeux le sens véritable en ce qu’il n’y va pas de la distinction entre expérience radicale et expérience ordinaire mais au contraire de l’ordinaire comme oubli propre du métaphysique et partant de la levée du voile par retour à la Racine – à la « Réalité », par-delà la dualité. Ce n’est donc pas que le « haut » doive être jugé, critiqué ou sacralisé, à l’aune de « l’ici-bas » : c’est « l’ici-bas » qui, oublieux, méconnaît sa propre hauteur.
[56] Ibid., p. 47.
[57] Taittiriya Upanishad, II, 9 (nous traduisons).
[58] Isa Upanishad. Voir Sept Upanishads, tr.fr. J. Varenne, Paris, Seuil, 1981.
[59] Christiane Singer, Où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?, Paris, Albin Michel, 2000.
[60] Adi Shankara, Ātma-Bodha, sloka 48 (nous traduisons).














