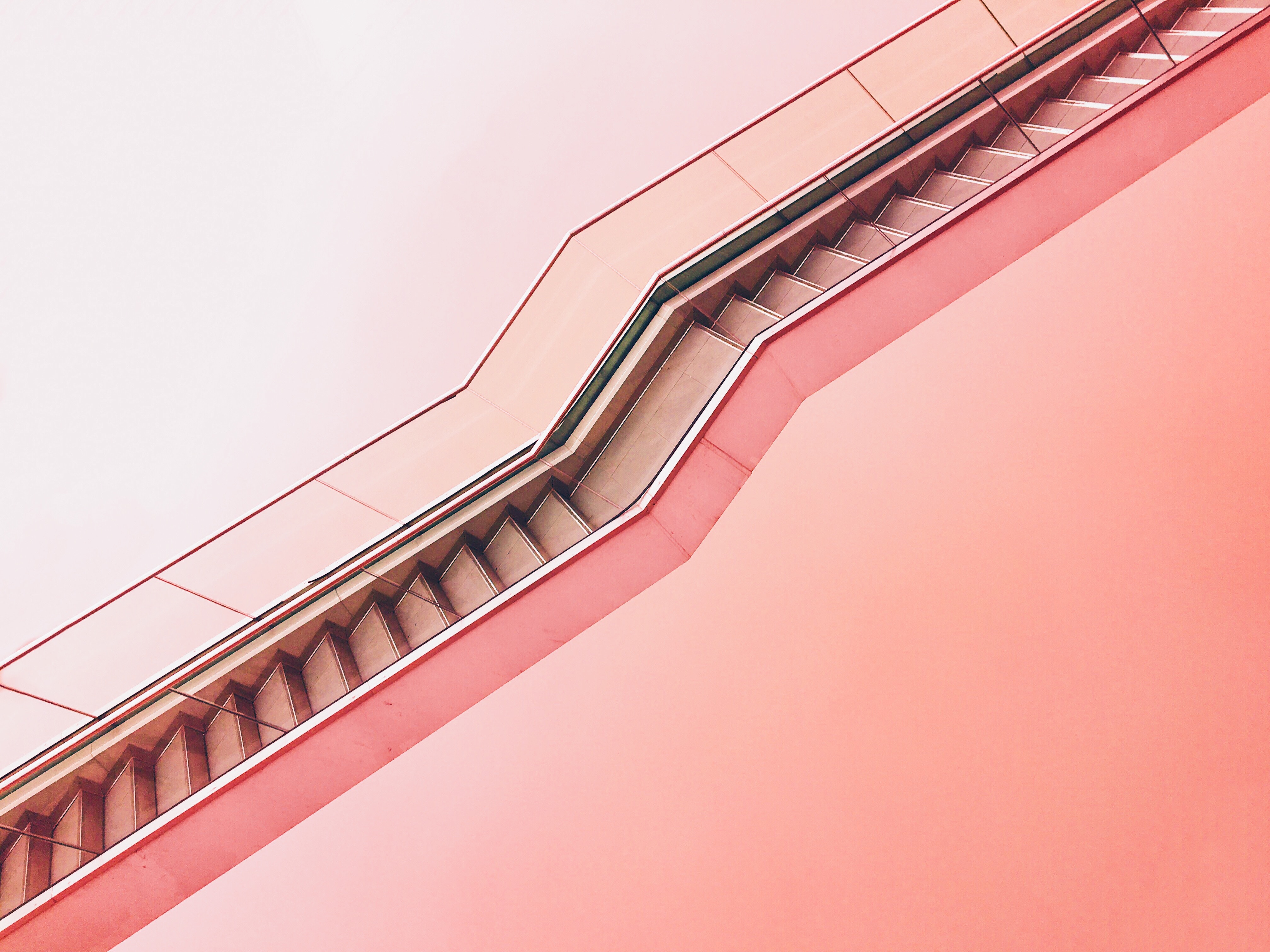« Qu’est-ce que les Lumières » à l’époque des technologies numériques
Autour du chapitre 1 d’Etats de choc. Bêtise et savoir au XXIème siècle.
[box] Anne Alombert. Doctorante à l’Université Paris Nanterre.
« Les ‘Lumières’ se définissent comme la sortie de l’homme hors de l’état de tutelle dont il est lui-même responsable. L’état de tutelle est l’incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. (…) Or, pour répandre ces lumières, il n’est besoin de rien d’autre que de la liberté; de fait, de sa plus inoffensive manifestation, à savoir l’usage public de sa raison et ce, dans tous les domaines. »
Kant, « Qu’est-ce que les Lumières ? », 1784.
« En simplifiant à l’extrême, on tient pour postmoderne l’incrédulité à l’égard des méta-récits. (…) Dans la société et la culture contemporaine, société post-industrielle, culture postmoderne, (…) le grand récit a perdu sa crédibilité, quel que soit le mode d’unification qui lui est assigné : récit spéculatif, récit de l’émancipation. »
J.-F. Lyotard, La condition postmoderne, 1979.
« Plutôt que de vouloir distinguer la ‘période moderne’ des époques ‘pré’ ou ‘postmoderne’, je crois qu’il vaudrait mieux chercher comment l’attitude de modernité, depuis qu’elle s’est formée, s’est trouvée en lutte avec des attitudes de ‘contre‑modernité’. (…) Je ne sais s’il faut dire aujourd’hui que le travail critique implique encore la foi dans les Lumières ; il nécessite, je pense, toujours le travail sur nos limites… »
M. Foucault, « Qu’est-ce que les Lumières ? », 1984.
« L’hypothèse ou le vœu que je serais tenté de soumettre à la discussion, c’est que, tout en prenant en compte, ou en charge, ce progrès des sciences, dans l’esprit d’une nouvelle ère des Lumières pour ce nouveau millénaire (et à cet égard je reste kantien), une politique du droit à la philosophie pour tous et pour toutes ne soit pas seulement une politique de la science et de la technique, mais une politique de la pensée. »
J. Derrida, Le droit à la philosophie d’un point de vue cosmopolitique, 1991.
« La Silicon Valley nous assure que la magie de la technologie va tout naturellement se glisser dans le moindre recoin de notre vie. A l’entendre, s’opposer à l’innovation reviendrait à renoncer aux idéaux des Lumières. Dirigeants de Google et de Facebook, MM. Larry Page et Mark Zuckerberg seraient les Diderot et les Voltaire de notre temps — réincarnés en entrepreneurs technophiles et asociaux. »
E. Morozov, « Résister à l’ubérisation du monde », 2015.
Introduction
 Dans La condition postmoderne, un « rapport sur les problèmes du savoir dans les sociétés industrielles les plus développées » réalisé par J.-F. Lyotard en 1979, celui-ci caractérise l’époque postmoderne par un état d’incrédulité à l’égard des méta-récits. Les méta-récits désignent pour lui les systèmes philosophiques qui avaient pour fonction de légitimer la science moderne et de justifier les institutions du savoir. Selon Lyotard, il existe deux grandes versions de ces récits de légitimation, qui recourent à deux modes de légitimation différents. Dans la première version, exemplifiée par la philosophie hégélienne, le savoir tire sa légitimité de lui-même : la légitimité des savoirs scientifiques est garantie par le savoir spéculatif qui « restitue l’unité des connaissances dispersées en sciences particulières en les rattachant les unes aux autres comme des moments d’une histoire de l’esprit ». Dans la philosophie des Lumières, le savoir tire sa légitimité de sa fonction émancipatrice pour l’humanité : le savoir doit servir les fins pratiques visées par une collectivité autonome, qui doit elle-même reconquérir son droit à la science, contre les pouvoirs religieux et tyranniques. Sous les noms de « récit spéculatif » et de « récit de l’émancipation », Lyotard distingue donc un mode philosophique et un mode politique de légitimation du savoir, notamment incarnés par la philosophie spéculative de Hegel et par la philosophie critique de Kant[1].
Dans La condition postmoderne, un « rapport sur les problèmes du savoir dans les sociétés industrielles les plus développées » réalisé par J.-F. Lyotard en 1979, celui-ci caractérise l’époque postmoderne par un état d’incrédulité à l’égard des méta-récits. Les méta-récits désignent pour lui les systèmes philosophiques qui avaient pour fonction de légitimer la science moderne et de justifier les institutions du savoir. Selon Lyotard, il existe deux grandes versions de ces récits de légitimation, qui recourent à deux modes de légitimation différents. Dans la première version, exemplifiée par la philosophie hégélienne, le savoir tire sa légitimité de lui-même : la légitimité des savoirs scientifiques est garantie par le savoir spéculatif qui « restitue l’unité des connaissances dispersées en sciences particulières en les rattachant les unes aux autres comme des moments d’une histoire de l’esprit ». Dans la philosophie des Lumières, le savoir tire sa légitimité de sa fonction émancipatrice pour l’humanité : le savoir doit servir les fins pratiques visées par une collectivité autonome, qui doit elle-même reconquérir son droit à la science, contre les pouvoirs religieux et tyranniques. Sous les noms de « récit spéculatif » et de « récit de l’émancipation », Lyotard distingue donc un mode philosophique et un mode politique de légitimation du savoir, notamment incarnés par la philosophie spéculative de Hegel et par la philosophie critique de Kant[1].
Lyotard soutient néanmoins que dans la société et la culture des années 1980 (qu’il qualifie de post-industrielle et de post-moderne), ces deux modes de légitimation ont perdu toute crédibilité. Ce déclin de la puissance unificatrice et légitimante des grands récits aurait été provoqué par l’essor déroutant des techniques et des technologies après la Deuxième Guerre mondiale (qui « a déplacé l’accent sur les moyens de l’action plutôt que sur ses fins »), ainsi que par le redéploiement du capitalisme libéral avancé (qui « a éliminé l’alternative communiste et valorisé la jouissance individuelle des biens et des services »). Mais selon Lyotard, les germes de cette délégitimation étaient déjà contenus dans les méta-récits eux-mêmes : alors que le récit spéculatif n’interrogeait pas la légitimité du discours légitimant, le récit de l’émancipation impliquait une relation entre énoncé dénotatif à valeur cognitive et énoncé prescriptif à valeur pratique – deux présuppositions qui semblent problématique à partir du moment où l’on considère que « la science joue son propre jeu, (qu’) elle ne peut légitimer les autres jeux de langage », que « celui de la prescription lui échappe », et qu’ « elle ne peut pas davantage se légitimer elle-même comme le supposait la spéculation ». Aux circonstances technico-économiques externes s’ajoutent donc des limites intrinsèques qui expliquent l’érosion des grands récits, l’abandon par la philosophie de sa fonction traditionnelle, et la nécessité pour les penseurs du début du XXème siècle de faire le « deuil de la légitimation ». Selon Lyotard, ce travail de deuil aurait ouvert sur une nouvelle perspective : celle de l’investigation des jeux de langage initiée par Wittgenstein, qui envisage une autre sorte de légitimation, à partir des « pratiques langagières » et des « interactions communicationnelles ». Ce serait avec une telle perspective que le « monde postmoderne aurait affaire », une fois admis que la légitimation ne peut pas venir d’un métalangage philosophique, mais seulement d’accords plus ou moins explicites entre locuteurs, autour des règles commandant les différents « jeux » et « coups » de langage qui constituent le lien social[2]. Dans « les sociétés industrielles les plus développées », « la nostalgie du récit perdu » serait ainsi « elle-même perdue pour la plupart de gens », qui auraient appris « la rude sobriété du réalisme » sans être « voués à la barbarie » pour autant[3].
C’est pourtant une « nouvelle forme de barbarie » qu’Adorno et Horkheimer voyaient advenir dans les « civilisations éclairées » des sociétés industrielles en 1944. Et c’est bien le projet des Lumières (Aufklärung) qui semble encore les hanter dans La dialectique de la raison (Dialektik der Aufklärung), une fois confrontés à « l’aporie » de « l’autodestruction de la raison »[4]. En effet, constatant que l’accroissement du niveau de vie et les progrès scientifiques s’accompagnait d’une liquidation de l’esprit et de sa transformation en bien de consommation par les industries culturelles, les auteurs décrivaient leur époque comme un « moment de régression » de la raison. Loin d’envisager les interactions langagières comme une nouvelle source de légitimation des savoirs, ils soutenaient que « non seulement l’activité scientifique, mais le sens même de la science était devenu problématique », à une époque où la pensée se voyait transformée en marchandise et le langage en un simple moyen de la promouvoir[5]. Ils constataient que contrairement au projet du « grand récit », la rationalisation des sociétés, loin d’avoir constitué un facteur d’émancipation sociale, avait paradoxalement engendré une décadence de la formation théorique, et la domination des masses par les groupes sociaux disposant de l’appareil technique et de la puissance économique[6]. Le récit des Lumières semblait ainsi revenir à travers le texte d’Adorno et Horkheimer, chargé cette fois de sa part d’ombre.
En effet, fidèles au « récit de l’émancipation », Adorno et Horkheimer ne cessaient affirmer que « dans la société, la liberté était inséparable du penser éclairé », mais ils suggéraient néanmoins que ce « penser » ne pouvait être analysé hors de ses formes historiques concrètes et des institutions sociales dans lesquelles il était inévitablement imbriqué[7], et qu’il contenait en lui-même les principes de sa désintégration. La dialectique de la raison avait précisément pour fonction de penser les « germes » de la régression dans la raison elle-même, qui ne pouvait dès lors plus se voir déterminée comme une « raison pure »[8]. Adorno et Horkheimer n’entendaient pas ainsi s’opposer à la philosophie kantienne, mais bien la critiquer, au sens où Kant lui-même avait critiqué la raison dans la Critique de la raison pure[9], c’est-à-dire non pas en vue de l’abandonner, mais pour en analyser les limites, afin d’en faire un usage pertinent face aux enjeux actuels. Les penseurs de l’Ecole de Francfort semblaient ainsi adopter à l’égard de la philosophie des Lumières ce que Foucault décrira comme l’ethos philosophique des Lumières elles-mêmes : une attitude critique, consistant à analyser les limites et à réfléchir sur elles, qui ne peut donc être assimilée à un « comportement de rejet »[10].
En effet, selon Foucault, la philosophie des Lumières se définit moins comme une théorie constituée qu’il faudrait accepter ou rejeter, que comme « une manière de penser et de sentir, d’agir et de se conduire », comme une attitude philosophique, qui serait toujours à réactiver. Dans un entretien sur les Lumières publié en 1984[11], Foucault soutient donc qu’hériter de l’Aufklarung ne consiste pas à répéter des éléments de doctrine, mais à réactiver un geste de pensée. Il s’agit alors pour lui de surmonter « l’alternative simpliste » consistant à simplement demeurer dans la tradition rationaliste ou à radicalement abandonner les principes de rationalité : Foucault refuse ainsi de s’affirmer « pour ou contre » l’Aufklärung, qui constitue avant tout un ensemble de processus historiques, mais il insiste néanmoins sur la nécessité de redonner sens à cet événement dans le contexte actuel, en se réappropriant la tâche que les penseurs de l’époque avait initiée, et qu’il définit comme une « critique permanente de notre être historique »[12].
Quelle est donc cette « critique permanente de notre être historique » qu’il conviendrait de réactiver pour hériter du geste des Lumières ? Selon Foucault, c’est Kant qui fournit le modèle d’une telle attitude à l’égard de l’actualité, justement dans son texte concernant les Lumières publié deux cent ans auparavant[13] : Foucault insiste en effet sur le fait que contrairement à ce qui se produit dans ses autres textes sur l’histoire, dans son texte sur les Lumières, Kant ne cherche pas à comprendre le présent à partir d’une totalité ou d’un achèvement futur, mais s’interroge au contraire sur le présent « comme différence dans l’histoire ». La question posée par Kant n’est pas une question d’origine ou de finalité, mais bien une question d’actualité, qui consiste à se demander : « quelle différence aujourd’hui introduit‑il par rapport à hier ? »[14]. Selon Foucault, ce rapport réflexif au présent est caractéristique de la modernité, qui constitue donc moins une période de l’histoire, encadrée par « des époques pré- ou post- modernes », qu’une attitude, toujours « en lutte avec des attitudes de contre-modernité », et qui se définit par un « mode de relation à l’actualité », que Foucault résume au moyen du précepte suivant : « Vous n’avez pas le droit de mépriser le présent »[15]. Cette interrogation critique sur le présent ne consiste ni à sacraliser le moment actuel pour tenter de le maintenir tel quel, ni à se laisser simplement porter par le flux vertigineux des événements : la modernité se distingue justement de la mode, dans la mesure où elle suppose de « ressaisir quelque chose d’éternel qui n’est pas au‑delà de l’instant présent, ni derrière lui, mais en lui », afin de le perpétuer tout en le transfigurant. Dans l’attitude moderne, « l’extrême attention au réel » n’est pas dissociable d’un « acharnement à l’imaginer autrement qu’il n’est et à le transformer », non pas « en le détruisant, mais en le captant dans ce qu’il est »[16].
S’il reconnaît que la philosophie des Lumières n’a pu voir le jour qu’à « un certain moment du développement des sociétés européennes », caractérisé par certains « types d’institutions politiques », certaines « formes de savoir », et certaines « mutations technologiques », Foucault soutient donc néanmoins qu’elle a initié une attitude de pensée qui reste à réactiver (celle qui consiste à saisir la singularité et la nouveauté dont le présent est chargé), et qu’elle a formulé un problème essentiel qui « nous demeure posé » (celui de la « relation entre le progrès de la vérité et l’histoire de la liberté »). Hériter de la philosophie des Lumières impliquerait donc de parvenir à réactiver ce problème en le confrontant à la nouveauté du contexte actuel, dans lequel les formes de savoir et de pouvoir semblent reconfigurées, non plus seulement sous l’effet des industries culturelles et des technologies analogiques décrites par Adorno et Horkheimer en 1944, mais aussi sous l’effet de l’industrie des données et des technologies numériques, qui se développent depuis les années 1990. Comment poser la question de la vérité dans « l’ère post-vérité[17] », où l’usage des algorithmes prétend signer la « fin de la théorie[18] » ? Comment poser la question de la liberté, quand l’internet des plate-formes semble court-circuiter l’exercice de la politique et l’application du droit[19] ? Bref, comment s’interroger sur et transformer « l’actualité », quand les fonctions des établissements d’enseignement et des institutions politiques semblent remises en cause par les évolutions technologiques ? Que faire de l’héritage de la modernité après l’époque postmoderne, et pour éviter que la condition postmoderne ne conduise à une « attitude de contre-modernité » ?
Ce sont ces questions qui semblent se poser dans le premier chapitre d’Etats de choc. Bêtise et savoir au XXIème siècle, dans lequel B. Stiegler confronte les réflexions de Kant sur les Lumières aux mutations technologiques, économiques, politiques qui caractérisent l’époque contemporaine. Kant définissait les Lumières comme le mouvement historique et social à travers lequel les hommes accèdent à la « majorité », c’est-à-dire sortent de l’état de tutelle et deviennent capables de se servir de leur propre entendement, sans la direction d’autrui. L’éducation permet ainsi de former des citoyens raisonnables et rationnels, qui peuvent participer à la politique de leur pays et transformer leur société, en faisant un usage public de leur raison, c’est-à-dire en communiquant publiquement leurs réflexions et leurs critiques au sujet des institutions et des lois qui règlent la vie de la communauté[20]. Néanmoins, selon Stiegler, ce passage à l’acte de la raison et cette formation d’une majorité psychique, morale et intellectuelle, est aujourd’hui devenue problématique, dans la mesure où les relations intergénérationnelles à travers lesquelles se transmettent les savoirs (lors de l’éducation familiale ou de l’enseignement scolaire par exemple) se voient court-circuitées par la rapidité des transformations technologiques et leur mise au service d’une économie consumériste. De même, les dispositifs et supports de publication qui configurent l’espace au sein duquel les citoyens sont supposés faire un usage public de leur raison ont été transformés en profondeur depuis l’avènement des médias analogiques (cinéma et télévision) et numériques (web puis internet des plateformes). Comment alors poser les questions de la formation de la majorité et de l’usage public de la raison sans ignorer « la différence qu’aujourd’hui introduit par rapport à hier[21] » ?
I. Les Lumières : formation et usage public de la raison.
La formation de la majorité comme sortie de l’état de tutelle.
Dans son texte intitulé Qu’est-ce que les Lumières ?[22], Kant définit les Lumières comme un processus de « sortie de l’homme hors de l’état de tutelle », à travers lequel l’homme passe de la minorité à la majorité. L’état de tutelle ou de minorité désigne « l’incapacité de l’homme à se servir de son entendement sans être dirigé par un autre[23] ». Kant donne trois exemples de cet état : « lorsqu’un livre nous tient lieu d’entendement », « lorsqu’un directeur spirituel nous tient lieu de conscience », ou « lorsqu’un médecin décide à notre place de notre régime ». Dans tous ces cas, l’homme, au lieu d’exercer sa faculté d’entendement pour penser par lui-même, accepte sans discuter l’autorité de quelqu’un d’autre pour le conduire.
Selon Kant, loin d’être victime d’un tel état, l’homme en est pleinement responsable : l’incapacité de l’homme à penser par lui-même ne résulte pas d’une insuffisance de l’entendement, mais d’un manque de résolution pour s’en servir. Kant insiste en effet sur le fait qu’il est plus facile et moins pénible de rester mineur : « Il est si commode d’être mineur. (…) Je n’ai pas besoin de me fatiguer moi-même. Je n’ai pas besoin de penser, pourvu que je puisse payer ; d’autres se chargeront à ma place de ce travail fastidieux[24]. » ; et définit la devise de Lumières par un appel au courage : « Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ![25] ». Comme le rappelle Foucault dans son commentaire, le passage à la majorité qui définit les Lumières n’est pas seulement présenté par Kant comme « un processus en train de se dérouler » « dont les hommes font collectivement partie », mais aussi comme « une tâche, une obligation », un « acte à effectuer personnellement » « dont chacun se trouve responsable » : bref, les hommes sont à la fois « éléments ou agents du même processus », qui ne se produit que « dans la mesure où ils décident d’en être les acteurs »[26] .
Or, selon Kant, le confort procuré par l’état de minorité et le courage nécessaire pour en sortir expliquent que bien que les hommes disposent tous naturellement d’une faculté d’entendement, certains parviennent néanmoins à diriger les autres, en exploitant leur « paresse » et leur « lâcheté » : en leur montrant « le danger qu’il y aurait à marcher seuls », les tuteurs rendent les hommes timorés et les font reculer devant toute tentative de s’arracher à leur état de tutelle, qu’ils prennent finalement pour leur état naturel et auquel ils finissent par s’habituer[27]. C’est pourquoi, selon Kant, seul quelques hommes parviendront à avoir le courage de se servir de leur propre entendement. Néanmoins, ces quelques hommes, cette minorité devenue majeure, répandront autour d’eux un état d’esprit qui « valorise la vocation de chaque homme à penser par lui-même », ce qui, selon Kant, ouvre la possibilité qu’un public s’éclaire lui-même, pourvu qu’on lui en laisse la liberté.
Bref, quand l’inclinaison et la vocation pour la pensée libre s’exerce, cette tendance influe peu à peu en retour sur la mentalité du peuple, qui devient ainsi plus apte à penser librement. C’est pourquoi Kant affirme la nécessité de garantir la liberté aux citoyens d’user publiquement de leur raison dans tous les domaines : seul un usage libre et public de la raison peut « répandre les lumières parmi les hommes[28] ». L’accès du public aux Lumières a donc des conditions à la fois « spirituelles, institutionnelles et politiques[29] » et se fera nécessairement lentement : Kant soutient en effet que si une révolution peut entraîner le rejet d’un despotisme personnel ou d’une oppression autoritaire, elle ne suffit pas à engendrer « une véritable réforme de la manière de penser », puisque tant que l’usage libre et public de la raison n’est pas garanti, « de nouveaux préjugés surgiront qui domineront la grande masse irréfléchie tout autant que les anciens »[30].
La question politique de l’usage libre et public de la raison.
Qu’entend donc Kant par cet usage libre et public de la raison, censé garantir la sortie de l’état de minorité et l’accès du peuple aux Lumières ? Pour le comprendre, il faut rappeler que Kant distingue usage public et usage privé de la raison : l’usage public de la raison est défini comme « celui que l’on fait comme savant devant le public qui lit », alors que l’usage privé de la raison est défini comme « celui qu’on a le droit de faire alors qu’on occupe telle ou telle fonction civile ». Alors que l’usage public de la raison doit être libre, selon Kant, son usage privé, lui, peut rester « étroitement limité, sans pour autant gêner sensiblement le progrès des Lumières ». En effet, en tant qu’il fait partie d’une communauté, chaque individu exerce un certain nombre d’activités dans l’intérêt de cette communauté, et il est dans l’intérêt de tous les membres que chacun d’entre eux remplisse les fonctions qui leurs sont attribuées en vues de fins communes. Dans l’exercice des activités nécessaires au fonctionnement de la communauté, l’individu ne doit pas être détourné de ces fins. Tant qu’il exécute une tâche qui lui est imposée par sa communauté, l’individu doit donc rester mineur, se contenter d’obéir sans raisonner. Kant soutient qu’il serait dangereux « qu’un officier ayant reçu des ordres se mît à raisonner, dans son service, sur l’opportunité ou l’utilité de cet ordre », de même qu’il serait dangereux qu’un citoyen ne paie pas ses impôts au moment où il doit s’en acquitter, ou bien qu’un prêtre ne respecte pas la doctrine de l’Église qu’il sert et qui lui fournit son poste[31].
Néanmoins, rien n’empêche cet officier, ce citoyen ou ce prêtre de communiquer au public leurs réflexions concernant le caractère inapproprié de tel ou tel ordre reçu, le caractère injuste de telle ou telle imposition, ou encore le caractère erroné de telle ou telle doctrine. Quand ils communiquent ainsi publiquement leurs réflexions au sujet des institutions qu’ils servent (armée, Etat, Eglise), et leurs suggestions pour modifier et améliorer le fonctionnement de ces institutions, l’officier, le citoyen ou le prêtre ne le font plus en tant qu’officier, citoyen ou prêtre, mais en tant que « savant devant le public qui lit[32] ». Si en tant que partie de la machine que constitue la communauté ils ont pour devoir d’obéir, en tant que « savants », en tant que membres de l’humanité raisonnable, l’officier, le citoyen ou le prêtre ont par contre pour mission d’informer cette même communauté de leurs réflexions « bien pesées et bien intentionnées ». Kant affirme ainsi que même du point de vue de la législation, il n’y a pas de danger à autoriser ses sujets à faire un usage public de leur propre raison et à exposer publiquement leurs réflexions sur une meilleure rédaction du texte législatif, quand bien même celle-ci s’accompagne d’une franche critique des lois en vigueur. Tant que les hommes respectent les fonctions civiles qui leur ont été attribuées, il n’y a rien à craindre pour la paix publique et pour l’unité de la communauté : non seulement ils ne vont pas à l’encontre de la fonction qui leur est attribuée, mais surtout, sans cet usage libre, public et critique de la raison par les hommes, « toute possibilité d’amélioration progressive » de la communauté se verrait annihilée, rendant ainsi l’époque « stérile » et « néfaste pour la postérité »[33]. Un gouvernement qui comprend bien sa fonction et vise son amélioration a donc lui-même intérêt à garantir ce « régime de liberté », dans lequel les hommes « se dégagent eux-mêmes progressivement de leur grossièreté »[34].
Il en va donc de l’intérêt du « régime éclairé », de la communauté présente, et de leur postérité que soit garantie non seulement la liberté de pensée, mais la liberté de communiquer sa pensée à un public capable d’en prendre connaissance. Comme le souligne Foucault dans son commentaire, l’usage public de la raison défendu par Kant se distingue de ce qu’on entend depuis le XVIème siècle sous le nom de liberté de conscience : il ne s’agit pas de garantir « le droit de penser comme on veut, pourvu qu’on obéisse comme il faut »[35], mais bien le double droit et le double devoir de remplir sa fonction sociale, et de soumettre à ses concitoyens des réflexions susceptibles de transformer et d’améliorer leurs institutions ou leur législation. Selon Foucault, le texte de Kant s’ouvre ainsi sur une question qui demeure non résolue : car si l’on conçoit bien que la liberté de l’usage de la raison de chaque individu puisse être assurée de façon purement négative par l’absence de toute poursuite contre lui, on voit mal cependant comment assurer positivement l’usage public de cette raison. La question se pose en effet de savoir « comment l’usage de la raison peut prendre la forme publique qui lui est nécessaire, comment l’audace de savoir peut s’exercer en plein jour »[36], bref comment donner au « public » les moyens de prendre connaissance des réflexions élaborées par les autres citoyens en tant que « savants ».
Selon Foucault, la définition de l’Aufklärung s’ouvre ainsi sur un véritable problème politique, qui, si l’on en croit Stiegler, ne peut être posé qu’à partir de ses dimensions mnémotechniques ou hypomnésiques. Stiegler désigne ainsi l’ensemble des dispositifs artefactuels qui supportent la mémoire individuelle et collective et permettent la diffusion et la publication des savoirs – supports qui évoluent selon les sociétés et les époques, et que les individus doivent pratiquer socialement afin de transmettre cette mémoire et de partager ou transformer ces savoirs. Selon Stiegler, ce sont ces conditions « rétentionnelles[37]» de formation et de « publication » de la raison – et les conditions économico-politiques qu’elles impliquent, qui ont été négligées par Kant : car si l’on admet que la transmission des savoirs et le partage de la pensée critique supposent des dispositifs technologiques de rétention et de publication, alors la question se pose de savoir par qui et comment sont contrôlés ces supports, par qui et comment est assurée leur socialisation[38], et si la transmission et la transformation (l’intériorisation et l’extériorisation) des savoirs qu’ils supportent par les individus qui les pratiquent est rendue possible. Poser la question des conditions rétentionnelles et politiques de la formation et de l’usage public de la raison au XXIème siècle implique donc de prendre en compte les évolutions technologiques des supports hypomnésiques, et les processus économico-politiques d’appropriation et d’expropriation de ces supports qui caractérisent l’époque contemporaine.
II. La formation et l’usage public de la raison face à l’évolution du milieu mnémotechnique.
Les « psychotechnologies » analogiques et numériques : captation de l’attention et dé-formation de la raison.
Or, le milieu mnémotechnique s’est considérablement transformé au cours du XXème siècle, et les fonctions de l’université et de l’école, les institutions en charge de la formation de la raison, ont été considérablement affectées par ces évolutions de leur « dehors »[39]. Stiegler rappelle en effet que selon Kant, la Raison n’est pas à comprendre comme une puissance impersonnelle, mais comme état mental et social précaire, toujours susceptible de se déformer : c’est pourquoi elle suppose une formation, que les institutions scolaires ont pour fonction de fournir, en formant l’attention des futurs citoyens en les faisant repasser par les controverses logiques qui sont à l’origine des disciplines rationnelles[40]. La raison constitue en effet une forme attentionnelle spécifique, issue d’une histoire, qui est celle des différentes disciplines rationnelles, dont l’état actuel est le fruit d’une accumulation d’expériences de pensées individuelles et collectives, sédimentées dans des supports de mémoire (livres imprimés ou sites internet par exemple) puis transmises, partagées, critiquées et transformées par des communautés de pairs certifiées, au cours de ce que Stiegler appelle des processus de transindividuation[41]. L’université constitue le lieu où s’élaborent et se transforment ces savoirs rationnels, que l’école a pour fonction de transmettre, en enseignant les règles et les apprentissages permettant aux individus de pratiquer et de socialiser les supports de mémoire (par exemple, en enseignant les techniques de la lecture et de l’écriture permettant d’intérioriser et d’extérioriser les savoirs conservés dans des livres). Selon Stiegler, les mutations technologiques récentes semblent néanmoins avoir remis en cause les fonctions de l’école (formation de l’attention rationnelle) et de l’université (transmission et transformation – transindividuation) des savoirs.
Concernant l’école tout d’abord, Stiegler soutient que le développement des technologies analogiques puis des technologiques numériques au service d’une économie consumériste a transformé le milieu mnémotechnique extérieur à l’école, au point de le rendre incompatible avec les fonctions de l’école elle-même. Les médias analogiques puis numériques ont été mis au service d’une captation de l’attention des individus et d’une exploitation industrielle de leurs pulsions, qui nuisent toutes deux à la formation de l’attention dont l’institution scolaire est responsable[42]. Stiegler explique en effet qu’au lieu d’être prise en charge par la puissance publique, la socialisation des technologies analogiques puis numériques (c’est-à-dire leur diffusion dans la société) a été abandonnée à des finalités de consommation mises en œuvre à travers les stratégies du marketing et de la publicité[43] : si bien qu’au lieu que les individus psychiques et sociaux n’inventent de nouvelles règles et n’apprennent de nouvelles pratiques pour s’approprier ces technologies, ce sont les technologies, devenues « médias de masse » au service d’une économie de l’attention ou « nouveaux médias » au service d’une économie des données, qui règlent les comportements et programment des actes d’achats. Qu’il s’agisse des industries de programmes développées à travers la télévision ou de l’industrie des données supportées par les réseaux sociaux ou les plateformes, il s’agit dans les deux cas d’augmenter les audiences en vendant du « temps de cerveau disponible[44] » aux annonceurs. Les mnémotechnologies deviennent alors des « psychotechnologies[45] » au service d’un « psychopouvoir », ayant pour fonction de polariser les attentions des individus et de canaliser leurs pulsions vers des objets de consommation, les détournant ainsi des objets communs que constituent les savoirs (savoir-vivre, savoir-faire, ou savoir-théorique), qui sont au fondement de la chose publique. C’est en effet à travers la pratique de savoirs que les pulsions se socialisent, se transforment en désir de groupe et en processus d’individuation collective, qui constituent la base d’une communauté politique et qu’une institution comme l’école a pour fonction de mettre en œuvre[46].
La fonction des universités a aussi été bouleversées en raison des évolutions technologiques : non seulement parce que leurs finalités ont été mises au service d’une économie de la « destruction créatrice » visant l’innovation technologique à court terme[47] , mais aussi parce que les supports technologiques des savoirs qu’elles ont pour rôle d’élaborer se sont radicalement transformés. Qu’il s’agisse des sciences humaines ou des sciences naturelles, la numérisation des instruments d’observation, d’expérimentation ou de publication a modifié en profondeur non seulement les méthodes et les pratiques, mais aussi les objets des disciplines rationnelles et les processus de certification qui les règlent[48]. Cette numérisation des instruments scientifiques pose néanmoins problème, dans la mesure où elle rend possible une extériorisation des fonctions mentales d’intellection et d’opérations logiques dans des machines (par exemple les calculs effectués automatiquement par des algorithmes sur d’immenses bases de données)[49], qui tendent ainsi à court-circuiter l’exercice de ces facultés par des individus psychiques et sociaux que sont les chercheurs, et à donner des résultats avant même que les conséquences d’une telle transformation n’aient pu être pensées. L’évolution de ces instruments est souvent si rapide que les nombreuses questions épistémologiques qu’elle pose aux disciplines n’ont pas le temps d’être scientifiquement instruites, avant qu’une nouvelle innovation n’apparaisse. L’évolution de leur propre discipline tend ainsi à échapper aux chercheurs eux-mêmes, qui ne comprennent parfois pas le fonctionnement des instruments qu’ils utilisent (dans la mesure où ils n’ont pas participé à leur conception), ni l’influence de ces instruments sur leurs objets et leurs pratiques (dans la mesure où ils n’ont pas été formés à l’étude du rôle des supports techniques ou « rétentionnels » dans la constitution des savoirs – sciences expérimentales comme humaines).
Alors que ces questions n’ont pas le temps de mûrir dans la communauté des chercheurs, le rythme de l’évolution des savoirs (axiomes, théorèmes, faits expérimentaux) échappe aussi aux enseignants, qui ne sont pas « armés pour enseigner ce qui a changé dans leur discipline au cours des deux derniers siècles, ni a fortiori au cours des cinq dernières décennies[50] », et qui ne sont souvent pas acculturé au fonctionnement des technologies numériques qui caractérise le milieu mnémotechnique des savoirs ou des non-savoirs contemporains[51] – milieu que les jeunes générations d’étudiants pratiquent continuellement. Selon Stiegler, cette mutation conduit à une perte d’autorité des enseignants, qui, du fait qu’ils ne comprennent plus et ne participent plus au devenir de leur discipline, ne parviennent plus à l’incarner et se sentent invalidés à leurs propres yeux comme à ceux de leurs élèves, aux questions desquels ils se trouvent souvent dans l’incapacité de répondre[52].
Les technologies de l’esprit : l’usage public de la raison dans l’espace public numérique
Selon Stiegler, ce discrédit des savoirs théoriques sous l’effet des mutations numériques de leurs supports, et le bouleversement des rapports intergénérationnels qu’il induit dans la sphère de l’enseignement scolaire fait suite à la dissolution des savoirs-vivre par la standardisation comportementale imposées par les médias de masse, qui avaient bouleversé les rapports intergénérationnels dans la sphère de l’éducation familiale (au lieu que les savoirs-vivre ne soient transmis et partagés de générations en générations au cours de processus d’individuation psychique et collective, les jeunes générations ciblées par la publicité étaient devenues prescriptrices d’actes d’achat pour les générations ascendantes, court-circuitant ainsi les processus d’identification et les conflits intergénérationnels nécessaires au passage de la minorité à la majorité[53]). Au XXIème siècle, la question n’est donc plus seulement celle de l’incrédulité à l’égard des méta-récits philosophiques, mais bien celle de la désintégration des savoirs en général (savoirs théoriques discrédités par les innovations technologiques, savoirs-vivre remplacés par des comportements standardisés, ou savoirs-faire automatisés) qui aboutit à un processus de prolétarisation généralisée, c’est-à-dire, au fait que les individus ne transmettent ni ne partagent plus collectivement leurs savoirs, qui, du coup, n’évoluent plus et ne se diversifient plus. Or, seule l’invention de nouveaux savoirs théoriques, de nouveaux savoir-vivre ou de nouveaux savoir-faire (qui sont autant de façons de faire, de vivre et de penser) peut permettre aux individus d’« améliorer » progressivement leur époque et de la rendre « féconde » pour la postérité[54], en adoptant les transformations du milieu mnémotechnique.
C’est pourquoi Stiegler soutient que l’université et l’école devraient entreprendre une lutte contre les processus de désapprentissage engendrés par l’appropriation des rétentions tertiaires analogiques et numériques par la sphère de l’économie consumériste et du capitalisme financier[55]. Il ne s’agit donc pas de rejeter les supports techniques hors de la sphère académique, mais au contraire, d’analyser leurs effets et de critiquer leur fonctionnement, afin d’inventer de nouvelles manières de les concevoir et de les pratiquer. Le programme des « études digitales[56] » proposé par Stiegler a ainsi pour but de mobiliser les chercheurs de différentes disciplines académiques, afin d’étudier la manière dont leur discipline est affectée par les technologies numériques au niveau épistémologique, et d’analyser les transformations de leurs instruments d’observation ou de leurs dispositifs de publication, afin de pouvoir décider de la manière dont ils fonctionnent et de celle dont ils doivent être utilisés, et de participer ainsi à nouveau à l’élaboration et à la transformation de leurs disciplines respectives. A condition que ces questions soient instruites et travaillées au niveau de la recherche, les futurs enseignants pourront ensuite être formés à l’histoire technique et au fonctionnement des technologies numériques, comprendre les évolutions contemporaines des savoirs qu’ils ont pour rôle de transmettre, et redonner ainsi du crédit à leurs enseignements.
Car selon Stiegler, le problème ne consiste pas à rétablir le prétendu rapport d’autorité des professeurs aux élèves qui aurait été perdu, mais plutôt de parvenir à articuler des enseignements magistraux et une culture technique savante aux savoirs empiriques des jeunes générations, afin de reconstituer une relation de co-individuation intergénérationnelle, quand bien même celle-ci devrait prendre de nouvelles formes. Stiegler soutient en effet qu’en dépit de leur potentiel toxique, les supports numériques ouvrent de nouvelles possibilités de transmission et de partage des savoirs, et impliquent donc de repenser les pratiques d’enseignement. S’il ne s’agit nullement de supprimer les cours magistraux, il devient néanmoins nécessaire aujourd’hui de les agencer avec les travaux personnels et collectifs que le champ rétentionnel contemporain rend possible, à condition d’être configuré à cette fin[57]. L’école pourrait ainsi devenir le laboratoire d’une réflexion critique et d’une invention technologique, ayant pour but de mettre les dispositifs de publication numériques au service du partage des savoirs et de la formation de l’intelligence collective, en développant notamment de nouveaux outils contributifs : par exemple, des langages d’annotation permettant aux apprenants de partager leurs notes et interprétations d’un contenu, des algorithmes d’analyse de données permettant d’analyser qualitativement ces annotations et de constituer des groupes d’interprétations ou d’affinités, des réseaux sociaux mettant en relation ces groupes en leur permettant de confronter leurs points de vue. Stiegler soutient en effet que si de tels outils étaient développés, les dispositifs numériques, au lieu de court-circuiter les fonctions éducatives et formatrices des institutions scolaires et académiques, pourraient être mis au service de la discussion argumentée et de la controverse logique, essentielle à la constitution des savoirs rationnels comme à l’exercice du débat public qui fonde la politique.
Car l’espace numérique constitue avant tout un processus de publication, dont la transformation reconfigure en profondeur l’espace public et l’exercice de la politique. Si les technologies numériques sont actuellement mises au service d’une traçabilité généralisée permettant d’analyser, de prédire et de contrôler les comportements des individus, elles constituent en droit un nouveau système de publication à travers lequel les individus deviennent « capables de publier et ainsi de diffuser leurs idées, leurs propositions, leurs analyses, leurs points de vue, leurs critiques, et donc de prendre part de façon tout à fait nouvelle à la vie publique[58] ». En effet, par rapport aux médias de masse et aux industries culturelles que critiquaient Adorno et Horkheimer, le web semble ouvrir l’espace d’une nouvelle puissance publique. Tout au long du XXème siècle, les technologies analogiques monopolisées par les industries culturelles avaient produit une asymétrie et une imparité ente d’un côté les producteurs industriels de symboles (de sons et d’images) devant se plier aux critères de leurs commanditaires, et de l’autre, les consommateurs de ces symboles constituant non plus « le public d’un espace public et d’un temps public », mais des audiences pour la publicité soumises à des programmes qui leurs sont imposés[59]. Or, cette situation est profondément transformée par la numérisation et la réticulation : non seulement de nombreuses données deviennent accessibles à tous, mais ce sont aussi les fonctions et les appareils de captation, de production, de diffusion qui furent durant plus d’un siècle réservées aux professionnels travaillant pour les industries de l’information et de la communication (et non plus au clercs, religieux ou laïcs), qui passent aujourd’hui entre les mains des publics eux-mêmes, qui ne peuvent dès lors plus être appréhendés comme des masses de consommateurs constituant des audiences calculables, mais bien comme des association de contributeurs, constituant des communautés de pairs ou d’amateurs (artistiques, scientifiques, politiques)[60]. Au lieu d’être utilisées pour exploiter les données personnelles des individus afin de prédire, calculer et contrôler leurs conduites et de produire ainsi des actes de consommation homogènes, les technologies numériques pourraient donc être mises au service de la constitution de nouveaux espaces d’expression et de partages, favorisant cette fois la diversité sociale et l’intelligence collective. Au lieu de constituer l’arme d’un psychopouvoir lui-même au service d’une guerre économique, le web pourrait ainsi devenir l’espace d’expression symbolique et argumentée des conflits, que constitue tout espace politique[61]. Une telle transformation ne pourra néanmoins être effective qu’à condition de repenser le fonctionnement des technologies de publication et la manière de les adopter ou de les pratiquer collectivement : ce sont sur ces questions que l’université, l’école et la société civile pourraient s’interroger ensemble, afin de faire des « psychotechnologies » numériques des « technologies de l’esprit », au service de la formation et de l’usage public de la raison[62]. C’est notamment à de telles interrogations que le projet de recherche contributive, explicité dans la seconde partie d’Etats de choc et mis en œuvre depuis 2016 sur le territoire de Plaine Commune est consacré[63].
Conclusion
A une époque où les individus des sociétés hyperindustrielles passent en moyenne dix-huit heures par semaine sur internet[64] et disposent de 140 signes pour s’exprimer, l’usage public de la raison semble difficilement pouvoir être défini comme « celui que l’on fait comme savant devant le public qui lit», et le principal obstacle à la formation de la majorité semble moins se situer dans des « livres » tenant « lieu d’entendement » ou dans les « tuteurs » exploitant la « paresse » des individus[65] , que dans les objets connectés qui captent leurs attentions, exploitent leurs pulsions et court-circuitent la pratique collective des savoirs. Stiegler remarque que dans un tel milieu mnémotechnique, les disciplines rationnelles que les universités ont pour fonction de transindividuer, et l’attention rationnelle que l’école a pour mission de former, sont mises en péril par le fonctionnement des dispositifs numériques au service d’une économie des données basée sur le consumérisme. Dans la mesure où les appareils connectés sont utilisés pour collecter massivement les données et non pour permettre aux individus de s’exprimer publiquement et singulièrement, dans la mesure où les algorithmes sont utilisés pour tracer et contrôler les comportements, et non pour constituer des groupes de contribution et de capacitation, l’espace numérique ne peut pas constituer le support hypomnésique et le lieu politique qu’il a pourtant la possibilité de devenir.
C’est pourquoi Stiegler soutient la nécessité d’un « projet à la fois scientifique, philosophique, politique, industriel et économique pour de nouvelles Lumières qui s’emparent pleinement des défis immenses que porte le numérique », en « luttant délibérément et rationnellement contre la toxicité » qui accompagne nécessairement ses potentialités curatives[66]. Si « nous ne sommes plus à l’époque des pures Lumières », si « nous sommes entrés dans l’époque des Ombres et des Lumières, c’est-à-dire d’une conscience pharmacologique de ce que provoque la technologie » fonctionnant à la vitesse de la lumière, comprendre « ce que sont les Lumières » au XXIème siècle impliquerait peut-être de transformer les instruments de contrôle que sont devenues les rétentions numériques en supports de savoir (faire, vivre, penser), afin de leur redonner effectivement leur rôle dans la formation et l’usage public de la raison – rôle que le « grand récit » des Lumières ne permettait pas de penser, mais qu’il devient difficile d’ignorer après la postmodernité.
[1] J.-F. Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979, chapitre IX « Les récits de la légitimation du savoir ». La philosophie marxiste quant à elle, n’aurait cessé d’osciller entre ces deux modes de légitimation.
[2] Ibid., chapitre III « La méthode : les jeux de langages. » et chapitre V « La nature du lien social : la perspective postomderne. ».
[3] Ibid., chapitre X « La délégitimation ».
[4] T. W. Adorno et M. Horkheimer, La dialectique de la raison. Fragments philosophiques (1944), Paris, Gallimard, 1974.
[5] Ibid.
[6] T. W. Adorno et M. Horkheimer, La dialectique de la raison. Fragments philosophiques (1944), Paris, Gallimard, 1974.
[7] Ibid.
[8] Notamment pure de toute dimension « mythique » :« La première étude qui est la base théorique des autres tente de faire comprendre l’intrication de la rationalité et de la réalité sociale, ainsi que l’intrication de la nature et de la domination de la nature, qui en est inséparable. (…) La première partie peut se réduire dans sa partie critique à deux thèses : le mythe lui-même est déjà raison et la raison se retourne en mythologie. », T. W. Adorno et M. Horkheimer, La dialectique de la raison. Fragments philosophiques, op. cit.
[9] La démarche de Kant dans la Critique de la raison pure consistait à s’interroger sur les limites de la connaissance rationnelle et à déterminer ainsi un usage légitime de la raison (citation CRP).
[10] M. Foucault, « Qu’est-ce que les Lumières ? », in Dits et Ecrits, Paris, Gallimard, tome IV, texte n°339.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] E. Kant, « Qu’est-ce que les Lumières », in Berlinische Monatsschrift, décembre 1784.
[14] Ibid.
[15] Ibid., Foucault reprend ici une formule de Baudelaire, après avoir analyser la manière dont celui-ci définit la modernité.
[16] Ibid.
[17] https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88re_post-v%C3%A9rit%C3%A9
[18] C. Anderson, « The end of theory. Why the data deluge makes the scientific method obsolete. », in Wired, juin 2008 (https://www.wired.com/2008/06/pb-theory/). Dans cet article, C. Anderson soutient de manière provocante que la collecte massive de données numériques soumises aux calculs des algorithmes pourrait dispenser les chercheurs des différentes disciplines rationnelles (physiciens, linguistes, médecins, …) de tout effort de théorisation, dans la mesure où des prédictions deviennent possibles sur la base de l’établissement de simples corrélations. Outre les biais introduits par la collecte et le traitement de telles données, il ignore néanmoins l’effet performatif ou auto-réalisateur de telles prédictions.
[19] E. Morozov, « Résister à l’ubérisation du monde », in Le Monde Diplomatique, septembre 2015 (https://www.monde-diplomatique.fr/2015/09/MOROZOV/53676). Dans cet article, E. Morozov montre comment le développement des entreprises de la Silicon Valley à travers les plateformes internet court-circuite les réglementations juridico-politiques et l’exercice de la puissance publique à travers les systèmes sociaux traditionnels.
[20] E. Kant, « Qu’est-ce que les Lumières ? », op. cit.
[21] M. Foucault, « Qu’est-ce que les Lumières ? », op. cit.
[22] E. Kant, « Qu’est-ce que les Lumières ? », op. cit.
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] Ibid.
[26] M. Foucault, « Qu’est-ce que les Lumières ? », op. cit.
[27] E. Kant, « Qu’est-ce que les Lumières ? », op. cit.
[28] Ibid.
[29] M. Foucault, « Qu’est-ce que les Lumières ? », op. cit.
[30] Ibid.
[31] E. Kant, « Qu’est-ce que les Lumières ? », op. cit.
[32] Ibid.
[33] Ibid.
[34] Ibid.
[35] M. Foucault, « Qu’est-ce que les Lumières ? », op. cit.
[36] Ibid.
[37] « Ce que peut-être nous, de nos jours, découvrons aussi et que nous éprouvons si douloureusement et anxieusement, c’est que la raison suppose pour sa Bildung des conditions rétentionnelles formant et supportant la mémoire individuelle et collective, qui dépendent de techniques hypomnésiques aujourd’hui industrialisées, et qui avec la poursuite de la rationalisation, ont échappé à toute puissance publique et noétique : elles sont passées entre les mains de ce que Polanyi appelle le marché autorégulateur. », B. Stiegler, Etats de choc. Bêtise et savoir au XXIème siècle., op. cit., p. 36.
[38] « L’Aufklärung aura été pensée au XVIIIème siècle comme conquête de la majorité et lutte contre la minorité, en ignorant encore pour l’essentiel la nécessité d’analyser non seulement les conditions hypomnésiques de cette conquête qu’est la formation de la raison, en particulier au moment où de nouvelles mnémotechniques et technologies rétentionnelles faisaient leur apparition, mais aussi les conditions économico-politiques d’appropriation et d’expropriation de ces hypomnemata telles qu’elles auront rendu possible le désencastrement du marché devenu ainsi auto-régulateur et du même coup auto-destructeur. », B. Stiegler, Etats de choc. Bêtise et savoir au XXIème siècle., op. cit., p. 38.
[39] Ibid., p. 54.
[40] Ibid., p. 51 et p. 55.
[41] Ibid., p. 44.
[42] Ibid., p. 51, 248, 348.
[43] Ibid., p. 53.
[44] En 2004, Patrick Le Lay, alors président du groupe TF1, affirme que la chaîne de télévision vend à Coca-Cola (et à ses annonceurs publicitaires) du temps de cerveau humain disponible, désignant ainsi l’attention comme la ressource principale que les médias de masse captent et vendent aux entreprises ou aux marques : https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_de_cerveau_humain_disponible. Cette formule et son contexte sont commentés par B. Stiegler dans De la misère symbolique, Paris, Flammarion, 2013.
[45] B. Stiegler, Etats de choc. Bêtise et savoir au XXIème siècle., op. cit., p. 146.
[46] Ibid., p. 51 et p. 349.
[47] Ibid., p. 53.
[48] Par exemple, la nano-physique contemporaine ne peut s’exercer comme discipline et accéder à /constituer ses objets qu’à travers l’instrument numérique que constitue microscope à effet tunnel, de même, les sciences sociales sont contraintes de transformer leurs théories et leurs méthodes sous l’effet des nouvelles observations de terrain rendues possible par la collecte massive de données numériques. Voir ibid., p. 332.
[49] Ibid., p. 57.
[50] Ibid., p. 308.
[51] Ibid., p. 345.
[52] Ibid., p. 42-43 et p. 308.
[53] Ibid., p. 47 et p. 50.
[54] « Ruiner ainsi en quelque sorte toute possibilité d’amélioration progressive pour une époque donnée, rendant celle-ci stérile et, par le fait même, néfaste pour la postérité, voilà qui est absolument interdit. », E. Kant, « Qu’est-ce que les Lumières ? », op. cit.
[55] B. Stiegler, Etats de choc. Bêtise et savoir au XXIème siècle., op. cit., p. 262 et p. 279.
[56] https://digital-studies.org/wp/fr/
[57] Ibid., p. 355.
[58] B. Stiegler, « Le blues du net », http://reseaux.blog.lemonde.fr/2013/09/29/blues-net-bernard-stiegler/.
[59] B. Stiegler, Etats de choc. Bêtise et savoir au XXIème siècle., op. cit., p. 340.
[60] Ibid., p. 313.
[61] Ibid., p. 146.
[62] Ibid., p. 331, 335, 345.
[63] https://recherchecontributive.org/.
[64] https://www.blogdumoderateur.com/etat-lieux-2017-internet-reseaux-sociaux/.
[65] E. Kant, « Qu’est-ce que les Lumières ? », op. cit.
[66] B. Stiegler, « Le blues du net », http://reseaux.blog.lemonde.fr/2013/09/29/blues-net-bernard-stiegler/.