Recension – La fabrique des pensées
Marco Passini est doctorant en philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il prépare actuellement une thèse en philosophie de la connaissance, et s’intéresse plus particulièrement à l’apport de l’anthropologie de la connaissance à la théorie de la justification épistémique.
Recension de La fabrique des pensées de Pierre Steiner, Paris, Editions du Cerf, 2023.
L’ouvrage est disponible ici.
Introduction
Comment la pensée peut-elle être à propos du monde ? Comment expliquer cette mystérieuse propriété qu’ont nos pensées de porter sur des objets qui la transcendent, de les « viser » – et cela qu’ils soient proches ou lointains, réels ou fictifs, concrets ou abstraits – propriété que la philosophie a voulu capturer par le concept d’intentionnalité ?
La fabrique des pensées de Pierre Steiner se veut moins une réponse à qu’une dissolution de cette question classique, en exposant l’image erronée de la pensée qui la motive. Il s’agit pour lui de mettre en cause tout le paradigme de l’intentionnalité, pour lequel la pensée serait comme un acte de visée qui aurait à se diriger vers des objets et à franchir une distance pour éventuellement les atteindre. La pensée n’est pas comme une flèche lancée dans l’espace qui ferait le lien entre le sujet conscient et les objets qu’il pense. Pour Steiner, la pensée ne porte pas sur le monde mais est du monde, une partie de celui-ci, entrelacée avec ses autres parties. L’accès de la pensée au monde ne saurait être un mystère puisque la pensée suppose déjà une inscription du penseur dans le monde. Loin de pouvoir être décrite comme une sphère autonome qui pourrait ou non entrer en contact avec la réalité, la pensée s’apparente plutôt à la technique : elle suppose le savoir-faire d’un sujet en prise avec des choses et des conventions qui le précèdent – et, plus spécifiquement, la famille de techniques que constitue le langage.
La fabrique des pensées se divise en deux parties. La première est historique et critique, et retrace l’histoire et les impasses du concept d’intentionnalité, de sa mise à l’ordre du jour par Franz Brentano jusqu’à ses réinterprétations dans les traditions aussi bien analytique que phénoménologique. La deuxième partie est constructive : elle propose une image originale de la pensée comme prise d’engagements à l’égard du monde à travers l’usage de concepts, conçus comme des techniques de maniement de signes.
I. Généalogie et critique de l’intentionnalité
Le premier chapitre propose une lecture du concept d’intentionnalité chez Brentano qui accentue la discontinuité entre le sens qu’en donne cet auteur et les leçons qu’en tireront les intentionnalismes phénoménologique et analytique qui se revendiqueront de lui. Brentano reprend, dans sa Psychologie du point de vue empirique de 1874, le concept médiéval d’intentio, pour défendre une définition célèbre des phénomènes psychiques par « l’in-existence intentionnelle d’un objet »[1]. Brentano veut marquer par là le caractère immanent de l’objet de la pensée (in-existenz signifiant existence-dans et non non-existence) et sa différence de nature par rapport aux objets réels. Si Brentano changera d’orientation lors de son tournant « réiste » (p.35), pour affirmer que seules des choses concrètes peuvent exister, il ne rangera pas les objets intentionnels parmi ces choses. Il préfèrera faire de ceux-ci une manière de parler, les objets intentionnels désignant, d’une manière contournée, des modifications de la chose concrète qu’est le sujet pensant : il n’existe pas de licorne pensée, mais seulement un sujet « penseur-de-licorne ». . Tantôt purement mental, tantôt propriété d’un objet physique, l’objet intentionnel ne fait jamais chez Brentano ne fait office de pont entre les deux.
Pour Steiner Brentano a le mérite de bien distinguer deux sens d’intentionnalité qui tendaient à se confondre chez les scolastiques : l’intentionnalité médiévale désignait tantôt l’immanence de l’objet à la pensée, tantôt la tension de la pensée en sa direction – sens toujours prégnant dans l’acception courante d’intention, proche du terme de volonté. Les successeurs de Brentano représenteraient une régression vers cette confusion conceptuelle.
Les chapitres 2 et 3 explorent cette postérité de l’intentionnalité brentanienne dans deux lignées qui se revendiquent d’elle, la phénoménologie et la philosophie de l’esprit analytique.
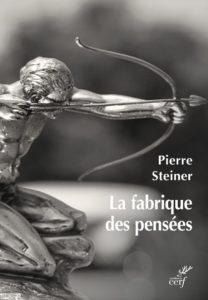 Steiner insiste sur l’originalité de Husserl, élève de Brentano, qui conçoit l’objet intentionnel comme objet transcendant auquel renverrait tout acte mental. La pensée viserait, par son contenu, un objet qui lui « manque » et qui viendrait la « remplir » et la « satisfaire » : c’est dire que Husserl réintroduit, pour combler le fossé entre objets immanents de la pensée et objets réels, le recoupement médiéval de l’intention comme mode d’existence de l’objet mental et comme être-dirigé-vers du sujet désirant (p.67-68). Ainsi, l’intentionnalité se dit non plus seulement des objets, mais des actes eux-mêmes. Le modèle de l’intentionnalité de la pensée devient alors l’intention pratique, la poursuite de la satisfaction d’un telos. Comme les buts, les objets intentionnels husserliens sont définis par l’acte qui les vise. Steiner identifie ainsi chez Husserl un idéalisme non pas des objets (un objet intentionnel n’est pas toujours réel) mais du sens (la pensée signifie ce qu’elle signifie par elle-même, par le seul fait qu’elle est pensée-de, indépendamment de la réalité de son objet) : si je pense à une baleine tout en croyant que les baleines sont des poissons, c’est effectivement à un poisson que je penserais, quoique je puisse découvrir à propos de la nature des baleines (p.92).
Steiner insiste sur l’originalité de Husserl, élève de Brentano, qui conçoit l’objet intentionnel comme objet transcendant auquel renverrait tout acte mental. La pensée viserait, par son contenu, un objet qui lui « manque » et qui viendrait la « remplir » et la « satisfaire » : c’est dire que Husserl réintroduit, pour combler le fossé entre objets immanents de la pensée et objets réels, le recoupement médiéval de l’intention comme mode d’existence de l’objet mental et comme être-dirigé-vers du sujet désirant (p.67-68). Ainsi, l’intentionnalité se dit non plus seulement des objets, mais des actes eux-mêmes. Le modèle de l’intentionnalité de la pensée devient alors l’intention pratique, la poursuite de la satisfaction d’un telos. Comme les buts, les objets intentionnels husserliens sont définis par l’acte qui les vise. Steiner identifie ainsi chez Husserl un idéalisme non pas des objets (un objet intentionnel n’est pas toujours réel) mais du sens (la pensée signifie ce qu’elle signifie par elle-même, par le seul fait qu’elle est pensée-de, indépendamment de la réalité de son objet) : si je pense à une baleine tout en croyant que les baleines sont des poissons, c’est effectivement à un poisson que je penserais, quoique je puisse découvrir à propos de la nature des baleines (p.92).
Steiner contraste cette conception « idéaliste » de la visée avec l’acte intramondain de viser, inapte à servir de métaphore d’une pensée souveraine. Viser est un verbe factif – qui suppose un objet réel. Il ne me suffit pas d’avoir l’intention de viser un cerf pour le faire – il faut que l’être que je vise soit effectivement un cerf. La métaphore de la visée prétend éclairer le fait que certains actes prennent des choses réelles pour but et les atteignent, mais échoue dès lors qu’elle les sépare de ses conditions réelles, de l’appartenance préalable au monde sans laquelle la réussite de ces actes est inintelligible. Pour Steiner, la phénoménologie ne se débarrassera jamais de ce péché originel. Même réinterprétée comme incarnée (Merleau-Ponty) ou être-au-monde (Heidegger), l’intentionnalité y subsisterait toujours comme le franchissement – quand bien même originaire – d’une distance, et donc d’une séparabilité en droit du sujet et de son monde.
Le chapitre 3 retrace les méandres du concept d’intentionnalité dans la philosophie analytique de l’esprit qui, à la différence de la phénoménologie, tente d’assoir l’intentionnalité de la pensée sur une ontologie naturaliste. Steiner examine en détail et réfute successivement trois grandes tentatives d’identifier une « intentionnalité intrinsèque », ancrée dans la nature, par rapport à laquelle des formes de représentation du monde comme le langage seraient des « intentionnalités dérivées » (p.122). Pour chacune des grandes familles de théories examinées, le vice argumentatif décelé par Steiner est similaire : il consiste à chaque fois à se donner l’intentionnalité que l’on voulait expliquer. On la conçoit alors soit comme propriété de représentations sub-personnelles (théories représentationalistes), soit comme une propriété phénoménale immédiate de la conscience (théories phénoménalistes), soit comme une forme d’interaction entre un organisme et son environnement (théories énactivistes). Or aucun de ces modèles n’est capable de rendre compte des dimensions intensionnelle (je ne pense quelque chose que sous une certaine description) et normative (penser que p, c’est s’engager à agir comme si p et pouvoir se tromper sur p) propres à la pensée humaine. Celles-ci ne deviennent compréhensibles qu’une fois qu’on fait intervenir le langage et la socialité, sphères dont l’intentionnalité ne saurait être donc « dérivée » de formes plus primitives. La pensée, dans sa prétention à décrire le monde comme étant d’une certaine manière, est conceptuellement inséparable de la pratique linguistique et de ses normes partagées, par lesquelles on apprécie le sens et la correction d’un énoncé : ce n’est pas par des propriétés naturelles qu’on peut individuer une pensée, mais par la façon dont elle est susceptible d’être exprimée. Penser à un citron n’est pas la même chose que penser à une orange tout simplement parce que les concepts des deux fruits s’emploient différemment dans le langage.
II. Une théorie pragmatiste de la pensée
Le chapitre 4 met en scène un procédé singulier qui sert en quelque sorte de pivot à l’ouvrage : la figure de l’archer qui vise est analysée en détail et à nouveaux frais, non plus pour montrer son inadéquation par rapport aux modèles de l’intentionnalité qui s’y réfèrent, mais comme le point de départ pour une autre image de la pensée (p. 223-249). Il ne s’agit plus de suggérer que la pensée est comparable à une visée. Seulement, de même que la visée n’est intelligible que compte tenu des conditions matérielles de sa réalisation, et plus précisément de sa participation à une technique (à savoir l’archerie), de même la pensée peut être comprise comme impliquant une forme de technique, à condition que celle-ci soit bien cernée. La technique ne serait pas un moyen permettant d’atteindre mécaniquement une fin qui lui préexisterait, mais une détermination mutuelle et dynamique entre des schèmes corporels et matériels et des actions possibles. La nature humaine ne précède pas la technique, car celle-ci conditionne en profondeur ses possibilités – y compris sa capacité de penser. Le geste de Steiner consiste à passer du topos philosophique qui consiste à prendre une technique particulière pour métaphore de la pensée (de l’image du bloc de cire à l’intelligence artificielle), censée pourtant précéder toute technique, à une compréhension de la technique comme genre dont la pensée serait une espèce. Ainsi, à l’image de l’archerie comme de toute autre technique, la pensée met en jeu une organisation du corps et de sa gestuelle ; elle est nécessairement incarnée et située, présupposant la présence et l’usage intelligent des choses plutôt qu’en étant la condition ; elle se manifeste à la fois dans des comportements réguliers et dans la capacité à s’appliquer à de situations nouvelles. La pensée est naturalisée, mais dans la mesure où la technique est elle-même un évènement de « l’histoire naturelle de l’humanité »[2], selon la formule de Wittgenstein, penseur tutélaire de l’ouvrage.
Après cette exposition générale de sa conception de la pensée comme technique, Pierre Steiner se penche plus précisément, dans les chapitres 5, 6 et 7 de son ouvrage, sur les actes de pensée, les jugements, pour expliquer par cette nouvelle approche les fonctions qu’on déléguait jusqu’à présent à l’intentionnalité.
L’intentionnalité a notamment servi à déterminer le sens des actes de pensée : le sens de mes pensées, au contraire du sens de mes mots, serait clair indépendamment de toute convention sociale. Dans le chapitre 5, Pierre Steiner s’efforce de remplacer cette vision de sens commun par une analyse pragmatiste du jugement, qui conçoit celui-ci comme un engagement, un pari pour l’existence d’un certain état de choses. L’objectivité du jugement dépend de ce que ses normes ne sont pas fixées par mon bon vouloir, mais par les concepts intersubjectifs dont je dispose : d’où le rapport intrinsèque du contenu de la pensée avec le langage – la pensée n’est pas un discours mental, mais elle est essentiellement exprimableen droit, au sens où les engagements qui la constituent sont soumis aux normes sociales qui régissent l’usage des signes.
Cette théorie pragmatiste et sociale du jugement comme engagement d’un sujet situé à l’aide de concepts extérieurement déterminés conduit Steiner à une conception contextualiste du contenu de la pensée : « Le contenu du jugement (et donc le jugement) est inséparable de ce qui (nous) importe au moment du jugement. » (p. 282) Steiner fustige l’exercice, courant en philosophie analytique, consistant à théoriser le sens d’énoncés tels que « la neige est blanche » comme s’ils pouvait être compris abstraction faite des pratiques et intérêts de celui qui les pense. Ce qui compte comme blanc pour le peintre ne sera pas le même pour le touriste ou le glaciologue, non pas par une différence de concept mais de situation. Celle-ci inclut non seulement les engagements du sujet mais les objets à propos desquels il peut s’engager, de sorte que, suivant la nature de ces objets, la signification de ce que nous pensons peut se révéler être autre que ce que nous « avions en tête ». Ainsi, de nouvelles applications d’un concept familier peuvent toujours me forcer à reconsidérer son sens, qui n’est dès lors fixé ni « dans la tête » ni même dans le langage. Par-là, Steiner tente de se différencier du pragmatisme inférentialiste d’un Robert Brandom qui, selon lui, idéaliserait toujours le sens comme consistant en des règles d’inférence définies.
Cette sensibilité s’explique plus précisément, dans le sixième chapitre, par l’étude de la dimension conceptuelle du jugement. C’est par le concept, défini comme technique d’usage de signes, que la pensée se voit dotée de cette appartenance au monde qui est celle de toute technique. « Le concept ne se maîtrise pas ; un concept est une maîtrise, qui s’acquiert et s’exerce : la maîtrise de l’usage d’un ou plusieurs signes » (p. 333). Si l’on désigne souvent un tel usage par un mot qui y figure, un concept n’est ni ce signe (le concept de triangle mobilise certes le signe « triangle », mais tout aussi essentiellement les signes « côté » et « angle », ainsi que des signes non-lexicaux, comme des tracés) ni quelque chose d’intangible que son usage exprimerait.
Le concept n’est ainsi pas condition de saisie du monde, puisqu’il implique que je sois en prise avec le monde ; il n’est pas l’expression d’une pensée qui le précède puisque, comme la technique conditionne les fins dont elle se fait le moyen, la possession d’un concept étend le domaine du pensable. Il est, à l’image de la technique en général, pluriel et hétérogène, inséparable d’une part de flexibilité et de sensibilité complémentaire de son caractère normé et régulier – le concept supposant un minimum d’accord sur nos manières de faire. Dans ces conditions, la question de l’individuation des concepts (l’autre utilise-t-il le même concept de façon idiosyncrasique ? de façon incorrecte ? ou est-ce un tout autre concept ?), va dépendre largement de nos intentions, des différences qu’il nous importe de marquer et de celles que nous pouvons ignorer dans une situation déterminée.
La fin du chapitre 6 et le chapitre 7 sont les parties les plus techniques de l’ouvrage. Ayant affiné de plus en plus le « grain » de son analyse pragmatiste (pensée, jugements, concepts), Steiner finit son effort par une interprétation des prédicats les plus solidaires de la notion d’intentionnalité. Celle-ci rendait compte du fait que la pensée fait référence au monde, qu’elle a un objet intentionnel, et qu’elle est à propos de quelque chose (aboutness) : Steiner doit donner une interprétation nouvelle de ces fonctions supposées. Ainsi, l’énoncé apparemment évident selon lequel « toute pensée est pensée de quelque chose » aurait une portée non pas ontologique, comme le voudraient les intentionnalistes, mais seulement grammaticale : en tant que jugement, une pensée a un objet au sens d’un thème qu’elle concerne (on parle ainsi de l’objet d’une plainte), sans que cela n’entraîne l’existence d’aucun individu en particulier. L’objet intentionnel, dans ce sens grammatical, serait dès lors à distinguer du fait que la pensée soit à propos (about) de quelque chose dans le monde. Ces deux sens de l’objet ne supposent pas une espèce unique de relation – référence, représentation ou visée – entre l’objet de la pensée et l’objet, réel ou fictif, sur lequel elle porte éventuellement, mais seulement que, grâce aux techniques conceptuelles variées par lesquelles une pensée s’exprime, je puisse la rapporter à cet objet.
Le livre de Steiner se conclut par l’étayage du cas précis des pensées démonstratives, qui vient nuancer cette distinction, en revenant sur l’image directrice du livre : le contenu de ces pensées étant intégralement déterminé par les objets réels sur lesquels elles portent, elles font coïncider l’objet intentionnel et objet de l’aboutness. Elles sont inséparables d’actes de monstration, comme pointer. Ces actes sont ce qui se rapproche le plus de la visée de l’archer dans le domaine de l’exprimable, donc du pensable – ils sont le bout par lequel « l’entrelacement » (p. 457) des concepts avec les choses apparaît le plus immédiatement, rendant caduque la question de l’accès au monde à laquelle l’intentionnalité venait répondre.
Conclusion
Le livre de Steiner est remarquable par son ambition et constitue une contribution indéniable au courant anti-représentationaliste en philosophie de l’esprit – porté par des figures comme John MacDowell, Robert Brandom et Huw Price. Il hérite de ce courant anglo-saxon un intérêt certain pour l’histoire de la philosophie et une capacité à enjamber la distinction analytique-continentale qui ne peut que le recommander auprès d’un public francophone. Son originalité à l’intérieur de ce champ vivant tient à sa focalisation sur l’intentionnalité, concept moins fréquemment critiqué que celui de représentation – ainsi que du pas supplémentaire vers la concrétude que constitue l’analyse de la pensée non seulement comme agir, mais comme agir technique. Ce dernier point pourra néanmoins susciter la résistance du lecteur philosophe : en insistant sur la largeur et l’hétérogénéité de la catégorie de technique et sur les conditions radicalement situationnelles de l’individuation des concepts, Pierre Steiner pose des difficultés indéniables à toute philosophie qui se penserait comme une discipline générale chargée de clarifier, réformer ou inventer des concepts.
[1] Franz Brentano, Psychologie Vom Empirischen Standpunkte, Leipzig, Duncker & Humblot, 1874.
[2] Ludwig Wittgenstein, Recherches Philosophiques, Paris, Gallimard, 2004, § 415.














