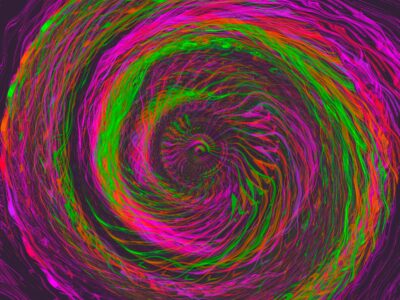Recension – Le marché de la vertu. Critique de la consommation éthique
Camille Roelens est Maître de conférences HDR en philosophie de l’éducation à l’Université Claude Bernard Lyon 1, INSPE de la Loire, laboratoire Éducation, Cultures, Politiques. Il est co-président de la Société Francophone de Philosophie de l’Éducation. Il est spécialisé dans les domaines de la philosophie politique et morale et des théories de la démocratie dans une perspective pratique touchant aux enjeux contemporains d’éducation et de formation, mais aussi de la pensée de Tocqueville et de ses héritages et du thème de l’individualisme démocratique.
Estelle Ferrarese, Le marché de la vertu. Critique de la consommation éthique, Paris, Vrin, 2023, 138p.
L’ouvrage est disponible ici.
En venir à la critique de la consommation éthique
Depuis des années, E. Ferrarese trace dans le paysage philosophique contemporain un itinéraire original dont il faut d’emblée dire un mot car il est permis de penser qu’il constitue une forme de condition préalable pour pouvoir écrire ainsi son dernier essai, alliant un style limpide et une grande profondeur de pensée. Ce parcours a d’abord un camp de base, l’étude de l’histoire et de l’actualité de la théorie critique et de l’école de Francfort, à travers une connaissance fine d’auteurs comme Adorno (Ferrarese, 2018a) et Habermas (Ferrarese, 2015) ou encore de certains de leurs contradicteurs contemporains comme Luhman (Ferrarese, 2007). Il connait également des excursions et des échanges de perspectives, passant par le biais d’études, de projets de recherche collectifs et de traduction, avec d’autres perspectives philosophiques, comme celle de N. Fraser (2005/2011), les théories du care et la centralité de la vulnérabilité (Ferrarese, 2018b) ou encore les retombées et inspirations plurielles du concept (notamment) wittgensteinien de forme de vie (Ferrarese et Laugier, 2018). En choisissant de s’intéresser ici à la consommation éthique – qu’elle définit comme un ensemble de « pratiques de consommation prônant un « juste » prix ou des achats « responsables » » (4ème de couverture) par le biais desquelles il s’agirait « tantôt d’amender, tantôt de fuir, tantôt de fendiller [la] logique d’accumulation » (p.10) du capitalisme – elle s’autorise tout à la fois à faire converger les ressources critiques glanées à chacune de ces étapes rapidement rappelées, et à démontrer une fois de plus la pertinence d’une pratique de l’histoire des idées tournée non seulement vers l’érudition, mais aussi la saisie d’enjeux contemporains[1].
Le contenu de cette critique
Précisons d’emblée, comme l’auteure le fait elle-même dès son introduction, que sa « critique de la consommation éthique […] porte sur ses effets sur la totalité sociale, la sincérité et le désintéressement des individus engagés dans ces pratiques restant à l’arrière-plan » (p. 13). Il ne sera donc ici nullement question de pensées du soupçon, de sociologie ou de psychanalyse des profondeurs, mais d’une démarche qui ne refuse pas une part de conséquentialisme selon laquelle des pratiques mises en œuvre, fut-ce dans un esprit vertueux, ne sauraient être jugées à même d’absoudre le capitalisme de consommation de ses effets les plus graves. Plus encore, l’auteure défend que l’échec macrosocial de la sommation de ses pratiques individuelles à constituer une réponse à la hauteur des enjeux contemporains dans ce domaine était en quelque sorte programmé, ou du moins inévitable. « Elles étaient vouées à l’échec, écrit ainsi E. Ferrarese, [car] elles sous-estimaient le fonctionnement systémique de l’économie de marché » (p. 14). Car en fait, et cette idée forte porte tout le déploiement argumentatif de l’ouvrage, penser ainsi, c’est déjà reconnaitre au marché un rôle prééminent d’harmonisation des choix et volontés individuelles, en un piquant hommage de la vertu au vice, aux conséquences amples.
 L’une d’entre elles, que l’auteur déploie et analyse, est de sacrer au fond le « règne de la mesure » (p. 26), sous l’empire duquel la justice se comprend comme « calcul et modération » (p. 30) approprié, et non comme remise en cause d’un mode de domination de l’humain sur l’humain ou de l’humain sur le vivant. Plus encore, « dans cette architecture, il n’y a pas d’égalité sans commensurabilité » (p. 34), et l’extension constante non seulement de l’échange marchand mais aussi de la logique de marché apparait alors comme le ferment d’une démocratisation plus accrue où se trouveraient des solutions légitimes aux problèmes vifs du temps où tout serait frappé au coin de l’ « interchangeabilité » (p. 42). En d’autres termes, le règne de la mesure serait aussi celui d’une courte vue, de l’absence de point de vue et de réflexion globale sur les phénomènes. Cela empêcherait en particulier de percevoir la contradiction fréquente entre nombres des pratiques dites de consommation éthique. Une autre conséquence dont l’auteure explore ensuite les implications étant notamment que la « quantité devient ainsi le mode d’existence de la Nature, comme du travail et du temps » (ibid.)
L’une d’entre elles, que l’auteur déploie et analyse, est de sacrer au fond le « règne de la mesure » (p. 26), sous l’empire duquel la justice se comprend comme « calcul et modération » (p. 30) approprié, et non comme remise en cause d’un mode de domination de l’humain sur l’humain ou de l’humain sur le vivant. Plus encore, « dans cette architecture, il n’y a pas d’égalité sans commensurabilité » (p. 34), et l’extension constante non seulement de l’échange marchand mais aussi de la logique de marché apparait alors comme le ferment d’une démocratisation plus accrue où se trouveraient des solutions légitimes aux problèmes vifs du temps où tout serait frappé au coin de l’ « interchangeabilité » (p. 42). En d’autres termes, le règne de la mesure serait aussi celui d’une courte vue, de l’absence de point de vue et de réflexion globale sur les phénomènes. Cela empêcherait en particulier de percevoir la contradiction fréquente entre nombres des pratiques dites de consommation éthique. Une autre conséquence dont l’auteure explore ensuite les implications étant notamment que la « quantité devient ainsi le mode d’existence de la Nature, comme du travail et du temps » (ibid.)
Sur ces bases, on l’aura compris, le scepticisme de l’auteure envers la capacité de la consommation éthique à s’instaurer en critique interne du capitalisme, sorte de ténia d’un veau d’or qui grossirait en lui à ses dépens mais sans ne le révérer, ne peut qu’être radical. E. Ferrarese montre ainsi en particulier que ces pratiques accréditent, au fond, l’idée d’un « échange [à appréhender comme] un fait anthropologique » (p. 60) dont toute réflexion sérieuse doit partir et non une construction socio-économico-culturelle. « Le mode de production se trouve ainsi défini par la psychologie des individus, plutôt que par sa base économique ou les rapports sociaux qui l’organisent » (p. 61). D’où ce verdict sans appel :
« Il est clair que la consommation éthique ne fait pas qu’échouer à maitriser deux mécanismes du capitalisme qu’elle se donne comme cibles, l’appropriation et le fétichisme ; elle contribue activement au fonctionnement de la totalité sociale qu’ils alimentent et qu’ils lissent » (p. 67).
On aura reconnu ici deux concepts clés de la pensée marxiste : la critique de l’appropriation privé des moyens de production (que devait contrer, dans le communisme, l’appropriation collective) et la critique du fétichisme en tant qu’invisibilisation du travail productif derrière un simple prix de marché. Le pendant logique au niveau individuel de ce constat d’échec collectif est que la « consommation éthique est intrinsèquement porteuse d’une logique individualisante et dépolitisante, nonobstant les nombreuses tentatives militantes et philosophiques de recouper le concept de responsabilité pour tenter de l’arracher à cette critique » (p. 71). Ce que l’auteure montre alors bien est que toute les formes de responsabilisation du consommateur, conçue comme un processus conjoint d’amélioration de soi et de l’ordre du monde, demeurent en quelque sorte encapsulées dans une responsabilité à la fois supérieure et implicite de maintenir le fonctionnement économique dans sa logique actuelle, voire d’en parfaire l’efficacité. On pourrait résumer ici en disant que le markéting éthique peut être de l’excellent markéting, mais non une forme d’éthique réellement effractive, et rien en tout cas qui ne permette d’échapper à ce qu’Adorno[2] nommait la « vie fausse » (p. 96), bercée par les illusions subjectives de bouleversements majeurs dans une « totalité sociale inchangée » (ibid.).
Ce qu’impliquerait l’avancée résolue vers une « autre forme de vie » (p. 99), concevable cette fois comme « vivre vrai » (pour l’approche duquel l’auteur puise dans des références allant notamment du dernier Foucault aux pensées du genre[3]), décourage ici toute velléité d’inventaire ou de synthèse. Notons simplement un point clé du raisonnement, qui concerne la « Nature » (p. 109-116). C’est en effet souvent le narratif d’une prise raisonnable de conscience du capitalisme de marché face aux effets environnementaux de son action qui porte les discours d’escorte de la consommation éthique. Or E. Ferrarese montre bien que la Nature telle que la consommation éthique la conçoit – non exempt d’accent herderiens[4] que la théorie critique de l’école de Francfort avait justement critiqué dans ses attaques contre le jargon de l’authenticité (Adorno, 1964/2018) – est en quelque sorte comme conçue pour être l’auxiliaire dont le marché a besoin, qui vient même en sacrer les mécanismes structurants. Comme elle l’écrit dans un paragraphe qui mérite d’être cité in extenso. Dans le respect de la Nature ainsi conçue,
« on consomme éthiquement d’abord pour soi et en vertu d’une consonnance avec son for intérieur. On voit ici l’harmonie dense qui tresse ensemble les états d’un contenu éthique. La Nature est la vérité du comportement, des choses, des êtres humains, elle s’est perdue, mais pour peu qu’on s’y conforme en la mimant, la cherchant, la respectant, le contenu éthique qu’elle représente se transfère sans reste d’une entité à une autre. Il faut alors tirer la conséquence suivante de cette construction : si consommer éthiquement est une manière de vivre en conformité avec ses lois, cela signifie, ironiquement, que la Nature peut être restaurée en ses lois par le marché. C’est in fine lui qui a le pouvoir de rendre – ou de donner – à la nature son statut de Nature » (p. 116).
On ne peut ainsi, montre E. Ferrarese, attendre d’une possible généralisation de la consommation éthique un changement de donne radical dans le rapport au capitalisme et à l’environnement, quand bien même certains acteurs s’y investirait dans ce but.
Portée de la critique et perspectives
Parvenu au terme de la lecture de l’essai d’E. Ferrarese – qui montre que ce « qui échappe à la consommation éthique, c’est que le système économique désajuste structurellement l’intention (morale) et son résultat » (p. 125) – il ne fait guère de doute que l’auteure parvient à s’inscrire dans la légitime postérité de deux traditions philosophiques, mais aussi, en un sens, littéraires. La première, évidente eu égard à son parcours de recherche rapidement rappelé ci-avant, est celle de la théorie critique contemporaine, centrée certes sur l’école de Francfort mais nourrie également de dialogues philosophiques serrés avec d’autres propositions contemporaines de remise en cause de l’ordre du monde tel qu’il (ne) va (pas). La seconde, plus inattendue peut-être, est celle des grands moralistes de l’âge moderne (Parmentier, 2000 ; Van Delft, 2008) qui, à la manière d’un La Rochefoucauld, à mettre au jour d’un trait de plume acéré les contradictions de la vertu, ou plus exactement l’écart quotidien entre de nobles proclamations et des conduites plus contestables dans leurs intentions et/ou leurs effets. Point de doute, l’hyperconsommateur au bonheur paradoxal (Lipovetsky, 2006) se voulant monarque éclairé du marché de la vertu apparait ici dans sa nudité la plus crue. Ainsi dépouillé par les rigueurs de la critique, de quel bois peut-elle espérer se chauffer ? Une voie – dont on aura compris qu’E. Ferrarese ne la prescrit nullement tant elle la perce préventivement de nombreux traits tant théoriques que rhétoriques – consisterait simplement dans l’abandon des proclamations de vertus et dans l’assomption telle qu’elle de la forme d’hédonisme consommatoire où l’individu démocratique contemporain investit sa passion du bien-être repérée de longue date par Tocqueville (1835/1981 ; 1840/1981) A cette école, la cohérence interne du raisonnement et des comportements gagnerait ce que les pétitions de vertu y perdraient, dans une morale toute mandevillienne[5] (Mandeville, 2017) sans illusions ni prétention. Une autre voie, que l’auteure laisse davantage ouverte même si elle ne prétend pas l’investir pleinement, consisterait en l’abandon de l’idée que les mécanismes du marché pourraient être mobilisés pour corriger, voire moraliser, le marché lui-même et donc dans la réintroduction d’une perspective institutionnelle (une profonde réforme de l’État et de l’action publique, par exemple), mue par une critique politique bien comprise. Mais sans doute serait-il possible de montrer à son tour que les mécanismes fonctionnels de la démocratie représentative contemporaine comprise comme démocratie libérale ne sont pas exempts eux-mêmes de tendances à miser sur le type de sommations des actions et choix individuels inhérents aux logiques de marché pour le dégagement de relatifs consensus publics dans des contexte pluralistes. Un auteur comme Dworkin (1985) a par exemple soutenu la thèse d’une possible défense de la valeur morale du marché en tant que forme organisationnelle la plus compatible avec la reconnaissance conjointe de l’irréductible pluralité des conceptions de la vie bonne, du droit égal de chacun de progresser vers la réalisation de celle qui a sa préférence et du libre usage par les individus de leurs propriétés.
Un beau livre, donc, qui présente le double intérêt de nous permettre d’échapper à quelques illusions courantes, mais aussi de refuser de nous conduire, ce faisant, vers d’autres chimères.
[1] Comme bien des sujets supposés « bien connus », la mise en dialogue de l’éthique et de la réflexion sur la société de consommation est aussi largement méconnue. On pourra notamment redécouvrir dans ce registre à l’occasion certains ouvrages d’auteurs comme J. Baudrillard (1970) ou Z. Bauman (2008/2009).
[2] Voir sur ce point en particulier l’ouvrage Minima Moralia (Adorno, 1951/2003).
[3] E. Ferrarese cite ici en particulier Le courage de la vérité (Foucault, 2009).
[4] Voir notamment en français les textes réunis sous le titre générique Histoire et cultures (Herder, 1774/2000), qui insistent sur l’importance de l’enracinement culturel inhérent, selon l’auteur, à l’expérience humaine.
[5] A condition toutefois de se rappeler que, si la morale de sa Fable des abeilles est passée à la postérité en français sous la formulation selon laquelle les vices privés font la vertu publique, le mot original désignant le second terme, benefits, admet une tonalité bien plus utilitariste que vertuiste.