Recension – Leibniz, lecteur critique de Hobbes
Recension de Leibniz, lecteur critique de Hobbes
Antoine Dumont, ancien élève de l’ENS Ulm et agrégé de philosophie.
[learn_more caption= » » state= »open »] Il s’agit d’une recension de l’ouvrage collectif Leibniz, lecteur critique de Hobbes, Eric Marquer et Paul Rateau (dir.), Presses de l’Université de Montréal / Vrin – Analytiques, 2018. Vous pouvez vous procurer l’ouvrage sur le site de la libraire philosophique Vrin en cliquant ici.
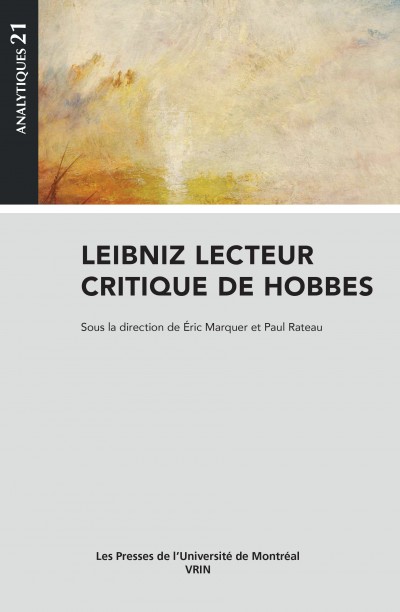 Si l’influence de l’auteur du Léviathan sur le jeune Leibniz est attestée depuis les travaux de Ferdinand Tönnies, elle restait jusqu’à présent l’objet de débats sectoriels portant sur des problèmes précis. L’ambition de cet ouvrage collectif, fruit, en partie, du colloque consacré en 2015 à Hobbes et Leibniz à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, dépasse celle d’un relevé systématique des références à l’œuvre de Hobbes dans celle de Leibniz. Elle vise à apporter un éclairage nouveau sur la genèse et le devenir des thèses du philosophe de Hanovre, tout en invitant le lecteur de Hobbes à parcourir son œuvre par de nouveaux chemins, ceux qu’emprunta justement Leibniz ; en effet, lecteur de Hobbes, Leibniz le fut tout au long de sa vie et, si ce ne fut pas le premier, il n’est certainement pas l’un des moindres ; la critique qu’il fit de ses thèses a contribué à irriguer toutes les dimensions d’une œuvre pourtant encyclopédique. D’une approche souvent ardue, Leibniz, lecteur critique de Hobbes s’adresse avant tout aux chercheurs et aux lecteurs avertis de ces deux philosophes. L’ouvrage comporte quatre parties : la première est consacrée à la question du statut de la vérité dans l’articulation entre les mots et les choses ; la deuxième traite de métaphysique et, tout particulièrement, de la question de la causalité et du nécessitarisme ; la troisième prend pour objet la philosophie naturelle de Leibniz où l’apport de la théorie hobbesienne du conatus, expliquant la cohésion des corps, se fait tout particulièrement sentir ; la quatrième partie aborde les questions cruciales de la philosophie du droit, de la philosophie politique et de l’historiographie chez les deux auteurs. Enfin, Leibniz, lecteur critique de Hobbes a le grand mérite de reproduire et de traduire dans leur intégralité à la fin du volume, pour la première fois en français, les deux lettres que Leibniz écrivit, dans sa jeunesse, à Hobbes.
Si l’influence de l’auteur du Léviathan sur le jeune Leibniz est attestée depuis les travaux de Ferdinand Tönnies, elle restait jusqu’à présent l’objet de débats sectoriels portant sur des problèmes précis. L’ambition de cet ouvrage collectif, fruit, en partie, du colloque consacré en 2015 à Hobbes et Leibniz à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, dépasse celle d’un relevé systématique des références à l’œuvre de Hobbes dans celle de Leibniz. Elle vise à apporter un éclairage nouveau sur la genèse et le devenir des thèses du philosophe de Hanovre, tout en invitant le lecteur de Hobbes à parcourir son œuvre par de nouveaux chemins, ceux qu’emprunta justement Leibniz ; en effet, lecteur de Hobbes, Leibniz le fut tout au long de sa vie et, si ce ne fut pas le premier, il n’est certainement pas l’un des moindres ; la critique qu’il fit de ses thèses a contribué à irriguer toutes les dimensions d’une œuvre pourtant encyclopédique. D’une approche souvent ardue, Leibniz, lecteur critique de Hobbes s’adresse avant tout aux chercheurs et aux lecteurs avertis de ces deux philosophes. L’ouvrage comporte quatre parties : la première est consacrée à la question du statut de la vérité dans l’articulation entre les mots et les choses ; la deuxième traite de métaphysique et, tout particulièrement, de la question de la causalité et du nécessitarisme ; la troisième prend pour objet la philosophie naturelle de Leibniz où l’apport de la théorie hobbesienne du conatus, expliquant la cohésion des corps, se fait tout particulièrement sentir ; la quatrième partie aborde les questions cruciales de la philosophie du droit, de la philosophie politique et de l’historiographie chez les deux auteurs. Enfin, Leibniz, lecteur critique de Hobbes a le grand mérite de reproduire et de traduire dans leur intégralité à la fin du volume, pour la première fois en français, les deux lettres que Leibniz écrivit, dans sa jeunesse, à Hobbes.
La question du nominalisme
La critique leibnizienne du nominalisme outré de Hobbes – Leibniz le qualifie ainsi de « plusquam nominalis » dans sa Préface au De veris principiis et vera ratione philosophandi de Nizolius – occupe une place centrale dans l’ouvrage, tant il est vrai qu’elle a des répercussions sur tous les autres domaines de la philosophie de Leibniz. Néanmoins, pour séminale qu’elle soit, elle n’est pas aussi univoque que le laisserait supposer la virulence de certaines estocades que Leibniz porte à Hobbes, ni aussi justifiée qu’on pourrait le croire.
C’est ainsi que Martin Schneider revient, dans un article d’une grande clarté[1], sur la genèse de cette critique. Tout en s’accordant avec Hobbes pour penser que la philosophie ne doit s’occuper que des choses concrètes singulières et pour concevoir les abstraits comme de simples noms, Leibniz affirme pourtant qu’il est allé trop loin dans son nominalisme qui aboutirait à faire dépendre la vérité de l’arbitraire humain. Or si Hobbes affirme que les définitions des noms est arbitraire, la vérité, elle, ne l’est pas puisqu’elle repose sur l’agencement correct des noms, agencement qui obéit à des critères que Leibniz reprend lui-même à son compte, comme le principe de non-contradiction et le « lumen naturale » qui nous fait consentir à des vérités axiomatiques. Toutefois, contrairement à Leibniz, Hobbes n’admettra jamais que les définitions et les explications nous donnent accès à la réalité des choses mêmes, seulement à leurs représentations.
Dans « L’objection leibnizienne au conventionnalisme de Hobbes »[2], Christian Leduc examine le rôle de l’analyse dans l’élaboration des démonstrations selon Hobbes qui, selon lui, vient compléter voire étayer les définitions nominales. En empêchant la formation de définitions comprenant des réquisits incompatibles, l’analyse impose aux définitions humaines la contrainte de la concevabilité, c’est-à-dire, de la non-contradiction.
L’article « Leibniz, Hobbes et les principes des sciences »[3] reprend à nouveau frais cette question à travers les différentes inflexions de l’œuvre de Leibniz. Marine Picon y revient sur la question de la réception de l’œuvre hobbesienne par d’autres auteurs comme Arnaud et Nicole, et montre comment la lecture de la Logique de Port Royal a pu influencer celle que Leibniz fait, entre autres, du De corpore. Dès lors, la critique du caractère arbitraire de la vérité et du fondement ultime de la science telle que Leibniz la conçoit chez Hobbes s’élabore dans un premier temps dans l’Accessio ad arithmeticam infinitorum de 1672, avant de trouver une résolution dans le Quid sit idea de 1676. Or, selon Picon, non seulement Leibniz aurait tiré de la lecture de Hobbes sa critique de la distinction et de la clarté comme critère de la vérité chez Descartes, mais également la principale composante de sa doctrine de la définition réelle, à savoir l’inclusion dans ce qui est défini d’un mode possible de sa génération.
La causalité et la question du nécessitarisme
La deuxième partie de l’ouvrage est consacrée à la question du nécessitarisme de Hobbes à l’égard duquel Leibniz a probablement adressé ses critiques les plus précises, mais aussi les plus séminales au regard de sa propre métaphysique.
Dans le premier article de cette section[4], Jean-Pascal Anfray part de la distinction entre le déterminisme – selon lequel rien n’est sans raison – et le nécessitarisme – selon lequel tout ce qui est possible est actuel, c’est-à-dire a été, est ou sera effectif – pour examiner le rapport que Leibniz entretient avec son propre déterminisme ainsi qu’au nécessitarisme de Hobbes. Leibniz estime que Hobbes a tiré, à tort, son nécessitarisme du déterminisme causal : plus précisément, Hobbes aurait inféré de l’idée selon laquelle tout possible exige une cause possible l’idée selon laquelle une chose ou une action auxquelles il manque une cause actuelle est impossible. Or, aux yeux de Hobbes lui-même, cette inférence n’est pas valide. Il s’agit plutôt de penser que le possible doit être pensé à partir de la potentialité, qui définit une possibilité réelle lorsque l’ensemble des réquisits causaux d’un état de chose est présent. C’est l’occasion pour Anfray de revenir sur le glissement de Leibniz lui-même quant à sa propre conception du réquisit qui, d’une notion quasi causale, devient une composante conceptuelle. Or cet écart n’explique pas l’ambivalence de Leibniz au sujet de la possibilité, notion qu’il fait reposer tantôt sur la possibilité d’une cause, qu’Anfray rattache à la relation expressive de l’ « indigentia » (tout possible renvoie, en raison de la connexion universelle, à l’ensemble des possibles dans le même monde) tantôt sur la simple non-contradiction interne d’un concept, qu’il renvoie à la relation métaphysique d’inhérence.
Dans « Leibniz critique du nécessitarisme de Hobbes »[5], Martine Pécharman revient sur le souci de Leibniz de montrer jusqu’où la conception hobbesienne de la causalité est compatible avec la sienne, et en quoi celle-ci est insoutenable, occasion qui lui est fournie par la dispute entre Bramhall et Hobbes sur la question de la liberté, de la nécessité et du hasard. Ainsi Leibniz s’approprie-t-il la théorie hobbesienne de la cause entière – un événement advient lorsque sont réunies toutes les conditions requises à son existence – tout en refusant de la confondre, comme le fait Hobbes, avec la cause nécessaire. Hobbes concluait à l’impossibilité des états de faits auquel il manque un réquisit, et à la nécessité des états de faits dont tous les réquisits sont réunis. À cela Leibniz répond qu’un état de fait possible auquel il manque le décret divin qui le fait advenir n’en demeure pas moins possible, et qu’un état de fait existant n’obéit pas à une nécessité absolue, mais à une nécessité hypothétique, puisque son existence est suspendue à ce même décret divin.
La controverse entre Hobbes et Bramhall occupe également une place centrale dans l’article[6] qu’Arnaud Lalanne consacre à cette question. Il y fait l’hypothèse d’une analogie, dans la théologie naturelle de Leibniz, entre les attributs divins de l’omnipotence, de l’omniscience et de la bonté et les facultés humaines du pouvoir, de l’entendement et de la volonté. Aux yeux de Leibniz, Hobbes aurait accordé une primauté démesurée à la toute-puissance, au risque de rompre cette analogie. En faisant dépendre l’efficience de Dieu de sa sagesse et de son omniscience, Leibniz rend possible la critique de la nécessité absolue telle que la conçoit Hobbes : tout arrive par une nécessité hypothétique, conforme au plan divin, ce qui ne change rien à la liberté de l’individu qui, lui, n’a pas connaissance des futurs contingents. À l’absolutisation de la toute-puissance chez Hobbes répond celle de la volonté chez Bramhall. Là où celui-ci postule une capacité de la volonté à choisir ce qu’elle veut, Leibniz avance une puissance oblique sur nos volitions, dont la clé est la maîtrise du temps : nous pouvons lutter contre la prédétermination de notre volonté, et tout particulièrement contre l’habitude, en nous donnant le temps de trouver de nouvelles raisons d’agir dans un sens plutôt que dans un autre. Aussi la prédétermination de la volonté incline-t-elle sans pour autant nécessiter. Tout l’enjeu des Essais de Théodicée consistera donc, pour Leibniz, à montrer pourquoi la nécessité morale par laquelle Dieu fait advenir le meilleur des mondes possibles ne contredit pas sa toute-puissance.
C’est au troisième volet de la controverse entre Bramhall et Hobbes, la question du hasard, qu’Éric Marquer consacre ses réflexions[7]. Pour Hobbes comme pour Leibniz, si le hasard n’est que le nom que l’on donne à l’ignorance des causes qui déterminent un événement, la place qu’ils vont lui attribuer au sein de leur pensée diffère. Ainsi la distinction que Hobbes opère entre prudence et science le conduit à penser que la contingence est une illusion produite par notre entendement limité, signe de notre incapacité à connaître l’ensemble des enchaînements causaux et à en prédire les effets. L’homme prudent sera donc incapable de prévoir ce qui doit arriver à partir de la connaissance partielle de causes de toutes les manières trop complexes pour qu’il puisse en mesurer la portée. Il se tournera alors vers la science (science politique, en particulier), seule capable de produire des effets nécessaires et prévisibles. Pour Leibniz, au contraire, la contingence peut être soumise à une maîtrise théorique et pratique, l’incertain pouvant faire l’objet d’un calcul de probabilité, ce qui lui permet d’élaborer, dans sa philosophie du droit, une théorie de la combinatoire des lois pour traiter l’ensemble des cas particuliers qui pourraient se présenter à une juridiction.
La philosophie naturelle
Autre point de rencontre entre Leibniz et Hobbes, la question de la physique en général et du matérialisme en particulier fait l’objet de la troisième partie de Leibniz, lecteur critique de Hobbes.
Dans « La lecture leibnizienne du De Corpore de Hobbes »[8], José Médina s’emploie à montrer les apports de la physique hobbesienne dans la pensée leibnizienne de l’élasticité de la matière et du mobilisme interne aux corps, apports qui seraient à l’origine de son anti-cartésianisme dans le domaine de la philosophie naturelle, tout particulièrement de son refus d’une force de repos.
Dans sa « Note sur la philosophie du point chez Leibniz et chez Hobbes »[9], Michel Fichant part d’une comparaison précise entre la théorie du point telle que l’élaborent respectivement Hobbes et Leibniz pour montrer comment Leibniz s’en inspirera en partie pour penser les entités métaphysiques – et non plus matérielles, comme chez Hobbes – que sont les monades. Ainsi la pensée de Hobbes donnera à celle de Leibniz une impulsion ou, comme le dit brillamment Fichant, un conatus contraire, puisque c’est dans le domaine des substances simples et immatérielles que la théorie du point trouvera sa pleine application.
François Duchesneau reprend dans son article[10] le fil suivi précédemment par Christian Leduc, à savoir la question de la synthèse (déduction causale des effets à partir de concepts définissant les modes du mouvement) et de l’analyse (remontée des phénomènes vers leurs causes par l’intermédiaire d’hypothèses) de la synthèse (déduction causale des effets à partir de concepts définissant les modes du mouvement) dans le De corpore, et l’influence que ces deux distinctions ont eu sur le système de physique leibnizien. Si cette distinction tranchée se retrouve encore chez Leibniz, elle fait l’objet d’une articulation voire d’une unification dans la Dynamica de potentia. En effet, pour Leibniz, l’ordre des causes et celui des finalités se rejoignent dans la même intelligibilité harmonique, raison pour laquelle il fallait dépasser la partition hobbesienne.
Enfin, dans « Leibniz et le matérialisme de Hobbes »[11], Anne-Lise Rey s’intéresse aux usages conceptuels que Leibniz va faire du matérialisme de Hobbes à travers différents emprunts. En particulier, dans le domaine de la perception, donc de l’action des corps dans la production d’idées, Leibniz aurait été tenté par un rapprochement avec Hobbes, contre l’arbitraire de l’atomisme de Locke. Toutefois, plutôt qu’une preuve du matérialisme de Leibniz, Rey voit dans ces rapprochements ponctuels une manière pour lui d’affirmer la relation entre l’autonomie de la causalité physique et l’hypothèse de l’harmonie préétablie qui permet d’articuler idéalisme et matérialisme.
Le droit, la politique, l’Histoire
C’est sur le thème de la philosophie politique que s’achève Leibniz, lecteur critique de Hobbes, dans une partie qui se caractérise par la variété des sujets choisis.
Sous la forme particulière de la question des châtiments[12], Paul Rateau s’emploie à montrer les tenants et les aboutissants d’une opposition théologique entre Hobbes et Leibniz : en son cœur, le statut, déjà évoqué, de la toute-puissance divine dans son articulation avec le nécessitarisme. Contrairement à ce que pensait Bramhall, et comme l’a bien vu Leibniz, le nécessitarisme de Hobbes ne le conduit pas au sophisme paresseux : les peines et les récompenses produisent au contraire des effets nécessaires qui prédéterminent et modifient le comportement des sujets. Leibniz va davantage s’opposer à la thèse hobbesienne selon laquelle la puissance serait la mesure du droit, et Dieu serait absolument juste, quoi qu’il fasse, en vertu de sa toute-puissance, ce qui conduit Hobbes à faire de Dieu un despote dont le bon plaisir tiendrait lieu de bonté et de raison. Aux yeux de Hobbes, le problème de la théodicée – comment Dieu peut-il permettre qu’il arrive du bien aux méchants et du mal aux bons ? – ne se pose pas : en vertu de sa toute-puissance, Dieu a le droit d’affliger toute créature sans être pour autant injuste. Pour Leibniz, comme chacun sait, cette question est cruciale : il faut penser que le mal n’advient que comme conséquence naturelle du péché, et que les torts que peuvent subir les justes ne sont que des moyens en vue d’un plus grand bien. Mais là où Hobbes restreint la peine à la punition que le souverain inflige à un criminel, Leibniz donne au châtiment une extension très large, puisqu’elle est, sur le plan théologique, l’expression de l’harmonie entre ce qui est et ce qui doit être. Voilà pourquoi le philosophe anglais rejette toute forme de châtiment vindicatif et éternel (puisque le châtiment ne doit se fonder que sur les effets, nécessairement limités, qu’il peut produire, et donc regarder vers l’avenir, contrairement à ce que fait la vengeance), alors que Leibniz fonde la nécessité de la justice vindicative sur l’impossibilité qu’une faute reste impunie et un bienfait sans récompense, en raison du principe d’harmonie, au-delà de toute considération de la souffrance de la victime ou de l’utilité de la peine. Néanmoins le fondement théologique de la philosophie du droit chez Leibniz ne suffit pas à expliquer sa défense de la justice vindicative : il s’agit aussi et surtout d’éradiquer des actions humaines le germe de la disharmonie et de la haine.
Dans « Conciliation avec le Léviathan. La correspondance entre Leibniz-Hobbes »[13], Mogens Lærke examine les deux lettres que le tout jeune Leibniz écrivit en 1671 puis en 1674 au philosophe de Malmesbury, alors âgé de plus de quatre-vingts ans, sans qu’elles ne lui parvinssent jamais. Dans les œuvres de Leibniz, Hobbes peut apparaître alternativement avec deux visages : tantôt sous l’aspect du nominaliste outrancier et penseur dangereux d’un nécessitarisme absolu, tantôt sous celui, réformé par Leibniz lui-même, d’un auteur dont les thèses seraient compatibles avec celles de son jeune lecteur. C’est ce denier Hobbes – celui de Leibniz, donc – qu’on rencontre dans ces deux lettres de jeunesse. Lærke y voit trois tentatives de conciliation avec Hobbes. La première concerne la notion de souverain, et la figure monstrueuse qu’il revêt avec le « Léviathan » : Leibniz s’emploie à montrer que Hobbes ne se réfère pas à un souverain concret mais à une figure abstraite dont les attributs ne se rencontrent au sens plein et entier qu’en Dieu. Le deuxième mouvement de conciliation concerne la conception hobbesienne de l’état naturel des hommes comme « guerre de chacun contre chacun ». Le raisonnement de Leibniz suit la même voie : Hobbes aurait avant tout fait œuvre de mathématicien et de physicien pour concevoir le fondement du politique, en réduisant sciemment la complexité des passions humaines au désir d’appropriation et à la volonté de sûreté, abstraction qui ne se rencontre jamais dans le concret de certaines sociétés qui vivent en paix sans vivre sous le régime de lois, comme Hobbes n’est pas sans l’ignorer. La troisième tentative de conciliation concerne le contractualisme hobbesien qui marque, semble-t-il, une rupture avec les conceptions traditionnelles du droit naturel, puisque au terme de la « convention », rien de ce que peut faire le souverain n’est injuste, quel qu’en soit le motif. Ici, Leibniz va accentuer les inflexions que Hobbes va lui-même donner à son absolutisme, lorsqu’il distingue entre la fin dans laquelle le contrat a été passé, à savoir la conservation du corps des individus, et les mots exprès du contrat par lesquels les ont transféré leur souveraineté naturelle et le droit qu’ils avaient sur toute chose au Léviathan. C’est cet écart qui permet d’expliquer qu’un individu ait la liberté de refuser d’obéir au souverain lorsque celui-ci met en péril la fin dans laquelle le contrat a été passé, sans pour autant être injuste.
Dans son article consacré à la confrontation entre Leibniz et Hobbes sur le terrain politique[14], Luca Baso dégage les grandes lignes de l’opposition de Leibniz aux conceptions hobbesiennes de la liberté et de la souveraineté. Chez Hobbes, la liberté et l’égalité des individus à l’état de nature rendent nécessaire la souveraineté politique, celle-ci instituant la justice ; chez Leibniz, le bien commun et la justice précèdent l’instauration de la souveraineté. Quant à la liberté, la forme juridique et institutionnelle de l’Empire germanique permet de comprendre que, pour Leibniz, la liberté ne concerne pas d’abord un individu à l’état naturel, mais pris dans diverses formes d’appartenances et d’associations. La liberté ne sera donc pas conçue sur le modèle hobbesien d’une absence d’obstacle au mouvement, mais sur celui de la conduite de l’existence humaine sous l’empire de la raison, dans la perspective d’une souveraineté relative et délibérative.
C’est à cette question de la rationalité politique que Philippe Crignon consacre ses réflexions[15]. Si Hobbes est souvent perçu comme une figure repoussoir de la philosophie politique, sa contribution a la conception de l’État moderne est indéniable ; a contrario, Leibniz n’est pas affligé d’une réputation aussi détestable, on peine toutefois à voir en lui un penseur de la modernité politique : il serait plutôt l’un des derniers défenseurs du droit médiéval chrétien. À rebours de ces idées reçues, Crignon va s’employer à montrer que Leibniz comme Hobbes a développé des conceptions de la souveraineté particulièrement prégnantes et fécondes pour la modernité. Là où Hobbes a développé, au fil de ses œuvres, un paradigme stato-centré et fondationnel de la souveraineté, celle-ci étant garantie par la forme juridique correcte des institutions, Leibniz va développer, à l’occasion de sa critique de Pufendorf, une conception de la souveraineté relative fondée sur la délibération entre plusieurs instances souveraines, sur le modèle de la co-souveraineté de l’Empereur et des Princes des États du Saint-Empire. Cette raison délibérative trouve à s’appliquer, chez Leibniz, dans une réflexion sur le rapport entre les États souverains sur la scène internationale, et sur le fédéralisme. Ainsi cette concordance des temps avec l’époque actuelle inscrit pleinement Leibniz dans la modernité politique.
Cette question en amène naturellement une autre, celle du rapport qu’ont entretenu Hobbes et Leibniz à l’écriture de l’histoire. Dans « Hobbes et Leibniz, philosophes et historiographes. Un portrait croisé »[16][17], Nicolas Dubos rend compte de deux paradoxes qui ont structuré leurs travaux respectifs. Alors que notre incapacité à connaître l’enchaînement complexe des causes devrait nous interdire l’accès à la rationalité de l’Histoire, Hobbes a développé un système causal d’explication des faits historiques ; inversement, Leibniz qui a affirmé la rationalité du réel, a aussi pensé notre incapacité à la saisir. D’autre part, alors que l’on peut considérer Leibniz comme un historien à part entière, Dubos avance l’idée selon laquelle Hobbes a fourni à la discipline historique l’articulation entre science naturelle, histoire des cultures et interprétation des Ecritures.
[1] Martin Schneider, « Le nominalisme chez Leibniz et chez Hobbes », dans Éric Marquer et Paul Rateau (dir.), Leibniz, lecteur critique de Hobbes, Les Presses Universitaires de Montréal, Vrin, 2017, p. 21-33.
[2] Christian Leduc, ibid., p. 35-51.
[3] Marine Picon, ibid., p. 53-73.
[4] Jean-Pascal Anfray, « Possibilité, causalité et réquisits chez Hobbes et Leibniz », p. 77-104.
[5] Martine Pécharman, ibid., p. 105-137.
[6] Arnaud Lalanne, « L’étude du rapport pouvoir-vouloir-savoir dans les Réflexions de Leibniz sur la Controverse entre Hobbes et Bramhall », p. 139-156.
[7] Éric Marquer, « Hobbes et Leibniz sur le hasard », p. 157-173.
[8] José Médina, ibid., p. 177-204.
[9] Michel Fichant, ibid., p. 205-218.
[10] François Duchesneau, « Leibniz et la méthode de Hobbes au fondement de la philosophie naturelle », p. 219-235.
[11] Anne-Lise Rey, ibid., p. 237-248.
[12] Paul Rateau, « Leibniz, Hobbes et le problème de la justice vindicative », p. 251-279.
[13] Mogens Lærke, ibid., p. 281-294.
[14] Luca Baso, « Leibniz, critique de Hobbes. La politique moderne entre liberté et souveraineté », p. 295-306.
[15] Philippe Crignon, « Deux rationalités politiques de la modernité. Hobbes et Leibniz sur l’État », p. 308-338.
[17] Nicolas Dubos, ibid., p. 339-364.














