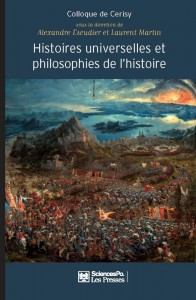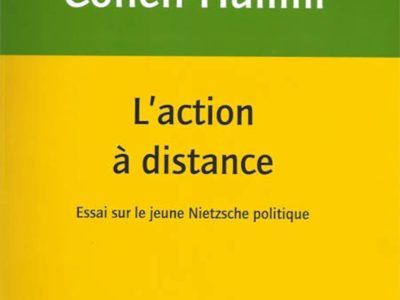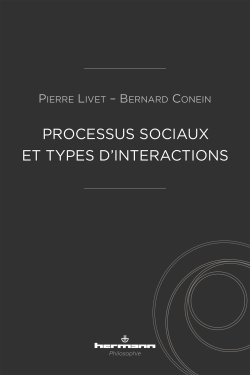Recension – Histoires universelles et philosophies de l’histoire
Alexandre Escudier & Laurent Martin (dir.), Histoires universelles et philosophies de l’histoire, Paris, Presses de Sciences Po, 2015, 405 p.
Recension rédigée par Gilles Marmasse, Université de Poitiers
Ce volume collectif, issu d’un colloque de Cerisy, se propose de réfléchir à la question de l’histoire, en confrontant approches philosophiques et approches proprement historiennes. Il s’agit notamment d’examiner les origines de l’idée d’« histoire globale », paradigme historiographique dont la légitimité s’affirme aujourd’hui fortement. Comme on le sait l’histoire globale, en réaction aux histoires nationales, étudie les interactions entre les peuples ou les groupes culturels. Or l’hypothèse qui préside à ce livre est que l’histoire globale est l’héritière d’une tradition intellectuelle au croisement de l’histoire universelle (qui remonte à l’Antiquité) et des philosophies de l’histoire (qui s’épanouissent à l’époque des Lumières). L’histoire universelle vise à présenter l’histoire de l’humanité dans son ensemble, tandis que la philosophie de l’histoire s’efforce de dégager le sens unifié du devenir humain. L’ouvrage montre en quoi l’étude conjointe de ces deux mouvements intellectuels peut être fructueuse.
Trois grandes parties structurent l’ouvrage. D’abord, l’examen de la tradition allemande de philosophie de l’histoire, de Kant à Norbert Élias. Ensuite, une étude des catégories qui sous-tendent le discours des historiens quand ils évoquent les rapports entre des nations distinctes, comme celles de « barbarie » ou de « civilisation ». Enfin, une réflexion sur les modèles de l’histoire universelle. On ne peut que saluer l’envergure des articles composant cet ouvrage, qui souvent synthétisent des recherches de longue haleine. La richesse du contenu défie toute présentation exhaustive, et on nous pardonnera de faire quelques choix.
Dans son article, Bertrand Binoche propose une typologie des philosophies de l’histoire – une manière de refuser leur identification à la seule figure kantienne-hégélienne. Il distingue trois ambitions possibles pour celles-ci (qui sont éventuellement compossibles mais ne s’entre-impliquent pas) : garantir la vérité des faits, montrer leur cohérence, établir l’identité de l’« historique » et du « réel ». Une philosophie de l’histoire peut être, par ailleurs, « catholique » au sens où elle concerne l’ensemble de l’humanité prise comme un tout, ou « générale » au sens où elle résulte de l’addition des histoires particulières. Enfin, une philosophie de l’histoire peut être téléologique (selon le modèle allemand de Fichte à Hegel), inductive (selon le modèle écossais de Hume) ou tabulaire (selon le modèle français de Condorcet).
Christophe Bouton, à l’encontre des clichés, montre la complexité de l’analyse du grand homme chez Hegel. D’un côté, il sort de l’action du grand homme autre chose que ce que ce dernier aurait voulu – le grand homme est grand malgré lui. De l’autre, loin d’être ignorant des enjeux de son époque, le grand homme possède une capacité exceptionnelle à saisir et à réaliser le « principe universel » de son temps. Y a-t-il ici une contradiction pure et simple ? Il convient, en réalité, de noter que le grand homme, pour Hegel, ne connaît la tâche de son époque que de manière intuitive : il est sûr de son dessein, mais incapable d’anticiper la marche des événements. Christophe Bouton montre par ailleurs la riche descendance philosophique du concept de grand homme (Clausewitz, Cousin, Droysen, Guizot…), mais aussi les contre-figures qu’il a suscitées chez Hugo et Marx.
Marc de Launay et Alexandre Escudier décrivent l’évolution de la conception de l’histoire dans le monde germanophone, en insistant notamment sur le rôle de Droysen. Il y a lieu, plus précisément, de distinguer tout d’abord l’histoire « pragmatiste » qui s’enseigne dans les universités allemandes au xviiie siècle, et se signale par son ambition systématique. Cette histoire, dont la personnalité la plus brillante est Schlözer, est marquée par l’idée rousseauiste d’une humanité indéfiniment perfectible. Droysen, en deuxième lieu, admet à la fois la permanence d’une tradition culturelle jouant le rôle de donné préalable, et le caractère irréversible de l’innovation individuelle transformant ce donné. Enfin, Troeltsch propose une réflexion épistémologique sur les individualités historiques par lesquelles les valeurs adviennent, et une réflexion historique sur la culture partagée en Europe (l’« européisme »). Il s’efforce par là de défendre l’idée selon laquelle le libéralisme politique est le seul système capable de rendre le pluralisme des valeurs politiquement viable.
Servanne Jolivet met en évidence l’originalité du projet diltheyen, qui refuse toute position de surplomb, et néanmoins ne renonce ni à penser le sens de l’histoire ni à présupposer son unité et sa cohérence. Chez Dilthey, la question du sens de l’histoire se déplace de la saisie du tout de l’histoire à la saisie de la cohésion de sens de chaque contexte historique. D’une manière inattendue, montre Servanne Jolivet, Dilthey parvient ainsi à échapper à l’écueil du relativisme : puisqu’il n’y a plus de perspective transcendante, puisque tout jugement est fondamentalement contextualisé, chaque époque propose un horizon indépassable, seul point d’ancrage pour la connaître et la juger. En d’autres termes, c’est en prenant conscience de la finitude de toute apparition historique qu’on se libère du scepticisme engendré par l’antagonisme des valeurs.
Dans sa contribution, Laurent Martin étudie une famille de pensée qui se caractérise par son « pessimisme culturel ». Freud, Adorno, Horkheimer et Elias conçoivent en effet la civilisation moderne comme essentiellement répressive : enserrant les Européens dans des contraintes toujours plus fortes, elle engendrerait une forme de barbarie. Il y a cependant, souligne Laurent Martin, d’importantes différences entre ces auteurs. Au pessimisme foncier de Freud, lié à la thèse selon laquelle il est impossible d’éradiquer les pulsions d’agression, s’oppose l’optimisme mesuré d’Elias, qui espère en la capacité réflexive de l’homme et en l’évolution socio-historique pour dépasser les contradictions de l’individu et du collectif. Tous deux font de la « barbarie » une chute, une rupture, une régression vers un état archaïque de l’humain. À l’inverse, Adorno et Horkheimer adoptent une vision radicalement désenchantée du monde moderne et placent au cœur de leur inquiétude le rôle, largement ignoré des deux premiers, de la science et de la technique.
Jean-Marc Ferry défend la thèse selon laquelle l’histoire universelle peut être relue à partir des liens illocutionnaires entre les cultures. Pour lui, il y a entre les séquences de l’histoire du monde un dialogue transculturel, au sens où toute expression symbolique advenue dans une certaine culture et à une certaine époque vaut comme une proposition de sens adressée à toute culture extérieure : « En relevant cette offre illocutionnaire, une culture historique établit une communication avec une autre, et cette communication rétrospective tisse le lien de l’histoire universelle. » Par exemple, c’est la communication nouée entre l’Europe médiévale et renaissante avec la Grèce classique qui a fait de cette dernière un pilier fondateur de la civilisation européenne. Un événement culturel peut certes en suivre un autre sans pour autant mériter le statut de « réponse » à la supposée « question » de l’événement qui précède. Mais alors il ne s’agit que d’une succession dans le temps physique. Il n’y a de liaison proprement historique que si celle-ci est illocutoire.
Silvia Caianiello met en évidence les principaux jalons historiques du concept d’époque, en montrant notamment le rôle que les sciences de la vie ont joué dans la construction de l’histoire comme science. Par exemple, dit-elle, on peut comprendre l’opposition entre Herder et Hegel à propos de l’histoire en la ramenant à celle d’un modèle épigénétique et d’un modèle préformiste. De même, on peut éclairer la notion de temps chez Braudel à l’aide de la théorie des systèmes organiques développée par L. von Bertalanffy et C.H. Waddington. Cette dernière théorie, en effet, invite à découper le monde (et le monde vivant en particulier) en plans étagés afin d’en rendre compte comme d’une pluralité intégrée. Il y a ainsi le temps long de l’évolution (objet de la théorie de l’évolution), le temps moyen du développement (objet de l’embryologie), et le temps court de la régénération énergétique et des réactions chimiques (objet de la physiologie). De fait, cette tripartition fait irrésistiblement penser à la distinction braudélienne entre l’histoire quasi-immobile de l’homme dans ses rapports avec son milieu, l’histoire sociale lentement rythmée, et l’histoire événementielle à oscillations brèves.
Abdesselam Cheddadi étudie le modèle d’explication socio-historique d’Ibn Khaldûn. Le travail de l’historien arabe, montre-t-il, est gouverné par la question du caractère unitaire ou pluriel de la civilisation humaine, par celle du caractère limité ou illimité de son développement, et par celle des facteurs de l’évolution historique. Dans le contexte propre à la culture musulmane, Ibn Khaldûn révèle la possibilité d’une approche « scientifique » de la société humaine. En effet, alors que l’histoire était considérée depuis Aristote comme l’étude du singulier, Ibn Khaldûn tente d’en faire une science de l’universel. La combinaison qu’il établit entre l’observation et la généralisation, ses études sérielles des faits sociaux, politiques et institutionnels, et sa construction de modèles explicatifs ne se retrouveront, finalement, que dans les sciences sociales modernes.
Christian Grataloup réfléchit à la question de la connexion entre les sociétés. Il réclame de sortir de l’alternative entre, d’une part, des histoires simplement parallèles et, d’autre part, une histoire où les civilisations seraient classées selon leur degré de similitude avec le parcours occidental. Il promeut en revanche une histoire « connectée » ou « métisse ». Mais la connexion, dit-il, est toujours complexe. On peut illustrer la diversité des modes et des degrés de contact entre les aires de populations à l’aide de l’histoire des pandémies. Quand il y a connexion, les maladies se répandent ; mais elles se propagent aussi suffisamment pour permettre la diffusion des anticorps. A contrario, l’absence de relations, durant des millénaires, entre l’Ancien monde et les Amérindiens explique que ces derniers, au xvie siècle, ont été incapables de résister aux pathologies apportées par les conquistadors et se sont effondrés démographiquement. Pour Christian Grataloup, les sociétés sont écartelées entre deux distances. D’une part, dès que des membres d’un même groupe originel s’éloignent trop les uns des autres, ils ont du mal à communiquer entre eux. D’autre part, les groupes humains migrent et sont capables de vivre dans les milieux les plus disparates. Ce double fait explique qu’il n’y ait qu’une seule humanité mais de très nombreuses sociétés – des sociétés qui cependant communiquent, échangent et rivalisent entre elles.
Catherine Colliot-Thélène, enfin et de manière très originale, propose de nuancer la thèse commune d’une histoire qui serait marquée par une abolition tendancielle des différences entre les hommes et par une « communauté humaine » toujours plus homogène. À cette fin, elle invoque la conception kantienne de la « politique morale », selon laquelle les droits subjectifs reviennent à l’individu en tant que tel, et non au titre de son appartenance communautaire. En effet, montre-t-elle, la république kantienne n’est pas une communauté mais l’aménagement juridique des rapports que les hommes sont forcés d’entretenir entre eux. Il y a lieu, soutient Catherine Colliot-Thélène, de faire nôtre cette conception en prenant acte de ce que le monde politique est irréductiblement un pluriversum – ceci, toutefois, non pas au sens d’une juxtaposition de communautés, mais au sens d’une coexistence non hiérarchisée d’instances de pouvoir hétérogènes. En d’autres termes, si l’on abandonne le fantasme d’une humanité communautaire réconciliée avec elle-même, on acceptera de concevoir la politique comme l’articulation, toujours problématique, des pouvoirs et des droits, et on comprendra que ce qui fait l’unité de notre monde est aussi bien ce qui le divise. De sorte qu’un cosmopolitisme en phase avec la réalité de l’histoire doit se passer de l’histoire universelle.
Assurément, l’ouvrage est d’une lecture indispensable pour qui veut s’instruire en philosophie de l’histoire et en historiographie. Il dresse le panorama le plus riche des élaborations conceptuelles relatives à l’histoire, en ne sacrifiant ni l’exactitude de l’analyse ni le souci de la problématisation. Mais l’intérêt le plus grand de l’ouvrage, finalement, est de montrer que, si nous sommes sortis des modèles classiques de philosophie de l’histoire, il y a aujourd’hui une philosophie de l’histoire bien vivante, celle qui réfléchit notamment aux notions d’« époque », d’« évènement », de « pluralisme des valeurs » et de « communauté humaine ».