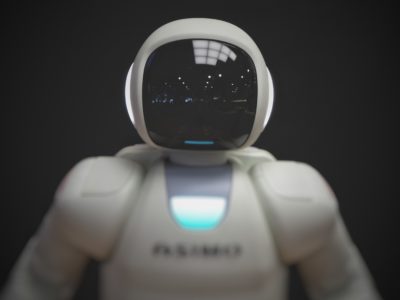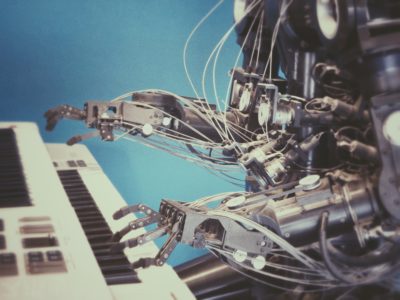La construction sociale du genre comme construction sociale
Sébastien Chauvin est professeur associé au Centre en études genre de l’Institut des sciences sociales à l’Université de Lausanne, où il co-préside la Plateforme interdisciplinaire en études genre (PlaGe). Il est co-auteur, avec Laure Bereni, Alexandre Jaunait et Anne Revillard, de l’Introduction aux études sur le genre (3ème édition, De Boeck, 2020).
Résumé
Faut-il distinguer sexe et genre ? Cet article ne répond pas à la question mais réfléchit aux manières dont le monde y répond et aux implications de ces réponses pour l’analyse des transformations du rapport entre vérité et subjectivité. Il revient d’abord sur les tentatives pour rendre compte de la genèse historique conjointe du genre et du sexe et penser la persistance de leur distinction. Il décrit ensuite la diversité contemporaine des manières d’appréhender le genre comme construction sociale et se demande enfin ce que les appropriations sociales du constructivisme font au genre comme fait social.
Mots-clés : genre ; sexe ; épistémologie ; construction sociale ; identité ; performativité ; sociologie ; réflexivité
Abstract
Must sex and gender be distinguished? This article does not answer the question but reflects on how the world answers it and on the implications of these answers for contemporary transformations of the relation between truth and subjectivity. Its first section reviews intellectual attempts at thinking the joint historical genesis of sex and gender and accounting for the perdurance of their distinction. After describing in the second section the diversity by which gender is approached as a social construction today, the last section reflects on what social appropriations of constructionism do to gender as a social fact.
Keywords: gender; sex; epistemology; social construction; identity; performativity; sociology; reflexivity
Introduction[1]
Si la notion de sexe a fait l’objet de nombreuses études sur son évolution historique et sa construction biomédicale[2], celle de genre a davantage été appréhendée comme « catégorie utile d’analyse » et moins comme objet historique à analyser[3]. La critique constructiviste de la distinction sexe-genre, en mettant principalement en avant, sous divers langages théoriques, la construction sociale du sexe par le genre, s’est ainsi moins interrogée sur l’autre versant de la distinction, la construction sociale du genre comme entité sociale. Elle a eu tendance à théoriser le genre comme acteur de la construction du biologique, faisant comme si la thématisation du genre comme objet culturel relevait d’une découverte et non d’une nouvelle construction sujette à objectivation.
Cet article propose un retour sur les enjeux du mouvement simultané de « socialisation » du genre et de biologisation du sexe, d’abord dans quelques textes clés qui ont entrepris de penser leur articulation historique, puis à travers une réflexion sociologique sur les appropriations du genre au sein d’un « sens commun constructiviste »[4], s’intéressant à la façon dont la « construction sociale de la réalité » constitue aujourd’hui une des modalités de construction de la réalité. Sans décider s’il faut opérer ou non la distinction entre sexe et genre, il part du constat que nos sociétés la font de plus en plus, alors même qu’on ne compte plus, dans le monde académique, les théories qui la remettent en cause. Plutôt que polémiquer avec une époque qui construit le sexe comme fait biologique et le genre comme fait social, il réfléchit à ce que leur distinction produit et examine l’infrastructure de sa mise en pertinence. Dans un contexte contemporain où le genre se distingue du sexe et réciproquement, il revient spécifiquement sur les débats que font surgir les nouvelles appréhensions performatives du genre nourries de constructivisme. Il décrit les hiérarchies ontologiques qu’elles dessinent dans l’expression et la régulation de l’identité individuelle, donnant à voir les différentes manières dont l’opposition entre le construit et le non-construit s’y déploie ou s’y trouve contestée.
I – La coproduction du genre et du sexe
La distinction sexe-genre, qui avait été centrale aussi bien pour la psychiatrie des années 1950-60 que pour les féminismes des années 1970-80, se trouve de plus en plus remise en question au tournant des années 1990. La critique de cette distinction est commune au féminisme matérialiste et au féminisme poststructuraliste. Pour Judith Butler, par exemple, « si l’on mettait en cause le caractère immuable du sexe, on verrait peut-être que ce que l’on appelle “sexe” est une construction culturelle au même titre que le genre ; en réalité, peut-être le sexe est-il toujours déjà du genre et, par conséquent, il n’y aurait plus vraiment de distinctions entre les deux »[5]. À la même époque, Christine Delphy propose une relecture matérialiste de la distinction sexe-genre : plutôt qu’un « idéal du moi » individuel permettant d’opposer le social au biologique, le genre devient le rapport social, fondé sur une relation d’exploitation, qui met en pertinence la dualité des sexes, gardant leurs frontières, organisant leurs différences matérielles et symboliques et reproduisant leurs inégalités[6]. Dans cette perspective, personne n’a de genre, ni au singulier ni au pluriel. Un individu n’a pas plus un genre qu’il n’aurait un capitalisme ou un racisme ; on a un sexe comme on a une classe ; il n’y a qu’un genre, et des sexes. Le genre est le système ou le rapport social : il devient quasi-synonyme de patriarcat.
Un faisceau de traditions, qu’il est impossible de restituer ici, entreprend ainsi de dépasser les définitions précédentes du genre comme « sexe social » propre à chaque individu. Dans ces nouvelles approches, le « sexe » demeure pour l’essentiel une catégorie de la pratique sociale et non un concept de l’analyse. C’est la raison pour laquelle le terme reste parfois entre guillemets, comme dans le titre de l’ouvrage de Judith Butler, Ces corps qui comptent. De la matérialité et des limites discursives du « sexe », paru en 1993 : le « sexe » (catégorie de la pratique) n’est pas le sexe (catégorie de l’analyse), l’argument est épistémologique plus qu’ontologique et l’exposé des effets de la « matérialité du sexe » comme discours ne vaut pas négation de toute matérialité en dehors du discours.
 D’autres auteur·ices défendent au contraire la nécessité d’un concept de sexe comme catégorie analytique. Pour Jay Prosser, cette nécessité est politique. Depuis un point de vue trans, Prosser reproche en effet à la théorie queer d’avoir selon lui pathologisé, au nom de l’anti-essentialisme, la volonté individuelle de « réconcilier » la matérialité sexuée avec l’identité genrée. Or, selon Prosser, les personnes trans ont besoin de la distinction sexe-genre : pour penser la dysphorie de genre, rendre sa remédiation intelligible, mais aussi plus généralement pour théoriser la domination cisgenre et la cis-normativité[7]. Pour d’autres chercheur·ses, la distinction sexe-genre répond à une nécessité scientifique. Chez Priscille Touraille, par exemple, celle-ci permet d’éviter l’« erreur constructiviste radicale » consistant à prétendre qu’il n’y a pas de caractères sexués collectifs liés entre eux en dehors d’une société donnée. Alors que, dans le sillage du féminisme matérialiste, l’Introduction aux études sur le genre propose de traduire « gendered » et « gendering » par « sexué » et « sexuation »[8], il s’agirait au contraire pour Touraille de distinguer clairement entre les « traits sexués du corps » comme « produits de l’information génétique » et les « traits genrés » comme « non héritables génétiquement »[9]. De même, pour Thierry Hoquet, s’il faut maintenir la distinction entre sexe et genre, c’est que le sexe tel qu’appréhendé par la biologie demeure un « concept essentiel de notre compréhension du vivant »[10]. Hoquet propose ainsi un « alternaturalisme » qui prenne le sexe au sérieux dans son autonomie biologique sans pour autant lui attribuer un rôle législatif sur le social. S’il s’agit néanmoins pour lui de prendre « acte de la continuité ou de l’indissociabilité du naturel et de l’artificiel »[11], d’autres courants prennent argument de cette indissociabilité pour proposer des concepts « continus » à même de la restituer analytiquement, de la « natureculture » chez Donna Haraway[12], à l’« intra-action » (entre nature et culture) chez Karen Barad[13], jusqu’à la notion de « gender/sex » chez Anne Fausto-Sterling[14], ou celle de « gendersex » (à la fois comme nom et comme verbe) chez Sølve Holm[15].
D’autres auteur·ices défendent au contraire la nécessité d’un concept de sexe comme catégorie analytique. Pour Jay Prosser, cette nécessité est politique. Depuis un point de vue trans, Prosser reproche en effet à la théorie queer d’avoir selon lui pathologisé, au nom de l’anti-essentialisme, la volonté individuelle de « réconcilier » la matérialité sexuée avec l’identité genrée. Or, selon Prosser, les personnes trans ont besoin de la distinction sexe-genre : pour penser la dysphorie de genre, rendre sa remédiation intelligible, mais aussi plus généralement pour théoriser la domination cisgenre et la cis-normativité[7]. Pour d’autres chercheur·ses, la distinction sexe-genre répond à une nécessité scientifique. Chez Priscille Touraille, par exemple, celle-ci permet d’éviter l’« erreur constructiviste radicale » consistant à prétendre qu’il n’y a pas de caractères sexués collectifs liés entre eux en dehors d’une société donnée. Alors que, dans le sillage du féminisme matérialiste, l’Introduction aux études sur le genre propose de traduire « gendered » et « gendering » par « sexué » et « sexuation »[8], il s’agirait au contraire pour Touraille de distinguer clairement entre les « traits sexués du corps » comme « produits de l’information génétique » et les « traits genrés » comme « non héritables génétiquement »[9]. De même, pour Thierry Hoquet, s’il faut maintenir la distinction entre sexe et genre, c’est que le sexe tel qu’appréhendé par la biologie demeure un « concept essentiel de notre compréhension du vivant »[10]. Hoquet propose ainsi un « alternaturalisme » qui prenne le sexe au sérieux dans son autonomie biologique sans pour autant lui attribuer un rôle législatif sur le social. S’il s’agit néanmoins pour lui de prendre « acte de la continuité ou de l’indissociabilité du naturel et de l’artificiel »[11], d’autres courants prennent argument de cette indissociabilité pour proposer des concepts « continus » à même de la restituer analytiquement, de la « natureculture » chez Donna Haraway[12], à l’« intra-action » (entre nature et culture) chez Karen Barad[13], jusqu’à la notion de « gender/sex » chez Anne Fausto-Sterling[14], ou celle de « gendersex » (à la fois comme nom et comme verbe) chez Sølve Holm[15].
Qu’elles concluent à la nécessité de distinguer sexe et genre, ou au contraire cherchent à conceptualiser leur inséparabilité, ces approches ont en commun d’envisager la relation entre les deux catégories comme une question ontologique. Par contraste, dans cet article on considèrera cette distinction comme une dichotomie sociale, appréhendable avec les mêmes approches sociologiques que d’autres distinctions. Dans cette perspective, s’il est bien impossible de se passer de la dualité entre sexe et genre, c’est dans la mesure où elle est faite par les personnes, les collectifs et les institutions, et se trouve incorporée au sens commun dans un monde où elle importe parce qu’elle y est pertinente en pratique.
Il ne s’agit pas alors de se demander si l’on doit ou non distinguer entre les deux catégories, mais de suivre la manière dont celles-ci sont effectivement distinguées, examiner ce qu’il se passe lorsqu’elles émergent, et s’intéresser à leurs implications[16]. Ainsi, bien qu’elle s’en approche par certains aspects, cette réflexion se sépare des perspectives anthropologiques normatives ambitionnant de « disqualifier la dichotomie entre nature et société »[17], ou réfléchissant à « la façon dont peut être dépassée l’opposition nature-culture propre à la cosmologie occidentale » à partir de contextes où cette opposition est absente ou contradictoire avec l’ontologie locale[18]. Dans une démarche d’épistémologie réflexive, elle s’interroge sur le problème particulier que posent aux sciences sociales les contextes où cette opposition est au contraire bien présente et dans lesquels son déploiement analytique est, par conséquent, redondant avec l’ontologie locale – la « nôtre ».
Pour les sciences sociales, il y a deux types de catégories de l’analyse, celles qui rompent avec les catégories de la pratique et celles qui les répliquent avec des guillemets afin de les ressaisir dans l’effectivité de leurs conséquences. Dans le contexte de cet article, « sexe » et le « genre » relèvent des secondes : elles sont utiles parce qu’utilisées. Mais comment rendre compte de la réalité de la distinction sexe-genre sans faire pléonasme avec le monde social qui l’opère ? Une première étape serait de mettre fin au double standard consistant, comme le fait parmi d’autres Butler, à mettre des guillemets à « sexe » mais pas à « genre », comme si le premier n’était qu’un objet à expliquer et le second qu’un concept explicatif. À l’inverse, la symétrie dans les guillemets (implicites ou explicites) désigne similairement sexe et genre comme des catégories de la pratique et des formations sociales à objectiver, de même que leur distinction : plus cruciale ici que la neutralité axiologique serait une forme de neutralité ontologique[19].
Historiciser la distinction sexe-genre implique également d’en exposer la dimension relationnelle et donc d’appréhender la biologisation du sexe et la « socialisation » du genre comme les deux faces d’un même processus[20]. Or, même les travaux parmi ceux poussant le plus loin la démarche d’historicisation catégorielle se contentent typiquement d’en historiciser l’une sans historiciser l’autre. Par exemple, défendant dans son ouvrage controversé la thèse d’un rôle central des technologies médicales dans l’émergence de la notion d’identité de genre au 20e siècle, Bernice Hausman affirme que l’historicité du « genre » ne permet pas de parler de genre avant les années 1950 ; mais elle prend moins de précaution épistémologique avec la notion de sexe, majoritairement utilisée sans guillemets, et en grande partie présentée comme le fond duquel le genre se détache[21].
Inversement, lorsque Thomas Laqueur retrace la manière dont la relation sexe-genre a évolué dans la pensée médicale à travers les siècles, il historicise bien la notion de sexe et la causalité variable qui lui a été attribuée. En effet, sa célèbre description du passage d’un modèle de sexe unique à un modèle binaire au tournant du 18e siècle s’adosse à un autre basculement, celui d’une représentation où le genre comme identité sociale serait premier et le sexe biologique un épiphénomène dérivé de celui-ci, à un raisonnement permuté ensuite dans lequel le sexe est ontologiquement et causalement premier et le genre second[22]. Mais son travail d’historicisation du sexe tend paradoxalement à mobiliser le concept de genre, associé au « métaphysique » et à « ce que nous appellerions une catégorie culturelle », de manière transhistorique[23]. Chez Laqueur, c’est le sexe qui se détache progressivement du genre. Or, on peut interroger l’opportunité même de théoriser un rapport entre sexe et genre dans des configurations historiques où la distinction entre le « biologique » et le « social » n’était, comme l’illustre Laqueur lui-même, précisément pas conceptualisée comme telle et où le sexe et le genre ne renvoyaient pas au même degré qu’aujourd’hui à des régimes d’expérience distincts, « si on entend par expérience la corrélation, dans une culture, entre domaines de savoir, types de normativité et formes de subjectivité[24] ». Dans la mesure où l’on considère qu’antérieurement à la stabilisation d’une distinction entre le biologique et le social, il n’y avait, sociologiquement parlant (comme catégories pertinentes de la pratique), ni biologique ni social, on ne peut simplement reprendre ces termes pour en inverser la causalité. S’il est anachronique d’utiliser l’un d’eux en son sens contemporain pour une époque donnée, alors il est tout autant anachronique d’utiliser l’autre : pas de genre, pas de sexe ; pas de « culture », pas de « nature ».
Les études parvenant à tenir ensemble les deux faces interdépendantes de cette histoire demeurent encore rares et n’offrent pas une chronologie unifiée. Dans son livre Doubting Sex, Geertje Mak trace par exemple la généalogie des façons dont le « sexe » a été pensé du début du 19e siècle au début du 20e. À partir de l’étude de l’appréhension par la médecine des cas d’« hermaphrodites » (selon le terme de l’époque) tout au long du siècle, elle donne à voir le passage d’un modèle de sexe arrimé à l’insertion au sein d’une communauté, modèle dans lequel la dimension corporelle n’assume pas une pertinence distincte des rôles sociaux (sauf en cas de problèmes conjugaux ou reproductifs), à un modèle dualiste opposant l’objectivité des corps chosifiés par la médecine à un soi sexué ancré dans la subjectivité[25]. En retraçant cette émergence simultanée et symétrique, Mak propose une histoire possible de la dualisation entre sexe et genre comme catégories de l’expérience sociale. Dans un article intitulé « Sex before gender », ultérieur à son ouvrage précité, Bernice Hausman décrit pour sa part la fin du 19e siècle comme un moment charnière durant lequel le sexe est déjà ancré dans la biologie mais où, dans le contexte de l’évolutionnisme néo-lamarkien, la biologie elle-même n’est pas conceptuellement distincte du « social » et ne relève pas encore du domaine de l’immuable. Ainsi, pour l’autrice, « apprendre à lire en dehors de la distinction sexe-genre, et pas toujours à travers elle, aidera les chercheuses féministes à articuler les significations du “sexe” […] antérieures à la scission sémantique entre le “sexe” et le “genre” »[26]. Alexandre Jaunait propose, lui, la notion de « sexe synthétique » pour désigner cet objet historique qui n’a pas encore été « formellement conceptualisé en plusieurs dimensions »[27]. Enfin, dans son travail récent d’anthropologie du Moyen Âge, Clovis Maillet décrit cette période comme un moment où la distinction sexe-genre n’a pas prise, notamment parce qu’elle n’y peut encore s’arrimer à une opposition entre nature et culture – ce qui, loin d’être un obstacle, permet sous certaines conditions des formes de fluidité et de passage entre les sexes/genres[28].
Les travaux manquent pour rendre compte adéquatement des temporalités diverses de la distinction sexe-genre hors des mondes savants. Tout indique néanmoins qu’elle s’inscrit dans une histoire sociale débordant amplement la fenêtre spécifique de l’invention psycho-sociologique du concept de genre dans les années 1950-60 qui, à l’aune de ce temps long, apparaît davantage comme un aboutissement qu’une inauguration. S’il n’est pas le lieu de discuter les détails de ces chronologies, on peut toutefois en retenir une série de leçons pour l’analyse du monde actuel : le sexe est devenu plus « biologique » à mesure que le genre se faisait plus « social », et réciproquement ; la distinction sexe-genre assoit simultanément la saillance du sexe et du genre ; leur existence s’avère inséparable de leur concurrence[29].
Alexandre Jaunait note ainsi, à propos des années 1950, qu’il n’est « pas le moindre des paradoxes que le terme de genre s’invente dans le cadre d’une configuration clinique résumée par le vocable du “changement de sexe”[30] ». Ce paradoxe n’est pas isolé, comme l’illustrent une série d’exemples contemporains. La distinction entre personnes cis et personnes trans, si elle met en jeu la notion d’identité de genre, opère également un surcroît de mise en pertinence du sexe. En se plaçant du point de vue de l’affirmation de genre, le « sexe biologique » est en effet ce qui distingue désormais, pour une même identité de genre, une personne cis d’une personne trans. Ce sont également des propriétés associées à une définition « biologique » du sexe qui confèrent sa pertinence au nouveau domaine de pratique et d’expertise consacré aux grossesses masculines. La différence entre un homme qui peut tomber enceint et un homme qui ne le peut pas se situe là aussi aujourd’hui au niveau du « sexe biologique »[31]. Plus généralement, le déclin des attentes cisgenres, loin de mettre le sexe entre parenthèses, fait au contraire gagner en pertinence l’interrogation autonome du sexe « biologique », dans la mesure où ce dernier n’est plus automatiquement perçu comme donné avec le « genre ».
C’est aujourd’hui parfois le sexe qui vient troubler le genre. Si la « matérialité du sexe » peut être invoquée (par les conservateurs autant que par le féminisme transphobe) pour prétendre invalider socialement les identités non cisgenres, elle peut tout autant être mobilisée pour remettre en cause une médecine androcentrique ou des présupposés sexistes dans la pratique scientifique, comme lorsque des guerriers préhistoriques décrétés hommes au 19e siècle se révèlent à l’analyse paléontologique du 21e avoir été des guerrières[32]. À leur manière, les aspirations intersexes contribuent elles aussi à mettre le sexe individuel en pertinence dans sa complexité, en opposition aux normes sociales de genre prétendant enfermer les personnes dans un binarisme contre-nature[33]. L’histoire de la mise en pertinence simultanée du sexe, du genre, et de la distinction sexe-genre, à rebours des prophéties nécrologiques sur la fin du sexe, reste là encore largement à écrire.
II – Le genre et la pluralité du « social »
Si la diffusion sociale de la distinction sexe-genre semble stabiliser le « sexe » en l’ancrant dans la physicalité au point qu’il n’a sans doute jamais été autant « biologique », de nombreux travaux ont montré que cet ancrage expose en retour le sexe à une dissolution – certes relative – dans l’hétérogénéité des critères biologiques possibles de sa détermination (génétique, endocrinologique, anatomique, etc.)[34]. Or, la distinction sexe-genre ne procède pas autrement avec le genre. La construction sociale du genre comme « social », loin d’accoucher d’une topologie univoque, n’échappe pas en effet à la tension entre les différentes définitions du « social » que le monde social se donne à lui-même. C’est à la vie sociale de cette « distinction genre-genre » qu’on s’intéresse maintenant.
 Une perspective matérialiste ne peut se contenter, armée de sa définition analytique du genre comme rapport social, de révoquer les autres (telles l’usage de « genres » au pluriel) comme fausses ou dépassées. La réalité n’a jamais tort et parvenir à une telle conclusion reviendrait à penser à l’envers. Le fait est qu’un nouveau régime identificatoire se stabilise aujourd’hui dans le monde occidental autour d’une triade sexe/genre/sexualité, qui nous laisse le choix des catégories (voyant même la multiplication de ces dernières[35]) mais beaucoup moins celui des axes de catégorisation et de l’injonction à s’y situer[36]. Au sein de ce régime, nous avons bien chacun·e un « genre » distinct du sexe (ainsi qu’un sexe distinct du genre), y compris les personnes cisgenres, et même les identifications qui rejettent l’injonction à l’identité de genre (« agenre », genderless etc.), demeurent des manières d’occuper l’étage identitaire du genre, de répondre librement à une question non choisie. À l’instar d’autres tentatives théoriques de dépasser la distinction sexe-genre, il est donc peu probable qu’une définition matérialiste et relationnelle du genre fasse un jour pléonasme avec le monde – et c’est sans doute ce qui en fait la force critique : un rapport social peut difficilement devenir une catégorie identitaire. Ainsi la distinction sexe-genre résiste. De même que les usages du mot « sexe » échappent à la complexité de l’objet « sexe » tel qu’il est travaillé par les biologistes, les usages sociaux de la notion de « genre » échappent à la définition du « genre » telle que pourraient vouloir leur imposer telle ou telle science sociale[37]. Il n’y a aucune raison pour qu’il en soit autrement et la sociologie ne devrait par principe jamais supposer une telle transparence terminologique, non seulement car ce serait alors source de malentendus, mais également parce que cette non-coïncidence de principe entre catégories de l’analyse et catégories de la pratique – y compris lorsqu’un même mot est utilisé – est une condition de l’étude des faits sociaux. En l’occurrence, le « social » est un enjeu de luttes au sein du monde social et la distinction entre domaine de l’analyse et domaine de la pratique n’est jamais aussi cruciale que lorsqu’il s’agit d’analyser l’analyse.
Une perspective matérialiste ne peut se contenter, armée de sa définition analytique du genre comme rapport social, de révoquer les autres (telles l’usage de « genres » au pluriel) comme fausses ou dépassées. La réalité n’a jamais tort et parvenir à une telle conclusion reviendrait à penser à l’envers. Le fait est qu’un nouveau régime identificatoire se stabilise aujourd’hui dans le monde occidental autour d’une triade sexe/genre/sexualité, qui nous laisse le choix des catégories (voyant même la multiplication de ces dernières[35]) mais beaucoup moins celui des axes de catégorisation et de l’injonction à s’y situer[36]. Au sein de ce régime, nous avons bien chacun·e un « genre » distinct du sexe (ainsi qu’un sexe distinct du genre), y compris les personnes cisgenres, et même les identifications qui rejettent l’injonction à l’identité de genre (« agenre », genderless etc.), demeurent des manières d’occuper l’étage identitaire du genre, de répondre librement à une question non choisie. À l’instar d’autres tentatives théoriques de dépasser la distinction sexe-genre, il est donc peu probable qu’une définition matérialiste et relationnelle du genre fasse un jour pléonasme avec le monde – et c’est sans doute ce qui en fait la force critique : un rapport social peut difficilement devenir une catégorie identitaire. Ainsi la distinction sexe-genre résiste. De même que les usages du mot « sexe » échappent à la complexité de l’objet « sexe » tel qu’il est travaillé par les biologistes, les usages sociaux de la notion de « genre » échappent à la définition du « genre » telle que pourraient vouloir leur imposer telle ou telle science sociale[37]. Il n’y a aucune raison pour qu’il en soit autrement et la sociologie ne devrait par principe jamais supposer une telle transparence terminologique, non seulement car ce serait alors source de malentendus, mais également parce que cette non-coïncidence de principe entre catégories de l’analyse et catégories de la pratique – y compris lorsqu’un même mot est utilisé – est une condition de l’étude des faits sociaux. En l’occurrence, le « social » est un enjeu de luttes au sein du monde social et la distinction entre domaine de l’analyse et domaine de la pratique n’est jamais aussi cruciale que lorsqu’il s’agit d’analyser l’analyse.
La signification du genre est au moins socialement construite par la lutte entre celles et ceux qui affirment qu’elle est socialement construite et les autres. Mais cette lutte n’oppose pas deux camps unifiés et les sciences humaines sont marquées par la pluralité vertigineuse des définitions du genre qu’elles mobilisent. Système, normes, statut juridique, rôles sociaux, sentiment de soi, identité ou expression, manières d’être ou de « performer », singulier ou pluriel, binaire ou non, continu ou discontinu : les usages peuvent varier chez les mêmes auteur·ices, voire sur les mêmes pages d’ouvrages. Le genre comme rapport social et le genre comme identité peuvent s’y trouver combinés analytiquement, qu’il s’agisse de décrire les parcours identitaires à la lumière de rapports pluriels de domination[38] ou de pointer, à l’instar des collectifs queer et transféministes pratiquant l’« auto-enquête », la manière dont le genre met au travail « nos » genres performés et préside à l’appropriation capitaliste de la valeur qu’ils produisent[39].
Loin d’être uniquement conceptuels, ces débats font écho, dans le monde social, à la multiplicité des rapports individuels à l’identité de genre[40], mais aussi, plus généralement, à la diversité des manières dont on peut découper l’identité ou lui attribuer un siège et un fonctionnement. Or, bien que le sexe soit généralement construit comme donné, le genre n’est pas toujours donné comme « construit ». Le genre est-il subjectif ou objectif ? À qui est déléguée sa détermination, avec quelle autorité ? Est-il un système de normes contraignantes ou un sentiment expressif de soi ? Est-il stable ou fluide ? Renvoie-t-il à ce qu’on est ou à ce qu’on fait ? La cosmologie dessinée par les réponses à ces questions demeure fondamentalement incohérente et versatile. La stabilité est-elle forcément donnée et la fluidité construite ? Le subjectif ne peut-il être lui aussi objectif ? C’est aux tensions et paradoxes soulevés par ces nouveaux questionnements qu’est consacrée la dernière section, qui s’intéresse non plus à la généalogie du constructivisme mais à ses effets et appropriations sociales.
III – Le « tournant performatif » comme tournant performatif
Si l’idée du genre comme construction sociale est elle-même une construction sociale, elle est, de ce fait, au minimum réelle dans ses conséquences. Durant une convention mondiale de drag queens à Londres rapportée par Maxime Cervulle, qui évoque à ce propos un « constructivisme ordinaire », une célébrité interpelle ainsi le public, majoritairement composé de jeunes femmes cisgenres, par les mots : « gender is… », à quoi la salle répond en chœur : «… a social construct ! [41]». Lors d’une « gender reveal party » subversive relayée sur les réseaux sociaux, des parents annoncent le sexe de leur enfant sur un gâteau : « le genre du bébé est… socialement construit ! ». Comédien·ne non binaire, Mae Martin répond en 2021 à sa nomination aux BAFTA dans la catégorie « meilleure performance féminine » : « Merci beaucoup BAFTA […] PS le genre est une construction sociale »[42]. La même année, la saison 13 de l’émission populaire RuPaul Drag’s Race accueille son premier candidat transmasculin – assigné femme à la naissance, à l’identité et l’expression de genre masculines, mais recourant à la performance féminine dans le cadre de ses pratiques « drag », et incarnant de manière inédite la distinction hiérarchique entre l’expression de genre (sérieuse) d’une part, et la performance de genre (ludique ou politique) d’autre part[43].
Avec quels concepts ressaisir cette réalité non comme vérité ou comme erreur mais comme fait social, d’une manière qui ne soit pas simplement redondante avec elle ? Que construit la « construction sociale du genre » ? Quelles sont les implications du « sens commun constructiviste » pour les politiques du genre ? Alors que la construction sociale a souvent servi d’outil de « dévoilement voire de négation des objets sociaux indésirables »[44], que signifie sa revendication par les acteur·ices elles- et eux-mêmes ? Qu’arrive-t-il au genre lorsque ses performances en viennent à se penser comme « performées » ? Comment pour les sciences sociales du contemporain penser la performativité elle-même non seulement comme outil de compréhension mais aussi comme catégorie de la pratique, dans un monde où, de plus en plus explicitement, « le genre ne se réfère pas à quelque chose que l’on est mais à quelque chose que l’on fait », pour reprendre les termes de l’activiste étatsunienne Riki Wilchins, qui a contribué à populariser l’étiquette « genderqueer »[45]?
 Se contenter d’applaudir, comme le fait Rogers Brubaker, l’émergence d’une « plus grande conscience du caractère construit, de l’artificialité et de l’élasticité[46] » des catégories risque en effet d’approcher la performativité comme quelque chose de déjà là, une vérité de l’identité n’attendant qu’à être découverte par une modernité réflexive enfin transparente à elle-même. « Il n’y a pas d’identité profonde, pas d’être en dehors du faire », proclame ainsi Brubaker pour résumer la nouvelle « compréhension performative » de l’identité, d’une manière qui semble, étrangement pour cet auteur, confondre en un seul jugement ontologie de l’analyse et ontologie de la pratique ; « l’identité est en toute part performance »[47]. Il me semble au contraire que pour appréhender, dans une perspective sociologique, ce moment historique particulier, il faut se défaire de l’impression de transparence ontologique. Le constructivisme ne peut se faire identité sans devenir autre chose que le constructivisme. La vie sociale de la « performativité », de l’« identité performative » comme expérience sociale réflexive, est un exemple flagrant du fait qu’une sociologie réellement pragmatique, c’est-à-dire une sociologie des conséquences du sens, ne peut se passer d’une rupture épistémologique avec les catégories ordinaires, quand bien même ces catégories sont, comme celle de « performativité », également des outils avec lesquels on travaille, milite ou conceptualise.
Se contenter d’applaudir, comme le fait Rogers Brubaker, l’émergence d’une « plus grande conscience du caractère construit, de l’artificialité et de l’élasticité[46] » des catégories risque en effet d’approcher la performativité comme quelque chose de déjà là, une vérité de l’identité n’attendant qu’à être découverte par une modernité réflexive enfin transparente à elle-même. « Il n’y a pas d’identité profonde, pas d’être en dehors du faire », proclame ainsi Brubaker pour résumer la nouvelle « compréhension performative » de l’identité, d’une manière qui semble, étrangement pour cet auteur, confondre en un seul jugement ontologie de l’analyse et ontologie de la pratique ; « l’identité est en toute part performance »[47]. Il me semble au contraire que pour appréhender, dans une perspective sociologique, ce moment historique particulier, il faut se défaire de l’impression de transparence ontologique. Le constructivisme ne peut se faire identité sans devenir autre chose que le constructivisme. La vie sociale de la « performativité », de l’« identité performative » comme expérience sociale réflexive, est un exemple flagrant du fait qu’une sociologie réellement pragmatique, c’est-à-dire une sociologie des conséquences du sens, ne peut se passer d’une rupture épistémologique avec les catégories ordinaires, quand bien même ces catégories sont, comme celle de « performativité », également des outils avec lesquels on travaille, milite ou conceptualise.
Il est d’usage de distinguer la « performance » goffmanienne de la « performativité » butlérienne, rappelant que la seconde ne suppose pas de sujet a priori[48]. Mais cette distinction analytique s’avère peu opératoire dans le monde social, où elle manque de prise, tant elle bute sur l’impossibilité subjective de l’absence de sujet. Dans la pratique et la perception de soi, au sein d’un monde où il y a des sujets, la notion de performativité ne demeure pas orthogonale à l’opposition hiérarchique entre performance et réalité, une observation qui n’a pas échappé aux critiques trans de Butler[49]. Talia Mae Bettcher rappelle ainsi que si la « construction sociale de l’identité » pose problème à toutes les identités, elle échoue spécifiquement à défendre contre le déni d’identité les identités socialement construites comme « socialement construites » et dénigrées en tant que telles[50]. D’autres ont pointé le risque que l’« identité de genre » demeure une propriété spécifiquement non-cisgenre, notamment dans le droit, tandis que les personnes cisgenres conserveraient, elles, le monopole d’un « sexe » intégré[51]. Enfin, on l’a vu, l’essor de conceptions constructivistes dans le domaine du genre n’est, dans l’ensemble, aucunement contradictoire avec la continuation, et même l’accélération de la biologisation du sexe[52].
Au-delà de ces mécanismes de stratification et de hiérarchisation, la diffusion et l’appropriation sociales de conceptions performatives de l’identité ne sont pas sans conséquences sur l’identité elle-même. Que devient en effet l’identité lorsqu’elle se pense comme identification ? Que signifie s’identifier comme s’identifiant ? Le sujet qui s’identifie a-t-il une identité qui précède l’identification ? Est-ce qu’on est son identité ? Si l’identification réflexive opère un changement dans l’identité de l’identité, ce mouvement consacre-t-il un retour de la transparence, non au sens où l’identification désignerait une identité transparente à elle-même, mais où elle se donnerait comme un geste d’affiliation identitaire transparent à lui-même en tant que geste ? Dans son analyse critique de l’activité de production de nominations de plus en plus nombreuses dans le domaine de la sexualité, Noémie Marignier établit pour sa part un contraste entre les aspirations historiques « queer » aux identités sémantiquement creuses déployées dans une logique subversive de resignification, et la prolifération actuelle fondée selon elle sur des « pratiques d’étiquetage du ressenti » et la « création ex-nihilo de catégories pleines », dessinant, derrière des nomenclatures de plus en plus riches qui semblent en surface consacrer l’inculturation victorieuse de la théorie queer, un nouvel essentialisme de l’identité passant par l’essentialisme du langage. L’identification opèrerait alors, à travers un lexique constructiviste, une renaturalisation de l’identité au moment même où est dénaturalisé le binarisme[53].
À mesure qu’elle se trouve démédicalisée, débinarisée, et distinguée aussi bien du sexe que de l’expression de genre, l’identité de genre se définit de moins en moins par une comparaison entre des « faits » biologiques et une vérité intérieure, et de plus en plus par l’expression ontologiquement auto-suffisante d’une subjectivité genrée reposant sur l’autodétermination[54]. On pourrait ne voir dans la réussite de l’identité à déterminer sa propre vérité qu’une victoire de la performativité de l’identité. C’est même à ce titre que cette aspiration est à l’inverse décriée par nombre de discours conservateurs. Mais, d’une part, l’idéal d’un « performatif toujours heureux », selon le mot de Cynthia Kraus à propos de la non-binarité[55], se heurte encore dans de nombreux pays à de violentes épreuves sociales où validation et humiliation sont souvent entremêlées et où l’émergence tendancielle d’un régime d’autodétermination fondé sur la « privatisation et l’individualisation du genre »[56] demeure paradoxalement contrainte par la persistance d’un cadre juridique binaire[57]. D’autre part, célébrations et dénonciations ont en commun d’oublier que l’infalsifiabilité revendiquée d’une performance identitaire n’est pas sans conséquence ontologique. En effet, l’acceptation sociale de l’infalsifiabilité change la nature de l’acceptation. En indexant l’objectivité sur l’objectivité de la subjectivité, elle opère paradoxalement une forme de circonscription ontologique, une telle modalité de véridiction impliquant à la fois une absolutisation de l’identité et un renoncement à cette absolutisation.
De surcroît, dans la mesure où une diversité identitaire est accueillie au sein d’un monde intersubjectif commun qui met ces identités en équivalence, l’ontologie de ce monde dans lequel il y a des ontologies, même en tant que « lieu vide » défini négativement, ne coïncide déjà plus avec les ontologies hétérogènes qu’il accueille et qui sous-tendent ces identités[58]. À bien des égards, la médiation neutralisante par l’identité est donc déjà un compromis ontologique, condition de la reconnaissance mutuelle et de la cohabitation intersubjective, indépendamment d’éventuels désaccords sur le siège de l’identité ou sa stratification. On est, en un sens, un peu moins quand on n’est qu’une possibilité d’être ou, plus exactement, quand l’ontologie qui donne sens à notre identité en vient à n’apparaître que comme une possibilité d’ontologie.
Conclusion
Faut-il faire la distinction entre sexe et genre ? A-t-on vraiment besoin d’un vrai genre ? Cet article ne s’est pas donné pour tâche de répondre à ces questions mais de réfléchir à quelques manières dont le monde y répond, et aux implications de ces réponses pour les transformations contemporaines du rapport entre vérité et subjectivité. Les sciences sociales n’ont le pouvoir ni de valider ni d’invalider les identités, ni de tracer les frontières ni de trancher dans les luttes de frontière.. Si le constructivisme n’a pas besoin d’être vrai pour avoir de vrais effets, dans le domaine du genre comme dans d’autres domaines la sociologie critique s’est sans doute trop longtemps concentrée sur la défense de la construction sociale comme outil analytique[59], se rendant ainsi, par redondance, partiellement aveugle à la performativité du tournant performatif auquel elle contribuait. À l’inverse, la sociologie pragmatique s’est peut-être trop consacrée à la discussion critique du constructivisme[60], négligeant elle aussi de le « prendre au sérieux » dans ses effets et sa « réalité ».
Naviguant entre ces écueils, on a tenté ici d’appréhender le donné et le construit, le biologique et le social, l’essentialisme et l’anti-essentialisme comme des dichotomies performatives de la pratique et des enjeux de luttes à l’intérieur du monde social. Rien n’interdit en effet de mettre en œuvre une sociologie critique de la critique et d’étudier par son truchement la construction sociale de la « construction sociale », que ce soit en retraçant sa généalogie ou en scrutant ses conséquences. Il n’y a pas d’extra-territorialité sociale de la réflexivité et l’homonymie entre le social et le « social » ne demande pas d’abolir la distinction entre catégories analytiques et catégories de la pratique, tout au contraire. La démarche consistant à s’intéresser à la vie sociale du « constructivisme ordinaire » ou à l’anatomie du « sens commun constructiviste » parallèlement à l’autorité culturelle de la biologie et d’autres possibles « sources du moi[61] », dessine quant à elle un horizon dans lequel se trouve pour une grande part effacée la frontière entre sociologie pragmatique et sociologie critique, les deux pouvant en effet se rejoindre dans une sociologie réflexive des conséquences de la réflexivité qui ne ferait pas pléonasme avec celle-ci ni avec le monde dont elle accouche.
[1] Je remercie chaleureusement Claire Grino, Thomas Crespo, Alex Jaunait, Ilana Eloit, Olivier Allard, Robin Corminboeuf et les deux évaluateur·ices anonymes pour leurs commentaires et suggestions critiques sur une première version de cet article.
[2] Delphine Gardey, « Les sciences et la construction des identités sexuées. Une revue critique. », Annales, 3, 61, 2006, p. 649-673.
[3] Joan Scott, « Genre : une catégorie utile d’analyse historique », Les Cahiers du Griff, 37, 1, 1988, p. 125-153.
[4] Voir Joan Stavo-Debauge, « Prendre position contre l’usage des catégories “ethniques” dans la statistique publique. Le sens commun constructiviste, une manière de se figurer un danger politique », dans Pascal Laborier et Dany Trom, Historicités de l’action publique, Rennes, PUR, p. 293-327 ; et Danny Trom, « À l’épreuve du paysage. Constructivisme savant et sens commun constructiviste », Revue du Mauss, 17, 2001, p. 247-260.
[5] Judith Butler, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, Paris, La Découverte, 2005 (1990), p. 69.
[6] Christine Delphy, « Penser le genre : quels problèmes ? », dans Marie-Claude Hurtig, Michèle Kail et Hélène Rouch (dir.), Sexe et genre: de la hiérarchie entre les sexes, Paris, CNRS Éditions, 1991, p. 89-101.
[7] Voir la réponse que fait Judith Butler à cette critique dans Défaire le genre, Paris, Editions Amsterdam, 2016 (2004), p.347-370 ; ainsi que la critique de cette réponse par Sam Bourcier dans Queer Zones 3 : Identités, cultures, politiques, Paris, Amsterdam, 2011, p. 307-346.
[8] Laure Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait et Anne Revillard, Introduction aux études sur le genre, Bruxelles, De Boeck, 2020, p. 19.
[9] Priscille Touraille, « L’indistinction sexe et genre, ou l’erreur constructiviste », Critique, 764-765, 2011, p. 87-99.
[10] Thierry Hoquet, Des sexes innombrables. Le genre à l’épreuve de la biologie, Paris, Seuil, 2016, p. 46.
[11] Thierry Hoquet, op.cit., p.40.
[12] Donna Haraway, Manifeste des espèces compagnes, Flammarion, 2019 (2003).
[13] Karen Barad, “Posthumanist performativity: Toward an understanding of how matter comes to matter”, Signs, 28, 3, 2003, p. 801-831.
[14] Anne Fausto-Sterling, “Gender/Sex, Sexual Orientation, and Identity Are in the Body: How Did They Get There?”, The Journal of Sex Research 56, 4-5, p. 529-555.
[15] Sølve M Holm, “Gendersex”, lambda Nordica, 25,1, 2020, p. 64-71.
[16] David Valentine, “The Categories Themselves”, GLQ, 10, 2, 2004, p. 215-220.
[17] Florence Rudolf et Claire Grino, “The Nature-Society Controversy in France: Epistemological and Political Implications”, dans Dennis Erasga (dir.), Sociological Landscape: Theories, Realities and Trends, Londres, IntechOpen, 2012, p. 42. Voir aussi Pierre Charbonnier, La fin d’un grand partage. Nature et société, de Durkheim à Descola, Paris, CNRS Éditions, 2015.
[18] Eduardo Viveiros de Castro, « Le don et le donné : trois nano-essais sur la parenté et la magie », Ethnographiques.org, 6, 2004, p. 4.
[19] On peut opérer le même raisonnement sur les guillemets à propos de la dyade race/ethnicité. Voir Sébastien Chauvin, « Le donné et le construit dans les débats sur le genre, la race et la filiation », dans Catherine Courtet et al. (dir.), Le jeu et la règle, Paris, CNRS Éditions, 2019, p. 235-248.
[20] Voir Ilana Löwy et Hélène Rouch, « Genèse et développement du genre : les sciences et les origines de la distinction entre sexe et genre », dans La distinction entre sexe et genre : une histoire entre biologie et culture, Cahiers du genre, 34, 2003, p. 6-16, et Donna Haraway, “ ‘Gender’ for a Marxist Dictionary: The Sexual Politics of a Word”, in Elizabeth Castelli (dir.), Women, Gender, Religion, New York, Palgrave, 2001, p. 49-75.
[21] Bernice Hausman, Changing sex: Transsexualism, technology, and the idea of gender, Durham, Duke University Press, 1995.
[22] Thomas Laqueur, La fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident, Paris, Gallimard, 1992 (1990), p.36.
[23] Voir Annick Jaulin, « La fabrique du sexe, Thomas Laqueur et Aristote », Clio, 14, 2001, p. 195-205 et Elsa Dorlin, « Autopsie du sexe », Les Temps Modernes, 619, 2002, p. 115-143.
[24] Michel Foucault, Histoire de la sexualité, tome II : L’usage des plaisirs, Paris, Gallimard, 1984, p. 10. Voir aussi Teresa de Lauretis, Théories queer et cultures populaires – De Foucault à Cronenberg, Paris, La Dispute, 2007, qui définit l’expérience comme « un complexe de significations, d’effets, d’habitudes, de dispositions, d’associations et de perceptions qui résultent de l’interaction sémiotique entre soi et le monde extérieur » (p. 76).
[25] Geertje Mak, Doubting sex: Inscriptions, bodies and selves in nineteenth-century hermaphrodite case histories, Manchester, Manchester University Press, 2013.
[26] Bernice Hausman, “Sex before Gender: Charlotte Perkins Gilman and the Evolutionary Paradigm of Utopia”, Feminist Studies, 24, 3, 1998, p. 488-51.
[27] Alexandre Jaunait, « Le genre peut-il tendre la main au sexe ? Pour une approche réflexive », dans Bérengère Abou et Hughes Berry (dir.), Sexe et genre : de la biologie à la sociologie, Matériologiques, 2019, p. 58.
[28] Clovis Maillet, Les Genres fluides, Paris, Arkhé, 2020. Cette fluidité sur le plan du genre n’est cependant acceptable que lorsqu’elle s’appuie sur une réputation de chasteté, donnant à voir pour l’auteur une forme originale de distinction genre-sexualité bien antérieure à celle qui se cristallisera au 20e siècle.
[29] Sébastien Chauvin, « Le donné et le construit… », art.cit.
[30] Alexandre Jaunait, « Le genre peut-il tendre la main au sexe ? », art.cit., p.58.
[31] Margaret Besse et al., “Experiences with Achieving Pregnancy and Giving Birth Among Transgender Men: A Narrative Literature Review”, Yale Journal of Biology and Medicine, 93, 2020, p. 517-528. Voir aussi Laurence Hérault (dir.), La parenté transgenre, Presses Universitaires de Provence.
[32] Marylène Patou-Mathis, L’Homme préhistorique est aussi une femme. Une histoire de l’invisibilité des femmes, Paris, Allary éditions, 2020, et Claudine Cohen, Femmes de la préhistoire, Paris, Belin, 2019.
[33] Michal Raz, « Bicatégorisation », dans Juliette Rennes (dir.), Encyclopédie critique du genre, Paris, La Découverte, 2021, p. 95-104.
[34] Voir Anne Fausto-Sterling, Corps en tous genre : la dualité des sexes à l’épreuve de la science, Paris, La Découverte, 2012 (2000) ; Thierry Hoquet, Des sexes innombrables, op.cit. ; et Sarah Richardson, Sex itself : the search for male and female in the human genome, Chicago, The University of Chicago Press, 2013.
[35] Noémie Marignier, « La prolifération des catégories de l’identité sexuelle : enjeux politico-discursifs », L’homme et la société, 208, p. 63-82 ainsi que Mathieu Trachman et Tania Lejbowicz, « Des LGBT, des non-binaires et des cases », Revue française de sociologie, 4, 59, p. 677-705.
[36] Sur le caractère récent et encore contesté de ces axes et de leur distinction, voir David Valentine, “The Categories Themselves”, art.cit., et Arnold Davidson, The Emergence of Sexuality: Historical Epistemology and the Formation of Concepts, Chicago, University of Chicago Press, 2004.
[37] Alexandre Jaunait, « Le genre peut-il tendre la main au sexe ? », art.cit., p. 62.
[38] Emmanuel Beaubatie, Transfuges de sexe. Passer les frontières du genre, Paris, La Découverte, 2021.
[39] Sam Bourcier, Homo Inc.orporated. Le triangle et la licorne qui pète, Paris, Cambourakis, 2017. Merci à l’évaluateur·ice qui a porté mon attention sur la manière dont ces collectifs proposaient une articulation matérialiste originale entre « genre » et « genres ».
[40] Emmanuel Beaubatie, « L’espace social du genre. Diversité des registres d’action et d’identification dans la population trans’ en France », Sociologie, 10, 4, 2019, p. 395-414.
[41] Maxime Cervulle, « Des robes couleur du temps : controverses autour des représentations raciales dans RuPaul’s Drag Race », communication au colloque international Télévision queer : représentations, sensibilités, formes et fandom, Université de Montréal, 9-11 mai 2019.
[42] https://www.pinknews.co.uk/2021/04/29/mae-martin-non-binary-comedian-bafta-best-female-performance-comedy-feel-good/
[43] https://www.them.us/story/rupauls-drag-race-first-openly-trans-male-contestant-gottmik
[44] Martina Avanza et Gilles Laferté, « Dépasser la “construction des identités ?” Identification, image sociale, appartenance », Genèses, 61, 2005, p. 137, à propos de Ian Hacking, Entre science et réalité. La construction sociale de quoi ?, Paris, La Découverte, 2008 (2001).
[45] Riki Wilchins, “It’s your gender, stupid” dans Genderqueer: Voices from beyond the sexual binary, New York, Alyson Books, 2020 (2002), p. 22.
[46] Rogers Brubaker, Trans: Gender and Race in an Age of Unsettled Identities, Princeton, Princeton University Press, 2016, p.146.
[47] Ibid., p.145.
[48] Judith Butler, “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory”, Theater Journal, 40, 4, 1988, p. 519-531. Voir aussi Eléonore Lepinard et Marylène Lieber, Les theories en études de genre, Paris, La Découverte, 2020, p. 522.
[49] Viviane Namaste, “‘Tragic misreadings’: Queer Theory’s Erasure of Transgender Subjectivity”, dans Invisible Lives, Chicago, University of Chicago Press, 2000, p. 9-23.
[50] Talia Mae Bettcher, “Trapped in the Wrong Theory: Rethinking Trans Oppression and Resistance”, Signs, 39, 2, 2013, p. 383-406.
[51] Florence Ashley, « L’in/visibilité constitutive du sujet trans : l’exemple du droit québécois », Revue Canadienne Droit et Société, 35, 2, 2020, p.317-340.
[52] Voir par exemple Georgi Marinov, “In Humans, Sex is Binary and Immutable”, Academic questions, 33, 2, 2020, p. 279-288.
[53] Noémie Marignier, « La prolifération des catégories de l’identité sexuelle », art.cit.
[54] Ido Katri, “Sex reclassification for trans and gender nonconforming people: From the medicalized
body to the privatized self”, dans Don Haider-Markel (dir.), The Oxford Encyclopedia of LGBT Politics and Policy, Oxford, Oxford University Press, 2019. Les dilemmes soulevés par la démédicalisation sont également matériels et concernent notamment la prise en charge par la couverture sociale : voir Judith Butler, « Dédiagnostiquer le genre », dans Défaire le genre, op.cit., p.110-145.
[55] Cynthia Kraus, « Puis-je toujours être ce que je dis ? », Conférence plénière du BruLau, Lausanne, 9 juin 2021.
[56] Ido Katri, art.cit., p.18.
[57] Alex Jaunait, « Genèses du droit de l’identité de genre. Approche des configurations sociojuridiques », Droit et société, 105, 2020, p. 429-451.
[58] Linda Zerelli, « Cet universalisme qui n’est pas un. À propos d’Émancipation(s) d’Ernest Laclau », Revue du Mauss, 17, 2001, p. 332-354.
[59] Quitte, comme l’a noté Cyril Lemieux, à verser dans un « charcutage ontologique » limitant la construction sociale à une région donnée de la réalité. Voir C. Lemieux, « Peut-on ne pas être constructiviste ? », Politix, 100, 169-18 ; et Dorothy Pawluch et Steve Woolgar, “Ontological Gerrymandering: The Anatomy of Social Problems Explanations”, Social Problems, 32 (3), 1985, p. 214-227.
[60] Michel de De Fornel, Cyril Lemieux (dir.), Naturalisme versus constructivisme ?, Paris, Éditions de l’EHESS,
2007.
[61] Charles Taylor, Les sources du moi. La formation de l’identité moderne, Paris, Le Seuil, 1998 (1989).