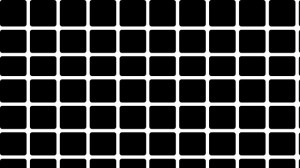Savoir voir, voir sans savoir : des politiques de la vision
Benjamin Tremblay, doctorant en sociologie au centre Max Weber, Université Lumière Lyon-II.
Introduction
Lorsque nous explorons le monde nous distinguons, parmi les entités qui se présentent à nous, celles qui sont « végétales », celles qui sont « humaines » et celles qui sont « cosmiques ». Cette catégorisation sommaire des éléments du décor mobilise des capacités sensorielles et des connaissances incorporées. Je perçois certaines formes et je sais les regrouper sous un seul nom – les deux étapes étant en pratique indissociables et effectuées, pour l’essentiel, inconsciemment. L’opération débouche sur une réactualisation et une reconnaissance tacite de l’ordre des choses. Voir un arbre, c’est reconnaitre un droit d’appartenance d’une chose physique à une espèce socialement instituée et caractérisée par des propriétés décrites dans les encyclopédies, dictionnaires, et autres ressources pourvoyeuses de définitions.
Ce quasi-réflexe qui nous permet d’individuer les choses vues, de les « subsumer […] sous une classe d’appartenance, munie d’un nom »[1], est le fruit d’une socialisation qui nous munit d’un sens commun, de « schèmes classificatoires »[2] qui rendent possible une appréhension normale du monde. Rectifier la prononciation (« ça se dit [aʁbʁ], pas [abe] »), apprendre à lier les bonnes choses aux bons mots (« c’est un arbre, pas un piquet »), c’est transmuer la vue (comme sens biologique) en vision. La vision est cette combinaison de ce que l’œil perçoit et de ce que l’esprit en conclut. Dans cette jonction se loge une problématique de l’émancipation : le lien entre ce que nous percevons et ce que nous savons/croyons percevoir est-il indéfectible ? Si nous nous arrêtons quelques instants sur notre expérience courante du monde, la réponse est sans appel : il est toujours trop tard, nous voyons toujours déjà quelque chose. C’est ce que résume A. Schütz :
« Nous savons que le monde où nous vivons est un monde d’objets bien circonscrits, aux qualités définies […]. Pour l’attitude naturelle, le monde n’est pas et n’a jamais été un simple agrégat de taches colorées, de bruits incohérents, de zones de chaud et de froid[3]. »
Il faudrait une sorte de gymnastique cérébrale pour que soient dénoués nos automatismes, pour que toute chose présente à notre vue soit finalement une surprise ou un chaos. Cette rupture avec le sens commun constitue une des marques de fabrique de la science mais, comme son nom l’indique, l’objectivation qu’elle se donne pour horizon produit toujours des objets et non une « pure perception »[4] hors de tout savoir. Cette perception est elle-même, comme le soulignait M. Merleau-Ponty, déjà organisée a minima. Avant même le quelque chose nominal (vision) existe « le “quelque chose” perceptif [qui] est toujours au milieu d’autre chose, il fait toujours partie d’un “champ”. Une plage vraiment homogène, n’offrant rien à percevoir ne peut être donnée à aucune perception[5]. » Quoiqu’il en soit, « l’attitude naturelle ignore ces problèmes »[6]. Nous utilisons la vision comme sens pratique sans nous soucier de déconstruire, à chaque instant, ce que nous croyons savoir sur ce que nous voyons. Je n’ai pas besoin d’être botaniste pour vivre avec les arbres, ni d’être sociologue pour vivre avec les hommes, et il est un point en-deçà duquel j’en sais bien assez pour agir.
Ainsi le sens commun peut-il être à la fois vertu – comme ressource nécessaire et suffisante à une vie sociale – et vice lorsqu’il est, pour des raisons diverses, jugé défaillant. Les litiges concernant la vision ont alors lieu lorsqu’elle est pensée comme aveuglement : les gens ne voient pas ce qu’il faudrait voir, ils voient « mal » ou « faux » (« en fait, cette petite maison, qui n’a l’air de rien comme ça, est un lieu de mémoire »). Cet article, comme une liberté prise en marge du travail scientifique à proprement parler, visera à restituer quelques interrogations concernant ces troubles de la vision. Ces derniers occupent en effet une place de choix parmi les problématiques récurrentes qui se posent lorsque l’on travaille, comme c’est mon cas, sur les choses mémorielles. La mémoire n’existe que lorsqu’elle est donnée à voir ; or s’il faut donner à voir, c’est bien parce que la vision, sans cela, est jugée être, au moins en partie, aveugle. L’objectif des lignes qui vont suivre sera d’établir des liens entre des sociologies et des philosophies trop souvent présentées comme inconciliables, pour essayer de comprendre ce que pourrait être une politique de la vision « émancipatrice ».
Sens commun, sens littéral et aveuglement
La vision ordinaire ressemble à une traduction quasi-instantanée des perceptions physiques en ressources cognitives antérieurement acquises. En simplifiant, on pourrait dire qu’elle fonctionne comme les dictionnaires évoqués plus haut, quoiqu’en sens inverse : voyant un tronc (a), des branches (b), des feuilles (c), je vois d’emblée un arbre (c’est le dilemme de la « forme plus analysée »[7] chez L. Wittgenstein. Je suis capable de voir les différentes parties d’un objet, mais je le saisis, en pratique, dans sa globalité – je n’additionne pas chacune de ses « parties constituantes » pour recomposer son tout. Ce qui m’importe ici, c’est que l’équation arbre = a + b + c vaut pour exprimer un sens littéral. Une identification est réussie lorsqu’elle aboutit à ce sens (« Qu’est-ce ? Ceci est, littéralement, un arbre. ») et permet la clarification de la situation. Ce sens générique, donné pour être littéral, censément descriptif et supposé coller à la « réalité », nous suffit la plupart du temps pour agir.
Mais pour J.R. Searle, le sens littéral d’une proposition est difficilement énonçable puisque la compréhension que nous en avons est tributaire d’un « ensemble d’assomptions contextuelles »[8], d’un stock de connaissances préalablement acquises à propos de l’ordre du monde, c’est-à-dire du sens commun. Les cas du chat flottant dans l’espace sidéral et du hamburger géant[9] permettent de comprendre par l’absurde l’impossibilité qu’il y a à formuler des énoncés dépourvus de toute ambiguïté. Chaque mot employé mériterait en effet des développements, eux-mêmes susceptibles d’être développés, dans un mouvement infini d’extension et de clarification – Searle reprenant ici la question posée chez Wittgenstein d’une explicitation « jamais achevée »[10]. Mais le paradoxe ressurgit à nouveau : là où le philosophe voit dans la phrase « Le chat est sur le paillasson. »[11] une source de problèmes (comme : ce chat est-il dans l’espace intersidéral ? Le paillasson est-il incliné ?), l’homme ordinaire use du sens commun qui lui permet de savoir de manière parfaitement limpide ce qu’une telle phrase signifie. Il sait qu’un chat est rarement dans l’espace, et qu’il se tient généralement assis sur un paillasson lui-même mis à plat sur une surface solide. Ainsi le bon sens vient-il compléter ce qui n’a pas été – et ne peut pas – être explicité dans le langage. Il fournit le contexte normal de compréhension des phrases et permet de régler par avance les ambiguïtés qui émergent si l’on s’en tient à une signification purement linguistique.
Lier ainsi les notions de « sens littéral » et celle de « sens commun » permet d’abord de mesurer l’enjeu que l’une comme l’autre représentent en matière d’émancipation. Lorsque nous sommes plongés dans une situation, notre vision en reconnaît les éléments caractéristiques, ceux-là même qui sont donnés dans les définitions (a+b+c = arbre) et qui soutiennent l’activité de catégorisation. Or ces définitions officielles de la « langue officielle »[12], qui valent pour être littérales, amenuisent les potentialités de la vision. Sens littéral et sens commun se rejoignent dans leur caractère restrictif. Il n’y aurait pour ainsi dire rien à (sa)voir en-deçà d’eux. Mais les exemples donnés par Searle (voir supra note n°9) permettent de mesurer tout ce que peuvent receler, comme complexifications possibles, les phrases les plus « évidentes ». Ensuite, à l’idée d’un sens littéral universel et suffisant succède l’idée d’un sens pragmatique que Wittgenstein résume ainsi :
« Pour une large classe des cas où il est utilisé – mais non pour tous –, le mot « signification » peut être expliqué de la façon suivante : la signification d’un mot est son emploi dans le langage[13]. »
Revenons-en maintenant à la vision. Lorsqu’elle met en pratique de façon intriquée sens littéral et sens commun, elle perçoit « l’évidence aveuglante »[14] d’un monde tenu pour être tel qu’il « est ». Ce que Bourdieu considère comme un aveuglement, c’est cette vision pour ainsi dire automatisée, celle qui voit sans savoir qu’elle ne voit jamais que ce qui lui est donné comme « étant ». Dans la perspective critique, l’intellectuel a pour rôle de penser l’impensé et de rendre publics ses analyses comme autant de « clés » qui, en somme, déverrouillent la vision ou, du moins, la conscience d’avoir une vision aliénée. « La démolition […] de tout le fatras de prénotions, de présupposés, de préjugés que construit la sociologie spontanée des agents en concurrence […] n’est qu’un premier pas, que je crois tout à fait décisif, vers une sorte de libération collective[15]. » À ce premier pas du travail scientifique doit alors succéder celui de l’« action politique »[16]. C’est le caractère « souhaitable » d’une telle action que j’aimerais questionner à présent, avant d’essayer de comprendre comment une action politique sur la vision est possible, et sous quelles formes.
L’enjeu d’une politique de la vision
Savoir voir, c’est adopter une vision jugée plus conforme à la réalité que celle dont on disposait jusqu’alors. Pour les promoteurs du savoir-voir, ceux pour qui il faut « changer de regard », « voir les choses autrement », « aller plus loin », « sortir des clichés » (etc.), l’objectif est d’émanciper les mal-voyants de leurs visions antérieures. Le monde enchanté, recouvert de sens faux qui travestissent sa « vérité », est « déconstruit », « désenchanté » pour faire place à un monde censément plus transparent à lui-même et aux êtres qui le composent. Or la notion de désenchantement appelle à un positionnement. Elle peut être comprise aussi bien comme une tragique démystification d’un monde déjà trop rationnel, que comme une entreprise positive nécessaire pour sortir de l’âge des demi-savoirs. Cependant, dans la lecture qu’il fait de Don Quichotte, A. Schütz donne une définition plus souple de l’enchantement qui le détache de toute évaluation morale. Les enchanteurs deviennent ceux qui traduisent « le schème d’interprétation prévalant dans un sous-univers en un schème d’interprétation valide dans un autre sous-univers[17]. » L’activité d’enchantement du monde consiste à maintenir les choses « sous une description »[18] telle que ces choses passent pour être recevables et vraies jusqu’à preuve du contraire. Pour assurer cette pérennité, les enchanteurs doivent ponctuellement endosser la casquette de désenchanteurs afin que le quidam ne se fourvoie pas dans les (fausses) explications que d’autres pourraient lui fournir. C’est à ce point que nous retrouvons le sens littéral. Un enchanteur est victorieux lorsqu’il impose sa propre description du monde en la faisant passer pour être la seule possible. Celui qui peut légitimement prétendre énoncer le sens littéral des choses est, pourrait-on dire, le douanier de la vision puisqu’il maitrise le point de jonction entre ce qui est vu et ce qui doit être compris. Le sens littéral ainsi compris prend une tournure politique ; il sort de la linguistique pour rejoindre les notions de sens commun et de doxa – « tout ce qui est taken for granted, qui va de soi, qui va sans dire[19] » et qui résulte précisément de l’histoire conflictuelle des (dés)enchantements successifs.
En réintroduisant les notions de sens littéral et d’enchantement, j’ai essayé d’accentuer davantage ce qui, sous la plume de Bourdieu, tend à être relégué au second plan. L’accent qu’il met sur le langage comme instrument de domination symbolique ferait presque oublier les potentialités de celui-ci. Elles sont suggérées en creux, puisque l’insistance mise sur l’arbitraire de la doxa porte à croire qu’il aurait pu en être autrement ; seulement, puisque la force performative du langage est tributaire de la position sociale de l’énonciateur[20], les mots ne peuvent rien faire en eux-mêmes. C’est l’ordre social qui, dans sa dynamique, a un potentiel de subversion. Pourtant, Bourdieu lui-même défend ailleurs une autre forme d’opérativité du langage : « s’il est vrai que la famille n’est qu’un mot, il est vrai aussi qu’il s’agit d’un mot d’ordre ou, mieux, d’une catégorie, principe collectif de construction de la réalité collective[21]. » Loin d’être des coquilles vides, les mots sont tous attachés non seulement à des définitions, mais aussi à des schèmes d’actions. Le mot est ainsi mot d’ordre dans la mesure où, lorsqu’il est énoncé, il a des échos dans notre sens commun et « définit une sorte de programme d’action, dégage des orientations d’action et configure un système d’action à actualiser[22]. » Ce qui signifie également qu’un mot n’a de force que pratiqué. Il faut donc distinguer ce qu’un énoncé doit à son contexte social d’énonciation de ce qu’il doit au couple sens commun/sens littéral. Le caractère coercitif du « mot d’ordre » n’apparait pas tant lors de son imposition explicite par une autorité que lorsqu’il agit tacitement à travers le sens commun. Si l’on me dit : « Monsieur X fait maintenant partie de ta famille », je me retrouve pris dans une forme spécifique de contrat (tacite) à son égard qui m’oblige à avoir des attitudes adaptées au fait qu’il soit de la famille, attitudes que j’adopterai certes plus ou moins, selon le contexte où j’ai entendu la phrase, selon la personne qui l’a prononcée, etc. Il reste donc bien une possibilité offerte par le langage dans la mesure où chaque mot possède une force pragmatique (tel « famille ») qui prend appui sur le sens commun. Proposer d’autres descriptions du monde, tenues sous d’autres champs lexicaux, c’est alors davantage qu’une modification symbolique ou qu’un changement de « représentation » : c’est en appeler à un agir différent.
Le temps d’un monde sans légendes
La question posée est la suivante : est-il possible de s’émanciper de notre vision, de ne pas voir un arbre là où nous en voyons un ? Il faudrait déjà, pour cela, renommer le monde à la manière des enchanteurs. Or le monde initial du sens commun est amplement légendé. On trouve, le concernant, des dictionnaires, des histoires, des tableaux, des photographies, des plaques descriptives, des enseignements, bref, un nombre infini de dispositifs qui en circonscrivent les lectures possibles. L’essentiel des activités auxquelles j’assiste dans le cadre de ma thèse est ainsi consacré au développement de ces dispositifs qui surajoutent du savoir autour du monde. Par exemple, passant devant un arbre, un guide touristique, suivi de son public, dira : « cet arbre-ci n’est pas n’importe quel arbre : il a une histoire spéciale » – et racontera l’histoire en question[23]. Celle-ci ne renverse pas la vision, mais l’approfondit en la focalisant sur certaines entités du décor qui se voient conférer une individualité. « Ce tas de ferraille, qui rouille dans le coin d’un parc, est en fait une œuvre d’art contemporain. » La légende (guide, plaque explicative, prospectus, etc.) est là pour donner à l’œil un surplus de connaissance qui réajuste la vision. On notera que cet ajustement n’est jamais totalement contradictoire avec le sens commun. Le fait que l’œuvre d’art contemporain soit un tas de ferraille ne pose pas de problème, la légende est là pour enchanter la matière et la tenir sous une description qui la transmue en œuvre. Pourtant, l’exemple de l’œuvre d’art se distingue déjà de celui de l’arbre en ce que la nouvelle catégorisation de l’objet induit des comportements radicalement différents à son égard. Si c’est un tas de ferraille, je peux le tagger, le scier ; si c’est une œuvre d’art, je dois réprimer ces envies (potentielles) pour adopter un rapport esthétique à la chose, me demander si elle est figurative, dans quelle courant elle s’inscrit, etc. Mes « investigations sur le phénomène, sur ses causes et ses effets, sur son passé et son futur »[24] prendront une tournure toute différente. Mais la déstabilisation reste limitée puisque l’incohérence entre la chose telle qu’elle a pu m’apparaître au premier abord (tas de ferraille) et sa description (œuvre d’art) est compensée par les légendes/les enchanteurs. Ma vision a été modifiée, je ne verrai plus cela de la même manière, mais je n’en suis pas pour autant perdu ; j’ai simplement basculé d’un registre à un autre et suis accompagné dans la redéfinition[25].
On pourrait envisager cependant que certains dispositifs se rapprochent de ce que J. Rancière regroupe sous le concept de régime esthétique de l’art, et qu’ils visent l’utopie. « L’utopie est le non-lieu, le point extrême d’une reconfiguration polémique du sensible, qui brise les catégories de l’évidence[26]. »Certes, nous avons depuis le départ affaire à des catégories et des évidences brisées, mais ici, une nouvelle étape est franchie qui consiste à ménager un espace à l’incertitude descriptive. C’est La trahison des images de Magritte, une décomposition de la vision. Celle-ci est empêchée et en reste au stade de la vue – « ceci n’est pas ». Nous retrouvons alors le geste de Searle : même là où foisonnent les légendes, il reste possible de s’emparer des dernières ambiguïtés et des derniers silences. C’est le ressort des artistes qui vont volontairement comprendre de travers, mais aussi des militants qui vont dénoncer la prétention du pouvoir à dire le vrai. « Pour le maire, ça n’est qu’un arbre. Pour nous, c’est un arbre qui était déjà là avant toute l’urbanisation. Il dégage quelque chose cet arbre. C’est la mémoire de la ville. » L’arbre n’est plus simplement a + b + c – il est, au-delà du littéral fallacieux, un être qui lui aussi peut avoir une âme, une aura, une quasi-humanité. On n’est plus ici dans un approfondissement du savoir mais dans une redéfinition des catégories politiques de la vision qui induit l’attribution, à certains êtres, de qualités jusque-là réservées à d’autres. Ici se situe le point d’achoppement avec le sens commun. Dire qu’un arbre a une âme, dire qu’un animal est un individu sensible, c’est redéfinir les identités et les affiliations. C’est donc un acte politique au potentiel émancipateur, mais qui s’accompagne rapidement de nouvelles légendes, de nouveaux enchanteurs qui rendent la nouvelle description acceptable et justifiable, puis acceptée et justifiée.
Nous atteignons à ce point quelque chose qui ressemble davantage à une reconstruction de la vision qu’à une émancipation dont l’idéal naïf correspondrait à cette pure perception dont parlait Merleau-Ponty : une vue sans savoir ajouté, un monde livré brut à notre œil. Une vision à l’état esthétique, « pur suspens, moment où la forme est éprouvée pour elle-même »[27]. Pour J. Rancière, ce « régime esthétique des arts »[28] correspond en effet à un abandon du projet éducatif, celui qui transparait à travers tout dispositif de savoir-voir. L’œuvre produite selon ce régime se contente d’exister dans le monde sensible, sans prétendre bouleverser quoi que ce soit a priori. Sa production même n’est plus le fait des artistes, puisque sa qualité d’œuvre dépend de ses effets (jamais prévisibles) et non du champ de sa genèse. Toute chose pourrait en ce sens faire œuvre, à condition d’être émancipée de tout « message parasite »[29]. Cette proposition, quoiqu’assumée comme utopique et heurtant le « réalisme scientifique », peut cependant nous inviter à penser des dispositifs de ralentissement de la vision. Plutôt que de remplacer une vision par une autre, un mot par un autre, l’émancipation résiderait alors dans le temps laissé dans l’intervalle entre le perçu et le compris. À l’urgence de la mise en sens se substituerait un temps laissé à l’incertitude. Plutôt que de participer à la querelle autour de la juste position de « l’accent de réalité »[30] d’une description ou d’une autre, une telle politique de la vision nous ménagerait un temps du voir sans savoir, où les légendes nous emmèneraient vers le doute – « ceci n’est pas… » –, sans nous reconduire nulle part.
[1] Louis Quéré, « La valeur opératoire des catégories », Cahier de l’Urmis, 1|juin 1995, mis en ligne le 15 janvier 2002, consulté le 2 septembre 2014, p. 7, URL : http://urmis.revues.org/435
[2] Pierre Bourdieu, Raisons pratiques – Sur la théorie de l’action, Paris, Seuil, 1994, p. 23.
[3] Alfred Schütz, Le chercheur et le quotidien, Paris : Klincksieck, 2008 [1971], p. 105.
[4] Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 2004, p. 26.
[5] Ibid., p. 26.
[6] Alfred Schütz, Le chercheur et le quotidien, op. cit., p. 105.
[7] Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, Paris, Gallimard, 2004, p. 61.
[8] John Rogers Searle, « Le sens littéral », Langue Française, n°42, 1979, p.34-47, p. 36.
[9] Ibid., p. 41 : « Supposons que j’entre dans un restaurant, déterminé à dire exactement et littéralement ce que je veux dire, c’est-à-dire déterminé à énoncer des phrases impératives qui expriment exactement mes désirs. Je commence par dire : “Donnez-moi un hamburger, à point, avec du ketchup et de la moutarde, mais pas trop de cornichons.” On remarquera d’abord qu’une quantité prodigieuse d’informations préalables a déjà été mise en œuvre dans la description de l’exemple – toute l’institution des restaurants et de l’argent, pour commencer – et il est difficile de voir comment cette phrase pourrait avoir les mêmes conditions d’obéissance si ces institutions n’existaient pas, ou si la même phrase était énoncée par un prêtre au cours de sa prière ou affixée à la fin du discours d’assermentation d’un nouveau président des États-Unis. […] Il y a toutes sortes d’autres assomptions sur lesquelles l’application de la phrase repose et qui sont loin de pouvoir être réalisées dans la structure sémantique de la phrase. Supposons par exemple qu’on m’apporte un hamburger pris au milieu d’un mètre cube de plastique transparent si solide qu’il me faut un marteau-piqueur pour l’ouvrir, ou supposons que le hamburger ait un diamètre d’un kilomètre et qu’il me soit “livré” en abattant le mur du restaurant et en insérant une partie de la circonférence à l’intérieur. Dans ce cas, puis-je dire que mon ordre “donnez-moi un hamburger, à point, avec du ketchup et de la moutarde, mais pas trop de cornichons” a été obéi ou satisfait ? Je serais enclin à dire que non, qu’il n’a été ni satisfait ni obéi, puisque ce n’était pas ce que je voulais dire dans mon énonciation littérale de la phrase. »
[10] Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, op. cit., p. 75.
[11] John Rogers Searle, op cit., p. 36.
[12] Pierre Bourdieu, Luc Boltanski, « Le fétichisme de la langue », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, vol.1, n°4, juillet 1975, p. 2-32, p. 2.
[13] Ludwig Wittgenstein, op. cit., p. 50.
[14] Pierre Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique, Paris, Seuil, 2000, p. 300.
[15] Pierre Bourdieu, Les usages sociaux de la science – Pour une sociologie clinique du champ scientifique, Paris, INRA, 1997, p. 58.
[16] Ibid., p. 60.
[17] Alfred Schütz, « Don Quichotte et le problème de la réalité », Sociétés, vol.3, n°89, 2005, p.9-27, p. 13.
[18] Louis Quéré, « Sociologie et sémantique. Le langage dans l’organisation sociale de l’expérience », Sociétés Contemporaines, n°18/19, 1994, p.17-41, p. 30.
[19] Pierre Bourdieu, « L’inconscient d’école », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, vol.135, n°135, décembre 2000, p.3-5, p. 3.
[20] Pierre Bourdieu, « Le langage autorisé. Note sur les conditions sociales de l’efficacité du discours rituel », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, vol.1, n°5-6, novembre 1975, p. 183-190.
[21] Pierre Bourdieu, « À propos de la famille comme catégorie réalisée », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, vol.100, n°100, décembre 1993, p.32-36, p. 33.
[22] Louis Quéré, « La valeur opératoire des catégories », op. cit., p.19.
[23] Benjamin Tremblay, « A quoi tient l’autorité d’un récit ? L’exemple du guidage historique », Trajectoires [en ligne], 8 | 2014, à paraître.
[24] Louis Quéré, « La valeur opératoire des catégories » op. cit., p. 15.
[25] Cette distinction faite entre le cas de l’arbre et celui du tas de ferraille ne tient cependant pas d’un point de vue sociologique, et n’est donnée ici que pour suggérer l’existence de différents degrés dans la transformation de la vision. En pratique, les effets d’un dispositif de savoir-voir dépendent de nombreux paramètres qui sont à explorer empiriquement.
[26] Jacques Rancière, Le partage du sensible : esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000, p. 65.
[27] Ibid., p. 33.
[28] Ibid., p. 35.
[29] Roland Barthes, « Le message photographique », Communications, n°1, 1961, p.127-138, p. 134.
[30] Alfred Schütz, « Don Quichotte et le problème de la réalité », op. cit., p. 11.