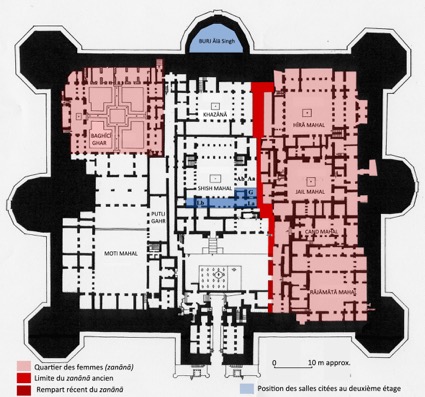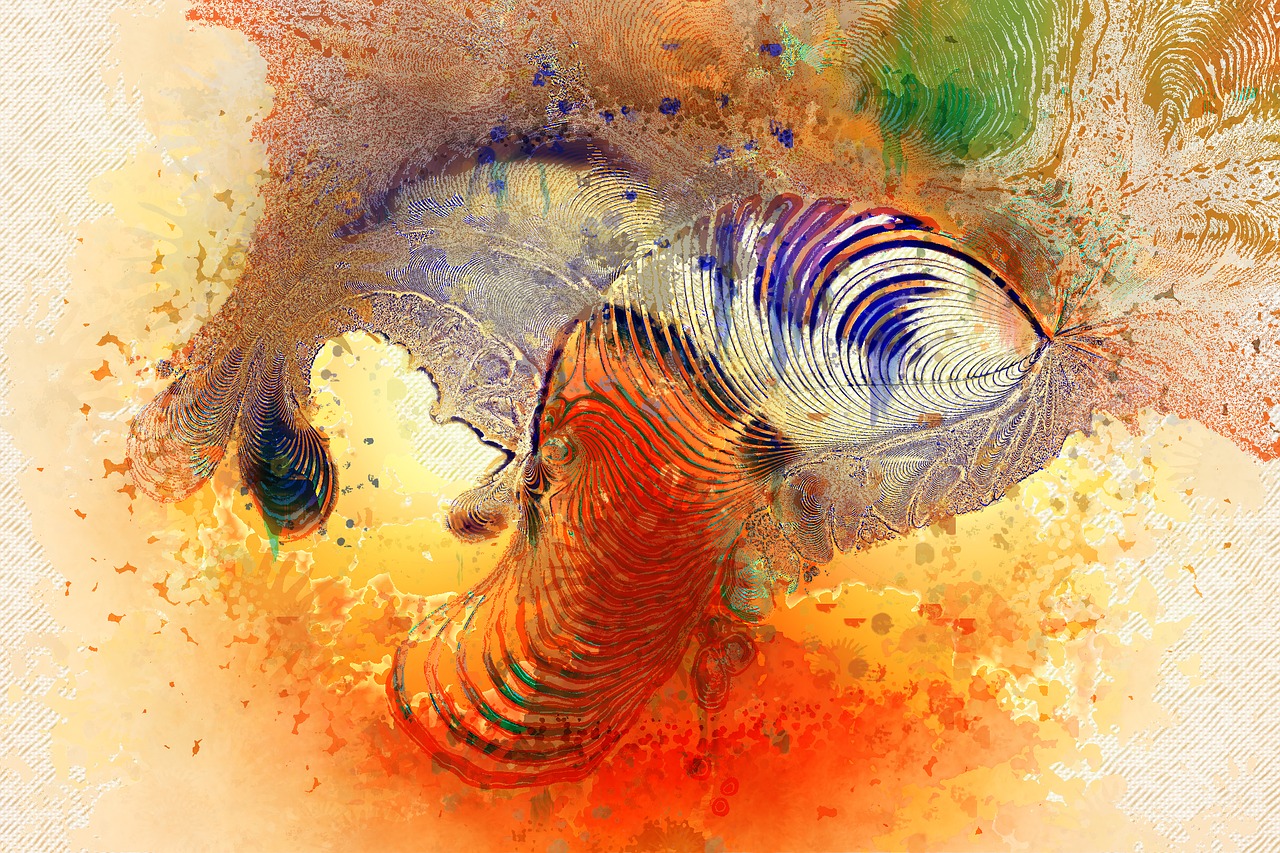La voix des artistes iraniens entre engagement, dissidence et censure.
La mobilisation des artistes iraniens : la dimension contestataire dans la production artistique et créative
Hanieh ZIAEI – Doctorante à l’Université Paris-Diderot et à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) – Coordonnatrice et chercheur en résidence de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, à la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques (Montréal).
De la Grèce antique à nos jours, un lien unit l’art à la politique et réciproquement. Si, à première vue, tout semble opposer ces deux activités humaines, de nombreux exemples historiques et actuels soulignent à quel point ces constructions humaines sont en réalité liées d’une façon ou d’une autre : « Les œuvres d’art se situent ainsi à la fois au sein et au-delà de la politique »[1]. Dans le cadre du présent article, nous nous intéressons uniquement à la place de l’art[2] et de l’artiste sous la République islamique d’Iran ainsi qu’aux nombreux artistes iraniens qui se trouvent aujourd’hui en exil (notamment à Paris, New York, Montréal ou Toronto)[3].
La République islamique d’Iran : en quelques mots…
La République islamique d’Iran est souvent classée dans la catégorie de « régime totalitaire » où les paramètres de fonctionnement sont constitués de structures fortement stratifiées et hiérarchisées et au sein desquelles un nombre restreint de personnes exercent le pouvoir politique et détiennent un monopole d’ordre à la fois économique, militaire et idéologique. Qui dit hégémonie socio-politico-économique, dit également exercice d’un monopole sur la culture, le monde des arts, l’information et la définition de l’ensemble des normes et coutumes de la société. En présence d’un tel système, la législation en vigueur, soit l’ensemble des lois et règles gouvernementales, est régie par l’ordre moral et culturel islamiques, renforçant ainsi le pouvoir et les privilèges du clan et de la caste au pouvoir. En l’espèce, la légitimité d’une loi puise sa source dans la religion, avec une référence systématique au Coran et aux Hadiths[4] et, de ce fait, dans les interprétations de ces derniers qui sont orientées dans un sens ou dans un autre, en fonction de positionnements politiques et sociaux.
Le culte de la personnalité est également une pratique courante dans ce type de régime et il est le plus souvent entretenu par divers moyens de propagande (par le biais des affiches, des fresques murales, du théâtre, etc.). Les personnalités telles qu’Adolf Hitler, Joseph Staline, Benito Mussolini, Mao Zedong ou Ruhollah Khomeiny constituent quelques exemples du XXIème siècle. Une fois arrivées au pouvoir, ces personnalités, souvent très charismatiques, mettent rapidement en place un nouveau système de références et de codes en vue de se distinguer de façon indéniable du régime précédent. Très vite elles se munissent de structures ainsi que d’appareils étatiques et répressifs forts qui vont permettre un encadrement total et progressif de la société dans son ensemble. On peut parler d’une « police de la pensée », pour reprendre les termes de George Orwell dans 1984[5], telle que la SAVAK en Iran sous le Shah (Mohammad Reza Pahlavi) ou le Ministère de la Guidance et de l’Orientation islamique sous la République islamique d’Iran. Ainsi des autorisations doivent-elles être impérativement et obligatoirement obtenues au préalable auprès des instances gouvernementales (généralement auprès du Ministère de la Guidance et de l’Orientation islamique) pour toute production culturelle et artistique (principalement d’ordre cinématographique, théâtrale, musicale ou pour toute forme de publication – ouvrage/magazine/revue) ou encore pour le contenu matériel et esthétique d’une galerie d’art (même privée) ou la tenue d’une quelconque exposition publique. Les artistes iraniens sont ainsi continuellement en présence d’un espace politique sclérosé (sous la pression d’ordres à la fois culturel, social, religieux) et surveillé (se traduisant par une forte répression et censure étatique).
Afin qu’un contrôle total et une surveillance efficace puissent avoir lieu, il faut que l’État se dote d’un mécanisme idéologique de contrôle afin de contrer les dissidences de toutes sortes et de délimiter les conduites sociales considérées comme acceptables selon les normes inculquées par l’appareil d’État.
Au niveau de la production artistique et littéraire, les œuvres ne doivent certainement pas mettre en évidence les aspects de la réalité que l’on s’efforce de passer sous silence, notamment les problèmes socio-économiques dont souffre la nation, tels que la pauvreté, le chômage, la maladie, la corruption et, bien entendu, la violence policière et la répression étatique. Dans un pays comme l’Iran dont l’idéologie est religieuse, les débats de société portant sur des questions liées à l’homosexualité, à la sexualité, au corps, à la religion ou à la femme ne sont généralement jamais tolérés ni permis. Dans l’ensemble des régimes totalitaires, politiques ou religieux, il ne faut surtout pas qu’un index accusateur pointe les autorités et la responsabilité de l’État face à la société ou interroge la réalité sociale existante.
C’est la raison pour laquelle tant la République islamique d’Iran, à l’instar de l’ensemble des régimes totalitaires a pris le soin d’établir rapidement, dès son arrivée au pouvoir, la ligne de démarcation entre les notions du bien et du mal, du normal et de l’anormal, du sain et du pathogène, du légal et du criminel, en deux mots : une ligne de démarcation entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Cette classification vaut également pour les domaines artistiques, littéraires et culturels où le régime établit à nouveau une frontière entre : l’art officiel (permissible) et l’art inacceptable (immoral ou décadent). Ces types de distinctions arbitraires nous rappellent la rhétorique nazie où le sang, la « race » et le sol étaient considérés la source de l’intuition artistique[6]. Il fallait donc « purifier la culture allemande » des éléments indésirables et corrompus, et cela s’est concrètement traduit par de nombreuses rafles dans les différents musées allemands investies de l’objectif d’y détruire un grand nombre œuvres : peintures, sculptures ou dessins.
Une fois au pouvoir, le système nazi définit clairement les contours de « l’art officiel » et de l’art dit « dégénéré »[7] (entartete Kunst). Ce que Hitler entendait par cette expression est « l’art de la décadence » représenté par l’art moderne, et de tout ce qui était différent de l’art officiel nazi, plus particulièrement certains courants artistiques tels que le cubisme, le dadaïsme, le futurisme, l’expressionnisme et l’impressionnisme qui constituaient, selon lui, des « extravagances de fous », des « éléments désagrégateurs »[8], ayant trait à la « décadence », aux « races impures » ou à un art souvent nommé « l’art judéo-bolchevique », alors qu’au contraire l’art classique (l’art passé / l’académisme) symbolisait les œuvres de la « race pure ».
Ces types de catégorisations facilitent indéniablement la pratique de la censure ou au contraire la valorisation et la glorification de formes artistiques particulières par la propagande via les images, les symboles, les mythes, les affiches publicitaires, la photographie, le cinéma, les arts plastiques, la peinture et la sculpture.
La censure en art et la censure d’État
La censure, la surveillance et, jusqu’à un certain degré, le mécénat ont toujours contraint la création intellectuelle et artistique. Nous retrouvons une continuité de ces pratiques au XXIème siècle à travers les exemples cités.
En contexte totalitaire, les enjeux stratégiques de la censure d’État s’inscrivent dans la mise en place d’une idéologie, de nouvelles mœurs, valeurs et symboles. La censure d’État est une manière de redéfinir la société dans son ensemble à partir d’une idéologie définie. Varda Burstyn définit la censure d’État comme : « une intervention idéologique appuyée par des mesures coercitives visant à maintenir le statu quo et l’autorité de l’État »[9], en ajoutant qu’il s’agit là de : « l’ensemble de règles imposées de l’extérieur et d’en haut »[10].
L’État procède ainsi à la censure de ce qui n’a pas été réduit par l’autocensure, la pression familiale et communautaire (la « pression sociale » pour reprendre les termes d’Émile Durkheim), les pesanteurs culturelles, les tabous et les arguments économiques dictés par la prétendue loi du marché. Ainsi les questions de morale et d’éthique sont-elles instrumentalisées par les censeurs en vue de justifier et légitimer leurs actes de censure. Les conceptions moralistes et la subordination des questions esthétiques à l’éthique ont pu ainsi servir de fondement de pilier fondateur à la censure. Varda Burstyn souligne aussi que : « Toute société se donne des règles de conduite qui établissent ce que ses membres peuvent et ne peuvent pas faire. […] toute société encadre également, par divers moyens, l’expression de ses membres »[11].
Si les moyens de mise en œuvre de cet encadrement divergent d’un système, d’un pays et d’une époque à l’autre, il nous est possible d’observer des similitudes entre les régimes totalitaires séparés par l’échelle du temps (cf. l’Allemagne nazie et la République islamique d’Iran). Pour ce faire, tout système idéologique se dote d’appareils et de structures de censure. Par exemple, sous les nazis, des Chambres de cultures du Reich[12] ont été crées le 22 septembre 1933 par Joseph Goebbels. L’adhésion à celles-ci fut obligatoire pour tout artiste dès le 1er novembre 1933. Il s’agissait d’une véritable cellule de censure médiatique. En Iran, nous l’avons mentionné, toute production culturelle et artistique doit passer au préalable par les filtres du Ministère de la Guidance et de l’Orientation islamique.
La censure d’État, dans le contexte d’exercice du pouvoir par des régimes totalitaires, constitue généralement un acte de coercition idéologique et se situe en contradiction totale avec la liberté d’expression. Pour mener à bien ce projet d’une censure totale, l’État totalitaire a besoin de se construire un terrain de consensus. Les Lumières, suivant Jean-Jacques Rousseau, parlaient d’un « contrat social » entre la société et l’État. Bien que nous soyons loin d’un tel « contrat social » à proprement parler, en Iran, un terrain d’entente et une légitimation est tout de même pensé comme nécessaire par l’État. Dans cette logique, le Léviathan[13] a réussi à mettre en place un autre contrat, de type consensuel, avec ses sujets. C’est ainsi que tout régime totalitaire trouve le besoin de légitimer ses actes et ses pratiques, la censure étant alors présentée comme « une nécessité » pour le bien collectif. Elle répondrait à une menace contre la sécurité nationale et l’ordre social établi : « La nature de cette menace peut varier. Elle peut consister en une franche critique politique »[14]. L’État iranien se donne alors le rôle de « protecteur » des valeurs fondamentales et se présente comme le « bon père de famille » qui apporte une protection paternelle à l’ensemble de ses enfants-citoyens transformés en sujets désarmés, obéissants et dociles. Il est alors plus aisé de leur imposer ses propres valeurs, idées et sentiments.
Les valeurs morales exaltées par les nazis étaient : patriotisme, héroïsme, obéissance, amour des masses, du travail, du chef et de la guerre.[15] Comme nous le rappelle Lionel Richard : « […] on s’aperçoit, en examinant certains aspects dans leur contexte historico-social, que la censure ne résulte pas de vérités éternelles et qu’elle n’a guère de justifications en dehors du groupe social ou de l’État qui l’utilise »[16].
En République islamique d’Iran, tout ce qui touche à la reproduction de la nudité et à la sexualité est interdit. Dans un système patriarcal, il va sans dire que le corps féminin est soumis à la domination sociale masculine et que l’homme dispose même du contrôle du pouvoir de procréation de la femme. La censure sur les questions de sexualité constitue, intrinsèquement, un geste politique et idéologique. La pratique de la sexualité devient alors un terrain plus politique ; c’est ainsi que le sexisme est une pratique courante dans l’espace public iranien (bus, métro, école, université, etc.). Ainsi, pour l’État, tout type de matériel sexuel qui mine l’ordre du patriarcat est-il politiquement et culturellement subversif et doit-il être ramené dans le droit chemin. C’est pourquoi la censure frappe souvent les milieux artistiques puisque les artistes, plus que d’autres acteurs sociaux, se consacrent à l’expression personnelle et sociale de leur sexualité, se retrouvant donc à briser les tabous et les normes de la société, franchissant ainsi la ligne de démarcation de ce qui est permis culturellement et socialement acceptable. Aucun régime totalitaire et dictatorial ne tolère d’ailleurs la moindre critique ou questionnement ou plutôt la remise en question d’un quelconque ordre de sa politique, de ses pratiques et de ses discours. Guy Sioui Dandurand observe que : « Ce n’est pas l’œuvre d’art qui menace la société, mais la réalité contre laquelle s’élève parfois la proposition artistique »[17]. En Iran, les femmes artistes se voient interdire toute performance en danse ou en chant dans un espace public, une représentation de la féminité ou de la sensualité féminine étant considérée comme symbole de débauche et immoralité. De plus, toute représentation ou présence d’un instrument de musique est interdite à la télévision étatique nationale en Iran : « L’art est censuré parce qu’il dit et révèle du tissu social dont il fait partie intégrante »[18].
Dans ce type de contexte totalitaire, le censeur est présent à chaque strate, moment ou événement de la vie quotidienne du pays, ce qui amène l’art à être davantage censuré puisqu’il est présent à plusieurs niveaux dans la société ; la censure devient alors omniprésente et intervient à la télévision, à la radio, dans la presse, le monde de l’édition, la musique, le théâtre, les arts plastiques et même jusque dans le système éducatif (par exemple à travers l’élaboration des manuels scolaires).
Que ce soit sous le nazisme, le fascisme ou sous la République islamique d’Iran, l’État cherche à passer sous silence l’expression du message des artistes en suivant la même logique qu’il entend supprimer les autres types « d’agitateurs » et « d’ennemis » de la société. À travers l’histoire, nombreux sont les régimes totalitaires qui n’ont pas hésité à faire régner la crainte et la terreur pour étouffer la contestation afin de se maintenir au pouvoir. En ce qui concerne le régime iranien, pour contenir les élans de protestations, celui-ci dispose d’un appareil répressif fort, tripartite, composé des Gardiens de la Révolution (Pasdarans), d’une puissante milice religieuse ainsi que des paramilitaires (Bassidji). Ceux-ci veillent d’une main de fer au respect des valeurs islamiques du régime et aux intérêts de celui-ci. Après la Révolution, une série d’organisations répressives fut mise en place afin de permettre un encadrement progressif de la société. Généralement, le régime iranien accole à toute personne arrêtée l’étiquette d’opposant politique et lui impute tout particulièrement une appartenance au groupe politique les Mojahedin du peuple, dont le leader est une femme, Maryam Rajavi, ou d’être à la solde des puissances occidentales (plus principalement des Américains). La théorie du complot est ainsi systématiquement mobilisée à travers le discours du régime iranien. Souvent, les personnes arrêtées sont accusées d’actes d’espionnage. C’est au nom du maintien de la sécurité et de l’ordre national que l’on favorise la répression, encourage les arrestations, la délation, la lapidation et la torture contre les « perturbateurs » et les « agitateurs ». Ainsi, quiconque s’oppose au gouvernement et à son pouvoir s’expose à une forte répression étatique. Tout opposant est ainsi considéré nécessairement comme un être immoral et corrompu.
Aujourd’hui des organismes tels que l’Association internationale de défense des artistes victimes de la répression dans le monde (AIDA) prennent position en faveur de ces derniers en soulignant : « Parce qu’ils relatent les faits vrais, des artistes – qu’ils soient écrivains, cinéastes, musiciens ou peintres – sont intimidés, censurés, interdits, emprisonnés, internés, torturés, assassinés dans un nombre croissant de pays »[19]. C’est notamment le cas en Iran, où par exemple, le réalisateur iranien Jaffar Panahi[20] a été condamné à six ans d’emprisonnement et à vingt ans d’interdiction de réaliser des films, de voyager ou de donner des entrevues.
On peut observer que la censure n’existe pas toujours de manière officielle. Aujourd’hui, il n’existe pratiquement pas d’État qui ne pratique, d’une façon ou d’une autre, la censure soit par le biais d’une politique culturelle, soit au moyen de l’appareil judiciaire. Par le passé, le programme du parti nazi par rapport à la presse et la littérature était clair : « Les journaux contraires au bien public devront être interdits. Nous demandons une loi pour lutter contre une orientation artistique et littéraire qui exerce une influence corruptrice sur notre vie nationale […] »[21]. Même dans les démocraties libérales on retrouve une sorte de « censure tranquille »[22] ou silencieuse qui est pratiquée de manière très subtile, mais impose des lois sévères au marché de l’art. Dans les démocraties libérales, tout acte de censure constitue une opération risquée qui s’expose de facto aux foudres potentielles ainsi qu’aux critiques de l’opinion publique ; en revanche, sous une dictature la censure est rigoureusement institutionnalisée et complètement intégrée et intériorisée par la société. Ainsi l’autocensure devient-elle un automatisme conscient ou inconscient, quand l’artiste procède individuellement à la censure avant même de recevoir la foudre du censeur. Ignacio Colombres souligne à juste titre que : « lorsque la censure finit, celle de l’autocensure commence, plus triste, plus sordide »[23].
L’Art de la dissidence
Malgré l’ensemble des contraintes auxquelles sont confrontés les artistes iraniens et bien que toute forme de production artistique doive composer avec une forte censure étatique, il existe bel et bien Iran une vie et un milieu artistiques qui s’inscrivent dans le répertoire de « l’art contemporain » tel que l’entend Nathalie Heinich[24], c’est-à-dire qu’on y retrouve l’idée de transgression où « l’art est dans l’idée » et où « l’œuvre se raconte ». C’est au sein de cette conjoncture qu’en Iran l’art joue progressivement sur les frontières entre « l’art autorisé » et « l’art interdit ».
Étant donné que l’espace public est difficile d’accès, c’est souvent par la Toile et les médias sociaux que ces artistes s’expriment, tantôt sous forme de satires graphiques, de la parodie, de l’ironie et du pastiche, tantôt par des illustrations ou caricatures à caractère politique qu’on retrouve plutôt dans les écrits à l’encontre du gouvernement iranien et de ses pratiques où l’humour, par exemple, sert à porter un message souvent critique vis-à-vis de la politique iranienne (aussi bien intérieure qu’extérieure).
Nous pouvons citer à titre d’exemple le travail des caricaturistes et illustrateurs iraniens, actuellement en exil, dont celles de Mana Neyestani[25] (basé à Paris) et de son frère Touka (basé à Toronto), ou encore de Kianoush Ramezan (qui partage son temps entre Genève et Paris). Nous qualifions les dessins de ces derniers de « caricature contestataire et politique » puisqu’à travers leurs œuvres, ces derniers touchent à des questions identitaires, à des questions ayant trait à la liberté d’expression (la fameuse question de la censure et de l’autocensure), au Mouvement vert (le mouvement de contestation aux élections présidentielles de juin 2009), à la répression étatique et institutionnalisée (dont la question de la peine de mort, les arrestations arbitraires, les conditions de détention, etc.), ainsi qu’à la question du mépris des droits humains (les minorités ethniques, l’homosexualité, la violence à l’égard des femmes, etc.).
Toutefois, les autorités iraniennes tentent de réguler tous les aspects de la vie sociale et l’ensemble des usages de l’espace public, privé de même que virtuel (comme c’est le cas actuellement à Cuba et en Chine). Pour ce faire, un système de filtrage et de contrôle a été mis en place par l’État, notamment par le biais des dispositifs tels que des « comités de filtrage », ou le Cyber Army. Cependant, ces mécanismes n’ont pas eu l’effet dissuasif attendu sur les artistes qui utilisent l’espace virtuel comme exutoire à l’emprise du système, par le biais notamment de l’utilisation massive de Facebook, pour la diffusion d’événements artistiques et d’arts visuels, ou de Youtube, pour la diffusion de vidéos clips de « musique Underground ». Le film-documentaire Les Chats Persans (2009), du réalisateur iranien Bahman Ghobadi, révèle l’existence de nombreux groupes de musique clandestins à Téhéran.
La Toile a ainsi permis à de nombreux artistes de contourner les interdictions et la censure étatique ; grâce à l’internet, les artistes iraniens en exil ont pu se faire connaître davantage et de sortir de l’isolement (pour certains) en réussissant à préserver un lien fort et efficace avec ce qui se passe à l’intérieur de l’Iran. Toutefois, à l’étape actuelle de notre recherche, qui est toujours en cours, nous ne pouvons avancer que tous ces artistes, en tant qu’acteurs sociaux, s’inscrivent d’emblée dans un espace de dialogue subversif et alternatif. En revanche, nous remarquons que de plus en plus d’artistes iraniens s’engagent socialement et politiquement par rapport aux problématiques de leur pays à travers leur créativité et leur art. Par exemple, l’art de rue (street art), qui constitue selon Anna Waclawek[26] « le mouvement artistique du XXème siècle », est désormais visible dans les rues de certaines villes (voire villages) en Iran (Tabriz, Téhéran, Khalkhal, Asalem), notamment par le travail d’Icy & Sot, MAD et A1 One[27]. Ces derniers émettent visuellement un message politique ou social (par exemple, la dureté et cherté de la vie, l’injustice sociale, les lacunes du système électoral, la liberté de boire une boisson alcoolisée, etc.), voire parfois une remise en question de la légitimité religieuse sur laquelle le régime se base depuis son avènement au pouvoir.
On retrouve également chez ces artistes de rue et chez les caricaturistes cités plus haut des clins d’œil à des référents occidentaux : la bouteille de Coca Cola ; des contes classiques (Pinocchio de Carlo Collodi) ; ou encore des personnages de la littérature (Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry). Ils recherchent ainsi un référent familier, qui puisse leur permettre de créer une relation et un rapprochement avec le public.
Les artistes iraniens qui réussissent à toucher le public occidental sont d’ailleurs souvent ceux qui parviennent à manier avec talent le langage universel et visuel qui n’a plus besoin d’aucune traduction et d’intermédiaire. Un des meilleurs exemples est l’adaptation de la bande dessinée Persepolis (2007) de Marjane Satrapi en film d’animation. Persepolis fait désormais partie du palmarès des meilleures bandes dessinées européennes ; or l’auteur est d’origine iranienne et actuellement en exil en France.
L’engagement des artistes a également pu être observable pendant le Mouvement vert de juin 2009 en Iran. Dans ce contexte, certains intellectuels et artistes iraniens (cinéastes, peintres, musiciens) qui s’étaient détournés depuis longtemps de la vie politique ont commencé à prendre position publiquement. D’autres artistes iraniens[28] ont démontré leur engagement politique à travers leur œuvre musicale en rendant hommage aux victimes (cf. le cas de Neda Agha Soltan)[29] et en dénonçant la forte répression étatique menée par le gouvernement iranien à l’égard des manifestants et des activistes et militants politiques. À juste titre, Aristote considérait la musique comme susceptible de jouer un rôle cathartique de régulateur social. C’est l’artiste qui fait alors tomber la tension. Dans le jargon freudien, l’on dit que « lorsque le patient parle, il guérit » ; dans ce contexte, lorsque l’artiste s’exprime, il aide d’une certaine manière à diminuer la pression sociale.
Le graphiste iranien et auteur de l’ouvrage New Visual Culture of Modern Iran, Reza Abedini, souligne avec raison que « les artistes iraniens ont toujours réagi et été réactifs à la situation sociopolitique du pays »[30]. Nous pouvons toutefois tempérer ce propos en ajoutant que la mondialisation des échanges, la conjoncture médiatique et la demande du marché de l’art sont également des facteurs à tenir en compte. Ainsi une visibilité est-elle donnée à cette effervescence artistique, et une reconnaissance de la productivité artistique iranienne est-elle aussi observable sur la scène internationale, ne serait-ce que par la présentation de nombreux films iraniens lors des festivals cinématographiques[31] et de la présence d’artistes iraniens dans de nombreuses expositions à l’étranger (Paris, Londres, Berlin, Bruxelles, Montréal, Toronto, New York), de même qu’une certaine visibilité dans la presse (cf. les numéros spéciaux d’Art Press) et dans les médias occidentaux (Radio Canada, BBC, TV5 Monde).
Reza Abedini parle en termes de générations d’artistes : la première étant formée dans les universités et écoles d’art fondées sur la méthode occidentale au moment de la révolution de 1979 ; la deuxième génération, dont la production artistique reste très engagée socialement et politiquement, étant celle impliquée dans la révolution et enfin, la dernière génération, qui a vécu une période sociale tumultueuse marquée par la guerre et les conflits politiques. L’émergence de cette nouvelle génération d’artistes est surtout visible depuis ces dix dernières années. Il faut noter qu’une vague d’immigration a suivi le Mouvement vert : nombre d’artistes iraniens ont profité de ce contexte de perturbation politique pour sortir du pays et s’exiler dans les grandes métropoles occidentales.
De plus, nous remarquons qu’il y a une circulation de plus en plus fréquente des œuvres en dehors du territoire iranien. Ces dernières voyagent sans forcément être accompagnées par leurs artistes-créateurs. Nous pouvons signaler à titre d’exemple l’exposition Unexposed qui a eu lieu à Bruxelles en décembre 2012, dans le cadre des activités de Tour & Taxis, et qui a mis en lumière les œuvres de 40 jeunes artistes féminines vivant et créant en Iran. En raison de la censure étatique discutée plus haut, il s’agissait, pour la plupart, de leur toute première exposition ; d’ailleurs aucune de ces jeunes femmes n’a pu être présente lors de la tenue de cet événement. Pour la petite histoire, nous pouvons souligner également la sortie clandestine du film « Ceci n’est pas un film » (2011) du réalisateur iranien, Jafar Panahi, enregistré sur une clé USB dissimulée dans un gâteau.
Dans une société où aucune place n’est laissée à la liberté d’expression, l’État en vient à engendrer progressivement la standardisation de la production culturelle qui pourrait se traduire de nos jours par un mode de protection et de consommation économique et politique. On peut mettre en parallèle cette absence de liberté d’expression et ce que Hannah Arendt nomme « la crise de la culture »[32]. Ce sentiment de la crise de la culture est thématisé non seulement chez Arendt, mais également dans les écrits de plusieurs auteurs de l’École de Francfort (l’Institut de recherche sociale) dont Theodor W. Adorno et Walter Benjamin. Aujourd’hui, la société « technobureaucratique de consommation dirigée »[33] exige des citoyens et des artistes qu’ils acceptent les limites fixées par le système. En Iran, par exemple, on exige des artistes qu’ils renoncent à toute action et pratique de dénonciation, à toute œuvre politiquement engagée ou abstraite ou encore jugée par les autorités comme immorale, malsaine et surtout en opposition avec les normes islamiques. Dans le cas contraire, ces artistes sont considérés comme « les ennemis des traditions nationales »[34], et l’on porte sur eux des accusations d’immoralité.
La dialectique positive ou négative de l’art veut qu’il ne se limite jamais à être un outil de résistance ou un instrument de propagande. Ainsi les pratiques artistiques ne peuvent-elles se résumer à une simple instrumentalisation sociale, culturelle, politique ou religieuse. L’art engagé constitue une forme de résistance au statu quo, aux mœurs, aux pesanteurs culturelles ou à un État oppresseur.
Face au poids de la censure, de l’autocensure et de la propagande d’État, certains individus, qu’ils soient artistes, militants/activistes, journalistes ou écrivains, résistent et se révoltent. Dans ce type de conjoncture, exprimer une opinion dissidente en public ou émettre une critique à l’égard de la politique étatique (ses pratiques et ses intrusions dans la vie des citoyens) constitue un véritable danger pour les artistes iraniens. Ces derniers prennent ainsi le risque d’être censurés, emprisonnés ou contraints à l’exil. Face aux interdictions et limites imposées par le régime iranien, certains artistes prennent des risques en diffusant leurs œuvres, d’autres rentrent dans une logique de confrontation frontale avec le pouvoir ou s’inscrivent dans un jeu de provocation avec les autorités en essayant de pousser les limites imposées et les restrictions légales, alors que d’autres s’exilent pour pouvoir créer en liberté sans risquer de se faire arrêter ou censurer. La répression qui s’abat sur les artistes peut même, dans certains cas, les aider à médiatiser leur cause, comme en Chine où l’artiste peintre sculpteur architecte Ai Wei Wei est considéré aujourd’hui comme l’un des plus célèbres artistes dissidents du monde. Pourtant, l’artiste qui agite la scène sociale n’attaque pas toujours délibérément les autorités ; il se livre parfois à une critique des traditions, des pesanteurs culturelles, de l’époque moderne ou encore du capitalisme sauvage. L’œuvre produite étant une création individuelle, son message varie d’un artiste à l’autre, d’un contexte à l’autre et d’une époque à l’autre.
Le travail de l’artiste-peintre iranienne, Sayeh Sarfaraz, est, par exemple, fortement imprégné des événements politiques liés à son pays d’origine. Ses dernières expositions à Montréal ont porté sur la thématique de la dénonciation de la forte répression étatique à l’égard des manifestants, activistes et militants politiques et de la torture et les emprisonnements arbitraires en Iran. Après un séjour en France, Sayeh a décidé de s’installer à Montréal depuis 2008, et elle risque de s’exposer à des interactions avec les autorités iraniennes si elle décide de retour sur le sol iranien.
Varda Burstyn note que : « L’art doit critiquer, éclairer, agiter, fomenter, méditer, préfigurer, rappeler, réinventer et transcender. L’art doit se mettre au service du changement social, mais sans jamais s’y subordonner : l’art doit être engagé, comme culture alternative »[35]. En contexte totalitaire, la répression punitive est tellement forte, et le climat de crainte, de peur et de terreur tellement entretenu et omniprésent que cela finit par étouffer l’art lui-même et les artistes finissent par baigner dans un sentiment de suffocation. C’est ainsi le cas dans le milieu artistique actuel en Iran, mais cela fut aussi le cas sous le stalinisme, le fascisme et le nazisme.
[1] Marc Signorile, Art et Propagande, Cabris, Éditions Sulliver, 2012, p. 17
[2] Lorsque le mot « art » est utilisé dans ce texte, le terme couvre alors un ensemble très large de disciplines (musique, peinture, sculpture, photographie, œuvres cinématographiques, arts plastiques, caricatures, théâtre…). Nous ne prendrons certainement pas le risque de nous lancer en ces quelques pages sur le terrain controversé des définitions de cette notion dont les contours sont, encore aujourd’hui, difficiles à tracer.
[3] Le choix de ces lieux s’explique par le fait que depuis le mouvement de contestation de juin 2009, nommé le « Mouvement vert », un nombre important d’artistes iraniens s’est exilé dans ces grandes métropoles.
[4] Il s’agit d’un terme arabe qui regroupe les faits et gestes du prophète Mahomet considéré comme des exemples à suivre par les musulmans.
[5] George Orwell, 1984, Paris, Gallimard, 1950.
[6] Lionel Richard, Le Nazisme et la Culture, Bruxelles, Éditions Complexe, 2006, p. 71
[7] Ironiquement l’idée de « dégénérescence » est à l’origine d’un médecin juif, nommé Max Nordau. Ce dernier utilisait le terme « dégénérescence », dans le jargon médical, pour parler de psychologie et de physionomie.
[8] Lionel Richard, Le Nazisme et la Culture, Bruxelles, Éditions Complexe, 2006, p. 185.
[9] Varda Burstyn, « Art et censure », in Réfractions, Montréal, Éditions Artextes – Bruxelles, La lettre volée, 1998, p. 401.
[10] Ibid., p. 397.
[11] Varda Burstyn, « Art et censure », in Réfractions, Montréal, Éditions Artextes – Bruxelles, La lettre volée, Bruxelles, 1998, p. 397.
[12] Jean-Michel Palmier, Weimar en exil, Paris Éditions Payot, 1988-1990, p. 532.
[13] Le Léviathan, ou Traité de la matière, est une œuvre écrite par Thomas Hobbes, publiée en 1651 – Thomas Hobbes, Léviathan, Paris, Gallimard, 2000, coll. Folio, 6e édition 2009.
[14] Varda Burstyn, Loc.cit., p. 400.
[15] Lionel Richard, Le Nazisme et la Culture, Bruxelles, Éditions Complexe, 2006, p. 72.
[16] Ibid., p. 14.
[17] Guy Sioui Durand, « La censure tranquille », in Réfractions, Montréal, Éditions Artextes – Bruxelles, La lettre volée, 1998, p. 419.
[18] Varda Burstyn, « Art et censure », in Réfractions, Éditions Artextes, Montréal – La lettre volée, Bruxelles, 1998, p. 403.
[19] Cette association a été créée à Paris en octobre 1979, présente dans cinq pays (France Allemagne, Belgique, Suisse, Hollande), l’AIDA mène des actions pour les artistes en péril.
[20] Jaffar Panahi a été arrêté en 2010, et il est accusé de « propagande contre le régime », pour avoir préparé un film sur le mouvement de protestation consécutif à la réélection du président Ahmadinejad en juin 2009 – Voir Jacques Mandelbaum, « “Ceci n’est pas un film” : ceci n’est pas un cinéaste iranien menacé », Le Monde, 27 septembre 2011 – http://www.lemonde.fr/cinema/article/2011/09/27/ceci-n-est-pas-un-film-ceci-n-est-pas-un-cineaste-iranien-menace_1578364_3476.html
[21] Il s’agit du paragraphe 23 – du programme en 25 points du Parti ouvrier national socialiste allemand (N.S.D.A.P) – qui aborde expressément les questions artistiques et littéraires et qui sera adopté à partir de 1933, in Lionel Richard, Le Nazisme et la Culture, Éditions Complexe, Bruxelles, 2006, p. 183
[22] Terme utilisé par Guy Sioui Durand pour parler des politiques culturelles de la société québécoise, Loc.cit., p. 418.
[23] Le texte d’Ignacio Colombres sur les « arts plastiques domestiqués », p.150 – in AIDA, Argentine : Une culture interdite. Pièces à conviction 1976-1981, Petite collection Maspéro, no 258, Vol. 81, 1981.
[24] Nathalie Heinich, Le Paradigme de l’art contemporain, Paris, Gallimard, 2014.
[25] Mana Neyestani, Une métamorphose iranienne, ARTE Éditions, Édition çà et là, Paris, 2012.
[26] Anna Waclawek, Street Art et graffiti, Londres, Thames & Hudson, 2011, p. 8.
[27] Cf. les artistes Icy & Sot (http://icyandsot.com/) et A1 ONE (http://tehranwalls.blogspot.ca/)
[28] Erfan Alipour, Farmarz Aslani, Sussan Deyhim, Shahin Najafi, Mojdeye Azadi Shakila et beaucoup d’autres.
[29] À la suite de sa mort (en juin 2009), après avoir reçu une balle au cours d’une des protestations, Neda Agha Soltan, une jeune fille âgée de 27 ans, est devenue la figure emblématique du Mouvement vert.
[30] Reza Abedini, New Visual Culture of Modern Iran, Edition Mark Batty Publishern NY, 2006, p. 11.
[31] Nous pouvons nous rappeler les nombreuses récompenses que les réalisateurs iraniens ont reçues au Festival de Cannes, du Festival international du film de Rimini/ de Berlin/ de Locarno, l’Ours d’argent/d’or, le César, le Golden Globe, le Lion d’or à la Mostra de Venise, etc. à savoir Abbas Kiarostami pour Like Someone in Love (2012) et Copie-conforme (2010) et bien d’autres, Jafar Panahi pour ses films Pardé (2013), Hors jeu (2006), Le Cercle (2000) et bien d’autres ou dernièrement Asghar Farhadi pour ses deux derniers films : Une Séparation (2011) – Le Passé (2013).
[32] Hannah Arendt, « La crise de la culture. Sa portée sociale et politique », La crise de la culture : huit exercices de pensée politique, trad. P. Lévy, Paris, Gallimard, 1972, pp. 253-288.
[33] Henri Lefebvre, La Vie quotidienne dans le monde moderne, Paris, Gallimard, 1968, pp. 133-209.
[34] Le texte d’Ignacio Colombres sur les « arts plastiques domestiqués », p.141 – in AIDA, Argentine : Une culture interdite. Pièces à conviction 1976-1981, Petite collection Maspéro, no 258, Vol. 81, 1981.
[35] Varda Burstyn, « Art et censure », in Réfractions, Éditions Artextes, Montréal – La lettre volée, Bruxelles, 1998, p. 403.